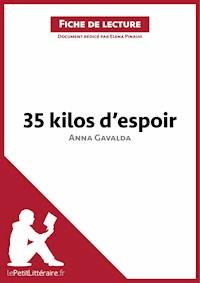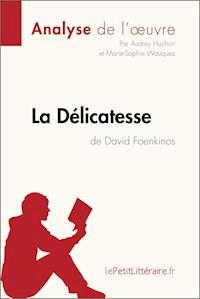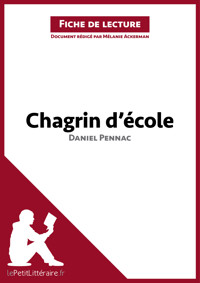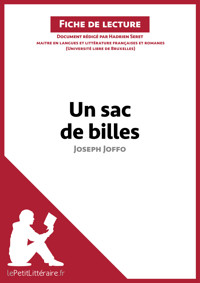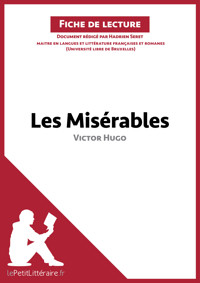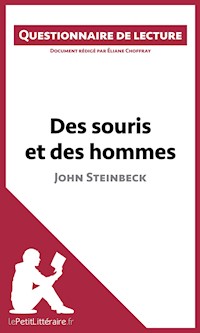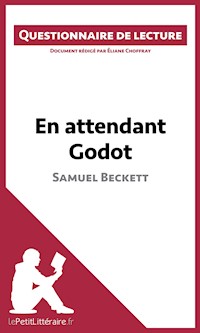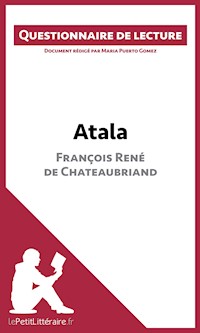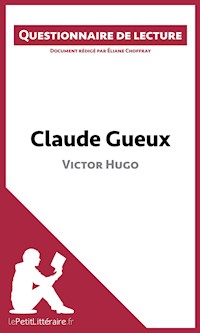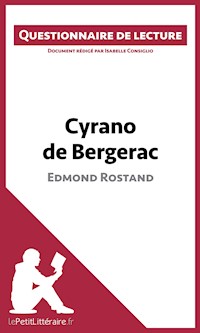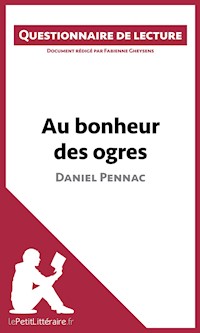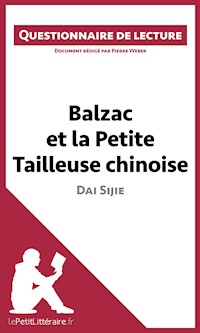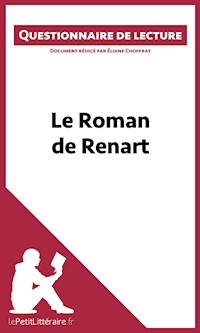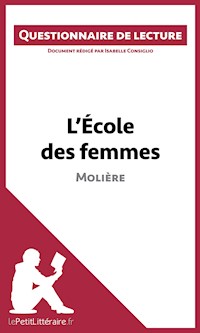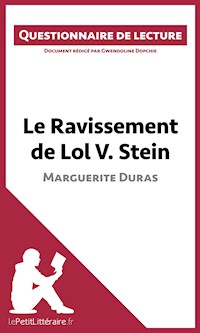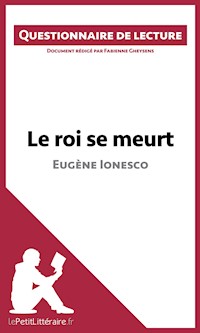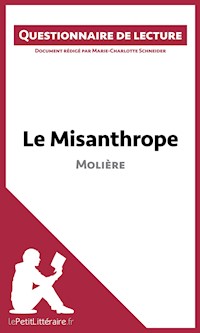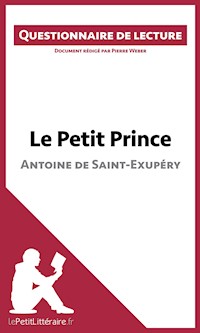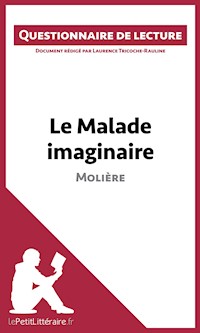9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: lePetitLitteraire.fr
- Kategorie: Bildung
- Serie: Fiche de lecture
- Sprache: Französisch
Décryptez Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau avec l'analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir du
Contrat social, l'œuvre de réflexion politique emblématique de la pensée des philosophes des Lumières ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une analyse complète et détaillée.
Vous trouverez notamment dans cette fiche :
• Un résumé complet
• Des éclairages tels sur les Lumières, leur réflexion politique et celle de Rousseau
• Une analyse des spécificités de l'œuvre : "Le projet de Rousseau", "Une construction logique", "Les thèmes centraux" et "Le souci constant du réel"
Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l'œuvre.
LE MOT DE L'ÉDITEUR :
« Dans cette nouvelle édition de notre analyse du
Contrat social (2017), avec Gabrielle Yriarte et Johanne Morrhaye, nous fournissons des pistes pour décoder cette œuvre majeure de la philosophie politique. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l'œuvre et d'aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN
À propos de la collection LePetitLitteraire.fr :
Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d'analyse d'œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation. Plus d'informations sur lepetitlitteraire.fr
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 29
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jean-Jacques Rousseau
Écrivain, philosophe et musicien genevois
Né en 1712 à Genève (Suisse)Décédé en 1778 à Ermenonville (Hauts-de-France)Quelques-unes de ses œuvres :Émile ou De l’éducation (1762), traité d’éducationLes Confessions (1765-1770), autobiographieLes Rêveries du promeneur solitaire (1776-1778), réflexion philosophiqueJean-Jacques Rousseau est l’un des plus illustres penseurs du siècle des Lumières (XVIIIe siècle) et l’un des pères spirituels de la Révolution française (1789-1799). Il connait une jeunesse mouvementée durant laquelle il exerce différentes professions, telles que précepteur ou copiste.
À Paris, Rousseau se lie aux philosophes des Lumières et acquiert la gloire en 1750 avec son Discours sur les sciences et les arts, où il développe ce qui deviendra le thème central de sa réflexion : l’homme nait naturellement bon et heureux, c’est la société qui le corrompt et le rend malheureux. Suivent des œuvres majeures telles que Du contrat social (1762) ou Émile ou De l’éducation. Considérées comme subversives, celles-ci sont rapidement condamnées et interdites. Rousseau est alors contraint à une série d’exils qui l’éloignent de la France jusqu’en 1769.
En proie à un sentiment de persécution, il consacre la dernière partie de sa vie à des œuvres autobiographiques : Les Confessions et Les Rêveries du promeneur solitaire. Il meurt dans l’isolement, en 1778.
Du contrat social
La société et la politique selon un philosophe des Lumières
Genre : essaiÉdition de référence :Du contrat social, Paris, Flammarion, coll. « GF Philosophie », 2001, 255 p.1re édition : 1762Thématiques : collectivisme, société, égalité, liberté, citoyenneté, ÉtatPublié en 1762, Du contrat social constitue l’aboutissement de la pensée politique de Rousseau. Reprenant des thèses exprimées précédemment (la nature humaine est corrompue ; la civilisation est la cause de l’inégalité), l’auteur examine les conditions de liberté au sein de la société civile. Pour regagner sa liberté perdue, l’individu doit renoncer à son intérêt particulier au profit de l’intérêt général, en concluant un contrat social avec ses semblables. Lorsqu’il agit politiquement, le citoyen doit être guidé par des principes universels.
Inégalement reçu et censuré en 1762, l’ouvrage fut encensé par les révolutionnaires, qui y virent la théorisation de la souveraineté du peuple. Il fut la référence de nombreux penseurs du droit et inspira la pensée marxiste.
Résumé
Livre I
Chapitres I – IV
Dès le départ, Rousseau part du constat d’échec des sociétés modernes, où l’homme est aliéné malgré qu’il soit né libre (« L’homme est né libre, et partout il est dans les fers », p. 42). Rousseau définit le terme « aliéner » comme l’action de donner ou de vendre quelque chose à soi contre quelque chose d’autre. Il peut s’agir de biens matériels comme d’éléments personnels tels que la liberté, la protection, l’honneur. L’aliénation de la liberté est perçue comme légitime dans deux cas uniquement : au sein de la famille et dans le cadre du contrat social.
Rousseau ne donne pas d’explication quant à cette aliénation, mais cherche à résoudre la question de la légitimité de l’ordre social. Selon lui, un changement de cet état est possible afin de regagner la liberté politique et civile. L’ordre social est un droit qui « ne vient point de la nature, il est donc fondé sur des conventions » (ibid.). L’ordre social est légitime s’il repose sur une première convention. La famille, le droit du plus fort et l’esclavage constituent trois fausses conventions qui ne sauraient servir de modèle à une société légitime.