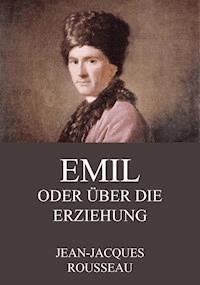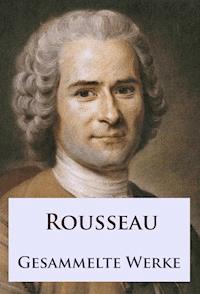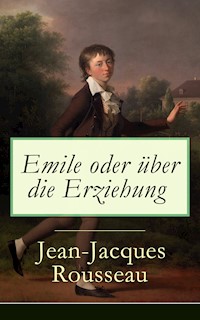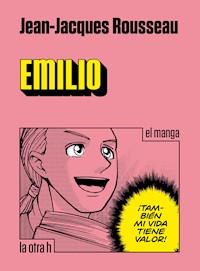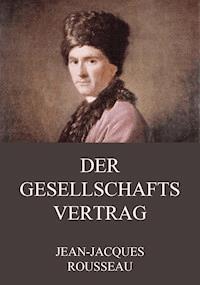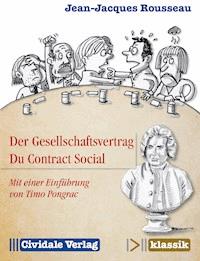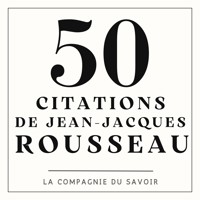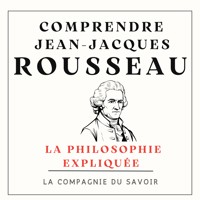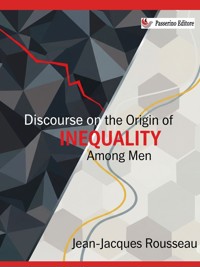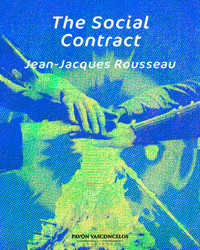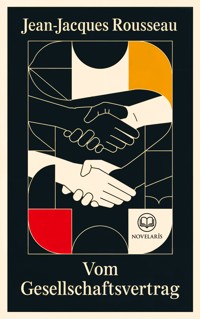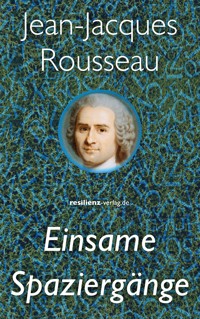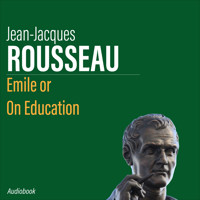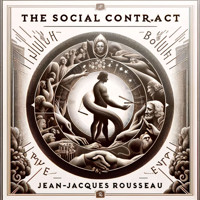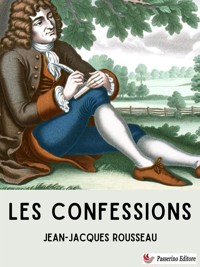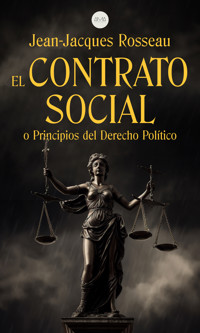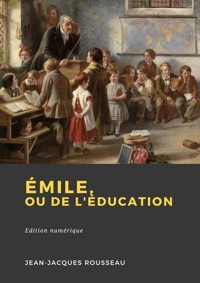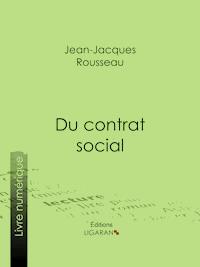
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Comprendre la liberté, l’égalité et la souveraineté : explorez les principes du droit naturel et les fondements du républicanisme selon Rousseau.
Plongez au cœur des idées qui ont façonné la pensée politique moderne. Ce manuel guide pas à pas lecteurs, étudiants et candidats à la philosophie à travers les concepts essentiels du contrat social, de la volonté générale et de la souveraineté populaire. Chaque passage difficile est éclairci, chaque théorie replacée dans son contexte, pour permettre une compréhension vivante et structurée.
Découvrez comment Rousseau interroge la légitimité de l’État, la tension entre autorité et liberté, et la construction d’une société juste fondée sur l’égalité civile. Les distinctions entre droit naturel, droit positif et organisation politique sont analysées avec précision, tout comme l’influence du calvinisme, de l’esprit cartésien et des débats entre Montesquieu, Hobbes et Locke.
Pensé pour l’étude approfondie, ce livre propose aussi une notice bibliographique, des exemples concrets, et des résumés clairs des points clés. Idéal pour préparer le baccalauréat ou l’agrégation, il met en lumière la portée révolutionnaire de la pensée de Rousseau et son actualité dans les débats sur la démocratie et la justice sociale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’objet de cette édition est de rendre possible à tous la lecture du Contrat social et d’en faciliter l’étude aux élèves des classes de philosophie et aux candidats à la licence ou à l’agrégation. L’ouvrage de Rousseau est universellement célèbre, mais fort peu lu, et en réalité fort difficile à lire. J’ai essayé, par un commentaire précis, d’expliquer tous les passages obscurs, de faire apparaître la suite des idées, de dégager les théories principales et d’en signaler la valeur. Dans une introduction, j’ai tenté de résumer le système politique de Rousseau et d’en faire comprendre la formation et l’influence. J’y ai joint une notice bibliographique, où l’on trouvera les moyens de compléter cette étude, dont je connais d’autant mieux-les lacunes que j’en ai davantage senti toute la difficulté.
Le Contrat social parut, un an après la Nouvelle Héloïse, quelques semaines avant l’Émile, au mois d’avril 1762. Rousseau avait alors cinquante ans : il était déjà célèbre. Il ne devait plus publier dans la suite que des ouvrages de polémique.
Le Contrat social diffère nettement de tous les autres ouvrages de Rousseau. D’abord, par le sujet même : ce n’est plus un roman, ni une lettre, ni même un discours, c’est un traité juridique et politique. Et le style en est tout nouveau : on n’y trouve plus les prosopopées, l’exaltation et l’enthousiasme des deux Discours ; le ton, au contraire, en est grave, précis ; les mots techniques abondent ; çà et là, quelque ironie vigoureuse, un mouvement oratoire aussitôt arrêté rappellent seulement l’éloquence des premiers ouvrages : on sent que l’auteur prétend démontrer, avec une rigueur parfois mathématique, une thèse scientifique. Enfin, tandis que les Discours et la Lettre à d’Alembert étaient des ouvrages de circonstance, le premier presque improvisé, le second et le troisième hâtivement composés, le Contrat a toutes les apparences d’un ouvrage longuement médité, soigneusement ordonné, écrit à loisir.
Si nous en croyons Rousseau lui-même, le Contrat social n’est qu’un fragment d’un ouvrage beaucoup plus étendu, dont il avait conçu la première idée pendant son séjour à Venise en 1743, auquel il travailla assidûment pendant près de dix ans à partir de 1750 environ, et qui devait, sous le titre d’Institutions politiques, « mettre le sceau à sa réputation » ; il finit par renoncer, vers la fin de 1759, à cette trop vaste entreprise et se contenta d’achever « en moins de deux années » le Contrai social. Les idées qu’il y expose constituent en effet un système progressivement élaboré et fermement arrêté : on en peut trouver les premières amorces en plusieurs passages de la fin du Discours sur l’inégalité ; – il apparaît déjà très distinctement ébauché dans l’article Économie politique, paru dans l’Encyclopédie en 1755 et publie à part en 1768 ; – une lettre à Voltaire, du 18 août 1756, contient un exposé fidèle du chapitre sur la religion civile ; – un important manuscrit de la Bibliothèque de Genève, récemment publié, dont la date précise est incertaine, mais qui est sûrement antérieur au Contrat, en exprime déjà presque toutes les idées essentielles, souvent même dans les mêmes termes, mais selon un ordre différent ; – enfin, dans le Ve livre de l’Émile, que Rousseau comptait publier avant le Contrat, mais qui ne parut qu’un peu après celui-ci, et dans la sixième des Lettres écrites de la montagne (1764), les mêmes idées fondamentales sont résumées, sur quelques points même précisées et développées : nous avons donc le droit de regarder le Contrat social comme l’expression mûrie, systématique et définitive des théories politiques de J.-J. Rousseau.
J’examinerai sommairement, dans cette introduction, les origines du système politique de Rousseau et l’influence qu’il a exercée ; mais je m’attacherai d’abord à dégager les idées maîtresses du Contratsocial et à en montrer l’enchaînement et la portée ; car l’obscurité réelle de certaines parties de l’ouvrage, et surtout l’étonnante diversité des commentaires et des critiques dont il a été l’objet, obligent à rechercher la signification exacte de ce livre célèbre, si célèbre qu’on s’est dispensé souvent de l’étudier, parfois même de le lire, surtout quand on voulait le réfuter.
« Je cherche le droit et la raison, et ne dispute pas des faits. »(Ms. de Genève, I, v ; éd. Dreyfus Br., p 262).
Le Contrat social a pour sous-titre : Principes du Droit politique. Si Rousseau n’a pas tout d’abord expliqué le sens de cette expression, il a du moins, dans de nombreux passages parfaitement concordants, défini précisément l’objet qu’il se proposait. Voici comment débute le premier chapitre du Contrat : « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers… Comment ce changement s’est-il fait ? Je l’ignore. Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. » Il répète plusieurs fois que les clauses du pacte social n’ont « peut-être jamais été formellement énoncées ». Quand bien même elles l’auraient été, quand le contrat aurait eu une réalité historique, ce n’est pas ce fait, en tant que tel, qui aurait fondé le droit, mais seulement la raison nécessaire dont ce fait aurait été l’expression contingente ; car il ne s’agit pas de savoir ce qui est ou ce qui a été, mais seulement « ce qui doit être ». Il est donc bien clair que le problème étudié par Rousseau dans le Contrat social n’est nullement un problème historique.
D’où vient donc que tant de critiques aient imité Voltaire et reproché à Rousseau d’avoir fondé son système sur une « erreur de fait », sur. une « chimère » n’ayant jamais existé ? – En grande partie, je crois, de ce qu’on a voulu voir dans le Contrat social une suite du Discours sur l’origine de l’inégalité et de ce qu’on a méconnu la différence profonde des problèmes posés dans les deux ouvrages, ce qui condamnait d’ailleurs à ne plus comprendre la différence de leurs solutions. Il s’agit dans le Discours, comme le titre l’indique, d’une question d’origine, par suite, d’une question de fait ; Rousseau prétend d’ailleurs la résoudre par le raisonnement a et par une construction de l’imagination ; il ne se pique point d’exactitude historique ; la simple vraisemblance lui suffit, car il tient beaucoup moins à reconstituer des faits réels qu’à distinguer « l’homme de la nature et l’homme de l’homme » et à montrer ce que la vie sociale a dû ajouter d’inégalités factices aux inégalités primitives. L’esprit et la méthode du Discours ne sont donc pas réellement historiques : mais Rousseau, pour expliquer ses idées, n’en avait pas moins donné à son ouvrage une forme historique, et il s’est par là même exposé à des critiques très fondées. Mais, dans le Contrat, il s’agit d’un tout autre objet et Rousseau y déclare précisément « ignorer » comment s’est faite cette évolution qu’il retraçait dans le Discours : ce n’est donc pas sur des évènements, réels ou hypothétiques, qu’il compte s’appuyer.
Ce n’est pas davantage sur l’histoire des doctrines, des lois ou des institutions : il ne traite pas du droit positif. Rousseau saisit chaque occasion de déclarer que, s’il se rencontre parfois avec Montesquieu dans l’étude des mêmes questions, pourtant le Contrat social diffère radicalement, par l’objet et par la méthode, de l’Esprit des Lois : Montesquieu, dit le précepteur d’Émile, « n’eut garde de traiter des principes du droit politique ; il se contenta de traiter du droit positif des gouvernements établis ; et rien au monde n’est plus différent que ces deux études ».
Le problème posé dans le Contrat social est aussi abstrait, théorique et général qu’il est possible : il s’agit de déterminer à quelles conditions une société peut exister légitimement, c’est-à-dire en respectant le droit naturel et la raison. L’homme est « né libre » ; la société lui impose des contraintes multiples, « des fers » : y a-t-il quelque principe rationnel qui puisse justifier cet état, enlever à cet esclavage ce qu’il a de déshonorant et concilier avec ce qu’on se doit à soi-même ce qu’on doit à la société ? Il s’agit donc uniquement de justifier en droit absolu et devant la raison la possibilité de l’État.
C’est en effet par la morale que Rousseau a été amené à la politique. C’est en constatant les maux qu’entraîne la vie sociale qu’il en est venu à rechercher si ces maux étaient nécessaires, ou si au contraire il ne pourrait pas exister une organisation politique conforme au droit et à la raison. Le Contrat est ainsi le complément logique des deux Discours et de la Lettre à d’Alembert : si la société ne corrompait pas si gravement la nature, il serait moins nécessaire de la réformer. « J’avais vu, dit Rousseau dans les Confessions, que tout tenait radicalement à la politique et que, de quelque façon qu’on s’y prît, aucun peuple ne serait que ce que la nature de son gouvernement le ferait être. Ainsi cette grande question du meilleur gouvernement possible me paraissait se réduire à celle-ci : quelle est la nature du gouvernement propre à former le peuple le plus vertueux,… le meilleur, enfin…. »
Le caractère abstrait et théorique de la question qu’étudie le Contrat social est donc bien loin d’enlever à l’ouvrage son intérêt pratique. Rousseau était l’homme du monde le plus incapable de ne viser qu’à construire un système purement spéculatif. Si le pacte social n’est pas une réalité historique et ne tire pas des faits son autorité et sa valeur, il peut et il doit agir sur les laits, à titre d’idéal. Le contrat n’est pas du passé, mais il peut être de l’avenir. Rousseau s’est souvent défendu d’avoir eu des intentions révolutionnaires : il croyait assurément les grands États de l’Europe moderne trop profondément corrompus et trop mal constitués pour qu’ils pussent jamais se modeler sur l’idéal qu’il avait tracé, et dont il ne se dissimulait pas les difficultés de réalisation. Pourtant, quand il écrivit le Contrat social, il croyait fermement que ses théories étaient applicables tout au moins aux petits États, pourvu qu’elles fussent accommodées aux faits et qu’on rencontrât un concours de circonstances favorables ; son projet de constitution pour la Pologne, ses lettres à M. Butta-Foco et surtout le curieux projet de constitution pour la Corse prouvent que le Contrat lui semblait réalisable, non seulement dans son esprit, mais parfois dans sa lettre. En tout cas, consciemment ou inconsciemment, il a bien proposé aux hommes un idéal révolutionnaire : c’est ainsi qu’il a été compris dès l’abord par tout le monde et l’on sait quelle en fut par la suite l’extraordinaire influence. Eu déterminant les conditions universelles et nécessaires d’un État fondé sur le droit naturel, il montrait de quels principes on devait s’inspirer pour introduire dans l’État la liberté et la justice.
Le problème du Contrat en détermine nécessairement la méthode. Cette méthode ne peut être l’expérience, car comment l’étude des faits pourrait-elle prouver le droit ? Sans doute, il y a eu de bons et de mauvais gouvernements, mais le meilleur de tous n’était tel que parce qu’il remplissait les conditions nécessaires de toute bonne organisation sociale. « Ce qui est bien et conforme à l’ordre est tel par la nature des choses et indépendamment des conventions humaines. » C’est donc le raisonnement a priori qui peut seul démontrer ce que doit être l’État : il faut déduire la politique, en la rattachant à des principes qui en fassent comprendre la légitimité. Peut-être, dans les deux derniers livres du Contrat, Rousseau a-t-il étendu cette méthode à des problèmes pratiques où elle était insuffisante. Mais, pour établir les principes du droit politique, la-méthode a priori était seule légitime et seule possible. Reprocher à Rousseau d’avoir fait « de la métaphysique » et de ne pas s’être appuyé sur les faits, c’est méconnaître l’objet même qu’il se proposait.
Déterminer a priori les conditions d’existence de toute société rationnellement organisée d’après les principes du droit naturel, tel est donc le but du Contrat social. On voit que la méthode de l’ouvrage est logiquement exigée par le problème posé et que c’est là, comme le disait Rousseau lui-même, un problème « pour tous les temps », le plus haut et le plus important qui se puisse concevoir. Il reste à étudier comment ce programme a été rempli et d’abord à établir les principes du droit naturel dont se déduit toute la théorie de l’État.
« Voici, dans mes vieilles idées, le grand problème en politique… : trouver une forme de gouvernement qui mette la loi au-dessus de l’homme. »(Lettre au Marquis de Mirabeau, 26 juillet 1767.)
Montesquieu, dans l’Esprit des Lois, avait pris pour point de départ les lois positives et il avait cherché à déterminer les conditions physiques, sociales et psychologiques qu’impliquait nécessairement chacune d’elles ; c’est ainsi qu’il donnait respectivement pour principes à la démocratie, à la monarchie et au despotisme trois sentiments, la vertu, l’honneur et la crainte : partant des lois, il cherchait donc ce que l’homme devait être pour s’y accommoder. Rousseau renverse la méthode : il veut prendre « les hommes tels qu’ils sont et les lois telles qu’elles peuvent être ». Les données, invariables et fixes, du problème doivent être fournies par l’étude, non des lois, mais de l’homme, de sa constitution physique et morale et des conditions d’existence que lui impose la nature.
Si l’on veut connaître l’homme véritable, il faut le considérer à l’état de nature : c’est là le postulat commun de toutes les œuvres de Rousseau. Qu’est-ce donc que ce fameux état de nature et quels moyens avons-nous de le reconstituer ?
L’état de nature est « un état qui n’existe plus, qui n’a peut-être point existé, qui probablement n’existera jamais… », mais « tant que nous ne connaîtrons point l’homme naturel, c’est en vain que nous voudrons déterminer la loi qu’il a reçue ou celle qui convient le mieux à sa constitution ». Il ne s’agit donc pas d’un état vraiment primitif, mais d’une sorte d’abstraction destinée à nous faire connaître la nature de l’homme ramenée à ses éléments essentiels. « Il ne faut pas prendre les recherches dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels, plus propres à éclaircir la nature des choses qu’à nous en montrer la véritable origine et semblables à ceux que font tous les jours nos physiciens sur la formation du monde. » Essayons donc d’écarter par la pensée tout ce que la vie sociale a fait naître en l’homme de passions, de besoins et de facultés factices, que l’habitude peut modifier et même à la rigueur détruire puisqu’elle a pu les engendrer, et qui, n’étant pas absolument nécessaires à la vie, ne sont pas naturels, et nous trouverons l’état de nature. La nature, c’est en somme ce que la raison nous fait concevoir comme nécessaire.
En cet état, l’homme est guidé par des instincts ou sentiments naturels, qui sont « gravés dans le cœur de l’homme en caractères ineffaçables » et qui spontanément le poussent vers les fins dont la réalisation est nécessaire pour la conservation de la vie. Ces principes naturels sont au nombre de deux, l’instinct de conservation ou l’égoïsme, et la sympathie, si l’on en croit la Préface du Discours sur l’inégalité ; dans le Contrat, il n’est plus question que du premier, qui est en tous cas le plus important : « Sa première loi (de l’homme) est de veiller à sa propre conservation, ses premiers soins sont ceux qu’il se doit à lui-même… ». Mais si ces principes sont tout d’abord « des inclinations de la nature » et tirent de là leur puissance, la raison en reconnaît plus tard la nécessité et par suite la légitimité ; l’homme en fait ou doit en faire les règles réfléchies de sa conduite ; il les érige en « loi naturelle. » C’est de là que découlent « toutes les règles du droit naturel ». Ainsi se justifie le droit fondamental de l’homme à la liberté. L’homme comprend qu’il a droit à la vie, qu’il est « juge des moyens propres à la conserver » et par suite « son propre maître ».
Jusqu’où s’étend cette liberté naturelle ? Il ne faut pas croire qu’elle soit sans limites : selon Rousseau, il y a toujours bien de la différence entre la liberté et l’indépendance. Comment pourrait-il être question pour l’homme d’indépendance absolue, puisqu’il vit dans un univers régi par des lois inflexibles et parmi d’autres hommes, ses semblables ? S’il prétendait se conduire sans règle et sans loi, au hasard de ses caprices, il se heurterait bien vite à ces deux sortes d’obstacles, et il comprendrait la nécessité de soumettre à la raison ses impulsions naturelles. Mais les obstacles qui viennent des choses ne ressemblent pas aux obstacles qui viennent des. hommes : si les uns et les autres détruisent l’indépendance, les derniers seuls détruisent la liberté. « Il y a deux sortes de dépendances : celle des choses, qui est de la nature ; celle des hommes, qui est de la société. La dépendance des choses, n’ayant aucune moralité, ne nuit point à la liberté et n’engendre point de vices ; la dépendance des hommes, étant désordonnée, les engendre tous, et c’est par elle que le maître et l’esclave se dépravent mutuellement. » Les forces naturelles ne sont point en effet des volontés poursuivant des fins déterminées et assujettissant l’homme à leurs caprices ; elles ont au contraire pour caractères l’ordre, l’uniformité et la nécessité : l’homme peut donc leur obéir sans devenir esclave ; en conformant sa volonté à l’ordre du monde, il reste libre de travailler, dans les limites que lui impose la nature des choses, à réaliser ses fins propres, sa conservation et son bonheur. La volonté humaine, guidée par la raison et soumise à l’ordre universel, voilà donc la liberté naturelle.
Mais les rapports des hommes entre eux ne se laissent pas régler aussi facilement. Sans doute, si les hommes, exempts de passions et de vices, savaient se contenter d’une vie frugale et paisible, s’ils suivaient ce penchant à la sympathie dont la nature a mis le germe dans leur cœur et qui s’accorde si bien avec leur intérêt, ils pourraient vivre côte à côte sans dépendre les uns des autres. L’inégalité naturelle qu’établit nécessairement entre eux la diversité des tempéraments, des forces et des intelligences aurait fort peu d’importance dans la simplicité de la vie selon la nature : tous du moins seraient également libres. Mais nous savons qu’en fait il n’en est pas ainsi. Les passions et les vices mettent les hommes en conflit ; la vie sociale amène une inégalité nouvelle, excessive et douloureuse. Or, si l’homme pouvait rester libre en cédant à des lois universelles et inflexibles, il devient nécessairement esclave, et souffre de sa sujétion, lorsqu’il doit obéir à des maîtres capricieux et volontaires qui l’utilisent comme un instrument en vue de fins qui lui sont étrangères. Ainsi s’établit ce régime d’iniquité et de violence dont le Discours sur l’inégalité nous a retracé la genèse. Les hommes, qui avaient tous un droit naturel égal à la liberté et presque des facultés égales pour l’exercer, se trouvent, par le fait de la société, privés de leur liberté et livrés à tous les maux de la plus criante inégalité.
La société a donc entraîné, en fait, la destruction de l’état de nature et a privé l’homme de ses droits naturels. Mais ce fait était-il nécessaire ? Ne peut-on imaginer une organisation sociale, non plus fondée sur les passions et sur la violence, mais réglée par la raison, et précisément destinée à assurer efficacement la réalisation des fins de l’état naturel ? Ce sont les vices des hommes qui rendent l’organisation sociale nécessaire, mais celle-ci ne peut-elle, au lieu de se faire la complice de la force et de l’inégalité, assurer au contraire la liberté et l’égalité ? « C’est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l’égalité, dit très fortement Rousseau, que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. »
On voit donc se poser maintenant sous une forme précise le problème du Contrat social : à quelles conditions une société humaine peut-elle exister, sans détruire la liberté et l’égalité naturelles, mais au contraire en leur donnant une extension et des garanties qu’elles ne sauraient avoir, en fait, avant l’organisation de l’État ? Ou, comme le dit Rousseau, il s’agit de « trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant ».
C’est donc bien l’état de nature qui détermine les données du problème social, car c’est à l’imitation de la nature et conformément au droit naturel que la raison doit organiser l’État. La liberté et l’égalité civiles devront ressembler – autant que possible et sous réserve des changements nécessaires – à la liberté et à l’égalité naturelles. La liberté civile ne sera pas le pouvoir de tout faire, mais le pouvoir de faire tout ce qui sera permis par la loi civile. L’égalité civile ne sera pas l’identité absolue des conditions, mais elle devra mettre tous les hommes également en état d’exercer les droits qui leur seront reconnus par la loi. Et la loi civile elle-même devra avoir un-caractère absolument impersonnel, universel et nécessaire, de telle façon que tous se sentent égaux devant elle et lui obéissent en hommes libres, comme on obéit à une force de la nature ou à un ordre de la raison. « S’il y a quelque moyen de remédier à ce mal (la dépendance des hommes) dans la société, c’est de substituer la loi à l’homme, et d’armer les volontés générales d’une force réelle, supérieure à l’action de toute volonté particulière. Si les lois des nations pouvaient avoir, comme celles de la nature, uneinflexibilité que jamais aucune force humaine ne pût vaincre, la dépendance des hommes redeviendrait alors celle des choses ; on réunirait dans la république tous les avantages de l’état naturel à ceux de l’état civil…. » Il faut donc imaginer une société où « la loi soit au-dessus de l’homme », où les hommes lui obéissent absolument et n’obéissent qu’à elle, et retrouvent, en passant de l’état naturel à l’état social, « l’équivalent de tout ce qu’on perd, et plus de force pour conserver ce qu’on a ».
Comment un tel problème peut-il être résolu ? N’est-il pas contradictoire de prétendre conserver dans une société, qui suppose nécessairement l’autorité, les biens de l’état de nature, dont le premier est la liberté ? « Par quel art inconcevable a-t-on pu trouver le moyen d’assujettir les hommes pour les rendre libres ? » La théorie du pacte social est la réponse à cette question.
« Corses ; faites silence : je vais parler au nom de tous. Que ceux qui ne consentiront pas s’éloignent, et que ceux qui consentent lèvent la main !… »(Œuv. et corr. ined., frag., p 116).
« Puisque aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes. » En effet, nulle autre solution n’apparaît possible. Celle-ci seule peut concilier la liberté naturelle de l’homme avec l’autorité nécessaire à l’État, en substituant à la première la liberté civile.
Plus encore que la liberté naturelle, la liberté civile diffère de l’entière indépendance. La première était limitée par la raison, la seconde l’est en plus par la loi. Pour que cette loi ne détruise pas la liberté de l’individu, il faut qu’elle ait sa source dans la volonté même de cet individu et qu’en lui obéissant, il obéisse à sa propre raison. Ainsi, la liberté civile rejoindra la liberté naturelle. « L’homme vraiment libre, lit-on dans Émile, ne veut que ce qu’il peut et fait ce qu’il lui plaît. Voilà ma maxime fondamentale. » De ce principe, Rousseau tire, dans le Contrat, cette conséquence catégorique : « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté ». Si Tunique autorité sociale est la loi, si cette loi tire toute sa puissance du libre consentement des individus eux-mêmes, la soumission à la loi ne sera plus dépendance et sujétion, mais liberté. Il faut donc que l’État sorte, par une libre convention, de la libre volonté des citoyens : il ne peut être légitime qu’à ce prix. Les principes du droit naturel conduisent nécessairement à la théorie du contrat.
Quelles seront les stipulations de cette convention fondamentale ? – Il ne faut pas se tromper, comme on l’a fait souvent, sur le sens de ce mot convention : il implique bien que l’État est quelque chose d’artificiel, puisqu’il résulte – en tant qu’il est légitime – de la volonté réfléchie des hommes, mais les caractères de l’État ne sont pas pour cela arbitraires. Au contraire, les clauses du contrat social résultent nécessairement de la nature de l’homme, et dès que notre raison conçoit ce que c’est qu’un État légitime, les termes du pacte sont déterminés. « Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l’acte que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet ; en sorte que, bien qu’elles n’aient peut-être été jamais formellement énoncées, elles sont partout les mêmes…. » C’est ce caractère nécessaire qui donne au pacte social sa valeur morale : ce n’est pas en tant que fait qu’il nous oblige, mais en tant qu’il résulte de la nature des choses et se fonde, par conséquent, sur la raison. Dans toute société légitime, en effet, l’objet du pacte est le même : il s’agit de concilier la liberté et l’autorité ; et les principes du droit naturel sont partout les mêmes. La raison détermine donc nécessairement les termes du contrat.
« Ces clauses, bien entendues, se réduisent toutes à une seule, savoir : l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. » D’où la fameuse formule que l’on trouve, presque dans les mêmes termes, dans le Ms. de Genève, dans l’Émile et dans le Contrat : « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout. »
Ainsi, à la base du contrat, se trouve la volonté libre des individus : sans cela, le contrat serait sans valeur et n’aurait aucun caractère obligatoire. Le but du contrat, c’est aussi la liberté des individus, car la raison d’être de cette convention est uniquement le désir de conserver les biens dont on jouissait dans l’état de nature, et dont le principal est la liberté. Le contrat est donc l’œuvre des individus et il a pour fin les individus : pour principe et pour terme, il a la liberté. Mais le moyen, c’est « l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à la communauté ». Il y a là de quoi surprendre. C’est donc la nécessité et l’efficacité de ce moyen qu’il s’agit de démontrer.
Rousseau en donne aussitôt, très brièvement, trois principales raisons. – Si l’individu doit ainsi se remettre tout entier au pouvoir de la communauté, c’est d’abord pour une raison morale, tirée de l’égalité : chacun se dépouillant totalement, il ne pourra y avoir d’arbitraire ni d’inégalité dans le sacrifice de chacun ; sans doute tous les hommes ne sont pas, au point de vue naturel, absolument égaux, et les uns apportent au tas commun un peu plus que les autres, mais leur sacrifice total les met du moins tous sur un pied d’égalité parfaite au point de vue social.
Puis, c’est pour une raison sociale, la plus forte de beaucoup. Sans cette renonciation totale de l’individu à ses droits naturels, le contrat perdrait son utilité et son efficacité et l’on retomberait dans tous les maux de l’état de nature. Si quelque exception était faite en effet, l’homme aurait deux sortes de droits, les uns qu’il tiendrait de la nature et dont il aurait seul la défense, les autres qu’il tiendrait de la société et que l’État se chargerait seul de garantir. À vouloir juxtaposer ainsi dans le même individu un homme de la nature, ne relevant que de sa conscience, et un homme social, ne relevant que de la loi, on enlèverait nécessairement à l’État sa puissance et à l’individu sa liberté ; car, d’une part, l’État se heurterait sans cesse à des résistances qu’il n’aurait aucun moyen légitime de briser, et, d’autre part, il ne pourrait efficacement protéger des droits qu’il n’aurait pas reconnus, sans compter que mille difficultés inextricables naîtraient continuellement de l’empiètement de la loi sur la nature ou de la nature sur la loi et qu’on serait sans cesse exposé soit à la tyrannie soit à l’anarchie.
Enfin, c’est pour une autre raison, plus singulière à première vue, et qui est tirée de la liberté : « chacun, se donnant à tous, ne se donne à personne,… on gagne l’équivalent de tout ce qu’on perd et plus de force pour conserver ce qu’on a ». Ce sacrifice que fait l’individu de tous ses droits naturels serait donc une opération avantageuse, même au point de vue de la liberté. L’individu, en se donnant tout entier, se trouverait « aussi libre qu’auparavant ». C’est ici la pièce maîtresse de tout le système de Rousseau : c’est contre cette proposition paradoxale que se sont acharnés les critiques ; c’est pour la justifier que Rousseau a construit sa subtile et profonde théorie de la volonté générale et de la loi.
« Il se peut qu’ils aient répondu à ce que j’ai dit, mais ils n’ont sûrement pas répondu à ce que j’ai voulu dire… Si donc quel-qu’un se donne la peine de chercher mes vrais sentiments à travers ma mauvaise façon de les dire, il pourra bien trouver que j’ai tort, mais il ne le trouvera sûrement pas par les raisons de mes adversaires, car elles ne font rien du tout contre moi. »(Œuv. et corr. inéd., pensées détachées, p 357.)
Toute théorie politique qui admet un contrat social – et l’on verra que cette idée, loin d’avoir été inventée par Rousseau, était au contraire devenue classique avant la fin du XVII siècle – aboutit nécessairement au problème des droits respectifs de l’individu et de l’État. Si c’est en effet une convention – expresse ou implicite – des citoyens qui fonde la société et confère à l’État sa puissance, on en vient toujours à se demander quelle est, après le pacte, la condition des contractants vis-à-vis des autorités qu’ils ont eux-mêmes instituées. Les individus se sont-ils totalement dépouillés en faveur du « prince », désormais armé d’une autorité souveraine ? – telle était, malgré quelques atténuations, la théorie de Hobbes. – Les contractants se sont-ils au contraire réservé des droits individuels, placés en dehors de l’autorité de l’État et plus ou moins solidement garantis contre ses empiètements, et n’ont-ils confié au prince qu’une puissance conditionnelle et limitée ? – telle était la théorie de la plupart des partisans de l’idée de contrat, notamment de Locke et de Jurieu. – Laquelle de ces deux solutions adopte Rousseau ? Quelques critiques lui ont attribué la première, d’autres la seconde, la plupart toutes les deux à la fois, et ils n’ont pas vu que précisément son originalité a consisté à n’adopter ni l’une ni l’autre et à en imaginer une troisième, beaucoup plus compliquée, mais qui seule répondait au problème, tel qu’il l’avait posé.
On trouve en effet côte à côte, dans les mêmes chapitres du Contrat social, l’affirmation des droits naturels et imprescriptibles de l’individu et l’affirmation de la toute-puissance de l’État : on pouvait feindre de n’apercevoir que l’une des deux thèses ; mais on a, en général, trouvé plus commode d’en constater la contradiction et d’accuser tout simplement Rousseau d’avoir complètement manqué de logique ou de sincérité, quelques-uns même disent, de logique et de sincérité. Selon l’opinion la plus répandue, Rousseau aurait été presque également séduit par la liberté et par l’autorité ; on nous montre deux hommes en lui, « un publiciste… prudent et modéré », ami des droits naturels de l’homme, et un « philosophe… absolu et hautain, hardi et tyrannique », théoricien du despotisme ; et, pour dissimuler l’incompatibilité des deux principes qu’il avait tour à tour proclamés avec un égal enthousiasme, il se serait abrité derrière un-nuage de sophismes absurdes, incohérents, inextricables, où « ni lui ni personne » n’auraient jamais vu clair. – A priori, cette interprétation commode soulève plus d’une difficulté : outre qu’elle fait vraiment trop bon marché de l’intelligence ou de la probité intellectuelle de Rousseau, comment expliquer qu’il ait reproduit sans modifications essentielles cette théorie du Contrat dans trois ou quatre ouvrages différents, à des années d’intervalle, et n’ait jamais manifesté l’intention de la remanier ni de l’abandonner ? D’autre part, Rousseau lui-même prend soin de signaler la difficulté et met en garde le lecteur trop pressé contre la contradiction qu’on pourrait lui attribuer et qu’il avoue n’avoir pu « éviter dans les termes ». Enfin l’ouvrage tout entier aboutit si manifestement à cette question capitale que je ne puis comprendre comment Rousseau aurait publié son Contrat social, s’il se trouvait incapable de la résoudre. Mais, en étudiant la théorie même de Rousseau, j’espère montrer qu’en effet la solution qu’il apporte – discutable assurément – n’est, du moins, ni incohérente ni contradictoire et au contraire parfaitement logique.
Il s’agit pour Rousseau d’organiser la société selon les principes du droit naturel. L’État doit donc répondre à une double condition. : il doit faire bénéficier les hommes des avantages de l’association et protéger chacun avec toute la puissance sociale, et cependant il ne doit porter aucune atteinte aux droits que l’homme tient de la nature et dont le principal est la liberté, ou du moins, si la liberté civile doit nécessairement différer de la liberté naturelle, elle doit rester égale à celle-ci en quantité, de sorte que l’homme social soit aussi libre – et plus puissant – que l’homme de la nature. Pour résoudre ce problème, Rousseau propose ce moyen : tous les hommes se dépouilleront de la totalité de leurs droits individuels en faveur d’une personne morale, d’un grand corps collectif, formé par la réunion des individus eux-mêmes et investi par eux d’une souveraine puissance. Que cette solution réponde à la première condition, on l’aperçoit aussitôt : la force de l’association atteindra ainsi son maximum et l’État tout puissant protègera sans peine les individus les uns contre les autres. Mais ne paiera-t-on pas cette sécurité au prix de la liberté ? L’individu, se donnant tout entier, ne sera-t-il point livré sans défense à la tyrannie capricieuse du souverain ? – Non, répond Rousseau, parce que « les actes du souverain ne peuvent être que des actes de volonté générale, des lois ». C’est donc dans la nature même du souverain, dans les conditions morales et logiques auxquelles il est soumis, que réside la garantie de l’individu.
Qu’est-ce que le souverain dans un État légitime, c’est-à-dire conforme au droit naturel et à la raison ? Ce « n’est qu’un être collectif », formé par la réunion de tous les individus ; la souveraineté n’est donc que « l’exercice de la volonté générale ». À quelles conditions, cette volonté générale pourra-t-elle s’exercer sans détruire la liberté des individus particuliers ?
D’abord, la volonté générale doit être la volonté de tous, et il faut que tous les citoyens soient également et directement consultés : la souveraineté ne peut être, pour cette raison, ni représentée, ni divisée, ni aliénée. C’est à cette condition seulement que la loi aura un caractère moralement obligatoire pour les individus : il faut qu’en y obéissant ils obéissent à leur propre volonté, car « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté ». Lorsqu’il ne peut y avoir accord unanime entre tous les citoyens, on tiendra la volonté de la majorité pour l’expression de la volonté générale, pourvu qu’une convention antérieure ait reconnu et déterminé d’avance la validité de ses décisions. Je puis ne pas vouloir individuellement ce que veut la majorité, mais je dois vouloir du moins que la volonté de la majorité fasse loi : c’est là la volonté commune à la majorité et à la minorité. En somme, directement ou indirectement, il faut toujours s’appuyer sur le consentement unanime des citoyens, qui est essentiel au contrat social : quiconque n’en accepte pas les stipulations s’exclut par là-même du corps social, qui nécessairement ne comprend que les contractants.
Mais si cette condition est nécessaire, elle n’est pas suffisante, car la minorité se trouverait ainsi livrée sans réserve à la majorité. La volonté générale n’est pas seulement la volonté de tons. Elle s’en distingue par un caractère essentiel : elle doit être générale, non seulement par son sujet, mais aussi par son objet ; elle doit provenir de tous, mais s’appliquer à tous, ou, en termes plus précis, elle ne peut viser qu’à l’intérêt commun et décider que des mesures générales. C’est là une condition absolument nécessaire de l’existence d’un État légitime. En effet, la volonté de tous ne saurait créer une loi obligatoire, si chacun n’a songé qu’à ses intérêts particuliers et n’a été consulté que sur une question spéciale. Selon le mot de d’Argenson, que cite à ce propos Rousseau, « chaque intérêt (particulier) a des principes différents »