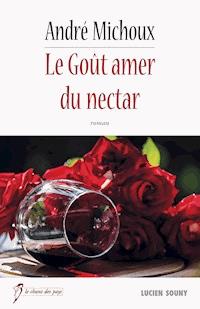Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Lucie, grâce à son mariage avec Paul, un avocat brillant, quitte sa province pour vivre dans la capitale au sein d’une famille bourgeoise, échappant ainsi à ses origines campagnardes. À la fin de la vie de sa mère Rose, Lucie retourne dans son village natal et se relaie avec son père Lucien au chevet de la malade. Dans cette atmosphère lourde, les trois personnages réfléchissent à leur passé, ce qui réveille Lucie après une période d’apathie. Après la mort de ses parents, Lucie décide, contre l’avis de sa famille, de renouer avec ses racines en passant du temps seule dans la maison de son enfance. Une série de circonstances malheureuses révèle un secret que Rose et Lucien avaient gardé enfoui. Cette découverte dramatique est suivie d’une révélation tout aussi tragique, laissant entrevoir une situation cauchemardesque pour Lucie et un autre membre de sa famille. Le conte de fées semble toucher à sa fin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
André Michoux
Du sel sur la blessure
Roman
© Lys Bleu Éditions – André Michoux
ISBN : 979-10-422-0840-0
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Vêtue d’un élégant tailleur qui met en valeur sa silhouette élancée, Lucie Smeter longe la rame du TGV. Le clic-clac de ses souliers à talons aiguilles rythme sa démarche et s’harmonise avec l’imperceptible mouvement de sa chevelure noire et brillante, aux reflets changeants. Le léger maquillage de son visage lisse met en valeur son regard lumineux, qui contraste avec la grisaille matinale de la gare parisienne. Si Lucie est consciente de l’admiration que suscite son charme et sa classe naturelle, elle exècre les œillades déplacées ainsi que les réflexions sexistes parfois proférées sur son passage. Consciente de son pouvoir de séduction, elle éprouve, cependant, lorsqu’elle est flattée, un malin plaisir à déceler, chez Paul, son mari, une pointe de jalousie ou d’agacement. Leur amour et la tendre complicité qui les unit depuis le jour de leur mariage, malgré les petites querelles inhérentes à toute vie de couple, ne se sont jamais fissurés.
Lucie s’arrête devant la voiture de première classe, saisit de sa main droite gantée la poignée de sa valise à roulettes et se hisse à l’intérieur. Elle repère la place isolée qu’elle a réservée, dépose son bagage dans l’espace prévu à cet effet, ôte la veste de son ensemble, la plie soigneusement, la range au-dessus de son siège, s’assied, sort de son grand sac à main un dossier et se plonge dans l’étude du document. L’écran de son smartphone, en s’allumant, dévoile le nom de son époux.
— Tu es à la gare, ma chérie ?
— Ça y est, je suis installée dans le train.
— Appelle-moi ce soir, dès que tu auras rendu visite à ta mère. Si la circulation n’est pas trop dense, pour sortir de la capitale, je pense arriver vendredi entre vingt-trois heures et minuit. Bon courage, mon amour. Je t’embrasse.
— Moi aussi. Sois prudent sur la route.
Lucie désactive la sonnerie de son téléphone et essaie de se concentrer sur son travail. Très rapidement son esprit s’évade. Après avoir relu trois fois le même paragraphe, elle n’en a toujours pas assimilé la teneur. Il lui semble préférable de renoncer pour le moment. Au-dehors, les entrepôts, les immeubles, les maisons des banlieues défilent. Le convoi accélère et des paysages moins tristes se succèdent. Lorsqu’il côtoie des routes, les automobilistes ont à peine le temps d’apercevoir la chenille qu’elle a déjà disparu. Lucie referme son classeur et laisse errer son regard sur les tableaux qui se relayent de l’autre côté de la vitre. Les visions hachées, en raison de la vitesse, deviennent de plus en plus floues et finissent par s’estomper pour laisser la place à un visage : celui de celle qui l’a mise au monde il y a cinquante-sept ans et à laquelle elle rend visite. Elle calcule. Rose, sa mère, a soixante-seize ans.
Lucie descend à Bourg-en-Bresse. Sa correspondance lui imposant une attente de trois quarts d’heure, elle se rend au bar. Une table vient de se libérer. Elle s’y installe et commande un chocolat chaud.
L’hôtel choisi se trouve à proximité de la gare de Lons-le-Saunier. Lucie, à sa descente du train, le rejoint en quelques minutes. Elle confirme, à la réception, sa réservation pour cinq nuitées, précise que son mari la rejoindra vendredi en fin de soirée et réserve son déjeuner au restaurant de l’établissement. Après une rapide toilette, elle se change. Elle opte pour un jean, un pull chaud, un anorak et une paire de chaussures de sport. Avant de descendre prendre son repas, elle commande un taxi pour quatorze heures puis téléphone à l’office de tourisme pour connaître les horaires des autocars pour se rendre à Prélisy et en revenir.
Le chauffeur, d’un naturel volubile, engage rapidement la conversation. Lucie, peu encline à se confier à cet inconnu, fournit des réponses vagues, brèves ou tronquées. L’homme, comprenant que sa cliente ne désire pas échanger, allume la radio.
La route se faufile entre des pâturages, s’enfonce dans une forêt puis en ressort pour saluer une ferme isolée. Cet environnement replonge Lucie dans les années de son adolescence lorsqu’elle rentrait chez ses parents, le soir, en autocar, après sa journée de lycéenne. Elle sourit avec émotion en se souvenant du jeune Arthur qui, chaque fois qu’il en avait la possibilité, prenait place à côté d’elle et la regardait avec des airs de merlans frits. Bien qu’elle n’ait jamais laissé le moindre espoir à ce jeune amoureux, elle s’amusait à adopter parfois, avec l’aide d’une copine confidente, un comportement équivoque. Cette tranche de vie, que Lucie a soigneusement effacée de sa mémoire, resurgit. Cette période, qu’elle a décidé d’occulter, correspond pourtant à des jours heureux. Au moment de son mariage, elle choisit de renier ses origines, son passé. Paul tenta de comprendre cette attitude de rejet, mais ses questionnements contrariaient Lucie et il ne chercha pas vraiment à prendre l’initiative d’un rapprochement avec la famille de son épouse.
Lucie, contrairement à son habitude, perd de son assurance au fur et à mesure que le véhicule se rapproche du village de son enfance. Elle fait stopper la voiture à une centaine de mètres de sa destination, paye la course et poursuit à pied. À l’entrée de la propriété, elle s’arrête. Le tilleul sous lequel elle jouait à la poupée a résisté aux intempéries et aux maladies pour attendre son retour. Une indéfinissable émotion l’envahit. L’atelier de menuiserie jouxtant l’habitation laisse entrevoir, sur les carreaux, à l’intérieur, des dentelles tricotées de toiles d’araignées, de copeaux et de poussières. Le cœur battant, Lucie frappe. Lucien, son père, lui ouvre.
— Entre.
Elle l’embrasse. Bien qu’âgé de soixante-dix-huit ans, il donne l’impression d’un homme robuste, en bonne santé. Il conduit sa fille dans la cuisine et lui propose un café.
— Comme je te l’ai précisé au téléphone, le cancer dont souffre ta mère s’est généralisé et j’ai dû faire installer un lit médicalisé, au rez-de-chaussée, dans le salon. Une infirmière assure les soins matin et soir et une auxiliaire de vie s’occupe de sa toilette. Viens. Elle t’attend.
Lucien entrebâille légèrement la porte avant de se décider à l’ouvrir complètement. Lucie le suit à pas feutrés. Les battements de son cœur s’accélèrent. Elle s’approche de la malade, saisit avec délicatesse la main blanche et décharnée posée à plat sur le dessus du drap. Rose entrouvre les yeux et fixe Lucie de son regard vitreux et fatigué. « Ma petite fille », murmure-t-elle. Malgré le nœud qui se forme dans son estomac, Lucie réussit à sourire et à déposer un baiser sur le front pâle. Les responsabilités qu’elle exerce dans sa vie professionnelle lui ont permis d’acquérir, en plus d’une exceptionnelle maîtrise comportementale, une grande confiance en elle. Cependant, dans cette pièce où rôde déjà la mort, elle perd d’un seul coup de sa superbe. Elle lutte pour affronter cette réalité qui la dérange. Rose abaisse de nouveau les paupières. Au contact des doigts de sa fille, le film de sa vie s’invite, une fois de plus, dans son esprit pourtant affaibli en raison du mal qui la ronge. Les premières images apparaissent. Ce sont celles des années heureuses de son enfance et de sa jeunesse, passées auprès de son père, de sa mère et de ses deux frères aînés, dans la maisonnette appartenant à monsieur le comte de Prélisy. Certes, la famille vit chichement, mais elle garde, de cette période, un souvenir de paix et de sérénité. Ses parents, Pierre et Henriette Pudout, métayers, consacrent le plus clair de leur temps à travailler des terres qui ne leur appartiennent pas. Parfois, Rose se rend au château où, en échange d’une maigre rétribution, on l’emploie comme lingère. On fait également appel à elle pour effectuer différentes tâches ménagères. Elle s’acquitte de ces besognes ingrates sans trop rechigner, car elle sait qu’elles sont provisoires. En effet, le jour de Noël 1943, elle s’est fiancée avec Lucien Faiveux, le fils du menuisier du village qui a embrassé, après des études dans la filière bois du lycée professionnel de Lons-le-Saunier, le métier de son père. Elle attend avec anxiété et impatience la fin de la guerre pour convoler en justes noces avec son amoureux qui combat actuellement dans les rangs de la Résistance. Et puis… il y eut, au mois de juillet 1944, cette réception au château…
Pour assurer le service, madame de Prélisy avait fait appel à Rose. Le dîner regroupait des personnalités de la région dont certaines affichaient ouvertement leur défiance envers les maquisards. Pour cette raison, Rose avait envisagé de refuser de rendre ce service. Devant l’insistance de sa mère, qui craignait que cette insoumission ne soit mal perçue par les châtelains dont la famille dépendait, la jeune fille avait finalement accepté.
À la fin du repas, les convives se retirèrent au salon pour poursuivre leurs conversations tout en savourant une fine du Jura et en fumant un cigare.
Rose desservit et transporta plats, assiettes et couverts à l’office. Elle rejoignit ensuite la chambrette de bonne qu’on lui attribuait, dans ces circonstances, pour y prendre quelques heures de repos. Dès la pointe du jour, elle laverait, essuierait la vaisselle puis s’occuperait de la lessive des nappes et des serviettes. Son contrat oral comprenait aussi le ménage et la remise en ordre de la salle à manger.
C’est le grincement de la porte qui la réveilla. Bertrand, le fils des châtelains, éclaira, referma derrière lui et s’approcha du lit. Ses intentions ne laissèrent que peu de doute à Rose. Elle se recroquevilla et maintint fermement, avec ses deux mains, la literie sur elle. Cette tentative de défense n’intimida pas le jeune homme qui, d’un geste brusque, retira la couverture et le drap. Rose essaya de se lever pour échapper à son agresseur, mais une poigne ferme la maintint allongée.
— Non, Monsieur, ne faites pas ça, je vous en supplie, implora-t-elle.
— Ne sois pas idiote. Je sais que tu en as envie, répondit-il. Tu n’as pas cessé de poser un regard langoureux sur moi, à chacune de tes apparitions, pendant le repas.
— Je vous assure que non, répondit Rose. Laissez-moi, je vous en prie. Je suis fiancée.
Le jeune homme ricana et, sans tenir compte des implorations, réussit, non sans mal, à dévêtir la jeune fille. Excité par ce corps gracieux qui s’épuisait dans une lutte acharnée, mais inégale, Bertrand parvint à vaincre toute résistance et à immobiliser sa victime. Rose, à bout de forces, étouffait sous le poids de l’homme à l’haleine imprégnée de l’odeur forte de l’alcool et du cigare. La pénétration brutale et douloureuse l’anéantit. Bertrand se retira enfin. Rose, hébétée, recouvrit son corps souillé. Avant de sortir, Bertrand lui tapota la joue.
— Tu as eu ce que tu voulais, petite salope !
Rose rouvre les yeux. Cette femme élégante qui lui tient la main, à la porte de l’au-delà, est le fruit de cette relation imposée par la contrainte. Comme en ce moment, Rose a souvent revécu le cauchemar de cette nuit d’été au cours de laquelle elle a non seulement été salie, mais aussi humiliée.
La détresse de Rose atteignit son paroxysme quelques semaines plus tard : à l’évidence, elle était enceinte. Elle avait attendu en vain l’arrivée de ses règles qui survenaient habituellement selon une fréquence régulière. Les nausées dont elle souffrait depuis plusieurs jours constituaient un signe supplémentaire de son état. Désespérée, elle se rendit, à plusieurs reprises, près du pont qui enjambe la rivière. Seule, cette eau sombre avait le pouvoir d’engloutir son infortune. En même temps que sa virginité, elle avait perdu son honneur et ne pouvait plus caresser l’espoir d’épouser un jour son Lucien adoré. À chaque fois, au moment de franchir le parapet, elle renonça, comme si une main invisible la retenait alors que sa décision paraissait prise. Rose ne put pas cacher bien longtemps ses écœurements à sa mère. Elle finit par se libérer du poids qui l’oppressait en avouant l’agression dont elle avait été victime. Henriette, abasourdie par cette révélation, ouvrit les bras à sa fille qui s’y réfugia en pleurs. Elle la dorlota et tenta de l’apaiser, comme elle le faisait déjà, avec des mots pleins de douceur, lorsqu’enfant, Rose, en rentrant de l’école, avait besoin d’être consolée après une méchante moquerie concernant les habits qu’elle portait et qui laissaient deviner sa modeste condition. Henriette la maintint ainsi tendrement, pendant de longues minutes, contre sa poitrine. À travers ses sanglots, Rose se souvenait des mots de désespoir qu’elle avait prononcés : « Lucien n’acceptera plus de m’épouser, maintenant. Maman, j’veux pas me marier avec Bertrand ». « N’aie crainte, il n’en a sûrement pas l’intention, mais il faut qu’il reconnaisse les faits ».
L’entrevue avec les châtelains, sollicitée par Henriette, provoqua le courroux de monsieur et madame de Prélisy. Ils se présentèrent un soir, sans crier gare, chez leurs métayers, au moment du dîner et déclarèrent avec véhémence qu’ils n’étaient pas dupes des intentions malhonnêtes de Rose. Il leur paraissait évident que la jeune fille avait profité du jeune âge de Bertrand pour le séduire et espérer, par cet acte répréhensible, intégrer une famille noble. Ils affirmèrent qu’ils n’étaient pas naïfs à ce point et qu’ils trouvaient la ficelle un peu grosse. Henriette ne devait pas être complice des agissements peu scrupuleux de sa fille qu’ils eurent l’indécence de traiter de traînée.
Quelques jours après cette rencontre, madame de Prélisy se rendit chez les Pudout pour exiger l’éloignement de Rose. En bonne chrétienne charitable, elle avait tout prévu. Une famille, parente de monsieur le comte, possédait une maison bourgeoise, à Millac, près de Sarlat, dans le Périgord. Le couple, sans enfant, gérait une ferme avicole spécialisée dans la production de foie gras. Auguste et Annette Duverger acceptaient d’offrir l’hospitalité à Rose qui, en échange de l’hébergement et de la pension, s’acquitterait de quelques tâches domestiques et tiendrait compagnie à la maîtresse du lieu qui souffrait de solitude dans sa grande demeure.
À l’énoncé du départ programmé de Rose, Pierre sentit son sang se glacer dans ses veines. Les mâchoires crispées, il serra les poings dans ses poches afin de maîtriser sa rage et Henriette osa même exprimer avec audace sa colère et l’injustice de la décision. Rose avait écouté la sentence en silence puis, alors que madame de Prélisy s’apprêtait à prendre congé, avec aplomb, elle se planta devant la comtesse et la transperça du regard.
— Ainsi, Madame, vous accordez à votre fils le droit de violer.
Pierre tira la chaîne à deux reprises, d’un coup sec. Le tintement de la clochette contribua à accélérer un peu plus les battements de son cœur. La lourde porte s’ouvrit et le Père Grosjean apparut. L’ample vêtement de l’ecclésiastique ne permettait pas d’ignorer l’embonpoint du personnage. Il invita le métayer à le suivre dans son bureau. Marie, la bonne du curé, par la porte entrouverte de la cuisine, put satisfaire sa curiosité quant à l’identité du visiteur. Tout en triturant sa casquette, posée sur ses genoux, Pierre narra, à voix basse et étranglée, l’agression dont avait été victime sa fille. L’ecclésiastique prit un temps de réflexion avant de se décider à parler.
— Mon cher Pierre, je comprends ton désarroi et je partage ta détresse cependant, étant donné que la supposée infamie que tu me décris s’est déroulée sans témoin, je ne peux pas prendre position en n’écoutant que ta version des faits. Dis à Rose de se confier à Dieu, éventuellement lors du sacrement de réconciliation. Grâce à l’infinie miséricorde de notre Seigneur, elle sera pardonnée pour ce péché de chair. De mon côté, je ne manquerai pas de prier pour elle. Je m’entretiendrai également avec madame et monsieur de Prélisy ainsi qu’avec leur fils. Ce sont de bons chrétiens et je suis sûr qu’ils auront à cœur d’aider ta fille.
Le Père Grosjean, en assurant son interlocuteur de sa compassion, se leva pour signifier au métayer la fin de l’entretien. Pierre, interloqué devant une telle turpitude, saisit machinalement la main tendue.
Une semaine s’était écoulée depuis la visite de la châtelaine et la rencontre avec le curé du village. En ce début d’après-midi, de gros nuages menaçants se poursuivaient dans un ciel bas. L’orage couvait. Rose posa sa valise à ses pieds, sur le quai de la gare de Lons-le-Saunier. Pierre garda la sienne à la main. Le père et la fille se taisaient. Une longue plainte métallique déchira l’atmosphère. Le train stoppa. À la suite des autres voyageurs, Pierre et Rose se hissèrent à l’intérieur du wagon.
Annette et Auguste Duverger accueillirent Rose avec bienveillance. Eux-mêmes venaient de vivre un drame. Le frère d’Annette, Marcel, postier à Oradour-sur-Glane et son épouse Denise, institutrice dans cette même localité, avaient péri le 10 juin, victimes de la barbarie nazie, dans des conditions atroces. Leur fille, Isabelle, âgée de dix-sept ans, pensionnaire à l’École normale d’institutrices de Limoges, avait, de ce fait, échappé au massacre. Depuis cette triste journée, elle vivait chez son oncle et sa tante à Millac. La grande et austère demeure, située à l’écart du village, regroupait donc des personnes tragiquement éprouvées par la vie. Même la vieille et dévouée employée de maison n’échappait pas à la règle : après la mort de son mari, seule et sans enfants, elle était entrée au service des Duverger qui la considérait comme faisant partie de la famille. Annette entoura sa nièce, mais aussi Rose d’une attention toute maternelle. Taciturne et renfermée, en raison du traumatisme subi, Isabelle devint, petit à petit, moins distante vis-à-vis de Rose. En septembre, elle retourna à Limoges pour poursuivre ses études. Elle en revenait pour les vacances et exceptionnellement le week-end. Au fil du temps, les deux jeunes femmes, marquées par leurs tragédies respectives, tissèrent des liens de confiance et d’amitié.
Les époux Duverger prirent soin de Rose pendant toute sa grossesse. Ils s’appliquèrent à atténuer la tristesse qu’ils percevaient au plus profond de cet être maltraité. Rose, se sentant en confiance, s’épancha auprès d’Annette qui ne fut pas surprise par le comportement de Bertrand. Elle le considérait comme un mauvais jeune homme, mal éduqué et soutenu par sa mère qui prenait toujours fait et cause pour lui, même lorsque ses agissements étaient inacceptables.
L’hiver succéda à l’automne et les prémices du printemps commençaient à se manifester. Rose caressait souvent son ventre de plus en plus arrondi. Que deviendrait-elle après la naissance du bébé ? Isabelle, après l’obtention de son diplôme, serait nommée dans une école communale et la confidente s’éloignerait donc pour se consacrer à ses élèves et sans doute fonder un foyer. Déjà, ses séjours à Millac s’espaçaient en raison de son implication dans plusieurs activités périscolaires. Rose comprit qu’elle était vouée à une vie de solitude. Qui voudrait d’une fille-mère, sauf peut-être pour en faire une esclave ! Elle ferma les yeux. Deux grosses larmes traversèrent ses paupières.
Le bébé naquit le 15 avril 1945, quelques semaines avant la signature de l’armistice.
La sage-femme, passa une main affectueuse sur le front de la jeune maman épuisée et somnolente, vérifia que le nouveau-né se portait bien et quitta la pièce.
Lorsque Rose se réveilla, elle posa un regard bienveillant et chargé d’émotion en direction du berceau où le petit ange non désiré souriait à la vie. Elle se promit, à ce moment-là, de l’entourer de toute la tendresse et de tout l’amour dont elle était capable. Au-delà de la fenêtre, dans le flou de cette maussade journée de printemps, elle scruta le lointain dans la direction de Prélisy. Les nouvelles qu’elle recevait de son village émanaient de courriers rédigés par sa mère. Elle lui en était reconnaissante, car elle savait que cette tâche lui demandait de gros efforts, surtout après ses dures journées de labeur. Demain, Rose lui écrirait pour lui annoncer la naissance du petit être et la rassurer sur son état de santé. Lucien continuait à habiter constamment son esprit c’est pourquoi, la décision, d’appeler sa fille Lucie était prise depuis longtemps. Il lui avait suffi de retirer la dernière lettre du prénom de celui qui resterait à jamais l’élu de son cœur. Que faisait-il en ce moment ? L’avait-il déjà remplacée ? De nombreuses jeunes filles ne cachaient pas leurs sentiments à son égard. Elles s’étaient sans doute réjouies du départ de Rose. Elles avaient maintenant le champ libre pour essayer de le séduire. La jeune maman en éprouva un sentiment de jalousie. La défaite programmée de l’armée allemande avait peut-être permis à son Lucien bien-aimé de reprendre son métier de menuisier ébéniste. Elle l’imaginait, dans l’atelier familial, maniant avec dextérité le rabot, sur le long établi en bois, interrompant parfois le va-et-vient de l’outil pour vérifier, en caressant la planche de la main, la qualité du travail. Son engagement au sein des rangs de la Résistance s’était très tôt imposé à lui. Son courage et sa clairvoyance pour échafauder des actions de guérillas afin de déstabiliser l’adversaire lui avaient valu la reconnaissance de ses frères d’armes. Il avait été promu chef de groupe. Fréquemment, le soir, dans l’intimité de son lit, Rose avait imploré le ciel en espérant que ses prières protégeraient Lucien et qu’elle pourrait bientôt se blottir dans ses bras pour la vie entière. Elle se souvenait, avec émotion, qu’elle avait souvent regardé son annulaire en imaginant une alliance à côté de sa bague de fiançailles.
Rose s’est endormie. Lucie se lève sur la pointe des pieds et regagne la cuisine. Lucien, un coude posé sur la table, la main soutenant sa tête, plonge son regard vide dans celui de sa fille. Elle s’assied.
— Je trouve que son état de santé s’est beaucoup aggravé, depuis ma dernière visite.
— Le mal qui la ronge est sur le point de la vaincre. Le médecin estime que son existence ne tient plus qu’à un fil et qu’il faut s’attendre, à brève échéance, à une issue fatale. C’est la raison pour laquelle je t’ai demandé d’avancer ta venue.
— Demain, je viendrai dès le matin et je resterai toute la journée. Cela te permettra de te reposer un peu. J’achèterai des victuailles et nous déjeunerons ensemble.
— Ta compagnie me réconforte, mais je désire surtout rester le plus possible à ses côtés. Nous avons été toute notre vie un couple fusionnel. Je n’ose pas imaginer l’existence sans elle. Nous avons toujours tout partagé. Grâce à notre amour sans faille, nous avons pu surmonter des moments difficiles.
Lucie ne comprend pas clairement l’allusion aux problèmes auxquels ont été confrontés ses parents. Lucien voulait peut-être exprimer leur frustration concernant la rareté des visites de leur fille.
Le coucou, dans le salon, chante à quatre reprises. Tous les deux se lèvent pour retourner près de la malade. Rose est réveillée. À travers les carreaux de la fenêtre, elle fixe le ciel, ce lieu inconnu et mystérieux. Lucien se dirige vers elle et lui pose un tendre baiser sur le front. Il lui caresse la joue, ridée comme une pomme qui vient de passer l’hiver. Elle lui sourit.
— Je vous prépare un thé, annonce Lucie, en retournant à la cuisine.
Lucien approche une chaise du lit, s’y installe et, après quelques contorsions, pose sa tête sur l’oreiller, tout près de celle de son épouse. Il ferme les yeux et aussitôt les souvenirs, réactivés par la présence de Lucie, s’impriment dans son esprit.
Au printemps et pendant l’été 1944, les escarmouches entre les résistants et l’armée allemande se multiplièrent. Pour ne pas mettre ses proches en danger, Lucien, pendant toute cette période, ne retourna pas dans son village. Fin septembre, profitant d’une nuit sans lune, il rendit cependant une brève visite à sa famille. Il apprit, à cette occasion, le départ de Rose. Ne pouvant rencontrer les parents de sa fiancée, ni obtenir la moindre explication tangible de la part de ses proches quant à l’origine de cette disparition, il reprit, bouleversé et en proie aux plus vives interrogations et inquiétudes, le chemin du combat. Il gambergea beaucoup. S’était-elle laissé séduire par un bel inconnu dont elle serait tombée amoureuse ? Peut-être même s’était-elle éprise d’un officier allemand ? Pour oublier sa probable infortune, Lucien participa à toutes les opérations de commando les plus périlleuses, l’esprit sans cesse occupé par l’incompréhensible trahison de celle dont il était toujours éperdument entiché.
Lorsqu’au printemps 1945 il réintégra son village, il se rendit chez Pierre et Henriette. Il fut impressionné par la métamorphose des deux petits vieux qu’il rencontra. Concernant le départ de Rose, Lucien n’obtint que des réponses évasives et gênées. Rose, sans donner d’explications, avait quitté un jour le domicile familial avec une valise et ils n’avaient jamais plus entendu parler d’elle. Lucien devina qu’on lui cachait la vérité. Il revint régulièrement à la charge jusqu’au jour où, en pleurs, Henriette, n’y tenant plus, lui avoua les vraies raisons de l’absence de sa fille.
À l’annonce de cette nouvelle, le regard de Lucien se durcit, son visage prit la teinte de la pâleur de l’aube. Il serra les dents pour ne pas laisser exploser sa colère. Abasourdi par la révélation, il imagina l’horrible scène de l’agression. Henriette posa une main affectueuse sur l’épaule du jeune homme. « Ils vont me le payer, murmura-t-il ». Henriette et Pierre, inquiets des intentions de Lucien, l’implorèrent de ne pas dévoiler le secret de peur qu’il n’éclaboussât toute la famille et ne discréditât à jamais leur fille. Le départ précipité de Rose avait déjà fait beaucoup jaser dans le village et les explications fournies quant au séjour chez des parents éloignés, qui avaient besoin d’aide, n’avaient pas vraiment convaincu. Marie, la bonne du curé, avait laissé planer des doutes sur la véracité de ces informations. Quand Lucien quitta le couple de métayers, les contours de sa vengeance avaient pris forme dans son esprit torturé.
Lucie pousse la porte avec son genou, pénètre dans le salon et pose le plateau sur la table. Les tasses tintent. Lucien, sort de sa léthargie, se redresse en grimaçant en raison d’un début de torticolis. Lucie verse le breuvage ambré dans les bols.
— Allez, les amoureux, il est l’heure de s’hydrater !
Elle s’approche de sa mère, l’aide à s’asseoir, défroisse ses coussins, les remonte derrière son dos et place le récipient fumant sur la tablette mobile. Elle pose celui de Lucien sur le chevet et, tirant une chaise, vient s’asseoir près d’eux. Ils soufflent à l’unisson sur le liquide brûlant qu’ils absorbent par petites gorgées. Tous les trois sont réunis dans cette pièce, où ils ont partagé, sans en avoir pleinement conscience, des moments de vrai bonheur, quelques dizaines d’années plus tôt. L’arrivée de l’infirmière les tire de leurs pensées nostalgiques. Lucie annonce son intention de préparer le repas et de dîner avec eux avant d’appeler un taxi pour rejoindre son hôtel.
Lucien se tourne et se retourne dans son lit sans parvenir à trouver le sommeil. Il a les sens constamment en éveil et ne dort toujours que d’un œil, craignant de ne pas entendre la sonnette qu’il a installée sur la table de nuit de la malade. Elle peut l’agiter en cas de nécessité. Allongé sur le dos, il aperçoit, sur le côté du rideau, la masse sombre du château de Prélisy. Cette vision nébuleuse lui rappelle l’audace incroyable dont il a fait preuve après la découverte du viol de Rose.
Dès le lendemain de sa rencontre avec les métayers, Lucien se rendit au château. Il fit tinter énergiquement plusieurs fois la clochette. Une personne entre deux âges, portant des vêtements noirs et un tablier blanc, lui ouvrit. En réponse à sa demande de rencontrer monsieur le comte, elle lui rétorqua qu’il était occupé et ne pouvait le recevoir. Il convenait de prendre rendez-vous en indiquant le motif de l’entrevue souhaitée. Elle ajouta que madame de Prélisy était, elle aussi, absente en ce moment. À la stupéfaction de l’employée de maison médusée et, sans tenir compte de ses protestations, Lucien força le passage et se retrouva face au châtelain qui, alerté par les vociférations de sa servante, était sorti dans le corridor. Lucien lui imposa, sans ménagement, un retour à l’intérieur de la pièce et referma la porte derrière eux. Sans attendre l’autorisation de s’asseoir, il s’installa dans l’un des deux fauteuils réservés aux invités et intima l’ordre au maître des lieux à prendre place à son bureau. Il se souvient encore avec précision du dialogue qui suivit au cours duquel il indiqua les raisons de sa venue.
— Connaissez-vous, monsieur le comte, une jeune fille prénommée Rose. Il s’agit de la fille de vos métayers, n’est-ce pas ?
— Assurément.
— Savez-vous où elle se trouve actuellement ?
— Il me semble qu’elle a trouvé une place dans une famille honorable du Périgord.
— Rose est ma fiancée. Avez-vous une idée de la raison de son départ ?