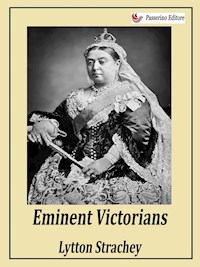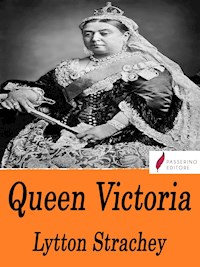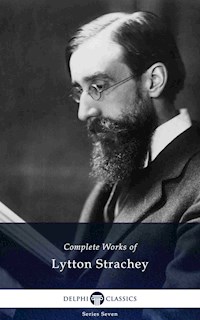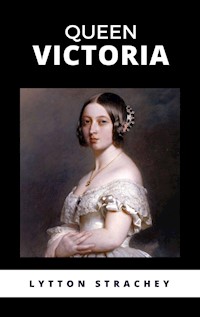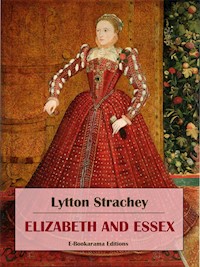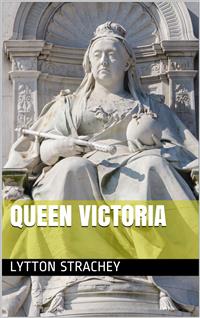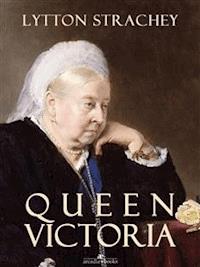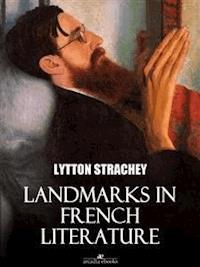Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "La Réforme en Angleterre eut une caractère non seulement religieux, mais social. A l'époque où le moule spirituel du Moyen Age était brisé, une révolution correspondante, non moins complète et de non moindre portée, se produisit dans l'économie de la vie temporelle et la répartition du pouvoir. Les seigneurs et les ecclésiastiques qui depuis des siècles avaient régné, disparurent ; on vit s'établir à leur place une classe nouvelle."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Réforme en Angleterre eut un caractère non seulement religieux, mais social. À l’époque où le moule spirituel du Moyen Âge était brisé, une révolution correspondante, non moins complète et de non moindre portée, se produisit dans l’économie de la vie temporelle et la répartition du pouvoir. Les seigneurs et, les ecclésiastiques qui depuis des siècles avaient régné, disparurent ; on vit s’établir à leur place une classe nouvelle, qui n’était ni chevaleresque, ni sainte ; et dans ces mains compétentes et vigoureuses, les rênes, et les avantages, du gouvernement se trouvèrent rassemblés. Étrange aristocratie ; créée par l’habileté d’Henri VIII, elle finit par submerger le pouvoir auquel elle devait d’exister. Le personnage royal ne fut bientôt plus qu’une ombre, tandis que les Russell, les Cavendish, les Cecil régnaient avec tout le poids de leur réalité. Pour de nombreuses générations ils furent l’Angleterre ; et il est difficile, aujourd’hui encore, d’imaginer une Angleterre où ils ne soient pas.
Le changement fut soudain, et consommé sous le règne d’Élisabeth. La révolte, en 1569, des Comtés du Nord, dernier effort important de la vieille Loi pour échapper à son destin, échoua : l’infortuné Duc de Norfolk – le faible Howard, qui avait rêvé d’épouser Marie Stuart – eut la tête tranchée ; et le nouveau système social fut définitivement assuré. Pourtant, l’esprit de l’ancienne féodalité n’était pas tout à fait épuisé. Une dernière fois avant la conclusion du règne, il se ranima de ses cendres, incarné dans un individu isolé – Robert Devereux, Comte d’Essex. La flamme fut belle à voir ; les couleurs de l’antique chevalerie et l’éclat des prouesses passées y brillèrent de mille feux ; mais rien de substantiel ne la nourrissait ; projetant de sauvages lueurs, elle vacillait, incertaine ; un coup de vent l’éteignit. L’histoire d’Essex, si confuse dans son enchaînement, si démesurée dans ses contrastes, si terrible dans sa fin, laisse voir, à travers le tragique dessin d’un désastre individuel, l’agonie hantée de spectres, d’un monde aboli.
Son père, qui avait été fait Comte d’Essex par Élisabeth, se rattachait à toutes les grandes maisons de l’Angleterre médiévale. Le Comte de Huntingdon, le Marquis de Dorset, Lord Ferrers – des Bohun, des Bourchier, des Rivers, des Plantagenet – se pressaient en foule sur son arbre généalogique. Parmi ses ancêtres, Eléonore de Bohun était la sœur de Marie, femme d’Henri IV ; Anne Woodville, la sœur d’Élisabeth, femme d’Édouard IV ; par Thomas de Woodstock, Duc de Gloucester, la famille remontait à Édouard III. Le premier Comte avait été homme chimérique : vertueux et malheureux. Avec l’enthousiasme d’un Croisé, il avait entrepris de soumettre l’Irlande ; mais les intrigues de la Cour, l’esprit parcimonieux de la Reine, et l’indomptable fierté des « Kerns » avaient eu raison de lui : il n’avait obtenu aucun succès, et était mort enfin dans la ruine et le désespoir. Son fils Robert était né en 1567. À neuf ans, quand son père mourut, l’enfant se trouva l’héritier d’un nom illustre et le plus pauvre Comte d’Angleterre. En outre, les influences complexes qui devaient modeler sa destinée étaient présentes à sa naissance : sa mère représentait aussi bien la nouvelle noblesse que son père l’ancienne. La grand-mère de Lettice Knollys était une sœur d’Anne Boleyn ; en sorte qu’Essex était petit-neveu d’Élisabeth à la mode de Bretagne. Une parenté plus considérable encore vint à se nouer quand deux ans après la mort du premier Comte, Lettice se remaria avec Robert Dudley, Comte de Leicester. La fureur de Sa Majesté et les murmures de scandale ? Nuages d’un instant et de peu d’importance ; seul resta le fait qu’Essex était beau-fils de Leicester, magnifique favori de la Reine, qui, depuis l’avènement de celle-ci, avait dominé la Cour. Que pouvait de plus souhaiter l’ambition ? Tous les éléments étaient donnés – une haute naissance, les plus grandes traditions, du crédit à la Cour, et même la pauvreté – pour composer une belle carrière.
Le jeune Comte fut élevé sous la tutelle de Burghley. Dans sa dixième année, il fut envoyé à Trinity College, Cambridge, où il reçut, en 1581, à l’âge de quatorze ans, le titre de Maître-ès-Arts. Il passa son adolescence à la campagne, dans l’un ou l’autre de ses lointains domaines de l’Ouest – à Lanfey dans le Pembrokeshire, ou, plus souvent, à Chartley dans le Staffordshire, où la vieille demeure, avec sa charpente sculptée, son faîte crénelé, et, sur les fenêtres, les armes et devises des Devereux et des Ferrers, se dressait de façon romantique au milieu de chasses illimitées que le cerf et le daim, le blaireau et l’ours sauvage peuplaient en abondance. Le jeune homme aimait la chasse et tous les sports virils ; mais il aimait la lecture aussi. Il savait écrire le latin avec correction, et l’anglais avec art. Il eût pu être savant, s’il n’avait été, avec tant de feu, gentilhomme. À mesure qu’il grandissait, cette double nature sembla se refléter dans son tempérament physique. Un sang généreux bouillonnait dans ses veines ; il courait et joutait avec les plus ardents ; puis, soudain, la santé se retirait de lui comme une mer qui reflue, et l’enfant au front pâle gisait des heures durant dans sa chambre, mystérieusement triste, un Virgile à la main.
Quand il eut dix-huit ans, Leicester, envoyé dans les Pays-Bas avec une armée, le nomma Général de la Cavalerie. Le poste comportait moins de responsabilités sérieuses que de manifestations pittoresques, et Essex s’acquitta parfaitement de ses fonctions. À l’arrière du front, dans les fêtes et les tournois, « il donnait à tous grand espoir », dit le Chroniqueur, « de sa noble hardiesse au combat » – espoir qui ne fut pas démenti à l’heure de la bataille véritable. Au cours de la charge effrénée de Zutphen, il fut parmi les plus braves ; Leicester l’arma chevalier le soir même.
Plus heureux – du moins en apparence – que Philip Sidney, Essex revint sain et sauf en Angleterre. Dès lors il commença à se montrer assidûment à la Cour. La Reine, qui l’avait connu dès son enfance, l’aimait bien. Son beau-père se faisait vieux. C’était un palais où des cheveux blancs et une figure rouge constituaient une grave infériorité ; et il se peut que le courtisan vieilli sous les armes ait pensé que la faveur d’un jeune parent donnerait plus de force à son action personnelle, et, en particulier, ferait équilibre à l’influence croissante de Walter Raleigh. Quoi qu’il en soit, il n’y eut bientôt plus sujet de pousser le jeune homme. Il devint clair à tous qu’Essex, avec ses manières ouvertes, son espièglerie, ses mots et ses regards adorateurs, sa haute taille, ses mains délicates, et la couleur châtaine des cheveux sur cette tête qui s’inclinait si noblement, avait ensorcelé la Reine. La nouvelle étoile monta avec une rapidité extraordinaire, et soudain parut seule briller au firmament. La Reine et le Comte étaient toujours ensemble. Elle avait cinquante-trois ans, il n’en avait pas encore vingt : âges dangereusement assortis. Mais pour le moment – on était au mois de mai 1587 – tout était calme et uni. Il y avait de longues conversations, de longues promenades à pied ou à cheval à travers les parcs et les bois de la campagne de Londres, et le soir, d’autres conversations, et des rires, et ensuite de la musique, jusqu’à ce qu’enfin les salles à Whitehall fussent vides, et qu’ils restassent, tous deux seuls, à jouer aux cartes. Tout le long de la nuit, ils jouaient aux cartes, ou à tel autre jeu, en sorte que, disaient les mauvaises langues : « Milord ne rentre jamais chez lui que les oiseaux du matin n’aient commencé de chanter ». Ainsi passèrent les mois de mai et de juin 1587.
Si seulement le temps avait pu s’arrêter dans son cours, et prolonger à travers un éternel été ces jours alcyoniens ! L’enfant qui, plein de fièvre, regagne sa maison à l’aube, la Reine qui sourit dans l’ombre… Mais il n’y a point de répit pour les mortels. Les rapports humains doivent ou se transformer ou périr. Quand deux caractères viennent à se rapprocher suffisamment, l’intensité de leur action réciproque, qui devient de plus en plus violente, conduit à un paroxysme inévitable. Le crescendo doit s’élever jusqu’à sa note extrême ; et seulement alors la solution préétablie du thème est manifestée.
Le règne d’Élisabeth (1558-1602) se divise en deux parties : les trente années qui précédèrent la défaite de l’Armada espagnole, et les quinze qui la suivirent. La première période fut une période de préparation : c’est alors que s’accomplit l’œuvre formidable qui fit de l’Angleterre une nation cohérente, définitivement indépendante du continent, et produisit un état de choses où toutes les énergies du pays pouvaient se donner carrière. Durant ces longues années, les qualités dominantes des hommes au pouvoir furent l’habileté et la prudence. Les temps étaient difficiles ; toute autre méthode eût été hors de saison. Pour une génération entière, ce fut l’infinie circonspection de Burghley qui exerça l’influence suprême en Angleterre. Les figures du second plan suivaient l’exemple ; et pour cette raison même, il ne nous est plus permis de les distinguer nettement. Walsingham eut une action souterraine ; Leicester, tout fastueux qu’il était, nous demeure obscur – personnage incertain qui pliait à tous les souffles ; le Lord Chancelier Hatton dansait, et c’est tout ce que nous savons de lui. Puis, tout d’un coup, le kaléidoscope tourna ; les vieilles façons, les vieux acteurs furent entraînés dans le naufrage de l’Armada. Burghley seul resta, monument du passé. À la place de Leicester et Walsingham, Essex et Raleigh, jeunes, audacieux, peints de couleurs vives, et qu’animait une originalité pleine d’éclat, bondirent sur la scène des affaires publiques et l’occupèrent. Il en fut de même dans tous les autres champs de l’énergie nationale : les neiges de l’Hiver, protecteur des germes, avaient fondu, et le merveilleux printemps de la civilisation élisabéthaine jaillit à la lumière.
L’époque – celle de Marlowe et de Spenser, du premier Shakespeare et du Francis Bacon des « Essais » – n’a pas besoin d’être décrite ; chacun connaît ses apparences extérieures, et les œuvres littéraires qui en expriment l’essence. Plus précieux que des descriptions, mais peut-être hors de notre portée, serait un moyen d’amener l’esprit moderne à pénétrer, par l’imagination, la psychologie de ces êtres d’il y a trois cents ans – à se mouvoir avec aisance parmi leurs sentiments spécifiques familiers – à toucher, ou à rêver qu’il touche (car de tels rêves sont l’étoffe de l’histoire) the pulse of the machine. Mais il semble que ce chemin nous soit interdit. Par quelle ruse nous insinuer dans ces âmes étrangères, et dans ces corps plus étrangers ? Plus clairement nous le percevons, plus distant nous devient ce monde singulier. Avec un petit nombre d’exceptions – et peut-être la seule exception de Shakespeare – les créatures dont il est peuplé se présentent à nous sans intimité : fantômes qui restent en dehors de nous, nous les connaissons, mais nous ne les comprenons pas. C’est avant tout l’aspect contradictoire de cette époque qui défie notre imagination et confond notre intelligence. Les humains, sans doute, cesseraient d’être humains s’ils étaient cohérents, mais l’incohérence des Élisabéthains excède toute limite permise à l’homme. Leurs parties composantes s’échappent l’une de l’autre avec impétuosité : on s’en saisit, on les secoue ensemble, et l’on travaille dur à produire un mélange simple : la cornue vole en morceaux. Comment serait-il possible de rendre compte avec suite de leur subtilité et de leur naïveté, de leur brutalité et de leur raffinement, de leur pitié et de leur luxure ? Où que l’on regarde, c’est tout de même. Quelle perverse magie avait entrelacé, en John Donne, l’ingéniosité intellectuelle et l’ingénuité théologique ? Qui a jamais expliqué Francis Bacon ? Comment se peut-il concevoir que les puritains fussent les frères des dramaturges ? Quel étrange tissu mental était-ce donc que celui qui pour trame avait les mœurs cruelles et fangeuses du XVIe siècle à Londres, et pour chaîne un sentiment intime et passionné du magnifique et de l’exquis, de Tamerlan et de Vénus et Adonis ? Qui saurait reconstruire ces êtres aux nerfs d’acier, qui, laissant la taverne où tel enfant gracieux, s’accompagnant du luth, chante un divin madrigal, allaient voir avec délices des chiens sanglants déchirer un ours ? Aux nerfs d’acier ? Peut-être, et pourtant le fat qui se pavane, et dont la braguette proclame l’étonnante virilité, n’était-il pas aussi, avec ses cheveux flottants et ses oreilles étincelantes de pierreries, efféminé ? Et la curieuse société qui se plaisait à des fantaisies si délicates, par quel prompt revirement la voyait-on mettre en pièces, et avec quelle hideuse cruauté, une victime de hasard ! Que la fortune vienne à tourner – le mot d’un espion – et ces mêmes oreilles, on les coupait au pilori, pour le rire de la foule ; ou bien, si l’ambition ou la religion faisait l’imbroglio plus sinistre, une mutilation plus horrible – au milieu d’un marécage de platitudes morales à l’usage des petits enfants, et de confessions suprêmes écrites dans un anglais admirable – pouvait ajouter, à la mort d’un traître, un ragoût spécial.
C’était l’âge du baroque ; et sans doute est-ce le peu de conformité entre la charpente et l’ornementation qui rend le mieux compte du mystère des Elisabétains. Il est très difficile de retracer, sous l’exubérance de la décoration, le secret, le subtil dessin de leur nature intime. Certainement c’est le cas d’Élisabeth elle-même, dernier et souverain exemple, et chef-d’œuvre de l’Elisabéthanisme ; jamais ne foula cette terre une plus baroque créature. De l’aspect visible jusqu’aux profondeurs de l’être, elle était pénétrée en toutes ses parties par le déroutant contraste du réel et de l’apparent. Sous la dense complication du costume – ce vaste panier, cette fraise aux plis raides, ces manches bouffantes, cette poussière de perles, ces soies brochées d’or et répandues sur elle – la forme de la femme disparaissait, et l’on voyait à la place une image – magnifique, monstrueuse, artificielle – une image de royauté, qui par un miracle n’en était pas moins effectivement vivante. La postérité a souffert d’une semblable illusion d’optique. La grande Reine de son imagination, l’héroïne au cœur de lion, qui humilia l’insolence espagnole, qui écrasa la tyrannie romaine avec des gestes splendidement assurés, est aussi loin de la Reine véritable qu’Élisabeth habillée d’Élisabeth nue. Mais, après tout, la postérité jouit d’un privilège. Approchons-nous : nous n’offenserons plus cette Majesté, si nous regardons sous ses robes.
Le cœur de lion, les gestes splendides, les traits héroïques étaient là, sans aucun doute, visibles à chacun ; mais leur exacte valeur dans le plan général du caractère était accessoire et complexe. Les yeux aigus et malintentionnés des ambassadeurs espagnols virent quelque chose de différent ; à les en croire, la caractéristique dominante d’Élisabeth était la pusillanimité. Ils se trompaient, mais en apercevant une plus grande part de vérité que le spectateur superficiel. Ils étaient entrés en contact avec des forces de son esprit qui se révélèrent à l’occasion fatales à leurs desseins, et valurent enfin à la Reine son triomphe suprême. Ce triomphe ne fut point l’effet de l’héroïsme. Au contraire : la grande politique qui gouverna la vie d’Élisabeth fut la moins héroïque qui se pût concevoir, et sa véritable histoire demeure une leçon durable pour les hommes d’État amateurs de mélodrames. En réalité, le succès lui fut donné en vertu de toutes les qualités dont un héros devrait le plus se passer – la dissimulation, la souplesse, l’indécision, la remise au lendemain, la parcimonie. On pourrait presque avancer que l’élément héroïque se manifesta surtout ici dans la durée paradoxale pendant laquelle elle permit aux susdites qualités de la mener. Il lui fallait assurément un cœur de lion pour consacrer douze ans à persuader au monde qu’elle était amoureuse du Duc d’Anjou, et pour rationner les vainqueurs de l’Armada ; de ce côté-là, elle était en vérité capable de tout. Elle se trouva femme de sens dans un univers de violents maniaques, entre des forces adverses d’une terrible intensité – nationalismes rivaux de la France et de l’Espagne, religions rivales de Rome et de Calvin ; pendant des années, il sembla inévitable qu’elle fût écrasée par l’une ou l’autre de ces menaces ; et elle ne dut le salut qu’à sa science d’opposer aux extrêmes qui l’entouraient ce qui chez elle était également extrême, l’astuce et l’art des faux-fuvants. La chance voulut que la subtilité de son intellect fût exactement adaptée à la complexité des circonstances. L’équilibre des pouvoirs entre la France et l’Espagne, l’équilibre des factions en France et en Écosse, les vicissitudes des affaires hollandaises donnaient lieu au cheminement d’une diplomatie tortueuse qui n’a jamais été jusqu’à ce jour complètement débrouillée. Burghley était son auxiliaire préféré, intendant zélé et selon son cœur ; et plus d’une fois Burghley désespéra devant ce rébus, la conduite de sa maîtresse. Or, ce n’était pas seulement son intelligence qui la servait ; c’était son caractère aussi bien. Ici encore le mélange du masculin et du féminin, du pas vigoureux et de l’allure sinueuse, de la persévérance et de l’indécision, était précisément ce que les circonstances demandaient. Un instinct profond lui rendait presque impossible de se déterminer sur quelque matière que ce fût. Ou, si elle y parvenait, elle s’empressait de contredire sa résolution avec une extrême violence, et, après cela, de contredire sa contradiction avec plus de violence encore. Telle était sa nature : flotter, pendant la bonace, sur une mer d’incertitudes, et, quand le vent s’élevait, louvoyer fébrilement d’un bord à l’autre. Autrement – eût-elle possédé, conformément au type reconnu de l’homme d’action, de l’homme fort, le don de choisir une direction et de s’y maintenir – elle était perdue ; inextricablement emmêlée aux forces qui l’entouraient, et presque fatalement, aussitôt détruite. Le côté féminin de son tempérament la sauva. Seule une femme pouvait être si effrontément transfuge, seule une femme pouvait, par un mouvement de cœur si entier et si peu tourmenté de scrupules, rejeter ses derniers lambeaux, non seulement de constance, mais de dignité, d’honneur, et de commune bienséance, dans le dessein d’échapper à l’effrayante nécessité de prendre parti. On doit reconnaître pourtant que la nature évasive des femmes n’y suffisait pas : il fallait un mâle courage, une mâle énergie pour fuir la pression qui pesait sur elle de tous côtés. C’étaient là des vertus qu’elle possédait aussi, mais leur valeur dans le cas d’Élisabeth – et ce fut le paradoxe final de sa carrière – ne fut que de la rendre assez forte pour tourner le dos, avec une indomptable ténacité, aux voies de la force.
Les personnes religieuses du temps s’affligeaient de sa conduite, et depuis, les historiens impérialistes, pensant à elle, se tordent les mains. Que ne cachait-elle ces hésitations et ces chicanes ? Plutôt courir un noble risque ! Qui la retenait de marcher, audacieuse et sûre de soi, à la tête de l’Europe protestante, d’accepter le sceptre de Hollande, et de combattre le bon combat pour la destruction du catholicisme et l’assujettissement de l’empire espagnol à la domination anglaise ? La réponse est qu’elle ne se souciait point de cela. Elle comprenait sa vraie nature et sa vraie mission mieux que ne font ses critiques. C’est seulement le hasard de la naissance qui l’avait fait présider aux intérêts du Protestantisme ; son cœur était profondément soumis au siècle ; et sa destinée fut d’être le champion, non de la Réforme, mais d’un plus grand évènement – la Renaissance. Quand elle vint au bout de son étrange travail, il y avait une civilisation en Angleterre. Le secret de sa conduite, après tout, est fort simple : il s’agissait de gagner du temps. Et le temps, pour elle, était tout. Une décision signifiait la guerre – la guerre, c’est-à-dire exactement l’opposé de ce qu’elle aimait. Il n’y a pas dans l’histoire un autre grand homme d’État qui ait été comme elle, non seulement en intention, mais en fait, pacifique. Non qu’elle se troublât beaucoup des horreurs de la guerre – elle était loin de toute sentimentalité. Elle la haïssait pour la meilleure raison de toutes : qu’elle est pur gaspillage. Son goût de l’épargne était spirituel aussi bien que matériel, et la moisson qu’elle mettait en grange n’était autre que le grand siècle auquel, bien qu’il n’ait atteint ses gloires suprêmes qu’avec le successeur d’Élisabeth, le nom de celle-ci a été justement donné. Sans elle, jamais ces champs prodigieux n’eussent mûri, foulés aux pieds par les hordes furieuses des nationalistes et des théologiens. Elle maintint la paix pendant trente années, à force, il est vrai, d’une longue suite de honteuses capitulations, et d’équivoques inouïes ; mais elle la maintint, et c’était assez pour elle.
Remettre la décision à demain, à demain encore, toujours à demain, semblait son unique objet ; et sa vie se consuma dans la passion de l’atermoiement. Mais ici encore les apparences étaient trompeuses, comme ses adversaires l’apprirent à leurs dépens. À la fin, quand des âges révolus s’étaient inscrits au cadran de l’horloge ; quand le Délai grisonnait déjà ; quand l’Attente s’était consumée jusqu’à la bobèche… alors quelque chose de terrible se produisait. Le rusé Maitland de Lethington aux yeux de qui le Dieu de ses pères n’était qu’un « espouvantail de nourrice », déclarait avec dédain que la Reine d’Angleterre était inconstante, irrésolue, timorée, et qu’avant que la partie fût jouée il la ferait « asseoir sur sa queue et pleurer comme chienne fouettée ». De longues années passèrent ; soudain, les pierres du château d’Édimbourg croulèrent comme sable au signal d’Élisabeth, et Maitland n’eut d’autre recours, contre l’inacceptable ruine, qu’une mort vraiment romaine. Marie Stuart méprisait sa rivale, d’un violent mépris de Française ; après dix-huit ans, à Fotheringay, elle connut qu’elle s’était trompée. Il fallut au roi Philippe trente ans pour être pareillement instruit. Pendant trente ans, il avait épargné sa belle-sœur ; enfin il prononça sa condamnation ; et il souriait de voir cette femme abusée toujours négociant une paix universelle, au moment où son Armada entrait dans la Manche.
Sans aucun doute, il y avait en elle quelque chose de sinistre. On le voyait aux mouvements de ses mains extraordinairement longues. Mais ce n’était qu’une ombre, et rien de plus – juste assez pour rappeler qu’en ses veines coulait du sang italien – le sang des subtils et cruels Visconti. Dans l’ensemble, elle était Anglaise. Dans l’ensemble, quoique infiniment subtile, elle n’était pas cruelle, mais presque humaine pour son temps ; si parfois elle laissait éclater quelque férocité, la peur ou la colère en était cause. En dépit de ressemblances superficielles, elle était exactement l’opposé de son très dangereux ennemi de l’Escurial – araignée attentive à ses trames. Tous deux étaient passés maîtres en dissimulation, avaient du goût pour le délai ; mais ce pied de plomb, chez Philippe, était le symptôme d’un organisme mourant, au lieu qu’Élisabeth temporisait pour la raison contraire – parce que la vitalité peut se permettre d’attendre. Farouchement immobile, la vieille poule couvait la nation anglaise, dont les palpitantes énergies, sous ses ailes, montraient chaque jour plus de maturité et d’unité. Elle couvait, immobile, mais les plumes hérissées ; redoutablement vivante. Cette vigueur débordante alarmait et réjouissait tout ensemble. L’Ambassadeur espagnol déclarait la Reine possédée de dix mille diables, mais l’Anglais ordinaire considérait en ce rejeton du roi Henri, fille au sang généreux, une souveraine selon son cœur. Elle jurait ; crachait ; frappait du poing quand on l’irritait ; riait à grands éclats quand on l’amusait ; et elle était facilement amusée. Une rayonnante atmosphère de bonne humeur adoucit et colora les lignes sévères de sa destinée, et à travers les zigzags de sa vie – affreux chemin – la maintint à flot. Sa réplique à toute impulsion était immédiate et riche : sous l’aiguillon du plaisir, ou devant l’horrible fracas des grandes circonstances, son âme bondissait avec une vivacité, un abandon, une présence d’esprit qui faisaient d’elle, et font d’elle encore, un spectacle fascinant. Elle savait jouer avec la vie comme avec une égale, boxant avec elle, se moquant, l’admirant, observant ses drames, et savourant à fond l’étrangeté de l’évènement, les soudains caprices de la fortune, et le caractère perpétuellement inattendu des choses. « Per molto variare la natura è bella » était un de ses aphorismes préférés.
Les variations dans sa propre conduite n’étaient guère moins fréquentes que dans la nature. La rude et tapageuse dame, avec ses méchants tours, ses façons de plein air, sa passion pour la chasse, se transformait soudain en une femme d’affaires, au visage glacé, claquemurée de longues heures durant avec ses secrétaires, à lire et dicter des dépêches, à contrôler des comptes avec une exactitude minutieuse. Puis, aussi soudainement, c’était la princesse de la Renaissance, infiniment cultivée, qui se manifestait. Car les talents d’Élisabeth étaient nombreux et éclatants. Elle possédait six langues en plus de la sienne, savait du grec, était calligraphe, et jouait excellemment de la musique. Elle s’y connaissait en peinture et en poésie. Elle dansait, dans le style florentin, avec une magnificence altière qui étonnait les spectateurs. Sa conversation, pleine, non seulement de gaieté, mais d’élégance et d’esprit, révélait un sens social infaillible, une charmante délicatesse d’intuition. Grâce à cette versatilité d’esprit, elle fut l’un des diplomates les plus éminents de l’histoire. Son âme protéenne, épousant avec une extrême vivacité les replis de toute forme imaginable, confondait les plus clairvoyants de ses antagonistes, et prenait au piège les plus circonspects. Mais sa virtuosité suprême était la maîtrise qu’elle exerçait sur les ressources du langage. Quand il lui plaisait, elle savait, sous le martèlement des mots, enfoncer jusqu’à la garde ce qu’elle voulait dire. Nul ne l’a jamais surpassée dans la subtile élaboration d’équivoques étudiées. Ses lettres sont écrites d’un style royal qui est bien à elle, fait d’apophtegmes et d’insinuants détours. Dans la conversation privée, elle savait gagner un cœur par certaine brusquerie vive et heureusement appliquée. Mais ses plus grands moments étaient lorsqu’en audience publique elle faisait connaître au monde ses vœux, ses opinions et ses méditations. Alors la magnificence du discours, se poursuivant à travers une constante volubilité, proclamait le curieux travail de son intellect avec une force captivante, et dans le même temps la passion intérieure vibrait magiquement sous l’accent sonore, fier, intraitable, et le rythme exquis des paroles.
Ce n’est pas seulement dans l’esprit d’Élisabeth qu’étaient visibles ces contrastes ; ils dominaient aussi son être physique. Ce grand corps osseux était sujet à d’étranges faiblesses. Des rhumatismes la mettaient à la torture ; d’intolérables maux de tête la tenaient prostrée et gémissante de douleur ; un hideux ulcère empoisonna son existence pendant des années. Quoiqu’elle ait eu peu de maladies graves, une longue suite d’indispositions, une foule de symptômes morbides tinrent ses contemporains dans une incertitude pleine d’alarmes et ont induit quelques modernes chercheurs à conjecturer qu’elle eût reçu de son père une infection héréditaire. Notre science, à la fois des lois de la médecine et des détails réels des troubles de sa santé, est trop limitée pour nous permettre une conclusion précise ; mais il semble à tout le moins certain qu’en dépit de ses souffrances multiples et prolongées, Élisabeth était d’une forte constitution. Elle vécut jusqu’à soixante-dix ans – âge avancé pour l’époque – s’acquittant jusqu’à la fin des pénibles devoirs du gouvernement ; toute sa vie elle fut capable d’efforts physiques extraordinaires ; elle chassa et dansa inlassablement ; et – fait significatif, difficilement compatible avec aucune faiblesse physique prononcée – elle prenait un plaisir particulier à se tenir debout, en sorte que plus d’un infortuné ambassadeur se retira de sa présence, après une audience qui avait duré plusieurs heures, chancelant et plaignant amèrement sa fatigue. Probablement, la solution de l’énigme – suggérée en son temps par divers témoins et acceptée depuis par les auteurs compétents – est que la plupart de ses malaises avaient une origine nerveuse. Cette structure d’acier était la proie des nerfs. Les hasards et les angoisses qui avaient marqué sa vie auraient suffi, en eux-mêmes, à ébranler la santé des plus vigoureux ; mais c’est un fait que, dans le cas d’Élisabeth, il y avait une cause spéciale de névrose : son organisation sexuelle était gravement faussée.
Depuis le commencement, sa vie émotive avait été soumise à d’extraordinaires tensions. Les années si profondément impressionnables de la prime enfance avaient été pour elle une période d’exaltation, de terreur, et de tragédie. Il est possible qu’elle pût tout juste se rappeler le jour où, pour célébrer la mort de Catherine d’Aragon, son père, vêtu de jaune des pieds à la tête, sauf une plume blanche à son bonnet, l’avait conduite à la messe au son des trompettes triomphales, puis, la prenant dans ses bras, montrée à tous ses courtisans l’un après l’autre, au comble de la joie. Mais il est possible aussi que son tout premier souvenir fût d’une nature différente : quand elle avait eu deux ans et huit mois, son père avait fait couper la tête de sa mère. Qu’elle se le rappelât ou non, les réactions d’un tel évènement sur un esprit d’enfant ont dû être profondes. Les années qui suivirent furent pleines de trouble et d’incertitude. Son sort variait sans cesse avec les complexes changements de politique de son père et ses mariages ; tour à tour caressée et négligée, elle était tantôt héritière d’Angleterre, et le moment d’après bâtarde et réprouvée. Puis, quand le vieux Roi fut mort, une nouvelle et dangereuse complication faillit la perdre. Elle n’avait pas encore quinze ans, et vivait dans la maison de sa belle-mère, Catherine Parr, mariée à l’Amiral Seymour, frère de Somerset, le Protecteur. L’Amiral était bien fait, charmant, et sans scrupule : il se divertit avec la Princesse. Le matin, de bonne heure, il faisait irruption dans sa chambre, et avec de grands éclats de rire bondissait sur elle qui était encore au lit ou venait juste de se lever ; il la prenait dans ses bras, la chatouillait, lui donnait des claques sur les fesses, et lançait une plaisanterie obscène. Ces privautés continuèrent pendant plusieurs semaines. Mais Catherine Parr en eut vent, et envoya Élisabeth dans une autre demeure. Quelques mois plus tard, Catherine mourait. L’amiral offrit à Élisabeth de l’épouser. L’ambitieux séducteur, qui visait au pouvoir suprême, espérait s’assurer contre son frère par une alliance avec le sang royal. Ses intrigues furent découvertes ; il fut jeté à la Tour ; et le Protecteur essaya d’inculper Élisabeth dans la conspiration. La jeune fille, au comble de l’angoisse, ne perdit pas la tête. La beauté et les manières de Thomas Seymour lui avaient plu ; mais elle nia fermement qu’elle eût jamais songé au mariage en dehors du consentement du Protecteur. Dans une lettre magistrale, d’une écriture parfaite, elle réfuta les allégations de Somerset. Le bruit courait, lui disait-elle, qu’elle fût « enceinte des œuvres de Milord Amiral » ; ce n’était qu’« une impudente calomnie ; » et elle demandait la permission de venir à la Cour où tous pourraient le constater. Le Protecteur comprit qu’il n’y avait rien à faire avec cette adversaire de quinze ans ; mais il fit décapiter l’Amiral.
Telles étaient les circonstances – à la fois horribles et singulières dans lesquelles elle passa l’enfance et la puberté. Qui s’émerveillera de voir son âge mûr marqué des signes d’une infirmité nerveuse ? Elle ne fut pas plus tôt sur le trône qu’une étrange anomalie de tempérament se déclara. Du moment que la catholique Marie Stuart était héritière présomptive, la cause protestante en Angleterre demeurait suspendue, tant qu’Élisabeth ne se marierait pas, au mince fil de ses jours. Conclusion évidente, naturelle, inévitable : il fallait que le mariage de la Reine eût lieu immédiatement. Mais la Reine était d’un avis différent. Le mariage lui déplaisait, et elle ne se marierait pas. Pendant plus de vingt ans, jusqu’à ce que l’âge mît la chose hors de question, elle résista, à travers une incroyable série de délais, d’équivoques, de perfidies, et de tergiversations, à l’incessante pression de ses ministres, de ses parlements, et de son peuple. La considération de sa sûreté personnelle était sans valeur à ses yeux. Qu’elle n’eût pas d’enfant mettait sa tête à prix. Elle le savait. Elle en souriait. Le monde était confondu par cette conduite sans précédent. Ce n’était pas comme si une chasteté de glace eût possédé le cœur d’Élisabeth. Loin de là ; au contraire. Nature l’avait faite une amoureuse si peu capable de contrainte que son mal était toujours évident et quelquefois scandaleux. La noble forme des hommes l’emplissait d’un trouble délicieux. Sa passion pour Leicester domina son existence, du jour où la tyrannie de sa sœur les eût réunis à la Tour de Londres, jusqu’à la dernière heure du favori ; et il y avait en Leicester une beauté virile, mais rien de plus que cette virile beauté, pour prévenir en sa faveur. D’ailleurs, Leicester ne brillait pas seul à son firmament ; il y avait d’autres astres qui, par moments, étaient près de l’éclipser. Il y avait le majestueux Hatton, si plaisant à danser la gaillarde ; il y avait le gracieux Heneage ; il y avait de Vere, audacieux prince de la lice ; il y avait le jeune Blount, avec « ses cheveux bruns, son doux visage, un corps si bien tourné, et une si haute taille », et la belle rougeur qui, si le regard de Sa Majesté se fixait sur lui, colorait un instant ses joues.
Tous, elle les aimait ; sur ce point, ses amis comme ses ennemis restent d’accord ; car le mot amour est d’un sens incertain ; et sur les faits et gestes d’Élisabeth plane une vaste interrogation. Ses adversaires catholiques proclamaient rondement qu’elle était la maîtresse de Leicester, et qu’elle avait eu de lui un enfant, porté clandestinement en lieu sûr – le conte est sans nul doute inventé. Mais il y avait aussi dans l’air des rumeurs tout à fait opposées. Ben Jonson dit à Drummond, à Hawthornden, après boire, qu’« elle avait une membrane qui la rendait incapax viri, quoique pour son plaisir elle eût essayé beaucoup d’hommes ». Les propos de table de Ben Jonson, naturellement, n’ont aucune autorité ; tout au plus nous renseignent-ils sur les commérages du temps ; ce qui a plus d’importance, c’est l’opinion réfléchie de quelqu’un qui était bien placé pour découvrir la vérité – Féria, l’ambassadeur espagnol. Ayant fait diligente enquête, il en était venu à la conclusion qu’Élisabeth, disait-il au roi Philippe, n’aurait jamais d’enfant ; « entiendo que ella no terna hijos » étaient ses propres mots. S’il en est ainsi, ou si Élisabeth le croyait, son refus de se marier devient tout de suite compréhensible. Avoir un mari et pas d’enfant, c’était simplement perdre son indépendance, sans gagner en retour aucun avantage équivalent ; la succession protestante ne serait en rien plus assurée, et elle-même subirait pour l’éternité l’outrage de servir un maître. La grossière légende de sa malformation physique peut bien avoir eu son origine dans un fait plus subtil, et pourtant non moins essentiel. En de telles matières, l’esprit est aussi puissant que le corps. Une répugnance profondément ancrée à l’acte final du commerce amoureux peut produire, quand la possibilité en approche, un état des convulsions nerveuses, accompagné, dans certains cas, d’une douleur intense. Tout nous induit à conclure que telle – résultat des graves perturbations psychologiques de son enfance – était la condition d’Élisabeth. « Je hais l’idée de mariage, disait-elle à Lord Sussex, pour des raisons que je ne divulguerais pas à une âme sœur. » Soit ; elle haïssait le mariage ; mais elle s’en ferait néanmoins un jeu. Son détachement intellectuel, et le flair suprême qu’elle avait des occasions de chicanerie politique, l’engageaient à faire miroiter cette promesse à la convoitise du monde. L’Espagne, la France, et l’Empire – pendant des années, elle les tint, leurrés de cet impossible appât, dans les filets de sa diplomatie. Pendant des années, elle fit de son mystérieux organisme le pivot sur lequel tournait le destin de l’Europe. Il se trouva qu’une circonstance accessoire lui permit de donner à son jeu une vraisemblance remarquable. Quoique, au centre de son être, le désir se fût changé en répulsion, il ne s’était pas évanoui tout à fait ; au contraire, les forces compensatrices de la nature avaient redoublé sa vigueur en d’autres points. Quoique la précieuse citadelle elle-même ne dût jamais être profanée, il y avait alentour des territoires, il y avait des retranchements et des bastions sur lesquels se pouvaient livrer d’émouvantes batailles, et que même, à de certains moments, il ne serait pas interdit de laisser tomber aux mains téméraires d’un assaillant. Fatalement d’étranges rumeurs devaient courir. Les princiers poursuivants multiplièrent leurs assiduités ; et la Vierge Reine tour à tour fronçait les sourcils et souriait de son secret.
Les années d’équivoque passèrent, et le temps arriva enfin qu’il ne put désormais plus être question de mariage. Mais le curieux tempérament de la Reine subsista. À l’approche de la vieillesse, son agitation émotive ne diminua pas. Peut-être, en réalité, devint-elle plus violente ; quoiqu’ici encore il y eût mystification. Jeune fille, Élisabeth n’était pas sans attraits ; elle resta pendant mainte année belle femme ; mais à la longue les traces de sa beauté furent remplacées par des lignes dures, des couleurs empruntées, et un certain éclat grotesque. Pourtant, comme ses charmes faiblissaient, croissait son insistance à les voir reconnus. Elle s’était contentée de l’hommage dévot de ses égaux en âge ; mais des jeunes hommes qui l’entourèrent dans sa vieillesse elle exigea – et reçut – les témoignages d’une passion romanesque. Les affaires de l’État s’accompagnaient d’un fandango de soupirs, d’extases, et de protestations. Son prestige, que le succès avait fait énorme, était encore magnifié par cette atmosphère de mystique adoration autour de sa personne. On sentait, quand on approchait d’elle, une présence surhumaine. Aucune vénération n’était trop grande pour une telle divinité. On racontait qu’un jeune gentilhomme d’une extrême beauté, en s’inclinant très bas devant elle, avait laissé échapper un bruit malheureux, et que là-dessus, si grands étaient son embarras et son horreur, il s’était expatrié et avait voyagé sept ans avant que d’oser reparaître devant sa maîtresse. La politique d’un tel système est évidente ; et pourtant il ne s’agissait pas uniquement de politique. Sa clairvoyance, si effrayante dans ses relations avec le milieu extérieur, s’arrêtait court dès qu’elle tournait les yeux au-dedans. Alors sa vue se faisait artificielle et confuse. On eût dit qu’obéissant à un subtil instinct, elle avait réussi à devenir l’un des plus grands réalistes du monde, à force de concentrer sur soi tout le romanesque de sa nature. Le résultat était peu commun. Le plus sage des monarques, obsédé par une vanité déraisonnable, vivait dans un univers qui était entièrement composé ou d’imaginations absurdes, couleur de rose, ou des plus dures et plus froides réalités. Il n’y avait pas de transition – seulement les extrêmes juxtaposés. Extraordinaire esprit qui tantôt était pur acier, et le moment d’après délicieux émoi. Une fois de plus sa beauté avait vaincu, une fois de plus son regard fascinateur avait provoqué la réponse inévitable. Avidement, elle absorbait l’encens alambiqué de ses adorateurs, et dans le même instant, par un coup décisif de chance et d’habileté, le convertissait, comme tout ce qu’elle touchait, en traites monnayables.
Cette Cour étrange était le temple du paradoxe et de l’arbitraire. La Déesse, s’animant dans un nimbe de gloire dorée, était une vieille personne, habillée de vêtements fantasques, toujours grande quoique voûtée, avec des cheveux teints en roux sur un pâle visage, de longues dents jaunissantes, un nez haut et dominateur, et des yeux qui étaient à la fois profondément enfoncés et lui sortaient de la tête – des yeux féroces et terribles qui, dans leurs profondeurs d’un bleu sombre, cachaient quelque chose de frénétique – quelque chose de presque dément. Elle passait – incarnation singulière d’une suprême énergie ; et la Fortune et le Sort la suivaient. Quand la porte de ses appartements était close, le monde savait que le cerveau, par-delà ces yeux, travaillait, avec la dextérité consommée d’un génie riche d’une longue expérience, aux complications infinies de la diplomatie européenne et au difficile gouvernement d’une nation. De temps en temps, l’on entendait un son rauque – une voix aiguë – une semonce. C’était un ambassadeur qui recevait un avertissement, une expédition aux Indes qu’on décommandait, une décision prise pour la constitution de l’Église d’Angleterre. L’infatigable créature reparaît enfin, saute sur un cheval, galope dans les clairières, et revient contente, pour une heure à son épinette. Après un repas frugal – une aile de volaille arrosée d’un peu de vin et d’eau – Gloriana dansait. Au son des violes, les jeunes hommes, groupés autour, attendaient ce que leur destinée apportait. Quelquefois, le Comte était absent, et alors que ne pouvait-on espérer de cette prompte susceptibilité, de ce caprice impérieux ? La Déesse, les joues en feu, plaisantait rudement avec l’un et avec l’autre, et finissait par sommer un garçon vigoureux de lui faire la conversation dans un coin. Son cœur se fondait aux paroles flatteuses, et, comme de ses longs doigts elle lui donnait de petites tapes sur le cou, en tout son être se répandait une lasciveté indéfinissable. Elle était femme – ah ! oui ! femme séduisante ! – mais encore, n’était-elle pas aussi vierge, et vieille ? Mais immédiatement, une autre vague de sentiments la balayait et la submergeait ; elle planait ; elle était quelque chose de plus – elle le savait ; qu’était-ce ? Était-elle… homme ? Elle considérait les êtres chétifs qui l’entouraient, et souriait à la pensée qu’elle avait beau être leur maîtresse en un sens, il y en avait un autre où elle ne le serait jamais – et qu’on pouvait presque dire que le contraire était vrai. Elle avait lu l’histoire d’Hercule et d’Hylas, et elle aurait pu, dans une rêverie à demi consciente, s’imaginer pourvue de quelques-uns des traits de cette païenne virilité. Hylas était un page – il était devant elle… mais un silence soudain troublait ses réflexions. Elle se retournait, et voyait qu’Essex était entré. Dans un éclair, il était près d’elle ; et la Reine avait tout oublié, comme il s’agenouillait à ses pieds.