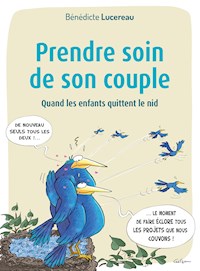Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Französisch
Cet ouvrage s’adresse à tous les amoureux qui se posent la question de l’avenir de leur relation. Forts d’une longue expérience d’accompagnement, les auteurs invitent les couples à s’interroger sur le sens profond du mariage et à faire la vérité sur eux-mêmes : attentes profondes, motivations inconscientes, histoire de leur relation, forces personnelles, mais aussi blessures et renoncements. Ils trouveront ainsi les ressources nécessaires pour approfondir leur amour et répondre avec assurance à la question : « Suis-je prêt à me marier ? » Un guide indispensable pour les couples qui souhaitent épanouir leur amour et envisagent la belle aventure du mariage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cédric Burgun et Bénédicte Lucereau
Et si on se mariait ?
Comment savoir si on est prêt
Nouvelle édition revue et augmentée
Conception couverture : © Christophe Roger
Dessin couverture : © Shutterstock/Piotr Marcinski
Composition : Soft Office (38)
1re édition : © Éditions Emmanuel, 2013
Réédition : © Éditions Emmanuel, 2021
89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris
www.editions-emmanuel.com
ISBN : 978-2-35389-885-5
Dépôt légal : 1er trimestre 2021
Préface
L’amour est « une marche […], un abandon de la fermeture en son propre “moi” pour aller vers l’autre personne, afin de construire un rapport durable » (Lumen Fidei, n° 27). Les propos du pape François dans sa première encyclique sont une bonne introduction au livre de Bénédicte Lucereau et du père Cédric Burgun. Car le questionnement sur le mariage – et, pour certains, la préparation au mariage – est le commencement d’une marche vers l’autre. Et cette marche est un chemin d’humilité. Parce qu’elle exige un décentrement de soi, alors même que la culture contemporaine conduit plutôt à l’affirmation de soi, au désir d’indépendance, à l’auto-construction et à la prétention d’invulnérabilité. Or, c’est précisément l’attitude inverse qui est suggérée dans ce livre, comme pour guérir les fiancés du mirage de l’amour-sentiment, d’un amour romantique, afin de les ouvrir à l’humble construction d’une relation fondée sur la vérité de ce qu’ils sont.
En ce sens, ce livre est une bonne leçon de réalisme. Lisons encore le pape François dans la même encyclique : « Sans vérité l’amour ne peut pas offrir de lien solide, il ne réussit pas à porter le “moi” au-delà de son isolement, ni à le libérer de l’instant éphémère pour édifier la vie et porter du fruit » (Lumen Fidei, n° 27). Bénédicte Lucereau et le père Cédric Burgun invitent les couples qui se posent la question du mariage à faire la vérité sur eux-mêmes, c’est-à-dire à oser mettre en lumière ce qu’ils n’ont parfois jamais appris à regarder en face : leurs attentes profondes, leurs motivations inconscientes, l’histoire de leurs relations, leurs forces personnelles ; mais également ce à quoi ils devront renoncer. C’est en se connaissant eux-mêmes qu’ils pourront se projeter dans l’avenir et construire une relation solide.
Pour chacun, cela passe d’abord par l’acceptation de ses fragilités. Il peut être très angoissant d’avoir à regarder ce dont on n’est pas fier, ce que l’on préférerait cacher à l’autre pour se montrer sous un jour plus avenant : ses faiblesses, ses défauts de caractère, les aspects fragiles de sa personnalité, ses péchés… Le premier acte de confiance est de se montrer avec sa part de vulnérabilité. « Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire », écrit saint Paul (Col 3, 13). L’amour consent à porter les fardeaux de l’autre et à continuer à avancer malgré les blessures et les doutes.
Une seconde leçon de réalisme est proposée à la méditation des couples : la communion conjugale suppose, de manière très paradoxale, d’assumer sa part de solitude. Il faut être capable de tenir debout tout seul pour se rendre disponible à une véritable rencontre. Sinon, le partenaire risque de n’être qu’un support, un tuteur, un appui, une bouée de sauvetage. Le mariage ne dispense pas de rester soi-même, d’avoir une vie propre et d’exister en face de l’autre. Pour cela, il est nécessaire de faire le deuil d’un rêve de fusion qui, au fond, nous protégerait d’un face-à-face avec nous-même.
Les auteurs insistent également sur les motivations cachées qui nous poussent vers l’autre. Il y a, là encore, un travail de vérité qui peut être douloureux. Pourquoi, écrivent-ils, avons-nous choisi celui-ci ou celle-là ? Évidemment, le lien amoureux n’est jamais réductible à des raisons conscientes. Mais l’approfondissement du sens et des conditions du mariage peut être un temps propice pour relire l’histoire de nos relations avec nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, nos éducateurs, afin de comprendre ce qui nous pousse vers l’autre, ce que nous recherchons en lui, ce que nous en attendons, et ne devons pas en attendre.
Cette démarche demande enfin de la patience. Patience pour aller à la découverte de l’autre. Personne ne se dévoile en quelques semaines. La personne aimée sera toujours un mystère. Il est bon qu’elle le reste parce que l’amour disparaît le jour où l’aimé est réduit à une équation, le jour où l’on prétend le cerner en quelques formules. Se poser la question du mariage, c’est permettre à l’autre de dévoiler une part de ce mystère ; mais en lui laissant la maîtrise des étapes.
Fragilité, solitude, motivations cachées, patience… Tous ces mots n’entrent pas, en général, dans l’idée que l’on se fait du mariage. Pourtant, ils sont absolument nécessaires pour parcourir l’itinéraire qui mène à une véritable décision. Non seulement celle de se marier, mais encore celle de s’engager avec cette personne-là. Ce moment de la décision est indispensable. Or, bien souvent, il est difficilement repérable dans l’histoire d’amour des couples. Comme si, au fond, la responsabilité de faire un véritable choix avait voulu être évitée.
On trouvera aussi dans cet ouvrage de préparation au mariage, comme en mode mineur mais toujours présent, deux thèmes chers au pape François : la miséricorde et le discernement. La miséricorde est justement l’accueil de l’autre dans son histoire, dans sa différence, avec son rythme propre. Elle accepte que tout ne soit pas donné tout de suite, qu’il y ait des étapes pour se connaître et pour s’aimer ; elle comprend aussi que tout en l’autre n’est pas parfait. Et s’il elle voit bien l’ivraie, elle commence par se réjouir de la présence du bon grain sans s’inquiéter pour l’avenir.
Le discernement est vraiment la marque propre de notre humanité. Qu’ai-je envie de devenir ? À quoi le Seigneur m’appelle-t-il ? Que voulons-nous faire de notre vie commune ? La vie conjugale n’est plus portée par des structures sociales qui la protègent et l’encouragent. La simple tradition ou la répétition des modèles qu’on a eus devant les yeux ne suffisent plus pour construire son couple. Il faut inventer son mariage dans des conditions nouvelles, singulières, propres à chaque couple ; et cela se fait dans un discernement constant, un discernement dans l’Esprit Saint. Plus la société se sécularise, plus les chrétiens ont à vivre dans la lumière du Saint-Esprit pour trouver un chemin de fidélité à l’Évangile. Cet ouvrage aidera les fiancés à trouver une méthode de discernement.
Pour accompagner les lecteurs, Bénédicte Lucereau et le père Cédric Burgun ont rédigé des exposés clairs, courts, illustrés d’exemples. Ils proposent aussi d’interrompre la lecture pour prendre le temps de répondre à des questions plus personnelles et d’intégrer ainsi les étapes de ce questionnement sur le mariage.
Voici un livre utile, qui méritait bien une nouvelle édition revue et complétée, afin de répondre toujours mieux aux besoins et aux attentes des couples. Nous pensons aussi qu’il contribuera à renouveler en profondeur la préparation au mariage, selon le vœu du pape François dans Amoris Lætitia.
+ Nicolas Brouwet,
évêque de Tarbes et Lourdes
Introduction
« Deux cœurs qui s’aiment… »
Et si on se mariait ? Cette question, posée ainsi, peut paraître légère et naïve. Mais elle en appelle, de facto, une autre : Comment savoir si on est prêt ? L’amour est la plus grande chose de la vie, celle que l’on désire plus que tout : l’homme et la femme sont faits pour aimer et être aimés ; et pour que cela dure. Quelle espérance pour chacune de nos vies : je suis fait pour aimer et être aimé ! Les artistes n’ont de cesse de décrire l’amour, de chercher à le cerner, à le chanter, et chacun de nous, un jour ou l’autre, se met en quête du grand amour de sa vie. Car on pressent bien qu’une des clés du bonheur se trouve là, dans cette capacité à aimer qui se cache au plus profond des cœurs.
Vouloir réussir son mariage
Mais deux amoureux qui s’aiment, qui « se sont trouvés », peuvent se poser la question : comment savoir que l’on est faits pour se marier, que l’on est prêts à franchir cette étape que chacun désire souvent au fond de lui ? Qu’est-ce que le mariage va apporter de plus ? Qu’est-ce que cela va changer à la relation ? Sera-t-on capables de tenir parole ? Tant de peurs peuvent bloquer, aujourd’hui, le désir d’un engagement durable : les divorces dans l’entourage, les risques accrus d’échec, les blessures de chacun, diverses inquiétudes, etc.
Le mariage est une affaire sérieuse : il reste un idéal pour beaucoup de gens, mais un idéal si élevé qu’il interroge, fait peur, qu’on peut décider de s’en passer ou l’arranger à sa façon, en déformer le sens… Pourtant, des mairies et des paroisses, conscientes des enjeux, proposent aux couples des préparations au mariage qui sont de vraies aides pour les futurs conjoints. Il est beau de voir combien les jeunes fiancés éprouvent le besoin d’être accompagnés et soutenus dans leur démarche. Il est tout aussi beau de voir la prise en compte de ce désir par ces différentes institutions. Mais parfois aussi, ces préparations sont trop hâtives ou manquent de moyens humains et d’une vision globale de l’Homme. Elles en deviennent alors décevantes, ou ne portent pas tous les fruits espérés pour ceux qui viennent les suivre.
Aujourd’hui, la durée de vie d’un couple peut atteindre soixante ou soixante-dix ans. Or, nombreuses sont les préparations au mariage réduites à deux ou trois soirées, centrées sur l’accueil des couples et la convivialité, ou la préparation du dossier administratif et de la liturgie s’il y a célébration du sacrement.
La préparation au mariage est plus que tout cela : c’est un lieu de formation, certes, mais surtout un lieu de maturation. On y fait l’expérience, de façon surprenante pour les amoureux, qu’on ne se connaît pas vraiment, même quand on a décidé de se marier. Des couples plus âgés témoignent qu’on ne peut prétendre avoir fait le tour de l’autre. Plus on aime, plus l’autre apparaît comme un mystère. C’est donc une vraie question de savoir si l’on connaît assez l’autre pour s’engager, et si l’on se connaît assez soi-même. On a tellement envie que ça marche, que son couple soit une réussite ! Si l’on n’attend de la préparation au mariage qu’un tampon à la mairie ou à l’église, il y a fort à parier que le mariage ne sera pas bien préparé…
Malheureusement, beaucoup arrivent au mariage sans se connaître. Ils se sont uniquement distraits ensemble, ils ont fait des expériences ensemble, mais n’ont pas affronté le défi de se révéler l’un à l’autre et d’apprendre qui est en réalité l’autre.
Aussi bien la préparation immédiate que l’accompagnement plus prolongé doivent assurer que les fiancés ne voient pas le mariage comme la fin du parcours, mais qu’ils assument le mariage comme une vocation qui les lance vers l’avant, avec la décision ferme et réaliste de traverser ensemble toutes les épreuves et les moments difficiles1.
Le couple est l’une des plus belles aventures qui soient : c’est le lieu de l’amour, le lieu du don de la vie et de la création d’une famille. La plupart des jeunes rêvent de fonder un couple, et que cet engagement dure. Ils ont envie que leur « oui » soit un vrai « oui ». Les préparer au mariage, c’est leur donner les outils pour que leur amour s’ancre dans la durée, soit alimenté au jour le jour par ces petites attentions délicates qui touchent le cœur de l’autre et lui permettent de se sentir meilleur. Pour les croyants, c’est comprendre aussi comment la grâce de Dieu leur est donnée pour vivre un amour toujours plus ouvert à l’autre et aux autres.
La majorité des couples connaissent le bonheur d’une vie stable, épanouie, autour d’une fidélité durable : il est d’ailleurs bon de rétablir la vérité des chiffres. Oui, beaucoup de mariages se vivent très bien ! Les époux que l’on interroge disent y mettre les moyens – réussir son couple, c’est vouloir le réussir – et s’investir personnellement pour cela. Probablement aussi ont-ils bénéficié d’une préparation au mariage sérieuse, qui a solidifié la base de leur engagement.
Physionomie des jeunes couples actuels
Aujourd’hui, la préparation au mariage s’adresse à de jeunes générations plus blessées et instables qu’autrefois. On ne peut nier les souffrances liées au nombre élevé des divorces, aux familles divisées ou recomposées… Chez les jeunes amoureux ou fiancés, la crainte est forte : Je ne veux pas faire subir à mes enfants ce que j’ai moi-même vécu. Ils se posent alors cette question : peut-on prévenir ces souffrances ? Se marier préserve-t-il des possibles échecs ?
L’âge de la première relation amoureuse sérieuse recule, alors que l’âge du premier baiser et des jeux amoureux avance. La durée des études augmente. Les trentenaires, façonnés par la quête de la réussite, le relativisme, le virtuel et l’instantané, ont plus de mal à poser des choix et à s’engager dans la durée (ainsi qu’à s’arrêter pour relire leur histoire, avec ses blessures affectives). Ils peinent à discerner ce qui est bon pour eux. Pour certains aussi, la multiplicité des expériences amoureuses n’aide pas à croire au véritable amour. Beaucoup habitent dans les grandes villes, sont très compétents dans leur travail (conseil en entreprise, gestion des ressources humaines, recherche scientifique et technologique de haut niveau…) ; mais pour leur vie personnelle, ils fonctionnent souvent à l’affectif, au coup par coup, sans réelle maturité ou intelligence du cœur.
À l’heure où l’on ne sait plus très bien ce que « mariage » ou même « engagement » veut dire, force est de constater que le désir d’aimer et d’être aimé est toujours là, bien ancré au fond du cœur des jeunes et des moins jeunes. Le rêve de fonder un couple stable et durable, avec un partenaire unique pour partager sa vie et fonder une famille unie, figure toujours au top du hit-parade pour trouver le bonheur.
Mais comment savoir si c’est le bon/la bonne ? Comment être sûr que l’on s’aime et que l’on s’aimera toute la vie ? Comment savoir si l’on est prêt à s’engager ?
De nombreux jeunes couples se font et se défont : cela laisse des cicatrices douloureuses, qui saignent parfois longtemps et empêchent d’avancer paisiblement dans une nouvelle relation.
Certains s’installent ensemble pour vérifier leur amour. Ils pensent en toute bonne foi que c’est la meilleure manière de discerner : essayer avant de plonger ! Mais ce pseudo-engagement ne fragilise-t-il pas plutôt l’avenir de leur lien de couple, ou d’un futur lien avec une autre personne ? La rupture potentielle de cette vie commune ne blesse-t-elle pas d’autant plus qu’elle s’appuyait sur des non-dits ? Je croyais qu’on allait vivre ensemble toute notre vie… Il me semblait que tu m’avais promis… que tu m’aimais…
D’autres couples attendent d’avoir des enfants pour envisager le mariage. Inconsciemment, ils font ainsi porter une lourde responsabilité à ceux-ci en cas de difficultés conjugales.
D’autres choisissent le mariage, parfois poussés par leur famille, parce qu’un enfant arrive à l’improviste… Mais les conditions sont-elles vraiment réunies pour discerner paisiblement, librement et sans précipitation ?
Beaucoup, enfin, foncent tête baissée sans réelle compréhension de ce qu’est véritablement le mariage. La ratification d’un sentiment ? L’officialisation d’une relation ? Le droit de vivre sous le même toit ? Le début d’une gestion commune des biens ? L’occasion d’une fête grandiose conforme aux usages sociaux ? L’autorisation d’avoir enfin une sexualité active ?
Par ailleurs, le désir très puissant de fonder une famille pour devenir adulte, père ou mère, peut aussi pousser vers le mariage, qui devient alors comme l’occasion de fuir sa propre famille. Le mariage n’est-il alors pas choisi pour lui-même, plus que pour le conjoint ?
Prendre soin de l’amour
Certaines préparations au mariage se réduisent malheureusement à une discussion sur la foi et l’Évangile et sont éloignées des vrais enjeux de la vie à deux. Que faire de notre amour ? Le prendre au sérieux, et le faire grandir par un engagement et la construction d’un projet de vie ? Ou décider d’y mettre un terme ?
Un amour qui stagne, ne s’engage pas, est un amour qui s’étiole et risque de s’épuiser. Quels moyens prendre alors pour le faire grandir, pour qu’il tourne l’homme et la femme toujours davantage hors d’eux-mêmes, vers l’autre ? Un tel mouvement de don mutuel s’apprend, de même qu’inscrire son amour dans un projet de vie à deux suppose la détermination et la persévérance de chacun. Il s’agit de faire rimer « amour » avec « toujours », et ainsi de le transformer en vraie joie : joie du don, joie de demeurer avec l’autre, joie de se donner ensemble dans la famille, la société, et pourquoi pas l’Église.
À l’heure de la rencontre ou dans les débuts de la relation, l’amour rend si heureux qu’il peut aveugler sur la réalité : réalité de l’autre et réalité du projet que les amoureux veulent construire ensemble. Parfois, ceux-ci n’abordent même pas cette question du projet de vie, pressentant inconsciemment que cela pourrait déraper… A-t-on la même vision du couple ? De la famille ? Du rôle de chacun ? Connaît-on les attentes de l’autre ? Et les siennes propres ? Cet amour passionnel des débuts donne un sentiment de toute-puissance, il croit pouvoir résoudre à lui seul tous les problèmes, ou a tendance à les gommer et à remettre leur traitement à plus tard : difficultés d’identité, d’insécurité, d’immaturité, d’estime de soi, d’acceptation de la différence, de gestion des contrariétés et des frustrations… Les jeunes amoureux sont convaincus que les couples qui ont divorcé ne peuvent pas s’être aimés autant qu’eux s’aiment maintenant. Ils ont du mal à imaginer que leurs parents, ou des personnes plus âgées, aient pu être jeunes et s’aimer comme eux s’aiment.
De l’amour au mariage
Cet amour initial entre un jeune homme et une jeune femme est beau : il a besoin d’être reconnu, admiré, soutenu. Il est moteur dans la construction de la relation, qui peut-être un jour deviendra un lien conjugal, s’ils le décident. L’amour ne fait pas le couple. Il ne peut en être le fondement, même s’il en est le déclencheur. C’est pourquoi les amoureux ont tant besoin d’être accompagnés, afin d’objectiver leur relation et de l’inscrire dans un projet de vie à deux. Le travail consiste à sortir de cette idéalisation de soi, de l’autre et du « nous », pour entrer dans la vérité : vérité sur soi, sur l’autre et sur son couple. Il permet d’inscrire cet amour dans un véritable projet de vie où chacun s’engage aux côtés de l’autre, un projet qui soutient l’amour et le fait durer.
Pour cela, il faut la connaissance et la volonté : on ne peut aimer que ce que l’on connaît, et on ne peut construire que ce que l’on a décidé de construire. Même si les aléas de la vie font évoluer le projet initial, peu importe : la direction est prise ensemble, les bases sont posées, les priorités sont établies. Le cadre pour la sécurité affective des époux étant posé, l’amour pourra grandir, se transformer, devenir fécond et s’ouvrir pour donner la vie.
Se préparer au mariage
La pastorale pré-matrimoniale et la pastorale matrimoniale doivent être avant tout une pastorale du lien, par laquelle sont apportés des éléments qui aident tant à faire mûrir l’amour qu’à surpasser les moments durs. Ces apports ne sont pas uniquement des convictions doctrinales, et ne peuvent même pas être réduits aux précieuses ressources spirituelles que l’Église offre toujours, mais ils doivent aussi être des parcours pratiques, des conseils bien concrets, des tactiques issues de l’expérience, des orientations psychologiques2.
Voilà ce qu’est le mariage : une institution humaine qui reconnaît et protège la cellule familiale, établie comme fondement de notre société depuis des millénaires.
Le mariage est une aventure passionnante, qui suppose que les deux partenaires aient appréhendé de façon sérieuse les questions qu’il soulève et soient libres pour y répondre. On constate qu’ils le font avec honnêteté lorsqu’ils y sont aidés de façon soutenue et avec un langage vrai, qui n’hésite pas à aborder les problèmes parfois latents.
Cet ouvrage s’adresse à tous, pas seulement aux croyants. Il s’appuie à la fois sur une anthropologie résolument biblique et sur les sciences humaines, qui apportent un éclairage complémentaire à la parole de Dieu sur l’amour humain. La réalité de l’amour, en effet, est de l’ordre de la nature, telle qu’elle a été voulue par Dieu dès le commencement. À nous d’accepter qu’elle soit élevée à la dignité de sacrement, si telle est notre conviction. Encore une fois, la liberté de l’homme et de la femme est sollicitée !
Les acteurs de la préparation au mariage sont bien souvent les témoins d’un amour humain authentique. Ils essaient d’amener les amoureux à voir ce que cet amour ressenti et expérimenté exige d’eux. Car l’amour vrai est exigeant. Il vient de plus loin que moi ; j’en suis dépositaire sans trop comprendre comment, mais je deviens responsable de ce que j’ai reçu. Je deviens aussi responsable de celui que j’aime,disait une jeune fille avec pertinence.
L’amour fait vouloir le bien de la personne aimée, il pousse à tout faire pour elle. Plus on connaît l’autre, ses besoins, ses désirs, ses espoirs, ses forces et ses faiblesses, plus on peut décider d’être présent à ses côtés, lui offrir le soutien, l’écoute, la bienveillance, la tendresse dont il/elle a besoin pour avancer.
Les enjeux d’une véritable réflexion personnelle, avant une demande en mariage et/ou pendant la préparation de celui-ci, consistent à vérifier les piliers de l’engagement et à donner des clés de discernement3 :
– Suis-je capable de demander en mariage celui/celle que j’aime ?
– Suis-je à même d’accepter la demande de l’autre ?
– Suis-je capable de m’engager avec mon ou ma fiancé(e) pour toute la vie ?
Se poser ces questions, c’est accepter de se confronter réellement à ce discernement (qui peut parfois faire peur) : Notre couple a-t-il des faiblesses, des souffrances voire des blessures qui nous fragilisent et qui pourraient empêcher, en l’état, le mariage ? Ou au contraire : Sommes-nous suffisamment solides pour que le mariage ait un sens pour nous et devienne un moteur nouveau pour notre amour ? C’est cette exigence-là qui rendra libres les fiancés et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, les accompagnent vers le mariage.
Ce livre est écrit à deux voix – un prêtre spécialisé dans les questions de nullité de mariage, et une conseillère conjugale, thérapeute de couples et de familles – à partir de l’expérience d’accompagnement de jeunes, de fiancés et de couples en difficulté. Il est conçu comme un chemin, qui aidera autant ceux qui sont concernés par la relation amoureuse que ceux qui les rencontreront (prêtres, couples accompagnateurs, parents), pour avancer ensemble vers la bonne décision.
1. PAPE FRANÇOIS, encyclique Amoris Lætitia, n° 210-211.
2.Amoris Lætitia, n° 211.
3. La préparation au mariage ne se résume donc pas à donner un contenu intellectuel sur le mariage ou sur la foi. Elle participe, à sa manière, à ce questionnement.
Chapitre 1
Qu’est-ce que l’amour ?
Un simple sentiment ou beaucoup plus ?
Se poser la question de l’amour humain, c’est se demander : Qu’est-ce qu’aimer ? Qu’est-ce qu’être aimé ? Comment aimer l’autre ? Avouons que cette question est loin d’être simple. Si l’on faisait un sondage, à quoi arriverait-on ? Chacun définirait l’amour à sa manière, selon sa propre expérience, probablement à partir de la façon dont il a été aimé. Un sentiment, une attirance ? Les plus romantiques voient ainsi l’amour comme ce ressenti « qui fait chavirer le cœur ». Les plus intellectuels le désignent par des termes comme le partage, la connivence, l’attrait physique et/ou intellectuel, des intérêts communs, une même recherche de la vérité. Certains encore voient l’amour comme le don de soi, l’oubli de soi. D’autres, enfin, le définissent d’abord comme l’exercice de la sexualité (d’où l’expression : « faire l’amour »).
L’amour que nous nous promettons dépasse toute émotion, tout sentiment et tout état d’âme, bien qu’il puisse les inclure. C’est une affection plus profonde, avec la décision du cœur qui engage toute l’existence. Ainsi, dans un conflit non résolu, et bien que beaucoup de sentiments confus s’entremêlent dans le cœur, la décision d’aimer est maintenue vivante chaque jour, de s’appartenir, de partager la vie entière et de continuer à aimer et à pardonner. Chacun des deux fait un chemin de croissance et de transformation personnelle. Sur ce chemin, l’amour célèbre chaque pas et chaque nouvelle étape4.
Comment définir véritablement l’amour ? L’homme a tendance à faire un certain nombre de dichotomies : il sépare les différents aspects de sa vie – vie affective, familiale, professionnelle, sociale – comme s’ils n’avaient aucun lien entre eux. Et de la même façon, il compartimente sa vie intellectuelle, sa vie sentimentale et sa vie sexuelle. Pourtant, peut-on être efficace au travail quand sa vie sentimentale ne tourne pas rond ? De plus, l’homme vit souvent comme s’il se réduisait à ses passions, ses pulsions, ses ressentis, son affect, au risque d’oublier l’essentiel.
Parler de l’amour et de sa beauté, y compris dans son aspect charnel qu’est la sexualité (cf. chap. 5), nécessite de parler de ce qui fonde notre différence avec les animaux. En effet, les bêtes mangent quand elles éprouvent la faim, elles boivent quand elles ont soif, le mâle copule avec la femelle quand la saison et ses hormones le lui dictent. Peut-on parler d’amour dans ce cas ?
Une différence fondamentale de l’homme avec l’animal est son intelligence et sa volonté, ainsi que leur coordination avec son corps. C’est pourquoi réduire l’amour et la sexualité à une pulsion corporelle revient à animaliser l’homme. Ce dernier a certes un corps, mais aussi un cerveau qui le commande et un cœur qui le conduit. L’homme humanise son corps en apprenant à canaliser ses pulsions. Ainsi, je ne me jette pas sur la première tablette de chocolat venue, ni sur une bouteille de whisky sous prétexte que j’ai soif et que c’est la seule boisson que j’ai sous la main. Contrairement aux animaux, je suis capable de me raisonner, voire de jeûner pour un examen médical par exemple, ou si je décide de poser un acte religieux. Je suis aussi capable de boire un verre avec des amis, même sans avoir soif, juste pour le plaisir de partager un moment amical et social. Bref, le corps n’a pas son autonomie propre. Je mange et je bois quand je le décide. Mon affectivité, elle aussi, sera donc soumise, pour une part, à ma volonté et à mon intelligence, dont je suis le pilote.
Le corps vit et agit uni à la tête et au cœur, nul ne peut le nier. Autrement dit, l’homme et la femme vivent toujours leurs sens à travers leur raison et leur intelligence, et pas de manière purement corporelle ni purement affective, comme on l’entend parfois. Leur intelligence et leur cœur les transportent plus loin que la simple perception elle-même. Leur plaisir sensible, s’il n’est pas que réponse instinctive à la pulsion, contiendra une joie spirituelle qui les dépasse, une joie plus grande et souvent cachée. En cela, ils sont humains et différents des animaux. On s’en rend particulièrement compte avec le sens du toucher, comme l’écrit le philosophe Fabrice Hadjadj :
À la différence de la vue et de l’ouïe, le toucher m’engage dans cela même que je perçois. Voir une mygale sous verre et la flatter de l’index n’est pas la même chose. […] Quand je touche ma femme, bien sûr, ce n’est pas comme quand je touche une chose ou une bête […]. La chair que je sens et par qui je me sens est aussi en train de me sentir et, par là, de se sentir elle-même. Nos mains et nos lèvres se répondent et réveillent mutuellement nos contours. L’étreinte modèle notre glaise à l’image de ce jour où elle sortit des doigts de Dieu5.
La caresse sur le dos du chat n’est que pure sensation pour lui : il ne fait rien intellectuellement de cette sensation, aussi plaisante soit-elle. Or, pour l’homme, le toucher, plus que les autres sens, est l’expression d’un autre ressenti : celui de notre interprétation. Une caresse peut être ressentie comme un geste tendre… ou comme le début d’un viol. Notre corps ne vit que dans une synergie avec notre cœur, notre mémoire et notre intelligence, qui interprètent tous les signaux et tous les affects. Les nôtres, d’abord, et ceux de l’autre. Il suffit, là encore, de regarder la sexualité pour s’en convaincre : l’hypophyse, cette petite glande qui produit des hormones sexuelles, se trouve à la base du cerveau, lieu de tous nos souvenirs, affections et émotions. De toutes nos réflexions aussi. Et je suis capable de liberté face à mes hormones !
De quoi l’homme et la femme sont-ils pétris ?
Pour bien comprendre ce qu’est l’amour, arrêtons-nous sur ce qui constitue l’être humain : de quoi l’homme est-il fait ?
Nous symboliserons l’homme à travers des cercles concentriques (cf. dessin p. 33) grâce auxquels on décrira, de façon très simplifiée, comment nous fonctionnons.
– La première zone d’une personne est le physique.
Tout ce qu’on voit du corps de la personne : sa taille, son visage, ses yeux, sa façon de se comporter, de s’habiller, de se maquiller. Le corps possède une certaine activité biologique autonome : il respire, son cœur bat, il se maintient en équilibre, il a faim et froid. Ces ressentis ne se contrôlent pas, mais se perçoivent indépendamment de la volonté. Ce sont des sensations, des émotions corporelles, des flux « électriques » qui parcourent le corps d’un organe à l’autre. Ces flux nerveux sont nommés, décrits et analysés par le cerveau, qui les mémorise. Ce sont classiquement tous nos sens : l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût, le toucher. Auxquels il faut ajouter tous les ressentis liés directement à notre corps : la faim, le froid ou la chaleur, la douleur, l’attirance, le plaisir, le dégoût, etc.
Il n’y a pas de frontière étanche entre les cercles qui décrivent une personne : tout se tient. La personne humaine a une unité, qui s’expérimente concrètement par le fait que tout est lié dans ce qu’elle vit. La douleur, par exemple, est une sensation corporelle : c’est un nerf qui s’exprime. La souffrance, elle, est une interprétation de la douleur par l’émotion qu’elle produit (psychique), puis par le sens qui va lui être donné (spirituel). Les émotions (joie, peur, colère, tristesse) sont à la frontière du physique et du psychique, de par la spontanéité des réactions physiques qu’elles engendrent. De même pour les pulsions. La peur, par exemple, est ressentie dans le corps : J’ai la chair de poule… J’ai la boule au ventre… La peur fait partie de ces émotions de base que l’on subit. Celles-ci sont parfois irrationnelles, et peuvent être enfouies, verrouillées.
Dans l’histoire d’un mariage, l’apparence physique change, mais ce n’est pas une raison pour que l’attraction amoureuse s’affaiblisse. On tombe amoureux d’une personne complète avec son identité propre, non pas seulement d’un corps, bien que ce corps, au-delà de l’usure du temps, ne cesse jamais d’exprimer de quelque manière cette identité personnelle qui a séduit le cœur. Quand les autres ne peuvent plus reconnaître la beauté de cette identité, le conjoint amoureux demeure capable de la percevoir par l’instinct de l’amour, et l’affection ne disparaît pas. Il réaffirme sa décision d’appartenir à cette personne, la choisit de nouveau, et il exprime ce choix dans une proximité fidèle et pleine de tendresse. La noblesse de son choix porté sur elle, parce qu’elle est intense et profonde, éveille une nouvelle forme d’émotion dans l’accomplissement de sa mission conjugale6.
– La deuxième zone d’une personne est le psychique.
L’homme a des affects, une vie intérieure, des pensées qui peuvent monter en lui, des sentiments. Si l’émotion est primaire (elle a un impact direct sur le corps), le sentiment est plus élaboré, plus réfléchi : il fait appel à la mémoire, à l’imaginaire, à la raison. Il est aussi plus permanent qu’une émotion furtive. On peut agir sur un sentiment, plus difficilement sur une émotion !
La mémoire, la raison logique, les habitudes, les croyances, l’imagination font partie de cette part psychique d’une personne. Elles aident à analyser le vécu, à comprendre les expériences, mais ne suffisent pas à rendre compte de la dignité de la personne, capable de réfléchir à son existence et de lui donner un sens.
– La troisième zone d’une personne est le spirituel.
La frontière entre le psychique et le spirituel est mouvante : on est plutôt dans un domaine ou plutôt dans l’autre, les deux se recouvrant partiellement, même s’ils sont bien spécifiques. Le spirituel est tout ce qui concerne les valeurs d’une personne, ce qui fonde sa singularité et qui fait d’elle une personne libre et responsable de ses choix. Pour les croyants, c’est la marque de l’image de Dieu en toute personne humaine, avec ce centre sacré de la conscience, qui éclaire sur le bien et le mal.
Les deux facultés spirituelles de l’homme sont l’intelligence (qui cherche la Vérité) et la volonté (pour faire le Bien).