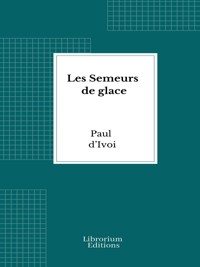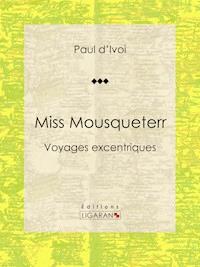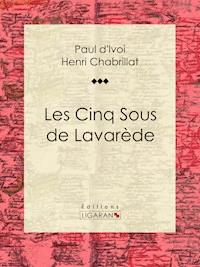Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encrage Édition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Œuvres de la Grande Guerre
- Sprache: Französisch
Quel était leur quotidien lors de la Première Guerre mondiale ?
Femmes et gosses héroïques est un recueil d’écrits de circonstances, mots, réflexions et nouvelles de guerre, publié en 1915. Il présente l’originalité de donner la vedette à des femmes et à des enfants, qui apparaissent comme des exemples de courage et de patriotisme à imiter alors que la guerre s’installe dans le quotidien des Français.
L’ouvrage se caractérise aussi par une grande variété : dans la forme adoptée par les textes, la nationalité et la condition des personnages, ou encore les lieux où se révèle leur héroïsme – à l’arrière, au front, à Paris, en province, en Allemagne, en Pologne… Avec des récits tantôt dramatiques, tantôt pleins d’une savoureuse ironie, il permet d’apprécier le talent de nouvelliste d’un auteur davantage connu pour ses romans d’aventures.
Découvrez la vraie vie de ces femmes et de ces enfants, au front comme à l'arrière
EXTRAIT
Lineke (diminutif affectueux d’Aline) est toute blonde et toute rose. Elle a grandi dans la Flandre catholique. Sa petite âme simplette et pure réprouvait naturellement la violence. Elle ne concevait que pardon, excuse, miséricorde, même pour les pires coupables.
Je la rencontre. Est-ce pour la taquiner ? Peut-être ; mais je lui dis :
— Vous avez lu… à tel endroit… cette hécatombe d’Allemands ?
Ses paupières palpitent. Elle pâlit un peu en murmurant :
— Et des nôtres ?
— Oh ! beaucoup moins. La proportion est de un à cinq.
Son visage s’éclaire. Elle joint les mains, et fervente :
— Que Dieu soit béni !
A PROPOS DE L'AUTEUR
Paul d'Ivoi est le nom de plume de Paul Deletre, né en 1856 et mort en 1915. Auteur de pièces de théâtre de boulevard, Paul d'Ivoi est surtout connu pour sa série
Les Cinq sous de Lavarède et pour la série des
Voyages excentriques, fortement influencée par
Les voyages extraordinaires de Jules Verne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage est proposé dans le cadre des ressources du Centre Rocambole accessible par Internet à l’adresse :
www.lerocambole.net
Edition électronique réalisée avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie
Bibliothèque du Rocambole
Œuvres de la Grande Guerre - 7
collection dirigée par Alfu
Paul d’Ivoi
Femmes et gosses héroïques (1914-1915)
1915
AARP — Centre Rocambole
Encrageédition
© 2013
ISBN 978-2-36058-912-8
Le tirailleur indigène
(dessin de Jonas paru dans La Guerre des nations)
Avertissement
de Philippe Nivet
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Picardie
Directeur du Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits
Pendant la Première Guerre mondiale, la diffusion de la culture de guerre passe par différents vecteurs : la presse enfantine, à l’image du journalFillette, la presse illustrée, commeL’IllustrationouLe Miroir, ou les estampes, à l’exemple de celles de Jean-Louis Forain.
Le roman populaire, souvent publié d’abord en feuilleton, participe également de cette diffusion.
Exemple notoire : dans L’Eclat d’obus, roman de Maurice Leblanc, initialement publié dans les colonnes du Journal en 47 feuilletons quotidiens à l’automne 1915, on trouve ainsi de multiples dénonciations de la « guerre à l’allemande », marquée par les violations du droit des gens : « Assassiner et espionner, c’est pour [les Allemands] des formes naturelles et permises de guerre, et d’une guerre qu’ils avaient commencée en pleine période de paix ». Guillaume II y est présenté comme « le plus grand criminel qui se pût imaginer », tandis que les actes commis par les soldats allemands lors de l’invasion y sont résumés de manière saisissante : « Partout, c’était la dévastation stupide et l’anéantissement irraisonné. Partout, l’incendie et le pillage, et la mort. Otages fusillés, femmes assassinées bêtement, pour le plaisir. Eglises, châteaux, maisons de riches et masures de pauvres, il ne restait plus rien. Les ruines elles-mêmes avaient été détruites et les cadavres torturés ».
Si son insertion, en 1923, dans la série des Arsène Lupin a donné à ce roman une audience particulière, les thématiques qu’il développe se retrouvent dans d’autres textes de Maurice Leblanc et dans ceux de la plupart des auteurs populaires du temps, depuis Gaston Leroux jusqu’à Delly, en passant par Jules Chancel ou les auteurs des brochures de la collection « Patrie », tel Gustave Le Rouge ou Léon Groc.
Encrage Edition et le Centre Rocambole (centre de ressources international fondé par l’Association des Amis du Roman Populaire) ont la judicieuse idée d’exhumer ces documents et de les republier dans cette période marquée par la célébration du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Le lecteur de ce début du XXIe siècle y verra comment étaient célébrés les soldats français, héroïques quels que soient leur âge et leur parcours antérieur, dénoncés les espions travaillant de longue date au profit de l’Allemagne et condamnées les atrocités de l’invasion. C’est toute une culture de guerre, assimilée par certains à un « bourrage de crâne », que l’on retrouve.
Préface
de Marie Palewska
Publié chez Flammarion en 1915, Femmes et gosses héroïques offre une autre facette du talent de Paul d’Ivoi, surtout connu jusque là pour ses romans d’aventures exotiques, avec en particulier la collection de ses « Voyages excentriques » (1894-1917).
Selon l’auteur lui-même, dans le préambule à ce recueil, l’heure ne se prête plus à des récits légers : en 1915, la guerre s’installe dans le quotidien des Français et elle le touche personnellement par la présence au front de son fils Henri-Paul Deleutre d’Ivoi. Ce sont donc des textes de circonstances, nourris du contexte de guerre, qu’il décide ici de livrer à des lecteurs adultes.
Trois caractéristiques générales s’en dégagent. La première est qu’ils mettent en avant deux catégories particulières de la population : les femmes et les enfants. Ce parti pris de Paul d’Ivoi est conforme à la place de choix qu’il octroie aux unes et aux autres dans l’ensemble de son œuvre. Cependant, dans des récits de guerre, ne pas privilégier le soldat mobilisé est original. La deuxième caractéristique de ces textes est que la plupart sont censés constituer un florilège de propos ou de lettres dont l’auteur se serait trouvé le témoin ou le confident, ce qui accentue à la fois leur apparence d’authenticité et leur charge émotionnelle. Enfin, troisième trait marquant, qui assure l’unité du recueil : c’est une lecture édifiante qu’il propose, les figures héroïques mises en scène se voulant des exemples à admirer, voire à imiter.
L’ouvrage s’organise en trois parties, que le découpage opéré dans cette édition met en lumière.
On y trouve d’abord une série de « Mots de guerre » précédemment publiés dans Le Matin les 30 octobre, 8 et 13 novembre 1914.
A l’époque, les « Mots », brefs traits d’esprit ou d’humour, alimentent souvent les rubriques des « Echos », récurrentes dans les journaux. Ils sont ici successivement mis dans la bouche de jeunes filles, puis d’épouses et de mères, et enfin d’enfants, chacun de ces trois groupes de l’arrière révélant une sensibilité et une vocation particulières. Les jeunes filles se montrent admiratives des soldats et dévouées aux blessés. Les épouses et les mères font preuve de solidarité dans l’épreuve et rappellent chacun à son devoir. Quant aux « Mots de guerre des gosses », ils manifestent combien la vie de tous est affectée, jusqu’aux plus jeunes, dont les jeux mêmes attestent le patriotisme, naïf mais attendrissant chez les plus petits, et déjà élan d’un cœur généreux.
Une seconde partie du livre regroupe quinze nouvelles qui toutes donnent la vedette à des femmes et dont quelques-unes sont des reprises de textes précédemment parus en 1901 dans le journal Le Français et modifiés pour être adaptés à la situation de guerre.
On y voit des Françaises se conduire avec héroïsme alors qu’elles se trouvent confrontées à toutes les souffrances possibles : frappées dans leurs enfants, tombés au front ou victimes civiles des Allemands (Une mère, La folle de Soissons), veuves (Le miracle de la fleurette tricolore), otages (La gosse alsacienne), atteintes dans leur intégrité physique (L’œil de verre) ou dans leur être moral (Veuves volontaires). « La valeur n’attend point le nombre des années » — « la gosse alsacienne » n’a que 13 ou 14 ans — et l’on rencontre des femmes admirables dans tous les milieux : une fermière (Une mère), des commerçantes (Veuves volontaires), une célèbre actrice de théâtre (Le tirailleur indigène), une jeune bourgeoise (L’œil de verre)… En des lieux variés — à l’arrière, dans les hôpitaux militaires, et jusque dans les tranchées (L’héritage) — chacune est amenée à donner le meilleur d’elle-même quels que soient son âge, sa condition ou ses convictions religieuses. L’héritage véhicule en particulier un idéal de charité chrétienne et de tolérance religieuse cher à l’auteur. Ce dernier s’applique aussi à varier l’origine géographique de ses héroïnes de façon signifiante. Les « provinces perdues » en 1871 se trouvent ainsi à l’honneur dans les deux nouvelles de La gosse alsacienne et Veuves volontaires. Deux autres histoires, particulièrement dramatiques, saluent le courage de martyres serbes et polonaises.
Face à ces victimes, la représentation de l’ennemi est sans nuances. Les Allemands — Teutons, Boches ou Schwobs — apparaissent systématiquement comme des barbares sans foi ni loi. Ce sont des traîtres qui, avant même le conflit, ont su s’introduire comme espions partout où les y engageaient leurs intérêts (Veuves volontaires). Ce thème de l’espion infiltré allemand s’est développé dans la littérature populaire de la première décennie du XXe siècle. On le trouve déjà alors chez Paul d’Ivoi, par exemple dans La Patrie en danger !, écrit avec le colonel Royet et publié en 1904-05. Mais il y a bien pire. L’ennemi de Femmes et gosses héroïques est grossier, soudard, cruel. « Traités, frontières, humanité, honneur sont pour lui des mots vides de sens. » (La gosse alsacienne) Il n’a ni parole (Une Serbe), ni respect des frontières (La gosse alsacienne) et se livre aux pires atrocités — froides exécutions, tortures de vieillards ou d’enfants, mutilations, viols…
La femme allemande se montre bien digne de ses compatriotes masculins. Trois histoires, aux titres maniant l’antiphrase — « Premier », « Deuxième » et « Troisième héroïsme teuton » — opposent des contre-exemples à l’idéal féminin prôné ailleurs. Pleins d’ironie, ces trois récits satiriques campent des personnages aux antipodes de la Française, la jeune fille pure et charitable, la bonne épouse et la bonne mère. Débauchée, infidèle, égoïste, coquette sans cervelle et sans cœur, l’Allemande a bien plutôt pour devise : « Aimante ne puis, maman ne daigne, poupée je suis, et poupée de Nuremberg » (Une héroïque Saxonne). Une telle caricature est là pour manifester que le véritable héroïsme ne peut être l’apanage que des femmes françaises, ou de leurs sœurs serbes et polonaises, qui souvent même en remontrent aux hommes (La gosse alsacienne).
Alliance latine, la dernière de ces quinze histoires, relatant la mésaventure d’un Français aux prises avec la Maffia argentine, tranche avec celles qui précèdent. Il s’agit en effet d’un « récit d’avant-guerre », déjà publié dans le Journal des voyages, sous le titre Un maffioso de La Plata, du 3 au 24 novembre 1901. Une modification significative intervient dans sa reprise : le chef de la Maffia n’est plus un certain Jose Antaclista — dont le nom subsiste une fois par erreur dans le texte d’Alliance latine — mais l’allemand Hermann Flush. La fin est aussi adaptée aux circonstances avec la mobilisation du héros français en 1914 et le parallèle fait entre le couple qu’il forme avec sa femme italienne, qui l’a aidé contre Flush, et l’alliance pleine de promesses des nations France et Italie dans la guerre contre l’Allemagne.
Enfin, dans une troisième partie, Paul d’Ivoi met dans la bouche d’un Gavroche générique, frère de tous les titis parisiens et ketjes belges, une série d’observations et d’anecdotes, sous la forme de lettres destinées à montrer la mentalité des gamins de Paris dans le contexte de la guerre. L’identité du narrateur permet d’allier argot pittoresque et esprit frondeur. Et par son entremise l’auteur peut glisser quelques réflexions personnelles qu’il tient à publier. Gavroche poursuit le salut adressé aux alliés de la France dans les nouvelles Christmas et Alliance latine, où intervenaient un Anglais généreux et une Italienne énergique. Avec lui, on rencontre des Belges (La Belge), et non des moindres (La reine Elisabeth). On le voit aussi s’enthousiasmer pour Joffre ou Clemenceau et dépeindre le kaiser comme un mégalomane fou que sauront tourmenter les hallucinations du remords. Mais il ne se prive pas non plus d’émettre diverses critiques de ses compatriotes, concernant par exemple les affectations de soldats loin du territoire qu’ils connaissent, ou le refus de certains propriétaires de participer à l’effort général en acceptant une baisse des loyers.
Le livre s’achève sur la peu glorieuse figure d’un Marseillais dont la « blessure de guerre » rappelle une galéjade du héros Massiliague de Marseille des « Voyages excentriques ». Le ridicule du personnage qui suscite la moquerie, autant que l’indignation, fait se terminer l’ouvrage sur une note plus enjouée.
Dans la variété de son contenu, Femmes et gosses héroïques révèle bien le talent de nouvelliste de Paul d’Ivoi, avec des récits tantôt dramatiques et poignants, tantôt pleins d’esprit et d’une ironie savoureuse. Parmi les plus réussis, relevons Le tirailleur indigène, hommage aux troupes coloniales engagées dans la guerre, précédemment paru dans le numéro 3, du 1er mars 1915, de La Guerre des nations, et l’émouvant Polonaises ! Mais ce recueil est aussi intéressant par tout ce qu’il montre des mentalités, des épreuves et des problèmes des Français dans les années 1914 et 1915.
Paul d’Ivoi donne également en ce temps de guerre un nouveau roman d’espionnage au journal L’Information politique, économique et financière : La Route du 75. On y retrouve au cœur du conflit de 1914-1915 le reporter rencontré sous un autre nom dans la trilogie des aventures de L’Espion X 323 (Méricant, 1909 et 1912), précédemment reprise dans L’Information sous le titre Z 212. La Route du 75 paraît à partir du 4 juin 1915. Mais Paul d’Ivoi meurt le 6 septembre qui suit, laissant à une autre plume le soin de l’achever.
Femmes et gosses héroïques est sa dernière œuvre publiée en volume de son vivant. Le destin lui aura épargné la douleur d’apprendre la mort de son fils, un an après lui, jour pour jour, tombé capitaine dans la Somme, à Berny-en-Santerre, le 6 septembre 1916. Plusieurs fois cité à l’ordre de l’armée, Henri-Paul d’Ivoi est dit avoir entraîné ses hommes aux cris de « Vive la France ! »
C’est bien un même idéal patriotique qui réunit le père et le fils, par la plume ou par les armes. La guerre les vit disparaître l’un et l’autre. Peut-être l’épouse et la fille de Paul d’Ivoi purent-elles alors puiser elles-mêmes un réconfort dans le modèle de cesFemmes et gosses héroïques…
Deux mots de préambule
En ces années 1914 et 1915, alors que dans le formidable creuset de la guerre, s’élabore une humanité nouvelle, il m’eût semblé irrespectueux d’imaginer des historiettes ainsi qu’aux jours de paix.
Gloires, triomphes, deuils, héroïsmes sont des réalités tragiques. Mon unique ambition est d’apporter la petite part de vérité qu’il m’a été donné de voir et d’entendre.
Pauld’Ivoi.
Première Partie
Mots de guerre
Mots de guerre des jeunes filles
Les historiens nous content que les femmes gauloises suivaient les guerriers au combat, exaltant le courage des braves et flagellant les timides. Quelques mois de lutte ont fait renaître chez les femmes de France la mentalité héroïque de leurs aïeules. Voici quelques « mots de guerre » jaillis de lèvres de jeunes filles, et que j’ai pieusement notés.
* * *
Lineke (diminutif affectueux d’Aline) est toute blonde et toute rose. Elle a grandi dans la Flandre catholique. Sa petite âme simplette et pure réprouvait naturellement la violence. Elle ne concevait que pardon, excuse, miséricorde, même pour les pires coupables.
Je la rencontre. Est-ce pour la taquiner ? Peut-être ; mais je lui dis :
— Vous avez lu… à tel endroit… cette hécatombe d’Allemands ?
Ses paupières palpitent. Elle pâlit un peu en murmurant :
—Et des nôtres ?
—Oh ! beaucoup moins. La proportion est de un à cinq.
Son visage s’éclaire. Elle joint les mains, et fervente :
—Que Dieu soit béni !
* * *
Me voici sur le quai de la gare d’évacuation d’A***. Un train de blessés vient de passer ; un autre est signalé. Durant l’attente, j’écoute deux jeunes filles affiliées à une société de secours, attachées à cette dure besogne que l’on dénomme : « service des trains ».
Je les ai remarquées un instant plus tôt, distribuant vivres, cigarettes, chocolat, sucre, etc., aux dolents voyageurs des trains sanitaires, avec le tact de braves fillettes de France : le nécessaire aux blessés allemands ; les gâteries aux nôtres. Maintenant elles causent :
—Oh ! cette Mme Z*** Quelle ridicule coquetterie ! Etre infirmière de la Croix-Rouge et porter aux oreilles des diamants comme des bouchons de carafe !
—Naïve, va ! C’est pour dissimuler les oreilles du roi Midas.
—Elle les a si longues que ça ? Je n’ai pas remarqué.
—Personne ne remarque. On ne voit que les diamants.
Le convoi annoncé entre en gare. Les gentilles « servantes des trains » courent à leur devoir. Soudain, un cri. L’une a reconnu son fiancé, la tête enveloppée de linges. L’éclat d’un shrapnell lui a labouré la joue, traversé la mâchoire.
Le train repart. L’amie enlace sa compagne qui regarde dans le vague, droit devant elle. Consolatrice, elle prononce doucement :
—Sois courageuse, ma pauvre chérie. Peut-être, il ne sera pas défiguré.
La fiancée secoue les épaules, et redressée en une fierté soudaine :
—Défiguré ! Il aura la médaille victorieuse de 1914-1915 ; on ne verra qu’elle. Cela vaut bien un diamant.
* * *
Sur mon bureau, je trouve la lettre d’une autre fiancée. Comment y est-elle venue ? Ceci importe peu ; on sait ma dévotion à Mme de Sévigné et au genre épistolaire, voilà tout.
Le futur de la signataire s’est « embusqué » comme conducteur de son auto 24 H.P.
Ancien élève cancre, citoyen très médiocre, il a craint sans doute d’être mauvais soldat.
Bref, il fut embusqué. En brillant uniforme, on le vit continuellement rouler en quatrième vitesse. Toute affaire cessante, il volait sans trêve… nulle part.
Or, revanche d’une immanente justice, cette course effrénée vers des buts inutiles a failli le mener à la mort.
L’auto a faitpanache(ironie cruelle pour un garçon qui en a si peu). Résultat : bassin fracturé, une jambe brisée.
Un coup moral devait s’ajouter à ce dégât matériel. Celle dont l’éclopé briguait la main lui adressa le joli billet dont je transcris cet extrait :
« Monsieur Albert,
Je fais, croyez-le, des vœux sincères pour votre prompt rétablissement ; mais je ne puis me tenir de vous féliciter. Une blessure de temps de guerre est presque une blessure de guerre. Etc., etc. »
Je crois que le mariage ne se fera pas.
* * *
Aux Champs-Elysées, près du Palais de Glace, où elles fréquentaient peut-être autrefois, d’élégantes jeunes personnes stationnent. Que disent-elles ?
—Aucune lettre de mon frère qui est là-bas !
—Et nous donc ! Rien de mes deux frères, ni de mon cousin. A la maison, nous sommes folles d’inquiétude !
Une nouvelle venue se mêle au groupe. Son arrivée motive cet appel de tendre et inconsciente solidarité :
—Voici Laure. Laure, remonte-nous un peu, toi qui n’as personne au feu.
L’interpellée les regarde. Elle a un sourire mélancolique, puis d’un ton très simple :
—C’était injuste, aussi, j’y vais moi-même, ou du moins le plus près possible.
—Toi-même ?
—Oui, mon tuteur, le major L***, m’admet à l’hôpital temporaire de *** (le nom d’une localité de l’Aisne). Je pars demain.
Et toutes, oublieuses de l’angoisse, s’embrassent avec effusion.
* * *
Rue des Martyrs à présent. Deux fillettes, arpètes en chômage forcé, ascensionnent vers Montmartre.
—Tu parles, explique l’une avec cet inimitable accent de Paris, un blessé, envoyé en convalescence : pas le rond et pas de train pour son patelin avant ce matin. Je ne pouvais pas le laisser en chandelle dans la rue.
—Bien sûr, seulement…
—Quoi ? Je l’ai monté chez nous. M’man lui a dit : « Repose-toi, mon gars. Colle-toi dans le plumard. Nous, on va à l’hôtel. » Et on s’est débiné dare-dare pour qu’il ne s’égosille pas à remercier.
La compagne de la narratrice marque un geste admiratif :
—C’est bath ! Mais l’hôtel par le temps qui court…
—T’es bête. L’hôtel… une frime ! On ne travaille pas, c’est pas l’instant de refiler quarante sous au logeur !
—Alors ?
—Alors ? La mère et moi on a dormi dans l’escalier… comme des reines !
Tu as raison, petite arpète, tu es une reine… de cœur.
Mots de guerre des mères et des épouses
Les jeunes filles méritent l’hommage que vous leur avez rendu, m’écrit-on ; mais ne croyez-vous pas les femmes, mères ou épouses, aussi dévotieusement françaises ? Transcrire leurs paroles est la meilleure réponse à la question.
* * *
A cette heure de souffrance commune, les Français se sentent tous d’une même famille. Cela se traduit par un respect plus accentué pour les femmes, les jeunes filles, nos sœurs. Quelques sots pourtant demeurent fidèles à l’inconvenance et se signalent ainsi au mépris public.
Un de ces malappris croise, rue de Passy, une jeune femme jolie, discrète, élégante, dont le visage mélancolique dit la pensée inquiète. Il murmure une lourde galanterie.
Elle s’arrête net. Ses yeux clairs se fixent sur ceux du faquin. D’un grand geste elle embrasse l’horizon du nord à l’est, et lance ces seuls mots :
— Au front !
C’est un ordre, une flétrissure. L’homme demeure stupide. L’énoncé de l’unique et saint devoir l’a étourdi.
* * *
Avenue de Villiers, plusieurs dames se réunissent tous les mardis. Elles parlent des « aimés » qui combattent. Elles échangent du courage.
Mardi dernier, Mme V***, retour de province, pénètre dans le petit cercle. On s’enquiert de son fils, vigoureux sportsman de vingt-trois ans.
— Oh ! répond-elle avec l’inconscience de la honte qui s’attache aux préoccupations égoïstes, je l’ai fait admettre comme secrétaire d’administration. Comme cela, le pauvre chéri n’ira pas à la boucherie.
On imagine le « froid ». Pour réchauffer l’atmosphère, l’une des personnes présentes s’adresse à la maîtresse de maison :
—Chère amie, avez-vous des nouvelles de votre fils ?
—Henri m’a adressé, hier, une lettre pleine de cœur.
—En vérité, s’exclame la mère du secrétaire d’administration. Serait-il indiscret de vous prier de nous en donner lecture ?
L’interpellée riposte aussitôt :
—Très indiscret, chère madame, les lettres de mon fils sontpour lire entre Françaises.
* * *
Trente-huit ans, en paraissant cinquante (son mari l’a quittée depuis un an pour suivre une rivale), la pauvre femme vient d’apprendre par hasard que l’infidèle, blessé au feu, est soigné à l’ambulance n° ***.
Elle y court. Voici la salle où s’alignent les lits de souffrance. De suite, elle a distingué le sien. Il occupe le lit n°7. A son chevet est assise une infirmière à la longue blouse blanche.
La délaissée s’approche. Mais le blessé pousse une exclamation. L’infirmière lève la tête. La femme ferme un instant les yeux comme étourdie.
Elle a reconnu celle qui lui a volé son mari.
Mais une infirmière-major a suivi la scène. Elle vient à l’abandonnée :
—Il a été soigné par la personne que vous voyez là… Il lui doit la vie.
—Ah !
C’est un soupir qui fuse entre les lèvres de l’épouse. Brusquement elle tend une main à la rivale, l’autre au blessé ; avec un regard qui renonce, qui pardonne, elle murmure :
—Quand on se regarderait en chiens de faïence… Tu l’as emmené… tu l’as sauvé… ça va comme ça.
* * *
Dans un cimetière parisien.
Un jardinet entouré d’une balustrade de fer ; une croix étendant ses bras éplorés sur la tombe. Fixée à la croix, une couronne porte cette inscription tragique :
Amon mari, tué à l’ennemi.
Toute noire en ses vêtements de deuil, une jeune femme songe douloureusement, les mains crispées sur la grille.
Elle n’entend pas approcher une seconde visiteuse. Celle-ci la considère avec surprise, puis :
—Pardon, madame, je ne vous reconnais pas.
L’interpellée tressaille. Elle tourne vers la nouvelle venue un sourire navré. Cependant elle rectifie :
—Vous ne meconnaissezpas… non…
Elle désigne la couronne :
—J’ai lu votre peine… Lemienest tombé en Lorraine, je ne sais pas où… J’ai prié sur la tombe d’un frère d’armes, à défaut d’une tombe à moi.
—Votre mari aussi ? soupire la veuve.
Son interlocutrice a une hésitation visible, puis d’un accent volontaire :
—Je ne veux pas mentir ici… Nous n’étions pas mariés.
Elle achève, la voix brisée :
—Mais, vous savez, l’écharpe du maire n’aurait pas ajouté du crêpe.
Les mains des endeuillées s’unissent. Elles s’inclinent ensemble sur la tombe qui, suprême charité, devient l’autel commun de leur double douleur !
* * *
L’autre charité.
C’est à la mairie du dix-huitième.
Une jeune ouvrière, tirant après elle une fillette de deux ou trois ans, est en face de l’employé aux « allocations aux familles de mobilisés ».
— Vous n’avez droit à rien, ma pauvre petite. La loi est formelle. Pas mariée, pas de certificat établissant la vie commune, pas d’allocation !
—Alors, quoi, avec ma gosse, faut mourir de faim ?
L’employé marque un geste apitoyé, mais que pourrait-il ?
—Viens-t’en avec moi.
C’est une voix enrouée, mais bonne, qui vient de prononcer ces mots.
C’est une autre mère accompagnée d’un bambin à peine plus âgé que la fillette. Elle reprend :
—Viens-t’en, que j’te dis. J’ai passé à la mairie, moi. Alors, avec le lardon, je palpe trente-cinq sous. Viens-t’en. Avec du pain et des pommes de terre, y en aura pour quatre.
* * *
Plusieurs personnes, par des lettres fort courtoises d’ailleurs, croient devoir m’affirmer que tous les conducteurs d’automobiles militaires ne sont pas des embusqués.
Qu’elles se rassurent. Jamais il n’a pu entrer dans mon esprit d’attribuer à la généralité des automobilistes qui accomplit vaillamment son devoir, la turpitude de quelques exceptions. Quand un conseil de guerre condamne un déserteur ou un lâche, il ne vient à la pensée d’aucun homme raisonnable que les soldats de la même arme en soient déshonorés.