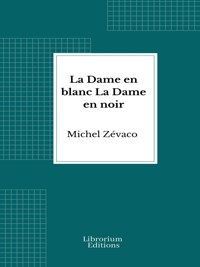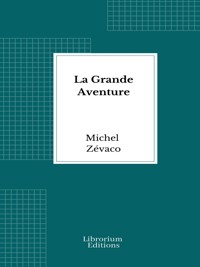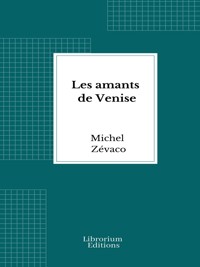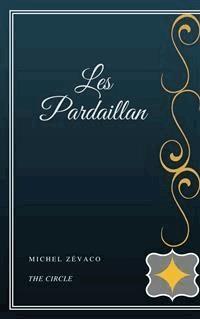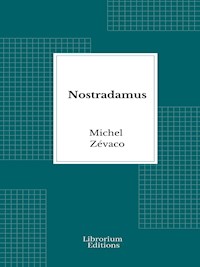0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La Réforme est inséparable de la Renaissance ; elle fut une révolution à la fois politique et religieuse. Prêchée en France par Calvin dès 1534, la Réforme provoqua, entre catholiques et protestants, une longue série de guerres.
Déjà sous François Ier et Henri II, des persécutions avaient été dirigées contre les non-catholiques : extermination des Vaudois, supplices d’Étienne Dolet et d’Anne du Bourg.
Mais, sous François II, la lutte ouverte éclata. Marié à Marie Stuart, nièce de François de Guise et du cardinal de Lorraine, François II est peu aimé de sa mère, Catherine de Médicis. Elle lui préfère son fils cadet, Henri – futur Henri III. À tout prix, elle veut écarter François II du trône et, pour servir ses sombres desseins, la reine mère n’hésite pas à s’entourer de bretteurs sans scrupules, dont le baron de Rospignac est le chef.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michel Zévaco
Fiorinda-la-Belle
1926
© 2021 Librorium Editions
ISBN : 9782383830726
I
Les fiançailles de Ferrière et de Fiorinda
La Réforme est inséparable de la Renaissance ; elle fut une révolution à la fois politique et religieuse. Prêchée en France par Calvin dès 1534, la Réforme provoqua, entre catholiques et protestants, une longue série de guerres.
Déjà sous François Ier et Henri II, des persécutions avaient été dirigées contre les non-catholiques : extermination des Vaudois, supplices d’Étienne Dolet et d’Anne du Bourg.
Mais, sous François II, la lutte ouverte éclata. Marié à Marie Stuart, nièce de François de Guise et du cardinal de Lorraine, François II est peu aimé de sa mère, Catherine de Médicis. Elle lui préfère son fils cadet, Henri – futur Henri III. À tout prix, elle veut écarter François II du trône et, pour servir ses sombres desseins, la reine mère n’hésite pas à s’entourer de bretteurs sans scrupules, dont le baron de Rospignac est le chef.
Dans ces sombres conjonctures de guerre civile, François II se lie d’amitié avec le chevalier de Beaurevers et le vicomte de Ferrière. Ils mettent leur courage et leur épée au service du roi, jeune et inexpérimenté, pour protéger sa vie, menacée par les entreprises criminelles de Catherine II et de sa clique.
C’est au cours d’une mission que le vicomte de Ferrière rencontre par hasard Fiorinda-la-Belle, diseuse de bonne aventure. Il s’éprend d’elle, mais sa passion ne lui fait pas oublier le devoir qu’il s’est tracé : protéger la vie du roi ; celui-ci partage les dangers de ses amis, affublé sous un nom d’emprunt : le comte de Louvre.
La reine mère Catherine II est rapidement mise au courant par Rospignac de l’amitié qui unit son fils au chevalier de Beaurevers, au vicomte de Ferrière et à leurs amis : Trinquemaille, Strapafar, Corpodibale et Bouracan. Elle voue à ses adversaires une haine farouche, mais les deux gentilshommes veillent et se tiennent sur leurs gardes. Pourtant, l’image de celles qu’ils aiment – le chevalier de Beaurevers est fiancé à Mlle Florise de Roncherolles – ne quitte pas leurs pensées. Le vicomte de Ferrière, qui n’avait pas revu Fiorinda depuis plusieurs jours, se décide à aller la voir.
Ce jour-là, Ferrière sortit de chez lui vers onze heures du matin. Il avait vainement attendu jusque-là la visite promise de Beaurevers. Il se rendait bien compte qu’il était encore de bonne heure, qu’il aurait pu attendre encore un peu, mais l’impatience le rongeait. Et il était parti.
Il jouait de malheur décidément : il ne trouva pas Fiorinda. La maison de la rue des Marais, où il alla tout d’abord, n’était plus qu’un amas de décombres.
Ce ne fut que tard, dans la soirée, que, sur une indication un peu plus précise, il finit par la trouver dans les environs de la croix du Trahoir.
« Je vous cherchais, Fiorinda... Je vous cherche depuis ce matin, onze heures. »
Elle s’inquiéta :
« Jésus Dieu ! serait-il arrivé malheur à M. de Beaurevers ou à M. de Louvre ? »
Il la rassura d’un signe de tête et, tout à son idée, il déclara sans plus tarder :
« Il faut que vous sachiez que je vous aime. Ne protestez pas... Ne me fuyez pas... Je vous en prie. Je n’ai rien oublié de ce que vous m’avez dit sous l’orme de Saint-Gervais... Et si je vous dis que je vous aime, Fiorinda, je vous aime depuis la première seconde où vous êtes apparue dans ma vie ; si je vous dis cela, c’est que je veux ajouter ceci : Fiorinda, voulez-vous faire de moi le gentilhomme le plus heureux de ce monde en consentant à devenir ma femme ? Dites, le voulez-vous ?... »
C’était l’amour pur, vibrant de sincérité, qui s’exprimait ainsi.
Fiorinda le vit et le comprit bien ainsi. Et ce fut comme un flot de lumière vivifiante qui pénétrait en elle. En même temps elle vit aussi avec quelle inexprimable angoisse il attendait sa réponse. Et elle dit simplement :
« Oui, monseigneur. »
Il respira fortement comme un homme trop longtemps oppressé. Il se courba sur la main qu’elle lui tendait dans un geste charmant d’abandon spontané, et déposa un baiser d’adoration fervente sur les doigts fuselés.
Il retint doucement cette main entre les siennes et glissa au doigt un cercle d’or très simple, serti d’une perle du plus pur orient : l’anneau des fiançailles. Et il dit d’une voix profonde, infiniment douce :
« C’était l’anneau de fiançailles de madame ma mère... Acceptez-le comme un gage d’amour ardent et fidèle jusqu’à la mort. »
Elle considéra un instant l’anneau symbolique avec des yeux embués de larmes. Elle leva lentement la main jusqu’à sa bouche et posa ses lèvres sur la perle dans un baiser de dévotion émue. Et se courbant devant Ferrière, d’une voix grave, changée, une voix harmonieuse si douce, si prenante qu’elle le remua jusqu’au fond des entrailles, elle prononça, comme on profère un serment solennel :
« Fidèle jusque par-delà la tombe, telle est ma devise, monseigneur, à laquelle je ne faillirai pas, je vous le jure. »
Et c’est ainsi que, par une belle soirée de mai, au milieu des rumeurs de la rue agitée, sous la croix du Trahoir qui étendait au-dessus d’eux ses longs bras qui semblaient bénir après avoir enregistré le serment de fidélité, ce fut ainsi que se fiancèrent très haut et très noble vicomte de Ferrière, futur comte de Chambly, baron de Follembray, seigneur d’une foule d’autres lieux, et Fiorinda, diseuse de bonne aventure, pauvre fille du peuple, sans nom, sans titres, sans fortune.
Ils se prirent la main et côte à côte, lentement, ils se perdirent au hasard dans le dédale des petites rues qui avoisinaient les Halles et sur lesquelles s’étendait peu à peu le voile de la nuit qui tombait.
Ce fut une longue heure de rêverie heureuse qui leur parut brève comme une seconde.
Et ce fut Ferrière qui le premier revint au sentiment de la réalité.
« La nuit tombe, dit-il, les rues ne sont pas sûres. Cette agitation populaire, que vous avez pu remarquer et qui a duré une bonne partie de la journée, semble s’être apaisée, mais je ne m’y fie point. Il faut rentrer. J’ai maintenant pour devoir de veiller sur vous. Devoir précieux et bien doux. Souffrez donc, mon joli cœur, que je vous accompagne jusqu’à la porte de votre logis.
– Je n’ai plus de logis, fit-elle en souriant tendrement, j’ai dû accepter l’hospitalité que m’offrit ma belle et bonne Myrta, la sœur de M. de Beaurevers. C’est donc à la petite maison des Petits-Champs que je demeure, en attendant d’avoir trouvé un autre logis.
– En attendant le jour où vous entrerez tête haute dans la maison de votre époux, où vous serez souveraine maîtresse. Dès ce soir avant de me coucher, je parlerai à monsieur mon père et lui demanderai de vouloir bien bénir notre union. »
Aussi naturellement, elle répondit :
« Je vous attendrai ici, dans cette maison amie. La fiancée du vicomte de Ferrière ne saurait plus courir les rues en disant la bonne aventure. Allez, monseigneur, vous avez tout Paris à traverser et mieux vaut le faire avant que la nuit ne soit complètement venue. Dieu vous garde. »
Elle lui tendit le front. Il posa ses lèvres brûlantes sur les fins cheveux, d’un beau châtain foncé, ondulés naturellement, en disant :
« À demain, mon cœur.
– À demain, mon seigneur et mon maître. »
Il partit brusquement. Fiorinda, sans s’en rendre compte, s’était avancée de quelques pas au milieu de la chaussée, afin de le voir plus longtemps. Elle soupira, extasiée :
« Ce n’est pourtant pas un rêve ! »
À ce moment, répondant à ces paroles qu’elle avait prononcées tout haut, une voix à la fois railleuse et menaçante gronda à son oreille :
« Il y a loin de la coupe aux lèvres ! »
Elle se retourna tout d’une pièce, et elle reconnut, penché sur elle, le masque grimaçant, avec ses yeux où luisait la flamme du désir, du baron de Rospignac.
Elle jeta les yeux autour d’elle et elle se vit encadrée par quatre individus armés jusqu’aux dents, immobiles comme des statues de marbre.
Rospignac n’ajouta pas un mot. Il fit un signe.
Elle se vit prise, soulevée à bout de bras. Elle n’essaya pas de résister. Elle cria. Elle appela de toutes ses forces :
« À moi !... Ferrière !... Beaurevers !... À moi !...
– Le bâillon, drôles ! » commanda la voix rude de Rospignac.
L’ordre fut exécuté avec une promptitude qui tenait du prodige.
Leur précieux fardeau sur l’épaule, les quatre sinistres porteurs s’éloignèrent vivement. Ils s’avancèrent ainsi dans la direction de la rue Coquillère. Rospignac marchait silencieusement à côté d’eux. Une litière, dissimulée dans un renfoncement, attendait à une vingtaine de toises de là. Quelques enjambées suffirent pour les amener jusqu’au véhicule.
Fiorinda fut doucement étendue sur les coussins de la litière, dont les mantelets étaient rabattus.
« Allez ! », ordonna Rospignac.
Et la lourde machine s’ébranla, conduite en main par un palefrenier, escortée par les quatre porteurs.
Cet enlèvement s’était accompli avec une incroyable rapidité. Depuis l’instant où Rospignac était apparu à Fiorinda, stupéfaite mais non effrayée, jusqu’au moment où, la litière s’étant éloignée, il fit demi-tour et s’enfonça dans la nuit, une minute tout au plus s’était écoulée.
Cette minute venait à peine de finir, Rospignac venait à peine de disparaître, lorsque la porte de la petite maison de la rue des Petits-Champs s’ouvrit brusquement. Un homme bondit dans la rue. C’était Beaurevers. Sur le seuil de la porte demeurée ouverte, deux hommes, deux colosses, dagues et rapières aux poings, se tenaient immobiles.
Beaurevers avait bondi dans la rue. Il parut tout étonné de n’y trouver personne. Il inspecta les environs immédiats de la porte.
« C’est étrange, se dit-il en lui-même, il m’avait pourtant bien semblé avoir entendu mon nom. »
Il revint à la porte. Les deux colosses armés n’avaient pas bougé.
« Je me serai trompé », leur dit-il d’un air soucieux. Et sur le ton bref du commandement :
« Faites bonne garde. Faites en sorte de ne pas laisser se morfondre dehors cette jeune fille quand elle viendra heurter à l’huis. Et veillez sur elle comme sur ma propre sœur. Bonsoir. Fermez tout. »
Sur cette dernière recommandation, et pendant que les deux colosses obéissaient passivement, il s’éloigna à grandes enjambées. En marchant, il grommelait :
« C’est tout de même extraordinaire et inquiétant que cette petite Fiorinda ne soit pas encore rentrée !... Après cela, c’est une fille si étrange, si éprise de son indépendance !... Peut-être s’est-elle sentie en cage dans cette maison et a-t-elle cherché un nid plus à sa convenance... Si ce n’était que cela !... Mais c’est qu’il m’a bien semblé reconnaître sa voix !... Au diable ! J’ai d’autres chiens à fouetter pour le quart d’heure et je n’ai que trop perdu de temps déjà ! Il sera temps, demain, de m’occuper de Fiorinda. »
II
Au Louvre
Raide dans son fauteuil, Catherine, livide, les lèvres pincées, sans un mot, sans un geste, fixait Rospignac, venu pour rendre compte, qui s’inclinait devant elle. Et sous la menace de ce regard de feu, le baron sentait un frisson d’épouvante l’étreindre à la nuque.
« Eh ! madame, avant de me poignarder du regard comme vous le faites, il serait juste de savoir d’abord si je suis coupable !... L’affaire a échoué, c’est certain. Il n’y a point de ma faute, c’est non moins certain.
– Expliquez-vous.
– Tout le mal vient de MM. de Guise, qui se sont avisés de venir déranger les dispositions que j’avais prises, que vous connaissez et que vous aviez approuvées, madame.
– C’est bien, dit-elle froidement, faites votre rapport. »
Rospignac comprit qu’il avait réussi à tirer son épingle du jeu. Malgré son calme apparent, il se sentit soulagé du poids énorme qui l’oppressait. Il fit le rapport qu’on lui demandait. Il le fit rigoureusement exact dans ses plus petits détails. Seulement, il mit bien en évidence la faute commise par les Guises en retardant par des questions oiseuses la marche des troupes qui étaient ainsi arrivées trop tard.
Quand il eut terminé, Catherine garda un instant le silence. Rospignac, dans une attitude respectueuse, l’observait du coin de l’œil, cherchant à lire sur son visage l’effet produit par ses paroles, et à deviner ses intentions. Peine parfaitement inutile d’ailleurs, car aucun visage humain ne savait se montrer plus indéchiffrable que celui de Catherine.
Comme si de rien n’était, elle prononça enfin :
« C’est ce soir, je crois, que MM. de Guise doivent avoir un entretien secret avec M. le vidame de Saint-Germain ?
– Oui, madame.
– Vous serez là ?
– Oui, madame.
– Bien. Vous viendrez me rendre compte demain matin. Je vais réfléchir... Demain, peut-être, je pourrai vous donner de nouvelles instructions. Allez. »
Rospignac s’inclina profondément et se dirigea vers la porte en se disant :
« Elle n’est pas contente... Mais elle n’a rien à me reprocher... et c’est l’essentiel pour moi. »
Comme il atteignait la porte, elle l’arrêta en disant :
« À propos, il faut connaître le nom de la personne qui a fourni à Beaurevers le moyen de descendre de la maison incendiée.
– J’y pensais, madame.
– Oui, mais il faut trouver... et trouver vite... Ne serait-ce pas des fois le vicomte de Ferrière ? »
En disant ces mots, elle le fouillait de son regard aigu. Il ne sourcilla pas. Et ce fut d’un air très naturel qu’il répondit :
« Cette idée m’est venue à moi aussi. Ferrière et Beaurevers, depuis quelque temps, sont devenus inséparables.
– Eh bien, il faut vous en assurer.
– Ce sera fait, madame.
– Ce n’est pas tout : il faut me trouver et m’amener cette jeune fille, cette diseuse de bonne aventure, cette Fiorinda, puisque c’est ainsi qu’elle se fait appeler. Il me la faut aujourd’hui même. »
Il sortit. Il exultait. Il était bien résolu à obéir et à s’emparer de Fiorinda le jour même.
Il eût été moins décidé, et surtout moins pressé, s’il avait connu le rôle joué par la jeune fille dans cette aventure. Et la joie qui le soulevait eût fait place séance tenante à l’inquiétude la plus vive s’il avait su que Catherine, elle, était au courant.
Mais Rospignac ignorait encore ces détails. Et c’est pourquoi, s’en tenant à la promesse de Catherine, il nageait dans la joie et prenait ses dispositions pour exécuter au plus vite l’ordre qu’elle lui avait donné.
Quant à Catherine, après le départ de Rospignac, elle se leva et se dirigea d’un pas lent et majestueux vers les appartements du roi où elle entra d’autorité.
Seule la reine mère pouvait se permettre d’entrer de cette manière. À cet instant, François était en compagnie de la reine Marie Stuart. Ils n’eurent donc pas besoin de se retourner pour savoir qui venait les déranger. Comme deux enfants qu’ils étaient, ils s’écartèrent vivement l’un de l’autre et prirent une attitude cérémonieuse, conforme au cérémonial.
« Vous filez le parfait amour, François, c’est fort bien. Mais, vrai Dieu, il y a temps pour tout cependant. Et il faut convenir que vous choisissez bien mal ce temps. Quoi ! les événements les plus graves se déroulent autour de vous et vous n’en avez cure !
– Eh ! madame, s’écria François impatienté, que se passe-t-il donc de si grave, selon vous ?
– Se peut-il que vous ne sachiez rien ! Heureusement que je suis là et que je veille, moi ! »
Elle le prit par la main et l’entraîna vers une fenêtre qu’elle ouvrit d’un geste brusque et tendant la main :
« Tenez, dit-elle, regardez, écoutez.
– Je vois, dit François sans s’émouvoir, je vois des bandes de vile populace, qui semblent échappées de la Cour des Miracles, parcourir les rues armées de bâtons. J’entends que ces truands – car ce sont là de vulgaires truands, madame, qui n’ont rien de commun avec mon peuple que je connais et qui est un brave peuple – je les entends, dis-je, hurler : « Mort aux huguenots !... » Je ne vois pas qu’il y ait là de quoi s’émouvoir. »
Ceci dit avec le plus grand flegme, François ferma lui-même la fenêtre et revint s’asseoir le plus tranquillement du monde.
« Quand vous entendrez ce peuple tourner ses menaces et ses hurlements contre vous, peut-être alors vous émouvrez-vous. Fasse le Ciel qu’il ne soit pas trop tard !
– Alors, j’enverrai contre eux une compagnie de mes gardes. On se saisira de ceux qui brailleront le plus fort, on les pendra sans autre forme de procès aux différents carrefours... et je vous réponds que tout rentrera dans l’ordre. »
« Oh ! rugit Catherine dans son esprit, ceci n’est pas de toi !... Ceci t’a été soufflé par ce misérable aventurier, par ce Beaurevers de malheur !... Mais il ne sera pas dit que je m’avouerai vaincue sans avoir lutté jusqu’au bout !... »
« Mon fils, si vous ne vous teniez pas éloigné des affaires comme vous le faites, vous comprendriez que la situation est grave et mérite toute votre attention. Souffrez que votre mère qui, heureusement pour vous, se tient au courant, elle, vous fasse part de ce qu’elle sait.
– Mais, madame, je ne demande pas mieux que de m’instruire. Parlez donc, je vous écoute avec la plus grande attention.
– Nous sommes en présence d’un vaste complot ourdi de longue main par les réformés que le populaire appelle huguenots. Leur but ? Rejeter l’autorité royale, se séparer du reste de la nation, ériger un État distinct dans l’État. Et, comme leur élément est essentiellement guerrier, absorber ensuite par la force l’État dont ils seront séparés, l’asservir, devenir les maîtres absolus du royaume. Ce qui revient à dire que vous seriez dépossédé de vos États, renversé et probablement occis.
– Voyez-vous cela ?... Je m’étais laissé dire que les réformés demandaient tout simplement le droit de prier Dieu à leur manière. Et bien que cette manière ne soit pas la nôtre, je ne vous cache pas, madame, que je ne trouve pas, quant à moi, cette prétention si exorbitante.
– Prétexte, mon fils, simple prétexte.
– Soit. Mais ne pensez-vous pas que, si on leur accordait ce qu’ils demandent, ces gens-là se tiendraient tranquilles ensuite ? Je ne sais si c’est un effet de mon ignorance des affaires, mais je ne les vois pas aussi noirs qu’on les fait. J’ai peine à croire à tant de scélératesse. En tout cas, on ne risquerait pas grand-chose d’essayer.
– Erreur, mon fils, quand nous leur aurons accordé cela, ces gens-là demanderont autre chose.
– Quoi, madame ? Précisez, je vous prie.
– Par exemple, l’obligation pour tous les catholiques d’aller au prêche comme eux.
– Peuh !
– Soit, dit-elle, mais vous êtes trop bon, François. En attendant, à tort ou à raison, voici les Parisiens qui crient.
– Laissons-les crier, madame. Quand ils seront las, ils s’arrêteront. »
Battue sur ce point, Catherine voulut une revanche. Et elle se rabattit sur sa bru.
« Ma fille, dit-elle soudain, il est vraiment fâcheux que vous ayez si peu conscience de vos devoirs de souveraine.
– Moi, madame ! balbutia Marie Stuart interloquée. En quoi ai-je manqué à mes devoirs, selon vous ? Je vous serai très obligée de me l’apprendre.
– Comment pouvez-vous supporter que le roi, votre époux, s’efface ainsi qu’il le fait ? s’écria Catherine avec aigreur. Je sais bien que cet effacement profite à votre famille. Il y a des limites à tout, cependant. Le roi passe la plus grande partie de son temps hors de sa maison. Que cela ne vous inquiète pas, cela démontre de votre part une confiance admirable. Songez cependant que les méchantes langues pourraient être tentées de remplacer le mot confiance par le mot indifférence, et avec une apparence de raison... Ne m’interrompez pas, je vous prie... Quand par hasard le roi reste chez lui, vous le chambrez, personne ne le voit. Savez-vous que, si cela continue, on finira par oublier complètement au Louvre, comme dans tout le royaume, qu’il y a un maître, un seul et unique maître, et que ce maître n’est pas M. le duc de Guise, votre oncle. »
Marie Stuart, douce et bonne, n’était cependant pas femme à accepter les perfides insinuations de sa belle-mère sans y répondre.
Elle allait donc les relever vertement.
François ne lui en laissa pas le temps. D’un geste à la fois doux et impérieux, il imposa le silence à Marie Stuart qui allait répliquer et, avec une violence qu’il ne pouvait pas maîtriser complètement :
« Puisque vous y tenez absolument, je vais montrer que le jour où il me conviendra d’agir en maître, ce sera pour tout de bon. Il faudra que tout le monde plie sous ma volonté. Vous entendez, madame : tout le monde. Vous vous en prendrez à vous-même : c’est vous qui l’aurez voulu. »
Ces paroles, et surtout le ton résolu sur lequel elles étaient prononcées, firent dresser l’oreille à Catherine. Un commencement d’inquiétude se coula dans son esprit. Mais elle se rassura en se disant que ce n’était là qu’une menace vaine que François n’aurait jamais l’énergie de mettre à exécution.
Nous avons dit qu’elle connaissait mal son fils.
François frappa sur un timbre et donna un ordre à voix haute.
À voix basse, il en donna un autre. Catherine eut beau tendre l’oreille, elle ne put entendre ce qu’il venait de commander. Elle avait pourtant l’oreille fine. Et l’inquiétude fit de nouveau irruption en elle.
En exécution de l’ordre donné tout haut, les portes furent ouvertes. Un héraut annonça d’une voix tonitruante que le roi accordait audience générale.
C’était presque un événement : le roi était fréquemment hors du Louvre et, quand il restait chez lui, comme ce jour-là, il se tenait volontairement à l’écart, ne recevait que ses intimes et n’accordait que les audiences particulières qu’il lui était impossible de remettre.
C’était donc assez rarement que la cour se réunissait. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et bientôt le vaste cabinet fut envahi par la foule des courtisans empressés à faire leur cour au roi et aux deux reines.
Beaurevers entra.
Le roi le vit dès qu’il mit le pied dans le cabinet. Il ne lui dit pas un mot, ne lui fit pas un geste. Seulement, il lui adressa un long regard. Beaurevers comprit la signification de ce regard. Il y répondit par un geste qui disait :
« Je ne bouge pas d’ici. »
Il voulut aller se placer modestement à l’écart. Mais Catherine l’avait vu, elle aussi. Elle lui adressa un gracieux sourire. Et il dut venir s’incliner devant elle.
Il pensait en être quitte ainsi. Mais alors ce fut Marie Stuart qui, de sa voix harmonieuse, avec son plus doux sourire, prononça au milieu de l’attention générale :
« Ah ! monsieur de Beaurevers, je suis heureuse de vous voir. »
Elle lui tendit la main. Le chevalier se courba sur cette main avec cette grâce altière qui avait un charme spécial chez lui, et l’effleura de ses lèvres.
Elle mit cet instant à profit et, pendant que le chevalier se courbait, elle laissa tomber dans un souffle, en désignant du regard François, à deux pas d’elle :
« Veillez, chevalier, veillez. »
Beaurevers répondit par un coup d’œil expressif qui disait clairement qu’elle pouvait compter sur lui. Et il alla se perdre dans la foule. Seulement, il se plaça de manière à ne pas perdre de vue François et à être vu de lui. Ainsi il pouvait accourir au premier signe.
En même temps que MM. de Guise et derrière eux, était entré un personnage auquel nul ne fit attention. Ce personnage, qui paraissait inquiet et se faisait tout petit, c’était le concierge du Louvre, l’espion de Catherine.
Nous avons dit que personne n’avait fait attention à lui. Nous nous sommes trompés. Le roi, qui l’avait fait appeler et le guettait, l’aperçut dès qu’il eut franchi la porte, malgré la précaution qu’il prenait de se dissimuler derrière le chancelier Michel de l’Hospital qui, lui, suivait les Guises.
Donc, François aperçut le concierge. Et il l’apostropha aussitôt :
« Venez çà, monsieur le concierge. »
La voix était grosse de menace. Pâle comme un mort, la sueur de l’angoisse au front, le malheureux, au milieu de l’attention générale, traversa le cercle d’un pas chancelant et vint se courber en deux devant le roi qui fixait sur lui un regard glacial.
« Monsieur, dit le roi d’une voix tranchante, je vous avais avisé moi-même qu’il se pourrait qu’on vînt demander mon valet de chambre Griffon de la part de deux personnages dont je vous avais fait connaître les noms. Je vous avais expressément recommandé de faire appeler Griffon, sans perdre une seconde, sans demander d’explications au messager, quel qu’il fût. Hier, comme je prévoyais, on est venu vous demander de faire appeler Griffon. Voulez-vous m’expliquer comment il se fait qu’il a fallu plus d’une demi-heure pour faire une commission qui pouvait, qui devait être faite en moins de cinq minutes ?
– Sire, bredouilla le malheureux, j’ai envoyé séance tenante un laquais vers M. Griffon... Je ne m’explique pas...
– Vraiment, vous ne vous expliquez pas !... Et comment se fait-il que vous vous soyez permis, malgré mes ordres formels, de faire subir au messager un interrogatoire qui n’a pas duré moins d’un quart d’heure ?... Il n’est plus question là de la négligence d’un misérable laquais. C’est bien vous qui êtes coupable. De quoi vous mêlez-vous ?... Ah çà ! les ordres que je donne ne comptent donc pas pour vous ?... »
Il s’était animé. La colère qu’il avait refoulée jusque-là, maintenant qu’il avait un prétexte plausible, éclatait dans toute sa violence. C’était la première fois que cette colère royale se manifestait ainsi en public. Elle parut d’autant plus effrayante que, dans les rares moments où le roi s’était montré au milieu de sa cour, on l’avait toujours vu d’une humeur douce, égale, un peu timide, volontairement effacé, comme le lui reprochait Catherine. Il reprit, et maintenant il paraissait très calme, très maître de lui, mais si froid, si résolu qu’il parut plus effrayant encore que dans l’éclat de sa colère.
« Il est temps que ces agissements cessent. Il est temps qu’on sache qu’il n’y a pas d’autre maître ici que moi. Qu’on se le tienne pour dit. »
Ceci, qui s’adressait à toute l’assemblée, était accompagné d’un regard circulaire. Et il fut remarqué que ce regard s’était arrêté un instant sur Mme Catherine et sur MM. de Guise.
Le roi revint à l’infortuné concierge, plus mort que vif :
« Quant à vous, monsieur, fit-il de sa voix glaciale, je ne veux pas autour de moi de serviteur en qui je ne puis avoir confiance. Je vous donne quarante-huit heures pour vous démettre de votre charge. »
Le concierge plia sous le coup. Instinctivement, il jeta sur Catherine un regard désespéré qui implorait assistance. Mais Catherine, pestant intérieurement contre le maladroit, se hâta de détourner les yeux.
Le roi surprit ce coup d’œil. Il acheva :
« ... Et vous retirer dans vos terres. Allez... Et si vous tenez à votre tête, faites en sorte que je ne vous rencontre jamais ni à la cour ni à la ville. »
Pendant que l’espion se retirait d’un pas chancelant, un murmure approbateur saluait cette exécution sommaire. Le roi avait parlé en maître et tout naturellement la foule des courtisans se déclarait pour lui.
III
Les Guises
Le duc François de Guise et son frère, le cardinal de Lorraine, avaient dû s’immobiliser, attendre la fin de cette scène. Ils étaient aussi troublés, aussi inquiets l’un que l’autre.
Après avoir échangé quelques réflexions à voix basse et s’être concertés, ils s’avancèrent vers le roi. Et leur inquiétude se manifesta d’une manière dissemblable qui marquait d’une façon criante la différence de caractère des deux frères.
Le duc, dans la force de l’âge (il avait à peine quarante et un ans), de haute taille, de carrure puissante, le visage congestionné, la cicatrice du front qui lui valait son surnom de Balafré, d’un rouge sanglant, accentuait la rudesse de sa démarche, la dureté du regard, le port de tête insolent, le pli dédaigneux des lèvres. Et il alla droit devant lui, sans un sourire, sans détourner un instant son regard qu’il tenait obstinément fixé sur le roi. C’était le chêne puissant qui redresse son front altier et brave la tempête.
Le cardinal, plus petit, plus mince, plus élégant, l’œil voilé, le teint pâle, l’allure souple, ondulante, glissait sur le tapis, courbé en une interminable révérence ; il prodiguait à droite et à gauche des sourires mielleux et il interrogeait anxieusement du regard sa nièce, Marie Stuart. C’était le roseau qui plie pour mieux se redresser.
Et ce fut ainsi qu’ils vinrent faire leur révérence au roi et que le duc débita son compliment.
Se croyant sûr de son pouvoir, le duc demanda au roi la faveur d’un entretien particulier, ayant amené M. le Cardinal et M. le Chancelier, dit-il, à seule fin de l’entretenir d’affaires urgentes et de la plus haute gravité.
C’était une satisfaction platonique qu’il donnait ainsi au jeune souverain, en ayant l’air de le consulter. Ordinairement, le roi ne faisait aucune difficulté d’accorder l’audience demandée et approuvait toutes les décisions qu’on lui soumettait.
Le duc était fermement convaincu que les choses se passeraient cette fois-ci comme elles se passaient toujours en pareil cas. Il fut stupéfait lorsqu’il entendit le roi déclarer d’une voix grave :
« Parlez, monsieur le Duc, je vous écoute.
– Quoi ! fit le duc assez interloqué, Votre Majesté veut que je traite ici, devant tout le monde, des affaires qui ne doivent être révélées qu’en conseil ?
– Pardon, répliqua François qui prit un air naïf, ne m’avez-vous pas dit, duc, que vous vouliez m’entretenir des agissements de MM. les Réformés, de certains événements qui se sont déroulés hier sur le Pré-aux-Clercs, et enfin de cette petite effervescence qu’on voit aujourd’hui dans les rues de la ville ?
– En effet, Sire, c’est bien de cela qu’il s’agit. Mais je ne me souviens pas d’en avoir parlé à Votre Majesté.
– Vraiment !... Il me semblait cependant vous l’avoir entendu dire... Au surplus, peu importe. C’est bien de cela que vous désiriez nous entretenir ? Oui. Eh bien, parlez, en ce cas. J’estime que ce sont là affaires sans conséquence qui peuvent être traitées au su et au vu de tout le monde. »
Il fallait voir de quel air détaché François venait de prononcer ces paroles.
Malgré les signes discrets que lui adressait son frère le cardinal, le duc ne voulut pas céder sans avoir résisté jusqu’au bout.
« Sire, dit-il en baissant de plus en plus la voix, il est impossible de traiter d’aussi graves questions en public.
– C’est votre opinion, déclara froidement le roi, ce n’est pas la mienne. Parlez donc, duc. Parlez à haute et intelligible voix. Je le veux. »
Le roi ayant dit : « Je veux », il n’y avait plus qu’à s’incliner.
C’est ce que fit le duc, la rage au cœur. Mais, au moment où il allait prendre la parole, le cardinal lui ferma la bouche par un coup d’œil d’une éloquence irrésistible, et prenant les devants :
« C’est un long discours qu’il faut faire. Ceci rentre dans mes attributions plus que dans celles de M. le Duc qui est un soldat d’abord et avant tout. Votre Majesté veut-elle me permettre de prendre la parole ?
– Peu importe celui de vous deux qui parlera. Je vous écoute, cardinal... Et surtout soyez bref. »
C’était sec. Le duc se mordit les lèvres jusqu’au sang. Mais un nouveau coup d’œil de son frère lui recommanda la prudence et la modération. Et comme, nous croyons l’avoir dit, il avait une confiance illimitée dans l’esprit subtil de son frère qui était la forte tête de la maison, il se contint.
Quant au cardinal, il se courba profondément, comme devant un compliment flatteur. Mais son dépit était violent. De plus, il était cruellement embarrassé. Et ceci nécessite une explication :
Forts de la confiance royale, les Guises n’avaient pas attendu cette audience pour prendre des mesures violentes. Ces mesures pouvaient déchaîner la guerre civile dans le royaume. Ils le savaient. C’était ce qu’ils voulaient. Ces mesures, ils comptaient les faire approuver par le roi, après qu’elles auraient été mises à exécution, en partie du moins, c’est-à-dire lorsqu’il serait trop tard pour revenir là-dessus. C’était leur manière de faire dans les coups de force.
Mais voici que tout à coup le roi paraissait se tourner contre eux. Cela changeait complètement la face des choses. Dans la disposition d’esprit qu’ils voyaient au roi, il eût été souverainement dangereux de lui révéler qu’ils avaient donné des ordres avant d’avoir obtenu son assentiment. C’était cela surtout qu’il fallait lui cacher et c’est pour cela que le cardinal avait demandé la parole.
Voilà pourquoi le cardinal de Lorraine était embarrassé et s’était accordé un bref instant pour se recueillir.
Il commença enfin son discours. Ce fut la répétition amplifiée des accusations que Catherine, l’instant d’avant, avait portées sur les réformés.
Il ne put en dire guère plus long qu’elle, car le roi l’interrompit presque aussitôt :
« Inutile de pousser plus loin, dit-il. Je suis fixé sur ce sujet... Je m’étonne de voir un esprit aussi éclairé, un savant comme vous, monsieur le Cardinal, se faire écho d’accusations aussi ridicules... Je dis bien : ridicules. Sachez, monsieur, que je suis renseigné sur cette affaire plus et mieux que vous ne pouvez l’imaginer. C’est ce qui me permet de constater que vous êtes dans l’erreur. C’est pourquoi je vous dis : Non, monsieur, les réformés n’en veulent pas à ma vie et ne complotent pas contre la sûreté de l’État... Mais ce qu’ils feront certainement si on les pousse à bout... Peut-être est-ce là ce qu’on cherche. Je finirai par le croire... Vous êtes venu me proposer des mesures. Je présume qu’elles sont violentes. S’il en est ainsi, je vous dispense de les formuler. La violence serait la pire des fautes. Elle nous mènerait fatalement à la guerre civile... Je vois très bien que c’est là précisément le but poursuivi par certains fauteurs de désordres qui, pour l’assouvissement d’ambitions effrénées, n’hésiteraient pas à noyer le pays dans des flots de sang... Mais je ne serai point leur dupe, et leurs abominables projets ne se réaliseront pas, je vous en donne ma parole royale. Inutile donc de prêcher ici la violence. Ce qu’il faut, c’est un large esprit de tolérance, calmer les esprits au lieu de les exciter sans trêve comme on le fait, leur prêcher l’amour et la concorde et non pas la haine et la discorde, leur faire comprendre, enfin, que les sujets d’un grand et beau royaume comme celui-ci sont comme les membres d’une même et vaste famille qui doivent s’entraider fraternellement et non pas se dévorer mutuellement comme des chiens enragés. Voilà ma politique, à moi. Vous la jugerez peut-être un peu simple. Je la crois bonne. Et si on l’applique comme je l’entends – et je veillerai à ce qu’il en soit ainsi – vous verrez bientôt renaître l’ordre et la prospérité dans ce pays. Alors, si Dieu me prête vie, il sera temps de rechercher ces criminels auxquels j’ai fait allusion. Et je vous jure Dieu qu’ils seront démasqués, saisis, jugés, condamnés et jetés pantelants sous la hache du bourreau. J’ai dit. »
Ce petit discours, auquel personne ne s’attendait, produisit une impression énorme. D’autant qu’il avait été prononcé sur un ton modéré, mais avec une fermeté que personne ne soupçonnait chez ce jeune homme d’aspect maladif, qui passait pour très indolent. Ce fut aussi une stupeur prodigieuse de le voir discuter, avec tant de bon sens et une réelle compétence, des affaires dont on croyait bien qu’il ignorait le premier mot.
Au milieu du silence, une voix grave s’éleva soudain qui approuva courageusement :
« Et c’est fort bien dit, Sire. C’est là un noble langage. Un langage de roi. »
C’était le chancelier Michel de l’Hospital qui prenait ainsi position contre les Guises.
Cette intervention fut agréable au roi. Avec son plus gracieux sourire, il remercia :
« L’approbation de l’homme intègre que vous êtes, monsieur le Chancelier, m’est infiniment précieuse. Elle ne saurait me surprendre cependant, connaissant la noblesse et l’élévation de votre caractère. »
Le chancelier se courba sous le compliment. Et redressant sa noble tête avec une gravité douce :
« Paroles inoubliables, qui me comblent de joie et d’orgueil, Sire. Si Dieu vous prête vie, vous serez un grand roi, Sire.
– Ce n’est pas là le titre que j’ambitionne, fit le roi avec la même gracieuseté. Que mes sujets disent de moi que je suis un roi juste et bon, je n’en demande pas plus. En tout cas, c’est ce que je m’efforcerai d’être et, avec les conseils d’hommes vénérables tels que vous, monsieur le Chancelier, j’espère y arriver sans trop de peine. »
Et, avec un accent d’inexprimable mélancolie qui trahissait la crainte secrète qui était au fond de lui-même, il ajouta, pour la deuxième fois :
« Si Dieu me prête vie, toutefois. »
Cette diversion, quoique très brève, avait permis aux Guises de se ressaisir. Le duc reprit la parole.
« Le roi, fit-il en s’inclinant profondément, repousse, sans les connaître, les mesures que nous étions venus lui soumettre. Le roi est le maître... Je m’incline devant sa volonté. Le roi refusera sans doute également d’entendre la relation des événements qui se sont produits hier... Sur le vu de rapports vagues, émanés on ne sait de qui et d’où, le siège du roi est fait...
– En effet, duc, interrompit vivement le roi, mon siège est fait, comme vous dites. Mais ce n’est pas d’après de vagues rapports, comme vous dites encore. J’étais là, duc, comprenez-vous ?... J’ai vu de mes propres yeux, j’ai entendu de mes propres oreilles. »
Si maître de lui qu’il fût, le duc plia sous le coup. Il fit précipitamment deux pas en arrière. Il croyait que le roi connaissait la terrible vérité et qu’il allait l’accuser devant toute la cour d’avoir voulu le faire assassiner...
« Votre Majesté était là !... dans cette échauffourée !... » bégaya le duc sans trop savoir ce qu’il disait.
Le pis est que le roi semblait jouir de leur trouble et de leur embarras. Il les fixait d’une manière inquiétante et ne se pressait pas de répondre. Enfin, il prononça avec une lenteur calculée :
« Oui, duc, j’ai vu et entendu par moi-même. Vous, vous n’étiez pas sur les lieux où se sont passés les événements dont nous nous entretenons. Donc, vous ne pouvez en parler que d’après les rapports qu’on vous en a faits. Oh ! je ne mets pas en cause votre bonne foi... Je sais que ces rapports-là ne sont pas vagues, et qu’ils émanent de M. le Lieutenant criminel et de M. le Chevalier du guet. Je ne dis pas qu’ils sont mensongers, ces rapports, et que vous ne devez pas avoir foi en eux. Mais je sais qu’ils disent des choses qui sont contraires à celles que j’ai vues et entendues moi-même. En sorte qu’il faudrait chercher comment ces deux officiers royaux ont pu se tromper aussi grossièrement. Et s’ils sont coupables, il faudra les frapper impitoyablement. Comprenez-vous, duc ? »
Ce que le duc et le cardinal comprenaient surtout, c’est que la mortelle accusation ne se produisait pas. Bien mieux, le roi semblait les mettre hors de cause, puisqu’il disait qu’il ne doutait pas de leur bonne foi. Ils se sentirent revivre tous les deux, et un vaste soupir de soulagement souleva leurs deux poitrines. Seulement la secousse avait été trop forte. Ils avaient sondé l’abîme, ils connaissaient maintenant les effets hallucinants du vertige. Et ils n’avaient pas envie de les éprouver à nouveau. C’est pourquoi le duc, qui allait tenir tête au roi, jugea prudent de louvoyer, d’avoir l’air de s’incliner.
C’est ce qui fait que, au grand étonnement de ceux qui le connaissaient, le duc déclara :
« Qui donc serait assez osé de mettre en doute la parole royale ? Si le roi affirme que les rapports qui m’ont été faits sont inexacts, c’est que cela est ainsi. L’enquête sera faite, Sire, et menée rondement, je vous en réponds. De même, je vous réponds que ceux qui m’ont mis dans cette fâcheuse posture aux yeux de Votre Majesté seront châtiés sans pitié, comme ils le méritent. »
Le roi se contenta d’approuver d’un léger signe de tête. Le duc reprit, achevant sa soumission :
« Il importe cependant que des mesures soient prises sans tarder au sujet de cette émotion qui s’est manifestée aujourd’hui dans la rue. Plaise à Votre Majesté de me donner ses ordres à ce sujet. »