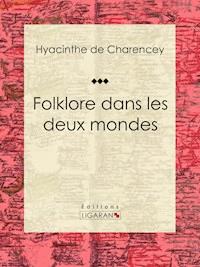
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Parmi les légendes inventées par la fertile imagination des peuples pour expliquer les origines du monde et celle de l'humanité, il en est une qui nous a semblé spécialement curieuse à étudier, à cause de sa diffusion au sein de races fort diverses et de la haute antiquité à laquelle il convient certainement de la faire remonter. Nous voulons parler de celle qui nous représente la terre habitable comme tirée du fond des eaux et composée de quelques grains de..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335038309
©Ligaran 2015
Le présent ouvrage se compose, pour la plus grande partie, d’articles détachés et par nous publiés à diverses époques. Tous d’ailleurs sont consacrés à l’examen comparé de légendes en vigueur chez les peuples tant de l’ancien que du nouveau monde.
L’on remarquera que la presque totalité des récits américains étudiés ici ont été recueillis chez les tribus sauvages du continent occidental. Ce n’est, pour ainsi dire, que par exception que nous nous sommes occupé de ceux des nations civilisées de l’Amérique.
Le rapprochement de toutes ces légendes entre elles semble conduire à des résultats que ne dédaigneront point les amateurs de Folklore. Peut-être pourra-t-on en tirer certaines données relatives à la solution de problèmes intéressant non seulement l’étude des traditions populaires, mais encore celle de l’histoire elle-même ?
Ainsi, les érudits se trouvent en complet désaccord lorsqu’il s’agit d’expliquer l’origine des légendes et leur presque identité en des régions parfois fort éloignées.
Une école admet sans difficulté que des contes analogues ont dû être inventés bien des fois et sur bien des points successifs. La chose s’explique, aux yeux de ces érudits, par l’identité de l’esprit humain, qui procède forcément toujours à peu près de la même façon. Certaines découvertes, disent-ils, ont parfois été faites simultanément par des savants qui, certes, ne s’étaient point donné le mot. En effet, s’ils parvenaient au même résultat, c’était souvent au moyen de méthodes absolument différentes. Comment ne pas admettre la possibilité de semblables coïncidences, lorsqu’il s’agit non plus de ces hautes spéculations, abordables seulement à un petit nombre d’esprits cultivés, mais de simples contes de nourrice qui n’ont pas coûté grand effort d’intelligence à trouver ?
D’autres professent une opinion toute contraire. La plupart des inventions, au nombre desquelles ils rangent celle des récits populaires, n’ont été, remarquent-ils, faites qu’une fois et se sont ensuite propagées au loin. L’homme, à leurs yeux, possède beaucoup plus de mémoire que d’imagination, et, d’ordinaire, il ne fait que se souvenir lors même qu’il se figure créer.
En plus d’une occasion, du reste, les faits semblent leur donner raison.
Bornons-nous ici à un seul exemple. Rien, sans doute, de plus naturel, de plus forcé même à un certain point de vue que l’éclosion de l’art dramatique chez une nation parvenue à un degré voulu de civilisation. Il est bien douteux cependant que les Indous eussent jamais possédé un théâtre proprement dit, s’ils n’avaient subi, d’une façon plus ou moins directe, l’influence hellénique. Lors donc que des contes identiques pour le fond, concluent ces monogénistes du Folklore, se retrouvent au sein de populations séparées par le temps et l’espace, il faudra admettre, en thèse générale, l’existence entre elles d’anciens rapports, d’anciennes communications dont l’histoire, le plus souvent, n’a même pas gardé le souvenir.
Nos recherches personnelles, entreprises sans aucune idée préconçue, semblent, avouons-le, donner, dans la majorité des cas, raison à ces derniers. C’est incontestablement avec ceux des populations de l’Extrême-Orient que les contes de l’Amérique du Nord offrent le plus d’analogie.
Vouloir expliquer ce fait par le pur hasard ne serait-il pas téméraire ? Force est donc d’admettre que les races fixées sur les rives opposées du Pacifique ont jadis entretenu des relations les unes avec les autres et se sont fait certains emprunts.
On s’est plaint souvent que le Folklore n’offre pas de points de repère aussi précis que la linguistique et que les questions de priorité y soient souvent fort difficiles, sinon absolument impossibles à trancher. La constatation de lois phonétiques bien déterminées, l’étude des règles présidant à la transformation des procédés grammaticaux, nous permettent, ajoutera-t-on, de déterminer avec un degré de précision à peu près absolu lequel de deux idiomes appartenant à un même groupe offre le plus de traces d’archaïsme ou de remaniement postérieur. Lors même que les documents historiques nous feraient défaut, aucun homme doué de sens ne saurait hésiter sur la question de savoir si c’est le français qui dérive du latin ou vice versa, si le vieux haut allemand a, oui ou non, précédé l’allemand moderne.
La difficulté sera beaucoup plus grande lorsqu’il s’agit, par exemple, de prononcer entre deux versions d’une même légende, de déterminer laquelle a servi de prototype à l’autre. Les contes, ne l’oublions pas, constituent une sorte de tératologie de l’esprit humain. Suivant l’occurrence, on les voit, à la façon des monstres, se dédoubler, perdre une partie de leurs éléments constitutifs ou bien s’enrichir d’éléments adventices.
Nous ne voulons pas entrer ici dans l’examen des théories linguistiques ni rechercher si elles s’imposent avec autant de rigueur qu’on se plaît généralement à l’admettre. L’on pourrait citer cependant force exemples de dérogations flagrantes à ces lois que l’on a voulu trop généraliser. S’il est une règle qui paraisse bien établie, c’est que les flexions casuelles tendent à s’effacer à mesure qu’un idiome vieillit, pour être remplacées par des particules indépendantes. Ne voyons-nous pas néanmoins le persan moderne doué d’une sorte d’accusatif en ra dont l’analogue ne se retrouve point dans les dialectes ariens primitifs ? Est-ce que l’on n’a pas constaté même de nos jours, dans certains cantons écartés de la Finlande, une tendance de l’esprit populaire à créer de nouveaux cas composés et à enrichir ainsi un système de déclinaison déjà compliqué à l’excès ?
Les mots, dit-on, ont toujours une tendance à s’écourter, à laisser tomber celles de leurs syllabes qui ne sont pas frappées de l’accent. On nous cite, à preuve, l’anglais devenu beaucoup plus monosyllabique que l’anglo-saxon, dont il dérive. Cela n’empêche pas qu’un dialecte chinois étudié par M. Mueller, celui de Shanghaï, si notre mémoire ne nous trompe pas, a pris l’habitude de joindre à chaque racine certaines désinences qui en font soit un nom, soit un verbe. En un mot, il est aujourd’hui presque entièrement composé de dissyllabes. Voici donc un idiome qui, en dépit des règles formulées par les savants, a réellement opéré son évolution de l’état isolant à celui d’agglomération.
D’un autre côté, si la méthode linguistique ne présente pas un caractère aussi immuable qu’on l’a si souvent prétendu, la difficulté qu’il y a à rétablir la généalogie des légendes populaires nous semble avoir parfois été quelque peu exagérée. De tout ceci, l’étude comparée du Folklore dans les deux mondes offrira plus d’une preuve sans réplique. Ainsi que nous nous efforcerons de l’établir plus loin, les contes et mythes de l’Amérique, comparés à leurs congénères d’Asie ou d’Europe, s’en éloignent souvent par un double caractère. D’abord, certains détails inhérents au fond du sujet et dont l’absence rend le récit obscur et incomplet leur font souvent défaut ; cela démontre clairement qu’ils n’ont pas pris naissance sur le sol américain et ont dû être importés d’ailleurs. De plus, ils sont moins chargés de ces éléments évidemment surajoutés, se laissent plus aisément ramener à une forme que l’on peut considérer comme typique. Ne devons-nous pas en inférer qu’ils ont passé de la côte ouest à la côte est du Pacifique à une époque déjà assez reculée et où le récit original n’avait pas encore eu le temps de perdre sa physionomie primitive. Sous ce double rapport, les divergences apparaissent plus suggestives encore que ne seraient les affinités.
Prenons maintenant une légende spéciale, celle du héros sauveur ou libérateur né d’une vierge. Nous serons aussitôt frappés d’une particularité fort importante à signaler. Elle ne se retrouve en Amérique que parmi les tribus du courant appelé Toltèque occidental ou Californien à tête droite par le savant L. Angrand, et cela en opposition avec le courant Toltèque oriental ou Floridien à tête plate du même auteur. On en constate l’existence chez presque tous les Toltèques occidentaux, et elle paraît tenir au fond même de leurs doctrines théologiques, tandis que les populations du rameau oriental ne connaissent rien de semblable. Que conclure de tout ceci, sinon que la légende en question n’est point, dans l’hémisphère occidental, d’invention indigène, qu’elle a été importée d’ailleurs ? Sans cela, comment se ferait-il qu’aucune nation du groupe floridien à tête plate n’eût jamais imaginé le moindre récit concernant les naissances virginales ?
N’y a-t-il pas là, tout au moins, une forte présomption que ce qui s’est passé pour le nouveau monde s’était produit déjà à une époque plus reculée pour l’ancien ? Si les Mexicains n’ont point inventé la légende en question, mais l’ont simplement reçue du dehors, pourquoi voudrait-on que la plupart des races de l’ancien monde aient été douées de plus d’imagination ?
Puisque nous la retrouvons chez beaucoup d’entre elles, n’y a-t-il pas tout lieu de croire qu’elles l’ont également empruntée et peut-être même à une source unique ? Et ce qui est vrai du récit en question ne le sera-t-il pas également de la plupart des autres ?
Nous pouvons aller plus loin : les recherches des folkloristes, aidées du secours de la linguistique comparée, fourniront, sans aucun doute, d’utiles renseignements sur l’époque approximative à laquelle remontent les communications les plus importantes entre l’Asie et le Nouveau-Monde. Le nom de Néna, l’épouse du Noé de certaines légendes diluviennes du Mexique, offre bien de l’analogie avec celui du Nannacus phrygien, au temps duquel serait arrivée la destruction du monde par une grande inondation. Or, M. Babelon a démontré, ce nous semble, d’une façon péremptoire, que la tradition du déluge, portée en Asie Mineure par les Juifs, ne remonte pas au-delà du troisième siècle avant J.-C. D’autre part, les traditions primitives des Mexicains nous reportent tout au plus au premier siècle de notre ère. C’est donc dans l’intervalle compris entre ces dates qu’il faudra placer les plus anciennes relations entre les deux continents dont l’histoire ait conservé quelque vestige.
Il va sans dire, d’ailleurs, que la question du Folklore n’a rien à faire avec celle des origines de la race américaine. Cette dernière avait sûrement déjà pris possession des solitudes de l’hémisphère occidental bien des siècles avant de subir l’influence des populations plus ou moins civilisées de notre continent.
Parmi les légendes inventées par la fertile imagination des peuples pour expliquer les origines du monde et celle de l’humanité, il en est une qui nous a semblé spécialement curieuse à étudier, à cause de sa diffusion au sein de races fort diverses et de la haute antiquité à laquelle il convient certainement de la faire remonter. Nous voulons parler de celle qui nous représente la terre habitable comme tirée du fond des eaux et composée de quelques grains de sable qu’un génie créateur ou plutôt formateur développa de façon à en former un vaste continent.
Cette légende elle-même se partage en plusieurs versions qui sont les suivantes :
1° La Version continentale, répandue tant dans l’ancien que dans le nouveau monde, et qui nous représente la terre extraite des eaux par un être animé (quadrupède ou oiseau).
2° La Version insulaire, propre au Japon et aux îles de la Polynésie et où le dieu lui-même tire le monde de l’eau, comme un poisson, au moyen d’un instrument de pêche ou d’un bâton.
3° La Version indoue ou mixte, résultant de la fusion des deux précédentes.
Voici la légende wogoule recueillie par M. Paul Hunfalvy, telle que nous la fait connaître M. Lucien Adam.
« En haut, il n’y avait que Numi-Târom, le Dieu unique, le Seigneur du ciel, et en bas la mer ; dans un berceau d’argent, suspendu au-dessus de l’abîme, par une chaîne de fer, un époux et une épouse n’appartenant point à l’humanité. Numi-Târom a déchaîné les vents qui soulèvent les flots de la mer et se jouent du berceau livré à leurs caprices ; aussi l’un des deux êtres non humains demande-t-il au père céleste de créer, pour ses enfants, un morceau de terre susceptible de porter une maison. Numi-Târom se rend à ce vœu.
Les hôtes du berceau prennent possession de leur demeure céleste et y font un séjour assez prolongé pour que la vieillesse commence à s’appesantir sur leurs têtes. Lasse d’être ainsi recluse, l’épouse sort de la maison, et après une absence assez longue pour causer de l’inquiétude à son mari, elle rentre en annonçant qu’elle porte dans son sein un fils de l’air. Elle donne le jour à Elempi, et l’époux célèbre la naissance de l’enfant par ce cri d’allégresse : Dieu, mon père, m’a donné un fils ; Dieu, notre père, nous a gratifiés d’un fils !
Elempi croît à vue d’œil. Il devient bientôt un chasseur consommé et un pêcheur habile. Puis son intelligence se développant, il se préoccupe de l’avenir, et annonce à ses parents qu’il songe à aller consulter Numi-Târom.
Elempi prend la forme d’un écureuil ; il gravit, non sans fatigue, les degrés de l’escalier qui conduit à la demeure de Numi-Târom et se jette aux pieds du dieu. Celui-ci s’informe avec bienveillance du motif de sa venue. Elempi répond que l’objet de sa démarche est le sort de l’homme qui ne pourra vivre sur l’eau de la mer créée par Numi-Târom. Comment s’y prendre pour former une terre ferme ?
Avant de répondre, le dieu s’assure de la cuisson d’un poisson qui est sur le feu. Il relève ensuite la tête et donne à Elempi une peau de canard et une peau d’oie, en lui disant de descendre sur le bord de la mer et de faire surgir lui-même la terre sainte destinée à l’homme. »
« Elempi revêt la peau de canard, plonge sous les flots et cherche, par trois fois, à atteindre le fond de la mer. Trois fois, il est ramené à la surface.
Il revêt alors la peau d’oie, et grâce à la vertu de ce talisman, il parvient à détacher du fond de la mer trois poignées de terre qui se transforment en fleuves, lacs, montagnes et prairies.
La demeure de l’homme est prête, mais elle flotte sur les eaux. Elempi comprend qu’il faut la fixer. Il reprend le chemin qui conduit à la maison de Numi-Târom, rend compte au dieu de l’état où se trouve la terre et lui demande comment il pourra la rendre immobile. Numi-Târom remet à Elempi une ceinture à clous d’argent, représentant la chaîne des monts Ourals ; le démiurge passe ce talisman autour de la terre, et aussitôt celle-ci cesse de flotter.
La création se poursuit de la sorte, par la puissance de Numi-Târom, mais toujours sur la prière d’Elempi. Le démiurge pose le problème et le dieu le résout.
À la création de la terre ferme succède immédiatement celle des hommes, des quadrupèdes et des oiseaux. Elempi fabrique ces trois sortes d’êtres avec un même mélange de terre et de neige. À peine sortis des mains de leur auteur, les hommes rient et folâtrent, mais ils n’ont rien à manger. Elempi monte vers Numi-Târom et reçoit de lui trois couples de poissons avec lesquels il peuple les fleuves, les rivières et les lacs. D’autre part, les bois sont remplis d’animaux sauvages et les oiseaux se sont multipliés dans les airs. Cependant Elempi demeure soucieux ; il se demande comment les hommes parviendront à s’emparer des animaux dont la chair est nécessaire à leur subsistance ! Numi-Târom résout ce problème en indiquant au démiurge la manière de fabriquer l’are, les flèches, les différents filets de chasse, ainsi que les vêtements de peau.
Vient ensuite l’institution du mariage, grâce à laquelle les hommes se multiplient au point de couvrir toute la terre. La vie menace de s’arrêter par l’effet même de son exubérance. Elempi s’adresse de nouveau à Numi-Târom, et le dieu lui répond : Emmène avec toi Kully-Ater ; il sera l’artisan de la souffrance et des maladies : une partie du peuple mourra et l’autre sera sauvée. »
Une autre légende du même peuple nous parle de géants batailleurs et adonnés à la magie qui, prévoyant l’arrivée prochaine d’un déluge d’eau bouillante, indiquent aux hommes les moyens d’y échapper. Ceux-là seuls sont sauvés qui suivent les conseils des géants. Tous les autres périssent dans les flots.
Le récit que nous venons d’étudier semble être, de tous ceux qui nous ont été conservés, celui qui se rapproche le plus de la version primordiale de laquelle dérivent toutes les autres légendes du type que nous avons appelé continental. Cependant, on y découvre un certain nombre de traits qui, sans aucun doute, ne sont point primitifs, par exemple celui du berceau d’argent et de la chaîne de fer. Ne devons-nous pas voir là un résultat de l’influence exercée sur les Wogoules par ces populations métallurgistes qui ont laissé tant de vestiges de leur industrie dans le sud de la Sibérie ? En tout cas, le récit wogoule ne paraît se retrouver chez aucun autre peuple ougrofinnois. Si nous ne savions avec quelle facilité des traditions de ce genre sont sujettes à s’effacer devant le progrès de la civilisation, nous y verrions une preuve qu’il leur avait été communiqué par quelque population d’origine différente.
Le trait concernant les géants qui prévoient un déluge d’eau bouillante a ceci de curieux qu’il rappelle singulièrement une légende talmudique dont nous devons connaissance au savant abbé Bargès. Le monde aurait subi une première inondation au temps d’Enos. Dieu voulant punir les géants de leurs crimes, ouvrit les sources dont l’eau devait couvrir la terre. Ces géants les ayant obstruées avec leurs pieds, de façon à empêcher les ondes de sortir, l’Éternel fut obligé de les transformer en eaux brûlantes. Mais, sans doute, ceux qui ont rédigé le Talmud n’étaient point, eux-mêmes, les premiers inventeurs de ce bizarre récit.
En tout cas, l’histoire de l’épouse du premier homme, qui se trouve enceinte du fils de l’air, aurait un cachet bien plus exclusivement finnois. On sait qu’il est longuement question dans le Kalévala de la vierge de l’air, personnage évidemment cosmogonique et qui donne naissance à la terre, aux montagnes, etc.. La façon dont Elempi annonce la naissance de son fils rappelle avec la fameuse exclamation d’Ève, lorsqu’elle enfanta son premier-né : « J’ai un homme par Jéhovah. »
Le nombre trois revient dans la légende par nous étudiée avec une fréquence qui démontre sa valeur symbolique et cabalistique aux yeux des Wogoules. Elempi plonge trois fois avant de recueillir les trois poignées de terre qui se transformeront en fleuves, montagnes et prairies. Il crée trois espèces d’êtres : les hommes, les quadrupèdes et les oiseaux. Enfin, les fleuves et les lacs se trouvent peuplés au moyen de trois couples de poissons donnés par Numi-Târom à Elempi.
Au dire d’un ancien coureur des bois, les tribus algiques, qui vivent sur les bords du Saint-Laurent, expliquent ainsi qu’il suit de quelle manière la terre a été formée :
« Ils savent (les sauvages) que tout n’estoit qu’eau avant que la terre fût créée, et que sur cette vaste étendue d’eau flottait un grand cajeu (radeau) de bois, sur lequel estaient tous les animaux de différentes espèces qui sont sur la terre, dont le Grand-Lièvre, disent-ils, estoit le chef. Il cherchait un lieu propre et solide pour débarquer, mais comme il ne se présentait à la veüe que cignes et autres oiseaux de rivières sur l’eau, il commençait désjà à perdre espérance, et on ne voyoit plus d’autre ressource que d’engager le castor à plonger, pour apporter un peu de terre du fond de l’eau, l’asseurant au nom de tous les animaux que, s’il en revenait avec un grain de sable seulement, il en produirait une terre assez spacieuse pour les contenir et les nourrir tous. Mais le castor tâchait de s’en dispenser, alléguant pour raison qu’il avait déjà plongé aux environs du cajeu sans apparence d’y trouver fonds. Il fust cependant pressé avec tant d’instance de tenter derechef cette haute entreprise, qu’il s’y hasarda et plongea. Il resta si longtemps sans revenir que les Suppliants le crurent noyé, mais on le vit enfin paraître, presque mort et sans mouvement. Alors tous les autres animaux, voyant qu’il était hors d’estat de monter sur le cajeu, s’intéresseront aussitôt à le retirer, et après lui avoir bien visité les pattes et la queue, ils n’y trouvèrent rien.
Le peu d’espérance qui leur restoit de pouvoir vivre les contraignit à s’adresser au loutre, de le prier de faire une seconde tentative, pour aller quérir un peu de terre au fond de l’eau. Ils lui représentèrent qu’il y allait également de son salut, comme du leur. Le loutre se rendit à leur juste remontrance et plongea. Il resta au fond de l’eau plus longtemps que le castor et revint, comme lui, avec aussi peu de fruit.
L’impossibilité de trouver une demeure où ils pussent subsister ne leur laissait plus rien à espérer, quand le rat musqué proposa qu’il allait, si l’on voulait, tâcher de trouver fonds, et qu’il se flattoit même d’en apporter du sable. On ne comptait guère sur son entreprise, le castor et le loutre, bien plus vigoureux que lui, n’en ayant pu avoir. Ils l’encouragèrent cependant, et luy promirent qu’il serait le souverain de toute la terre, s’il venait à bout d’accomplir son projet. Le rat musqué, donc, se jeta à l’eau et plongea hardyement. Après y avoir esté près de vingt-quatre heures, il parut au bord du cajeu, le ventre haut, sans mouvement, et les quatre pattes fermées. Les autres animaux le reçurent et retirèrent soigneusement. On luy ouvrit une des pattes, puis la seconde, puis la troisième, et la quatrième, enfin, où il y avait un petit grain de sable entre ses griffes.
Le Grand-Lièvre, qui s’estoit flatté de former une terre vaste et spacieuse, prit ce grain de sable et le laissa tomber sur le cajeu, qui devint plus gros. Il en reprit une partie et la dispersa. Cela fit grossir la masse de plus en plus. Quand elle fut de la grosseur d’une montagne, il voulut en faire le tour, et à mesure qu’il tournait, cette masse grossissait. Aussitôt qu’elle lui parut assez grande, il donna ordre au renard de visiter son ouvrage, avec pouvoir de l’agrandir. Le renard ayant cogneu qu’elle estoit d’une grandeur suffisante pour avoir facilement sa proye retourna vers le Grand-Lièvre pour l’informer que la terre estoit capable de nourrir et contenir tous les animaux. Sur son rapport, le Grand-Lièvre se transporta sur son ouvrage, en fit le tour et le trouva imparfait. Il n’a voulu depuis se confier à aucun de tous les autres animaux, continuant à l’augmenter, en tournant sans cesse autour de la terre. C’est ce qui fait dire aux sauvages, quand ils entendent du retentissement dans les cavités des montagnes, que le Grand-Lièvre continue à l’agrandir. Ils l’honorent et le considèrent comme le dieu qui l’a créé. Voilà ce que ces peuples nous apprennent de la création du monde, qu’ils croient estre toujours porté sur un cajeu. À l’égard de la mer et du firmament, ils affirment qu’ils ont esté de tout temps. »
Ensuite le Grand-Lièvre s’occupa un peu du genre humain ; il institua le mariage, assignant à chaque sexe ses occupations spéciales. L’homme eut dans ses attributions la chasse et la pêche. À la femme furent dévolues les charges du ménage, spécialement la confection des vêtements et les soins de la cuisine.
Dans le chapitre suivant, le même auteur nous apprend que, d’après la croyance canadienne, le Grand-Lièvre aurait fait naître les hommes des cadavres des animaux et même des hommes qui étaient venus à mourir. C’était, en quelque façon, affirmer la supériorité de notre espèce sur tous les autres êtres. En sa qualité de roi de la création, l’homme apparaît, dans la Bible, comme le dernier ouvrage du Tout-Puissant. Seulement, la légende américaine reconnaît une sorte de confraternité ou plutôt de filiation entre notre espèce et l’animalité dont, bien entendu, nos livres saints ne contiennent aucune trace. C’est juste le contraire des métamorphoses des mortels en oiseaux, singes ou poissons mentionnés dans les traditions cosmogoniques des peuples de la Nouvelle-Espagne.
Inutile de faire ressortir l’affinité de la légende canadienne avec celle des Wogoules. Seulement elle a quelque chose de plus simple, de plus approprié aux idées et aux mœurs d’une race encore complètement sauvage. Il ne saurait, bien entendu, y être question de la chaîne de fer retenant le berceau d’argent de nos premiers ancêtres, puisque les tribus du nord de l’Amérique ignoraient l’usage des métaux, jusqu’à l’époque de la découverte et que, d’ailleurs, ces détails n’avaient pas, sans doute, été ajoutés au récit primitif lorsqu’il passa en Amérique.
Nous nous trouvons donc ici en présence d’un fait important et qui se répète fréquemment aux yeux de l’observateur, à savoir : que les légendes américaines offrent souvent un caractère plus archaïque que leurs congénères de l’ancien continent, et que c’est chez les hommes de race cuivrée qu’il convient de se transporter pour retrouver les traditions asiatiques dans toute leur pureté, et, pour ainsi dire, à leur état naissant. Ainsi, dans le mythe votanide, qui offre tant de points de contact avec celui du Siamois Phra-Ruàng et du héros Barman Pyù-tsau-ti, tout ce qui rappelle la légende de Thésée a été omis. De même pour l’histoire du second Quetzalcohuatl, qui n’est qu’une contrefaçon de l’iranien Djemschid. C’est l’ivrognerie qui cause la chute du héros Toltèque, tandis que celui de la Perse perd sa pureté pour s’être laissé aller à faire usage d’une nourriture animale. À cet égard, le récit américain se trouve beaucoup plus près de celui de la Bible, qui se rapporte à l’ivresse de Noé, que du récit recueilli par Firdousi ; de même pour l’aventure de Cuextecatl, le Chanaan mexicain et qui se rencontre étrangement défigurée dans le Schah-Nameh.
Au contraire, l’idée d’impureté attachée à une alimentation animale pourrait bien être duc à l’influence des idées indoues, quoique l’on en rencontre quelques vestiges dans la Genèse, mais seulement pour l’époque antédiluvienne. En tout cas, l’origine biblique d’une partie au moins de la légende de Djemschid et, par suite aussi, de celle de Quelzatcoatl semblent aujourd’hui chose hors de doute.
De tout ceci, nous ne conclurons pas certainement que ces vieilles traditions aient passé d’Amérique en Asie. Le contraire nous semble indubitable. Si elles offrent parfois une physionomie plus primitive au sein de la race cuivrée, cela tient à différentes causes ; d’abord, et surtout, à l’état stationnaire où elle est si longtemps restée et qui lui inspirait, sur ce point, un esprit éminemment conservateur. C’est ainsi que la tranquillité politique relative dont ont joui les Polonais et Lithuaniens pendant toute la durée du Moyen Âge leur a permis de conserver dans leurs légendes et chants nationaux beaucoup de traits d’archaïsme remontant à l’époque païenne et qui font défaut à ceux des Serbes. Chez ces derniers, en effet, les nécessités de la lutte contre l’infidèle faisaient perdre le souvenir des antiques récits, et on ne songeait guère à célébrer que les exploits des héros chrétiens, vainqueurs du croissant.
Il en a été exactement de même pour les races de l’Asie ; l’introduction du bouddhisme, les révolutions sociales et politiques, l’influence d’une caste sacerdotale, l’infiltration des idées helléniques, juives et chrétiennes, etc., etc., voilà autant de causes qui les ont contraintes à remanier bien des fois leurs légendes anciennes. Or, de ces causes, aucune, pour ainsi dire, n’a pu agir sur la population du Nouveau-Monde.
En outre, si l’existence d’anciens rapports entre les deux hémisphères semble un fait aujourd’hui incontestable, il s’en faut de beaucoup que ces mêmes rapports aient été constants. Tout, au contraire, indique qu’ils ne se sont produits qu’à de très longs intervalles et ont commencé dans des temps assez reculés.
Évidemment, tout le nouveau continent a été peuplé ou du moins visité, à bien des reprises différentes, par des tribus qui ont traversé le détroit de Behring, et plusieurs savants font aujourd’hui encore de la Sibérie et des régions de l’Asie orientale le berceau primitif de toute la race cuivrée.
Un docte anthropologiste russe, M. de Maïnoff, a été conduit, par l’étude de leur physionomie, à reconnaître dans les Yakoutes des bords de la Léna de véritables Peaux-Rouges, bien qu’ils parlent aujourd’hui un dialecte turc, et dans les Tongouses, des Esquimaux métissés de Mongols. On croit retrouver quelques vestiges de sang américain chez les Aïnos de l’île de Yézo, lesquels cependant constituent une population de sang caucasique plus ou moins pur. Enfin l’on, rencontre parfois, dans le sud du Japon, de ces visages à nez recourbé, à mâchoires massives, à teint fortement basané qui ne sont certainement ni Caucasiens ni Mongols, mais offrent, au contraire, la plus grande ressemblance avec ceux de certains Indiens de la côte nord-ouest. Les instruments de pierre polie tirés des cavernes du Japon et dont les amateurs de ce pays, à l’imitation de leurs collègues d’Europe, commencent à faire collection, offriraient également un caractère franchement américain. Certaines différences essentielles de forme les distingueraient nettement des instruments similaires trouvés en Europe.
D’autres communications, mais celles-là, sans doute, temporaires et accidentelles, paraissent également avoir eu lieu aux sixième et septième siècles après J.-C., mais c’est un sujet que nous n’avons pas à traiter plus en détail, quant à présent du moins. Tout ceci nous rend parfaitement compte de la physionomie archaïque des traditions du Nouveau-Monde.
Nous remarquerons que l’esprit créateur du monde était appelé « Grand-Lièvre » et vénéré sous cette forme par la plupart, sinon la totalité des populations de race algique. Tel est, en effet, le sens des termes Manihojo, Nanabojou, Michaho, Messou, sous lequel il était désigné dans les dialectes algonkin, chippeway et autres de même origine. Mais il est plus que probable, comme le remarque M. le Dr Brinton, que telle n’était point leur signification primordiale. Diverses raisons étymologiques et autres le conduisent à admettre une signification primitive analogue à celle de Grand Blanc ou Grand Brillant, fort appropriée au rôle de dieu de l’aurore que joue le Grand-Lièvre. Il se serait produit, à son occasion, un de ces calembours étymologiques qui abondent dans l’histoire des mythes.
C’est qu’en effet, s’il existe, dans ces dialectes, un terme wabos voulant dire « Lièvre », l’on y rencontre également la racine wap, wab, qui correspond à notre mot « Blanc » et dont dérivent les termes indiens signifiant « est, aurore, lumière », etc… On voit quelle confusion pouvait résulter de la présence de ces deux homophones.
Une particularité également assez curieuse de la légende par nous étudiée en ce moment, c’est le rôle assigné à des quadrupèdes aquatiques, par opposition à celui que la légende wogoule réserve à des oiseaux d’eau. On dirait cette substitution caractéristique non seulement des traditions algiques, mais encore de celles de toute la race cuivrée. Nous pouvons citer comme preuve l’une des versions du déluge d’après les Péruviens, dans laquelle la colombe et le corbeau de Noé se trouvent remplacés par le chien.
« Les habitants de ce pays (le Pérou) disent qu’à une époque fort ancienne, la terre avait été toute couverte par les eaux, sauf quelques montagnes fort élevées. C’est là que les hommes trouvèrent un refuge dans de grandes cavernes qu’ils avaient creusées et préparées à cet effet, et où d’ailleurs ils avaient eu soin de porter toutes les choses nécessaires à la vie. Après y être rentrés, ils bouchèrent soigneusement toutes les moindres ouvertures, de sorte que l’eau n’y pouvait pénétrer. Au bout d’un certain temps, jugeant que l’inondation tirait à sa fin, ils firent sortir quelques chiens, qui revinrent mouillés et sans que leur poil fût souillé par la boue. Les réfugiés jugeant, à cet indice, que les eaux étaient encore hautes, ne voulurent point sortir, et ils ne se décidèrent à quitter leur retraite que lorsque d’autres chiens, lâchés après les premiers, furent revenus, tout tachés de boue. En effet, c’était une preuve sans réplique que la terre, cessant d’être submergée, avait recommencé à devenir habitable. »
Il est vrai que les oiseaux du récit mosaïque vont reparaître chez les Tarasques du Méchoacan, aussi bien que chez les Mélomènes ou Indiens folle-avoine des États-Unis, tribu, comme l’on sait, de race algique. Au dire de Humboldt, Tezpi, le Noé Tarasque aurait échappé au déluge dans un spacieux Acalli, litt. « Maison d’eau, maison aquatique » ou vaisseau. Sitôt que les eaux eurent commencé à se retirer, il lâcha le Zopilote (Vultur Aurea), lequel s’étant arrêté à dévorer les cadavres des animaux noyés ne reparut plus. Le colibri, ou plutôt l’oiseau-mouche (car il n’existe point de colibris en Amérique), fut envoyé à la découverte. Il revint à l’embarcation de Tezpi, portant une branche verte dans son petit bec. Il est vrai que, par une négligence qui ne lui est point habituelle, de Humboldt néglige de nous faire savoir où il a pris cette histoire de Tezpi. Serait-elle tirée d’un manuscrit pictographique indigène ? Mais on sait bien quelles erreurs furent parfois commises dans leur interprétation. On est bien d’accord aujourd’hui pour reconnaître que la fameuse Mappe mexicaine, où des exégètes trop complaisants avaient vu l’histoire du déluge, de la tour de Babel et de la dispersion des peuples, se rapporte uniquement à la migration entreprise par les Nahuas-Mexicains à la suite de leur départ d’Aztlan.
Passons maintenant au récit Mélomène :
Le genre humain aurait tout entier péri dans un déluge, sauf un homme et une femme auxquels une montagne servit d’asile. L’eau resta deux jours sur la terre. Un oiseau blanc fut envoyé pour apporter le feu aux réfugiés, mais s’étant arrêté à dévorer des charognes, il laissa le feu s’éteindre et fut obligé d’en aller chercher de nouveau. Pour le punir de sa gourmandise et de sa négligence, le Grand-Esprit noircit son plumage. Puis il chargea l’Erbeth, petit oiseau gris et marqué d’une bande noire de chaque côté de l’œil, de faire la commission. Voilà pourquoi les Mélomènes regardent ce volatile comme un bon génie. Afin de lui ressembler, ils se peignent deux bandes noires sur le visage. Ces mêmes sauvages auraient, dit-on, mais cela paraît plus douteux, conservé le souvenir de la confusion des langues.
Cette légende est fort curieuse. Toutefois elle a été recueillie bien récemment et l’on peut se demander si elle n’a point, au moins dans quelques-unes de ses parties, été modifiée par l’influence des idées chrétiennes.
Rappelons-nous, à ce propos, la tradition diluvienne recueillie chez les Chaoucoups de l’Orégon et qui ne consiste qu’en une contrefaçon ou plutôt une compilation de plusieurs passages de nos livres saints. En tout cas, l’oiseau blanc, qui se nourrit de corps morts, semble bien parent, à la fois, et de la colombe et du corbeau de l’arche. Le détail du changement de couleur par lequel il se trouve puni pourrait être difficilement regardé comme d’importation européenne. Cependant, il rappelle singulièrement le châtiment infligé par Apollon au corbeau pour le punir de lui avoir révélé la trahison de Coronis, son amante.
La bande noire dont est marqué chacun des yeux de l’Erbeth ne serait-elle pas prise ici comme le signe de la vie ? Rappelons-nous les poteries des Zûnis, ornées de figures animales ; ces dernières portant, depuis la bouche jusqu’au cœur, une sorte de ligne recourbée sur elle-même et qui constitue, pour ainsi dire, l’hiéroglyphe de la vie.
Ce serait là un point de contact remarquable entre la symbolique des Mélomènes et celle des Indiens Pueblos. Le rôle des oiseaux porteurs du feu nous fait songer au nom de Kin-ich-Kakmô, litt. « Ara de feu, œil du soleil » donné par les Yucatèques à une idole représentant sans doute cet oiseau, et qui couronnait la pyramide située au nord de la ville d’Izamal.
Mais il est temps de revenir au sujet principal de notre étude. La légende racontée déjà par M. Perrot nous est rapportée encore par un autre explorateur. Voici son récit :
« Les sauvages (du Canada) croient et tiennent pour assuré qu’ils ont tiré leur origine des animaux et que le dieu qui a fait le ciel s’appelle Michapous. Ils ont quelque idée du déluge et croient que le commencement du monde n’est que depuis ce temps-là ; que le ciel a été créé par ce Michapous, lequel, ensuite, créa tous les animaux qui se trouvèrent sur des bois flottants, dont il fit un cayeu, qui est une manière de radeau, sur lequel il demeura plusieurs jours sans prendre aucune nourriture. Michapous, disent-ils, prévoyant que toutes ces créatures ne pourraient subsister longtemps sur ce radeau et que son ouvrage serait imparfait, s’il n’obviait aux malheurs et à la faim… et ne se voyant alors que maître du ciel, se trouva alors obligé de recourir à Michinisi, le dieu des eaux, et voulut lui emprunter de la terre pour y loger ses créatures. Celui-ci ne se trouva pas disposé à écouter la demande de Michapous qui envoya, tour à tour, le castor ; la loutre et le rat musqué chercher de la terre au fond de la mer, sans pouvoir recouvrer que fort peu de grains de sable, et cela, seulement, par le moyen du dernier.
Michapous mit habilement ce peu de sable à profit, puisqu’il servit de levain à une haute montagne. Le renard fut invité à tourner autour de cette montagne : Michapous l’assurait que ces tours augmenteraient la terre. Le renard tourna quelque temps pour augmenter le globe terrestre, mais il se lassa bientôt, et Michapous acheva le reste. »
Du reste, ces sauvages croient les hommes issus des cadavres putréfiés de ceux que Michapous tua parce qu’ils se querellaient constamment entre eux. À peine nés, les hommes inventèrent l’arc et la flèche pour faire la guerre aux animaux. Un jour il arriva qu’un d’entre eux, qui s’était écarté des autres, arriva à une cabane, résidence de Michapous en personne. Le seigneur du ciel lui fit cadeau d’une épouse et détermina les devoirs respectifs de chaque sexe. La chasse et la pêche furent le partage de l’homme. Sa compagne eut dans son lot la cuisine et la quenouille ; en un mot, tous les soins du ménage. Michapous maria également de sa main les compagnons de l’Indien qui l’avaient visité en imposant aux nouveaux ménages les mêmes conditions. Enfin, les hommes furent avertis qu’ils avaient été faits sujets à la mort, mais qu’après le trépas, leurs ombres iraient dans un lieu de délices.
Les hommes vécurent heureux pendant quelques siècles, puis l’accroissement de la population les contraignit à chercher de nouveaux pays de chasse. Des rivalités et des discordes éclatèrent entre les chasseurs, et telle fut l’origine de la guerre.
Ce que nous avons dit plus haut au sujet de l’étymologie de Michabou ou Michapous nous dispense d’y revenir ici.
Quant au refus opposé par Michinsi, le dieu des eaux, à la demande que lui adresse la déité céleste et créatrice, elle nous paraît un résultat de l’inimitié habituelle qui régnait entre les deux personnages.
Il est bien remarquable que dans la mythologie mexicaine se retrouve la même opposition entre Quetzalcoatl, déité céleste, et Mictlan Tauctli, le Pluton de ces peuples, peut-être parfois considéré comme déité de la mer, s’il est vrai, comme le rapporte un exégète, que l’Océan soit quelquefois qualifié de « bassin de Mictlan Teuctli ».
Ajoutons que la rivalité de ces deux personnages se manifeste, précisément comme dans la légende canadienne, à propos de la création ou plutôt de la restauration de l’univers. D’après les peuples de la Nouvelle-Espagne, l’espèce humaine ayant été anéantie dans un de ces grands cataclysmes qui ont successivement désolé le monde, Quetzalcoatl descendit aux enfers. Il allait réclamer du roi de l’Orcus, de Mictlan-Teuctli, litt. « Seigneur du pays des morts, » l’os d’émeraude ou de jaspe, Chalchiuh-Omitl, avec lequel il devait refaire une humanité nouvelle. Mictlan-Teuctli accède d’abord à la demande de son collègue et lui donne l’os d’émeraude, puis se repentant de sa générosité, il court après lui pour le lui reprendre. Quetzalcoatl, effrayé, se laisse choir, ainsi que son fardeau. L’os se brise en morceaux inégaux, et voilà pourquoi les mortels qui en sont issus n’ont pas tous la même taille. Enfin, des cailles (Çoçoltin) se jettent sur les débris de l’os d’émeraude qu’elles becquetèrent tandis que Quetzalcoatl s’évanouit.
Nous n’entrerons pas ici dans l’étude de chacun des détails de la légende ; qu’il nous suffise d’indiquer que le rôle joué ici par Quetzalcoatl se trouve, d’après d’autres auteurs, réservé à Xolotl.
Terminons en faisant remarquer que, d’après M. Perrot, les Canadiens se figuraient Michinsi, le dieu des eaux, sous la forme d’un gros chat ou d’un tigre qui, par les mouvements de sa queue, produisait les tempêtes et l’agitation des flots. Précisément, dans la symbolique des nations civilisées de l’Amérique, une autre sorte de félin, le jaguar ou panthère, était d’ordinaire pris comme emblème du principe humide femelle et de la puissance lunaire, tandis que l’aigle personnifiait le principe opposé, mâle et solaire. D’autres tribus de race algique possèdent la même légende, mais, ce semble, avec mélanges de traditions relatives au déluge. Voici celles des Montagnais, telle qu’elle fut traduite de leur idiome par le père Lejeune, en 1643 :
« Un jour que Messou était à la chasse, les loups dont il se servait en guise de chiens entrèrent dans un Grand lac et s’y arrêtèrent.
Messou, regardant tout autour de lui, aperçut un oiseau qui lui dit : « Je les aperçois au milieu du lac. Il entra donc lui-même dans l’eau pour leur porter secours, mais les eaux du lac s’étant enflées sortirent de leur lit et inondèrent l’univers.
Messou, fort étonné de cet évènement, envoya le corbeau pour chercher une motte de terre avec laquelle il pût restaurer l’univers ; mais l’oiseau ne revint pas. Alors le dieu chargea la loutre de la même commission ; toutefois l’animal revint sans avoir pu l’accomplir. Alors le rat musqué fut dépêché. Étant parvenu à se procurer une toute petite pincée de terre, il la remit à Messou. C’est par ce moyen que le dieu parvint à rétablir le monde dans l’état où il se trouve aujourd’hui.
Les arbres avaient perdu leurs branchages. Messou lança ses flèches contre leurs troncs dépouillés, et elles se transformèrent en branches. Il se vengea de ceux qui avaient retenu ses loups dans les eaux et repeupla l’univers par son mariage avec le rat musqué. »
Ce récit mérite d’être signalé à l’attention du lecteur, d’abord à cause du mélange déjà signalé de deux traditions différentes et ensuite parce que le rôle qui y est assigné au corbeau rappelle tout à fait la narration mosaïque. Signalons encore le trait des flèches transformées en branches d’arbres. On retrouve quelque chose de fort analogue dans la légende du second Quetzalcoatl. Le roi-pontife de Chollula, obligé de fuir la fureur de ses ennemis victorieux, lança près de Huéhué Quauhtitlan des pierres dans un arbre où elles restèrent enclavées. Une autre fois il perça un pochotl (Bombax Pentandrum) de façon à figurer une croix. La légende des Michabous, tribu de la nation Ottawa, se rapproche, à la fois, de celle des Montagnais et de celle des Indiens des rives du Saint-Laurent, mais on n’y signale plus la présence du corbeau.
« Les Ottawas de la famille du Michabou, c’est-à-dire du Grand-Lièvre, prétendaient que ce dit Grand-Lièvre était un homme d’une prodigieuse grandeur, qu’il tendait des filets dans l’eau à dix-huit brasses de profondeur et que l’eau lui venait à peine aux aisselles ; qu’un jour, pendant le déluge, il envoya le castor pour découvrir la terre, mais que cet animal n’étant point revenu, il fit partir la loutre, qui rapporta un peu de terre couverte d’écume ; qu’il se rendit à l’endroit du lac où se trouvait cette terre, laquelle formait une petite île, qu’il en fit le tour en marchant sur l’eau, et que cette île devint extraordinairement grande ; c’est pourquoi ils lui attribuent la création de la terre. Ils ajoutent qu’après avoir achevé cet ouvrage, il s’envola au ciel, qui est sa demeure ordinaire ; mais qu’avant de quitter la terre, il ordonna que quand ses descendants viendraient à mourir, on brûlerait leur corps et qu’on jetterait leurs cendres au vent, afin qu’ils pussent s’élever plus facilement vers le ciel ; que, s’ils y manquaient, la neige ne cesserait pas de couvrir la terre, que leurs lacs et leurs rivières demeureraient glacés, et que, ne pouvant point pêcher de poissons, qui constituent leur nourriture ordinaire, ils mourraient tous de faim au printemps. »
De là vient, chez les Michabous, l’usage constant de brûler les cadavres de tous ceux qui appartiennent à leur clan. Au contraire, les deux autres tribus de la nation ottawa, à savoir celle de Namépich ou de la carpe et celle de Machova ou de l’ours, ont l’habitude d’ensevelir leurs morts.
Signalons ce fait important que dans les légendes dont il vient d’être question (sauf la dernière, qui a pu être altérée soit par les Indiens eux-mêmes, soit par les Européens, qui nous la font connaître), on parle toujours de trois voyages entrepris par autant d’animaux différents. Ce trait est caractéristique et nous pouvons le considérer comme incontestablement empreint d’archaïsme. Les Wogoules mentionnent également les trois tentatives d’Elempi, et dans la Bible, nous voyons le même nombre de voyages entrepris, tant par le corbeau que par la colombe. Il est vrai que, dans ces deux derniers récits, deux volatiles figurent seuls, et cette dernière particularité mérite certainement d’être tenue pour primitive.
En Amérique, la légende en question semble avoir, à l’origine du moins, été propre à la race algique, tout aussi bien que le culte de Messou ou de Michapou. Par la suite des temps, elle fut transmise d’une façon plus ou moins complète, plus ou moins détaillée à des peuplades d’origine différentes. Les Indiens Côtes de chiens ou Flats dogs ribes des rives du Mackensie sont la seule tribu de race athabaskane ou denné-dindjié possédant, à notre connaissance, une tradition analogue. Sans doute, ils l’auront reçue de leurs voisins du Sud. Encore entremêlent-ils le récit du déluge avec celui de la création. Suivant ces Indiens, Tchaëpiwich, leur premier ancêtre, dut monter en canot pour échapper à l’invasion des eaux. Il avait eu soin de prendre avec lui des animaux et des oiseaux de toute espèce. L’eau séjournait depuis bien des jours sur la terre lorsque Tchaëpiwich s’écria : Cela ne peut durer de la sorte, nous devons retrouver la terre ! » Et il envoya un castor chercher du limon. Le castor se noya et l’on vit flotter son corps à la surface de la mer. Alors le navigateur fit sortir le rat musqué. Ce deuxième messager resta longtemps absent. Il revint, enfin, presque mort de fatigue, tenant une petite motte entre ses pattes. À cette vue, Tchaëpiwich se réjouit ; il soigna d’abord son fidèle serviteur, le caressa doucement, le réchauffa dans son sein jusqu’à ce qu’il fût entièrement rétabli. Le héros prit ensuite la terre et, façonnée entre ses doigts, la posa sur l’eau, où elle grandit de manière à former une île immense.
À mesure que nous avançons plus vers le sud, le souvenir de ce récit cosmogonique tend de plus en plus à s’effacer, et nous n’avons pu en constater que des vestiges au sein des races de la Nouvelle-Espagne. Il était toutefois connu de certaines tribus du midi des États-Unis, lesquelles, sans aucun doute, doivent l’avoir reçue de leurs voisins du Nord.
Ainsi, trois ou quatre vieillards, chargés du dépôt des traditions religieuses des Kapawassou-Arkansas (territoire de l’Arkansas), firent aux missionnaires le récit suivant :
« Du temps où toute la terre était inondée, un dieu vêtu de blanc et portant un petit sac de tabac sur l’épaule vint tirer les hommes de l’abîme, puis il se mit à leur tête pour chercher un asile. La terre était toute couverte de ténèbres. Le castor ayant plongé, rapporta du limon. C’était le symbole de la nouvelle patrie qu’ils devaient habiter. Ensuite, un aigle blanc arriva, tenant au bec un rameau vert. Le divin vieillard quitta alors ses compagnons, après leur avoir donné divers conseils. Le pays où arrivèrent les fugitifs était situé au nord et très froid. La tribu s’étant ensuite décidée à l’émigration se dirigea de plus en plus vers le sud. C’est là qu’elle s’établit à la suite de grands combats. Si les Arkansas voient un aigle voler flans les airs, pendant qu’ils préparent une expédition de guerre ou de chasse, ils s’arrêtent aussitôt. Les mêmes sauvages auraient, dit-on, mais cela paraît plus douteux, également conservé le souvenir de la confusion des langues. »
Le divin guide qui dirige les Indiens vers une nouvelle patrie et leur enseigne les éléments de l’agriculture ne serait-il pas une forme du Quezuga des Chicoréens, peuple habitant au sud-est des États-Unis, sur les bords de la mer des Antilles ? Ce Quezuga, représenté comme boiteux, était le roi du séjour des bienheureux, situé vers le midi. C’est là que les âmes passaient leur temps à chanter, à danser et à faire l’amour. Quezuga, enfin, n’est, suivant toutes les apparences, autre chose que le premier Quetzalcoatl des Mexicains, mais passé de l’état de demi-dieu, de héros civilisateur à celui d’habitant de l’Olympe. Quetzalcoatl, on le sait, nous est repré- comme ayant colonisé les rivages du sud-est de la Nouvelle-Espagne, et c’est lui qui serait allé chercher dans le Tonacatépetl, litt. « Montagne de notre subsistance, de notre chair », les graines alimentaires nécessaires à la nourriture de l’homme. Il convient de se souvenir que ce héros, tout comme le vieillard de la légende Kapawassou, après avoir établi ses compagnons dans leur nouvelle patrie, les quitte, mais en annonçant son retour. Cette circonstance des hommes retirés de l’abîme nous semble fort importante parce que nous y retrouvons comme le reflet d’une croyance répandue chez une foule de tribus américaines, à savoir que notre race avait primitivement habité soit le fond d’un lac, soit les entrailles de la terre. Ainsi, les Iroquois, au dire de Pyrlœus, rapportent que leurs aïeux menaient jadis une existence souterraine et ne pouvaient jouir de la vue du soleil. Tout le gibier servant à leur nourriture consistait en taupes qu’ils étaient obligés de tuer avec leurs mains. Par un heureux hasard, Ganawagehha trouva une issue qui lui permit d’arriver à la surface du sol. Là, il rencontra un daim mort, le coupa en morceaux et, ayant emporté la viande avec lui dans les profondeurs du sol, il en fit goûter à ses compagnons. Ceux-ci la trouvèrent excellente. Aussi, lorsque Ganawagehha leur eut dépeint la beauté de ce monde supérieur, éclairé de la lumière du soleil, les mères résolurent de quitter leur ancien séjour avec toutes leurs familles et de monter à la surface. C’est depuis ce moment que l’on commença à cultiver le maïs et les autres végétaux. Une seule créature se refusa à suivre ses compagnons et resta dans sa ténébreuse patrie, c’était Nocharauoront





























