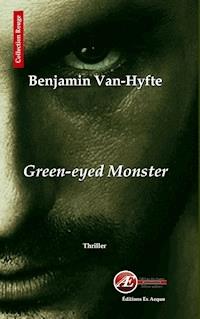
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Ex Aequo
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rouge
- Sprache: Französisch
Deux meurtres et un rituel identique : une créature aux yeux verts peinte sur la scène de crime.
Qu’arrive-t-il à Ellis Greene ? Il a tout pour être heureux. Le voilà promu chef de groupe à la brigade criminelle de Paris, après une brillante carrière dans la police. Pouvait-il rêver mieux, lui qui, vingt-cinq ans plus tôt, quittait son Amérique natale sans un sou en poche ? Mais il se sent malade : il a des trous de mémoire, des absences… Les médecins soupçonnent un Alzheimer précoce. On lui conseille de prendre un congé en attendant les résultats. Mais pour Ellis, il n’est pas question de quitter la brigade. Il vient de mettre au jour les agissements d’un tueur en série. Deux meurtres, et un rituel identique – une créature aux yeux verts peinte sur la scène de crime. Qui est donc ce tueur insaisissable ? Ellis veut en avoir le cœur net. Alors, il suit la piste du tueur aux yeux verts, malgré son état de santé, et les soupçons grandissants de sa hiérarchie.
Suivez les investigations d'Ellis Greene qui, malgré l'interdiction de ses médecins et de ses supérieurs, part à la poursuite du tueur aux yeux verts.
EXTRAIT
Je me réveille, et je pense à la maladie. A-t-elle gagné du terrain ? Quel souvenir ai-je perdu ? Je tourne la tête et je vois les cheveux d’Anna sur l’oreiller. Parfois, cette image suffit à me faire recouvrer la mémoire. Les autres jours, je délire un peu ; je m’imagine dans un vieil hôtel de Karikal, et il me faut des heures pour reconnaître la maison.
Je ne suis plus flic depuis quelques mois. Mais il hante encore mes cauchemars. Le tueur aux yeux verts, comme l’a surnommé la presse – mais avec mon équipier, on l’appelait le green-eyed monster.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Âgé de 20 ans, étudiant en commerce à Lille, Benjamin Van-Hyfte se consacre en parallèle à l’écriture. Originaire du Nord, il est passionné de littérature depuis l’enfance. Les lectures de James Ellroy et de Trevanian l’ont inspiré pour l’écriture de son premier roman policier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Résumé
Green-eyed Monster
ÉPILOGUE
Résumé
Qu’arrive-t-il à Ellis Greene ? Il a tout pour être heureux. Le voilà promu chef de groupe à la brigade criminelle de Paris, après une brillante carrière dans la police. Pouvait-il rêver mieux, lui qui, vingt-cinq ans plus tôt, quittait son Amérique natale sans un sou en poche ? Mais il se sent malade : il a des trous de mémoire, des absences… Les médecins soupçonnent un Alzheimer précoce. On lui conseille de prendre un congé en attendant les résultats.
Mais pour Ellis, il n’est pas question de quitter la brigade. Il vient de mettre au jour les agissements d’un tueur en série. Deux meurtres, et un rituel identique – une créature aux yeux verts peinte sur la scène de crime. Qui est donc ce tueur insaisissable ? Ellis veut en avoir le cœur net. Alors, il suit la piste du tueur aux yeux verts, malgré son état de santé, et les soupçons grandissants de sa hiérarchie.
Âgé de 20 ans, étudiant en commerce à Lille, Benjamin Van-Hyfte se consacre en parallèle à l’écriture. Originaire du Nord, il est passionné de littérature depuis l’enfance. Les lectures de James Ellroy et de Trevanian l’ont inspiré pour l’écriture de son premier roman policier.
Benjamin Van-Hyfte
Green-eyed Monster
Thriller
ISBN : 978-2-35962-802-9
Collection Rouge
ISSN : 2108-6273
Dépôt légal fevrier 2016
©Ex Aequo
©2016 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite.
À Loïc et Juliette,
Relecteurs assidus.
À la
1
Je me réveille, et je pense à la maladie. A-t-elle gagné du terrain? Quel souvenir ai-je perdu? Je tourne la tête et je vois les cheveux d’Anna sur l’oreiller. Parfois, cette image suffit à me faire recouvrer la mémoire. Les autres jours, je délire un peu; je m’imagine dans un vieil hôtel de Karikal, et il me faut des heures pour reconnaître la maison.
Je ne suis plus flic depuis quelques mois. Mais il hante encore mes cauchemars. Le tueur aux yeux verts, comme l’a surnommé la presse – mais avec mon équipier, on l’appelait le green-eyed monster.
Je ferme les yeux et je revois le plancher couvert de sang. Ironie du sort. Cette image, que je hais, reste gravée en moi pendant que mon cerveau efface toutes les autres.
J’écris cette longue note pour enfermer le souvenir du monstre au fond d’une étagère. Drôle d’idée, non? En général, on écrit pour se souvenir. Ce soir, au contraire, j’écris pour oublier.
Tout commença en mars 2014. J’étais alors chef de groupe à la crim’ du Quai des Orfèvres. Mon équipe fut saisie d’un assassinat, dans un appart du dixième. La victime s’appelait Arthur Klein.
En arrivant sur la scène de crime, je vis d’abord Joseph Narboni. Je le connaissais bien. C’était un vieux briscard de la police scientifique. Un spécialiste de la citation. Ce jour-là, penché sur le cadavre, il murmura :
— L’œil était dans la tombe, et regardait Caïn…
— Tu comptes entrer dans les ordres, Narboni? C’est drôle, j’ai toujours cru que tu étais athée.
— Ce n’est pas la Bible, mécréant, ce sont des vers. Et s’il faut trouver quelque chose à écrire sur la pierre tombale de notre macchabée, je pense qu’ils conviendront.
— Pourquoi donc?
— Jette un œil.
Il s’écarta un peu et désigna le cadavre avec son bistouri. Arthur Klein était allongé par terre, nu. Une corde épaisse liait ses poignets au bas de ses mollets. Les fibres avaient entamé sa peau. Des lésions, au moins une quarantaine, couraient le long de son torse. Sur chacune, le sang coagulé avait formé une auréole d’un noir poisseux. Comme des morsures de serpent.
Il y avait une longue plaie, à la gorge, suffisamment nette pour trancher la carotide et provoquer le décès. Sa bouche était entourée par un bâillon.
En promenant mon regard ailleurs, je compris ce qui avait motivé la remarque de Narboni : deux yeux verts, surmontés de deux petites cornes, étaient dessinés sur la cuisse du cadavre.
— Un tatouage?
— Non. Dans les deux cas — les yeux et les cornes — c’est de l’aquarelle toute simple qui a été utilisée. Touche un peu, si tu en doutes, l’américain.
L’américain. C’est le surnom que m’avait trouvé Narboni, à cause de mon prénom anglo-saxon. Ellis Greene. Parti des States depuis trop longtemps pour avoir gardé ne serait-ce qu’une nuance d’accent.
Je pressai mon doigt sur ce que j’avais pris pour un tatouage. Aussitôt, l’œil se déforma et laissa apparaître des incisions le long de l’iris.
— De la peinture séchée, rien de plus, commenta Narboni. Et vu la réaction de la peau, elle a sûrement été appliquée post-mortem.
— Et pour les lésions sur le ventre?
— L’homme a été longuement battu. Je suis presque certain que les coups ont été faits avec une crosse. Ça ressemble fort à des impacts de palette. La victime était encore vivante à ce moment-là, vu la coagulation du sang. Étant donné l’angle des blessures, l’assassin doit mesurer cinq à dix centimètres de plus que sa victime. Les plaies sur le haut du torse sont plus profondes, ce qui confirme cette idée.
— Et pour la blessure à la gorge?
— Faite à l’arme blanche, avec une lame très courte. C’est un coup fulgurant, rapide. Je pense à un poignard, ou une lame plus fine encore. Peut-être un couteau à huître. C’est cette blessure qui a provoqué le décès.
— L’heure de la mort?
— Entre deux heures trente et trois heures du matin. Le légiste confirmera.
— En pleine nuit. Pas étonnant pour quelqu’un qui a prévu de dérouiller sa victime avant de l’assassiner.
— Oui, c’est sûr…
Quelque chose dans sa voix me fit penser qu’il était préoccupé.
— Quoi?
— Rien, rien…
— Arrête, je vois bien que ça fourmille d’hypothèses sous ce petit crâne chauve.
— J’ai juste l’impression que quelque chose cloche.
Il montra de nouveau le cadavre :
— Dis-moi franchement : tu trouves que ce type a l’air d’un caïd?
— Pas vraiment… C’est un comptable, à ce qu’on m’a dit. Un locataire discret.
— Pas vraiment, répéta Narboni en clignant de l’œil. Alors, j’ai du mal à comprendre pourquoi ce type sans histoires s’est fait zigouiller par un tueur chevronné, et assez timbré pour dessiner une peinture sur la cuisse de sa victime.
— Qu’est-ce qui te fait dire que ce gars est chevronné?
— Eh bien, tout ça est trop propre pour un amateur. Pas un cheveu, pas une fibre, pas une empreinte. L’assassin a même nettoyé les doigts du cadavre pour qu’on ne retrouve pas de chair sous les ongles. C’est du travail de pro. Quelque chose me dit qu’il portait des vêtements de protection, tout comme nous.
Pour illustrer son idée, Narboni tapota la charlotte qui recouvrait son crâne dégarni.
— Autrement dit, tu penses que l’assassin et la victime forment un drôle de couple.
— Je ne pense rien. Je ne fais que constater. Et mon constat, c’est que le mode opératoire ne colle pas avec le profil de la victime. Après, tu en déduis ce que tu veux. Penser, c’est ton job, l’américain.
La mort de Klein coïncida avec l’entrée à la crim’ d’une nouvelle recrue : Guillaume Crombez, la trentaine, et deux ans et demi de carrière aux stups. Schneider, mon patron, me chargea de former Crombez les premières semaines, et de veiller à sa bonne intégration dans mongroupe d’enquête.
C’était un lundi matin, et je broyais du noir avant même que le procureur nous passe un coup de fil. L’idée d’avoir ce Crombez dans les pattes m’agaçait plus qu’autre chose. Ce n’était pas de la mauvaise volonté; juste que j’avais entendu des trucs sur ce type. On disait qu’il avait fait foirer une saisie de coke, d’où son départ précipité des stups. La façon dont Schneider me présenta le bonhomme ne fit rien pour me rassurer.
— Veille bien sur lui, Greene. C’est un bon flic, il a un grand potentiel. Il est juste un peu sanguin.
Pour une bleusaille de soixante kilos, avoir le sang chaud peut être une qualité. Mais en feuilletant le dossier de Crombez, je découvris qu’il avait la carrure d’un boxeur poids lourds, et qu’il avoisinait le mètre quatre-vingt-dix.
— Et je suis censé faire quoi s’il s’énerve?
Amine leva les yeux de son journal. Lui et moi partagions le même bureau depuis huit ans — un record à la crim’ — et chacun avait pris l’habitude d’écouter l’autre d’une oreille attentive. Une sorte d’accord informel, car en règle générale, nous étions tous les deux de très mauvais confidents.
— Tu lui mets un coup de Taser.
— Je ne sais pas si Schneider avait ça en tête quand il m’a demandé de veiller sur lui.
— Qui sait ce qu’il a en tête? Schneider a tellement potassé le management à l’anglo-saxonne que quand un flic prend la porte, il préfère dire que notre cher collègue s’envole vers d’autres horizons.
Il mima des guillemets, pour m’assurer que la citation était authentique.
— Mmh. Mais alors, quel adjectif il faut deviner quand on me dit que Crombez est sanguin?
Amine haussa les épaules, et proposa :
— Bourrin?
Mon rire retentit jusque dans le couloir, où passaient deux lieutenants qui jetèrent un regard curieux dans ma direction.
— Vu son physique, je ne serais pas étonné.
— Il bossait où, avant?
— Aux stups. Deux ans et des poussières.
— Qu’est-ce que ça apprend, un bleu aux stups? Ça sait taper à la machine? Faire du café?
— J’en sais rien. En tout cas, ça sait écouter. J’étais censé le rencontrer à onze heures, mais il est midi passé et Schneider lui tient toujours le crachoir.
Je le savais, car, quelques minutes plus tôt, j’étais passé devant le bureau de Schneider, et j’avais aperçu Crombez à travers la vitre en verre fumé.
Il se tenait debout, la tête légèrement inclinée. Sa silhouette était si imposante qu’elle donnait l’impression de remplir tout l’espace du bureau, et en le voyant se balancer d’un pied sur l’autre, j’avais presque été soulagé que les murs ne s’effondrent pas.
Je n’étais pas entré. Mieux valait laisser Schneider finir sa leçon de morale sur les qualités du flic modèle. Tous les nouveaux venus passaient par là. J’y avais échappé, uniquement parce que Schneider était toujours à l’école de police quand je posais mes cartons au premier étage du 36.
Et parce que, l’année de son parachutage à la crim’, il avait appris, à ses dépens, qu’Ellis Greene n’acceptait pas d’autres sermons que ceux du pasteur.
Ma première rencontre avec Crombez eut lieu le même jour, vers seize heures, sur la scène de crime. Je consultais le contrat de location de Klein, quand j’entendis Claire, qui m’appelait depuis le balcon.
— Greene! Je pense que ton élève est arrivé…
Je sortis. En me penchant sur la balustrade, je vis un homme aux dimensions d’ogre, rajeuni par des cheveux très clairs qu’une raie soignée séparait en deux. Il était courbé, dans la cour intérieure de l’immeuble, une main collée contre la gouttière; il vomissait.
Je descendis les escaliers, en me demandant s’il vomissait à cause du cadavre, ou bien parce que le long entretien avec Schneider avait eu raison de ses tripes.
— Lieutenant Crombez?
Je lui tendis un mouchoir. Il s’essuya la bouche, se releva et me fit face. Je découvris sa tête, qui dépassait la mienne de quelques centimètres.
Ma surprise fut telle que je reculai d’un pas. J’attendais un visage buriné, un nez écrasé par les coups, un regard bovin. Le visage de Crombez était tout l’inverse : fin, harmonieux, allongé par un long nez retroussé… Et percé par deux yeux brûlants, où l’on pouvait lire autant de crainte que de défi.
Avant d’être appelé sur la scène de crime, j’avais feuilleté ses états de service.
Mandelbaum, son mentor aux stups, avait écrit : «vif d’esprit, bonne capacité d’analyse. Mais ne fait aucun effort d’intégration; tendance à l’insubordination…» Étonnant de voir à quel point il portait sur la figure les attributs que lui prêtait son ancien chef.
— Je suis le lieutenant Greene. Tu vas intégrer mon groupe d’enquête pour ta période de formation.
Il voulut dire quelque chose, mais la nausée l’empêchait encore de parler. Il me fit signe d’attendre, se pencha et vomit de nouveau.
— Ça va aller?
— Oui… C’est passé, merci. Désolé…
— Bien. Hum, comme tu le vois, tout le monde est déjà au travail. Quand on arrive sur une scène de crime, les hommes de mon groupe savent ce qu’ils sont censés faire.
Je pointai mon doigt vers le balcon, où Claire mitraillait la façade avec son appareil.
— Par exemple, Claire est quatrième de groupe. Son rôle, c’est de prendre des photos de la scène de crime. Elle part du cadavre, et elle s’éloigne jusqu’à prendre une vue d’ensemble. Ça nous sert ensuite pour le dossier de l’enquête.
— D’accord.
— Pour l’instant — ça changera dans les jours à venir — tu n’as pas de rôle attitré, tu es un électron libre. Ça t’évite les tâches pénibles comme la paperasse et l’enquête de voisinage. Tu peux faire ce que tu veux. Le revers de la médaille, c’est qu’il faut te creuser la cervelle pour trouver une activité utile… Tu vois la véranda derrière toi?
Crombez se retourna. De l’autre côté du grillage, une dizaine de clients prenaient le café en terrasse.
— J’ai lu sur leur devanture qu’ils faisaient des concerts trois nuits par semaine, continuai-je. Qui sait, peut-être qu’un client a remarqué une drôle d’activité la nuit dernière, dans l’immeuble d’en face. Ou, mieux encore, peut-être que le café a une caméra de surveillance braquée sur la cour intérieure… Tu devrais aller y faire un tour.
Il acquiesça et s’en alla. Je faillis conclure par un mot de bienvenue, mais il avait disparu de la cour avant que j’ouvre la bouche.
Crombez… Toute une histoire! Les quatre mois que nous avons passés ensemble ont été houleux. Je l’ai haï, d’abord. Il m’a fait quelques coups bas, en retour. C’était de bonne guerre.
Pourtant, quand la maladie empira, il fut le seul à me couvrir. Les autres m’ont cru fou. Sans Crombez, je n’aurais jamais su la vérité. Et si Crombez n’avait pas été là, jusqu’au bout, on m’aurait retrouvé raide mort, dans un mobile-home, sur un plancher sanguinolent.
2
J’ai encore passé trois heures, assis dans un fauteuil, à regarder fixement le papier peint. Sandra appelle ça un épisode apathique. Dans ma tête, ça ressemble à un court-circuit. Comme si une bestiole se promenait dans mon crâne et m’empêchait de penser.
Je me rappelle de mon premier court-circuit à la brigade, le matin suivant le meurtre de Klein. C’était un jour gris. Une pluie fine battait les carreaux de la mansarde — Bureau secret (Amine et Ellis veillent au grain!) — où l’on se réunissait toujours pour les briefs. Chacun s’assit dans la pièce suivant nos habitudes. Crombez, qui entrait dans le bureau pour la première fois, s’assit contre l’appui de fenêtre, un peu mal à l’aise.
Je pris la parole sans me douter du fiasco qui allait suivre. Je fis d’abord un résumé de l’enquête préliminaire. Le témoignage des voisins ne nous avait pas appris grand-chose. L’immeuble d’en face était occupé en majorité par de vieilles Polonaises, qui avaient l’imagination fertile quand il s’agissait d’avoir entendu un bruit la nuit dernière.
— Nous avons les informations générales sur la victime. Arthur Klein, quarante-six ans, expert-comptable. Divorcé, sans enfants. La priorité, c’est d’établir le déroulement des heures qui précèdent le meurtre. Quelles personnes ont vu Klein la veille? Ça ne va pas être facile. Je pense que le bonhomme avait peu d’attaches. Les contacts dans son calepin et sur son mobile sont assez réduits. La plupart sont des numéros professionnels. Claire, que t’a raconté le frère Jonathan?
— Ils avaient prévu de déjeuner ensemble, hier midi. Quand Jonathan est arrivé à l’appartement, il a vu que la porte fermait mal et qu’on avait brisé la serrure. Il est entré et a découvert le corps. Il a appelé les pompiers.
— Quand se sont-ils vus, dernièrement?
— Au réveillon. Depuis, Arthur n’a pas donné de nouvelles. Juste un coup de fil, il y a quelques semaines, pour dire qu’il commençait à travailler en freelance, à côté de son job. Il a parlé d’un cabinet d’audit, en Suisse. Il voulait travailler pour eux.
— Ce qui explique les séjours à Zurich, ajouta Amine en brandissant le plus récent relevé bancaire de Klein. Trois transactions qui concernent le Central Hotel, et quatre faites à la gare de Zurich, depuis le vingt-six février.
— Et aussi un contrat téléphonique signé en début d’année chez un opérateur suisse. On dirait que Klein se préparait à bourlinguer d’un pays à l’autre. Krohn s’occupe déjà des relevés du mobile français, je veux quelqu’un sur le mobile suisse. Lieutenant Hugard?
Claire leva le nez de ses notes, regarda autour d’elle, puis acquiesça :
— C’est dans mes cordes…
Ça manquait de naturel, sans doute à cause de la présence d’un nouveau. J’avais l’impression de répéter un texte. Crombez, d’ailleurs, nous écoutait avec un sourire en coin.
— Bien. Il faudra discuter avec les types de Zurich. Voir s’ils savent quelque chose des activités de Klein avant sa mort. Quand on en saura davantage sur la Suisse, on pourra s’attaquer à la deuxième piste de l’enquête, à savoir…
Le mémo rédigé par Narboni, l’autopsie prévue pour seize heures, le lien entre la peinture verte et d’autres crimes enterrés dans les archives du 36?
Qu’avais-je en tête en parlant d’une seconde piste? Je n’en sais rien. En un instant, mon idée s’évapora. Je n’entendis plus que les clapotis sur le carreau, et le bourdon du radiateur. Un putain de court-circuit. J’étais incapable de sortir un mot.
— Ça va, Ellis?
La voix d’Amine me parvint d’outre-tombe. Je sortis comme d’un long sommeil, et je vis les regards curieux posés sur moi. C’était si gênant. Pas une fois, dans ma carrière, je n’avais perdu mes moyens pendant un brief.
— cha vva bieeeen…
Et voilà que je fourche. Ressaisis-toi, Grenne! Ma tête enfla, devint lourde. Mon regard atterrit sur une page ouverte du dossier.
LETTRES VALERIE MONTEUX.
Trouver quelque chose à dire. N’importe quoi.
Je repris mon speech d’une voix blanche :
— Excusez-moi… La seconde piste, donc… Klein tenait une correspondance avec son ex-femme. Il conservait des… des brouillons de ses courriers. Dans une lettre… qui date du sept mars… Klein parle d’un bar, le club Nightingale, où il allait régulièrement pour écouter du rock et «discuter avec des mélomanes». Plusieurs de ses retraits de monnaie ont été faits en soirée, à un distributeur de billets situé à vingt mètres de l’établissement. Bref, un coup d’œil dans ce bar ne sera pas en pure perte.
Ça va le faire, pensai-je.
— Dans un courrier de janvier, Klein parle d’une église baptiste qu’il commence à fréquenter. Je cite : ça va te surprendre, quand on sait combien je t’ai bassiné avec mes discours contre la religion («L’opium du peuple», Marx avait raison sur ça!), mais j’ai trouvé une certaine paix intérieure au contact des autres fidèles. Il avait sympathisé avec le prêtre de l’église, le père Langlois. Apparemment, le père avait été séduit par l’enthousiasme de son nouveau disciple; il avait même envisagé de confier à Klein l’orchasignat… orgionsa…
La chemise sur laquelle reposaient les brouillons me parut soudain à mille kilomètres. Les mots se brouillaient, dansaient devant mes yeux.
Le père l’organisation d’un séminaire Langlois pour les jeunes croyants va me confier complète, tu rends te compte ? Je vais SEMINAIRE un gérer bientôt, bien plus responsabilités que chez putain de B & K on m’ait jamais donné!
L’eau tambourinait au carreau; la cafetière éclatait. Je voulus dire quelque chose. Ma bouche tomba comme le ressort d’un pantin, mais aucun mot n’en sortit.
Parle, Greene, parle! Même les plus cons en sont capables depuis le Neandertal.
— On allait lui conffffiiierrrrr… L’organichassion d’un sénimmmmm…
Le reste de la phrase s’évanouit dans un sifflement. Je fis signe à Amine de me remplacer, murmurai «désolé, me sens mal…» et sortis en trombe du bureau.
«C’est de perdre certains mots qui vous inquiète le plus?
— La mémoire qui flanche, vous voulez dire? Non, pas vraiment, je pourrais mettre ça sur le compte du stress. En revanche, il y a quelques jours, il m’est arrivé un truc encore plus inquiétant.
— Et ce truc inquiétant? Vous pensez qu’il fait partie des symptômes de votre maladie?
— C’est vous, le médecin. Je suis venu ici pour savoir si je suis un malade imaginaire, ou bien si ma tête déconne pour de vrai.
— Alors, racontez-moi…
C’était un dîner de famille comme les autres. Nous étions réunis dans le salon. Dehors, il faisait nuit, mais le jardin enneigé baignait dans une lumière cotonneuse. Anna allait et venait entre la cuisine et le salon, mettait puis retirait son tablier, faisait puis défaisait son chignon, comme si le passage d’une pièce à l’autre la faisait changer de personnage.
Du dîner, il me reste des bouts de conversation, des fragments que ma mémoire s’est chargée de mêler les uns aux autres. Cependant, je me rappelle encore très bien de la discussion, juste avant l’accident.
— Alors, Ellis, comment avance ce journal du crime?
La question venait de ma belle-mère, Hélène (Ma Coutelier, pour les intimes). Dès qu’elle en avait marre des récits militaires de son mari, le vétéran Michel Coutelier, elle posait une question au hasard à un invité. À ce jeu-là, j’étais sa victime toute désignée. Un flic de la criminelle a toujours un tas d’anecdotes sous le manteau.
— Ça avance, répondis-je sans conviction. J’ai déjà rempli la moitié d’un carnet.
— C’est quoi, cette histoire de journal? marmonna Michel. On ne m’en a jamais parlé.
Ma Coutelier fixa son mari comme s’il était le dernier des imbéciles.
— Enfin, Michel… Le journal du crime! Ellis découpe dans les journaux les brèves qui parlent de meurtres, et après il les met dans un grand carnet. Même que tu l’avais feuilleté, la dernière fois. D’accord, à l’époque, il devait y avoir cinq ou six malheureuses pages, mais c’était déjà un bel ouvrage!
Le vétéran hocha la tête sans conviction, et murmura quelque chose que personne ne comprit.
Je jetai un œil aux autres invités; personne ne suivait notre conversation. Tant mieux! Je préférais ne pas trop éventer cette histoire de journal. Que penserait-on d’un homme qui se passionne pour les récits morbides?
Ma Coutelier était la seule, dans la famille d’Anna, à trouver ma profession noble. Les autres m’ont toujours regardé comme un animal étrange.
— Quoique, je ne sais pas s’il faut se réjouir de l’avancée d’un journal du crime, reprit-elle. Ça veut quand même dire qu’il y a beaucoup de violence sur notre vieille Terre.
Cet instant philosophie vous a été offert par Ma Coutelier.
— Ce n’est qu’un passe-temps, bien sûr. Mais, qui sait, un jour je ferai le lien entre plusieurs affaires non résolues. Des meurtres qui, au premier coup d’œil, ont l’air différents, mais qui ont en fait le même modus operandi.
— Drôle de passe-temps, renchérit Anna. J’aurais mieux aimé que les horreurs de la crim’ restent à la crim’.
— C’est la rançon de la gloire, ma fille, dit le vétéran Coutelier. On ne peut pas grimper les échelons sans y perdre un peu de tranquillité. Du jour au lendemain, on se retrouve avec plus de types à gérer, plus de paperasse, et surtout plus de choses à penser. Avant, on te dit quoi faire et tu t’écrases; dès que tu passes au commandement, c’est à toi de prendre des initiatives. Et va savoir qui du chef ou du tâcheron est le plus à plaindre…
Six mois plus tôt, Schneider m’avait promu chef de groupe. Depuis, j’avais trouvé grâce aux yeux de mon beau-père, qui jusque-là ne s’était jamais retenu de pointer mon manque d’ambition. « Quand j’avais ton âge, l’état-major me faisait déjà les yeux doux », qu’il disait toujours.
— Alors, je porte un toast à la promotion d’Ellis! dit Ma Coutelier en levant son verre. Si sa montée en grade doit le faire bosser davantage, qu’elle lui donne aussi une occasion de s’enivrer.
Tout le monde trinqua.
Quelques minutes plus tard, je me trouvais sur un parking où stationnaient une dizaine de cars aux vitres couvertes de givre. Juste devant moi, une large inscription se déployait sur les deux battants rouillés d’un portail : Le Soleil est à portée de main avec les cars MOLINA TRIP!
Le froid me mordait le nez et les oreilles. J’avais à peine conscience d’où j’étais. Peut-être que je n’avais pas dépassé le pâté de maisons. Ou peut-être avais-je marché bien au-delà. Je me répétais : j’aurais dû prévenir Anna, elle va sûrement s’inquiéter.
Le soleil est à deux pas, mon cul! Trente mois qu’avec Anna on s’est enterrés ici, dans un pavillon à l’extérieur de la capitale, où il pleut à transformer les gazons en éponges grandeur nature. Et encore, sans l’aide de Ma Coutelier, on moisirait encore en plein Paris. C’est elle qui nous a suggéré de déménager. C’est même elle qui a payé les deux premières années d’intérêt à la banque pour notre maison. Elle disait «quinze ans de mariage, ce n’est ni assez court ni assez long pour vivre dans un trois-pièces». Et quand je jurais de la rembourser, elle me souriait et répondait : «Un chef de groupe fraîchement augmenté n’a pas à faire ce genre de promesse». Anna ne savait rien de l’intervention de sa mère dans nos finances.
— Mais devenir chef de groupe ne rend pas riche en un claquement de doigts, Ma, murmurai-je dans le noir.
J’aperçus des phares sur la route qui contournait le parking. Une voiture venait dans ma direction. Elle roulait lentement, à un rythme qui me rappela les rondes de nuit dans les quartiers chauds de Paris, à mes débuts.
Une pluie glacée se mit à tomber. La voiture passa un virage, puis s’approcha encore. Je reconnus mon véhicule. Anna dut me voir aussi, car elle donna un violent coup de frein quelques mètres après le vantail.
Soudain, je me rendis compte de l’absurde de la situation. J’avais laissé les invités et je m’étais barré en pleine cambrousse. Au cœur de l’hiver, à une heure du matin, sans veste, sans manteau… Sans la moindre raison.
— Quéss euj fout ichi?
— Tu es parti chercher une bouteille dans le cellier. Ensuite, on ne t’a plus revu. Je suis allée jeter un œil; la porte du cellier était grande ouverte. On t’a cherché partout… Ça fait bien une demi-heure que je sillonne les environs.
Anna tenait le volant d’une main et se rongeait les ongles avec l’autre.
— Les invités sont encore là?
— Ceux qui commençaient à s’ennuyer en ont profité pour s’en aller. Hélène et Michel m’ont dit qu’ils resteraient à la maison le temps que je te retrouve.
J’eus la vision de mes beaux-parents assis sur le canapé, guettant mon retour. Le vétéran me poserait sûrement un tas de questions; Ma Coutelier me fixerait de son air de mère Theresa venue bénir les incroyants. Comparée à ce tableau, la perspective d’un parking humide me parut tout à coup moins désagréable.
— Bordel, Ellis! Qu’est-ce qui t’a pris? Je me suis fait un sang d’encre. Regarde-toi, tu es gelé.
J’examinai mes doigts, et vis qu’ils grelottaient encore.
— J’étais très fatigué. J’ai eu besoin de prendre l’air, alors j’ai marché un peu. Après, j’ai eu un petit temps d’absence, et je ne sais plus exactement comment j’ai atterri dans ce dépôt. C’est sûrement un peu de surmenage; je dors trois heures par nuit depuis une semaine.
— Un peu de surmenage? C’est ça qui t’a poussé à marcher trois kilomètres en pleine nuit? Ne me mens pas, Ellis. Je sais que tu essayes de me rassurer.
— C’est la vérité. Je tombais de fatigue en quittant la maison. Après, ma tête a déraillé. C’est rien de grave. C’est juste ce truc qui m’embête depuis que Schneider me confie trente-six affaires à la fois. N’importe qui en tomberait malade.
Un panneau annonça le centre-ville à deux kilomètres et demi. Anna n’avait pas menti sur ma performance.
— Est-ce que tu as pris rendez-vous avec Sandra? Ma collègue de la clinique. Je t’avais donné sa carte.
— Oui, j’ai pris rendez-vous avec elle, dis-je en haussant le ton. Mais je ne vois pas pourquoi tu tiens absolument à ce que j’aille la consulter. Son dada, c’est Alzheimer. Dix contre un que j’entre dans son cabinet et qu’au bout de cinq minutes, je réalise que je me suis trompé d’adresse.
— Ironise autant que tu veux, mais s’il te plaît, va à ce rendez-vous. Fais-le pour moi. Sandra ne s’occupe pas que d’Alzheimer; c’est une neurologue de renom. Je serai plus tranquille quand tu auras passé des examens.
Nous entrâmes dans le jardin et Anna coupa le moteur. Je vis une lumière dans la maison, qui provenait de la véranda. Derrière le rideau, une silhouette — sans doute ma belle-mère — nous observait.
Je n’avais pas bougé de mon siège qu’Anna était déjà sortie de la voiture. Avant de claquer la portière, elle me regarda d’un air sombre, et dit :
— Tâche de faire bonne figure. Et trouve une histoire plus convaincante que le coup du surmenage. Mon père n’est pas né de la dernière pluie.
Arrivé dans le salon, j’avais en tête plus de mensonges crédibles que le vétéran n’avait de médailles à son veston. Mais la réaction de mon beau-père était le cadet de mes soucis.
En fait, je crevais d’angoisse. Pour la première fois, je m’étais retrouvé face à ce que j’appellerai ensuite le court-circuit.
Ce putain de sourd qui cuit.
3
Dans les jours qui suivirent, les proches et lointaines connaissances de Klein ne nous apprirent rien de passionnant. À chaque fois, le même portrait angélique : il était très gentil, il n’aurait pas fait de mal à une mouche. Un brave garçon.
L’étude des relevés nous apprit que, courant janvier, Klein avait téléphoné quatre fois à un riche chef d’entreprise, un certain Louis Kharkov. On s’intéressa de près à ces coups de fil.
Le vingt-huit mars, Amine débarqua tôt le matin au bureau, avec de nouvelles infos. Kharkov était le patron d’une boîte de papèterie et produits d’emballage, la B & K (Bergue et Kharkov).
— Et devine qui était son expert-comptable jusque vers 2002 ?
— Klein?
— Dans le mille.
À première vue, le fait que Klein ait gardé contact avec son ancien patron n’avait rien de suspect. Mais l’irrégularité de la chose éveilla ma curiosité. Pas un coup de fil de septembre à janvier, et soudain, quatre appels en l’espace d’une semaine. Au moment même où Klein changeait ses habitudes de vie et se mettait à fréquenter l’Église baptiste.
Le lendemain, avec Crombez, je rendis une petite visite à Kharkov, à Cergy, où se trouvait le siège social de B & K.
C’était un homme d’une soixantaine d’années, mais vieilli prématurément par trop de pouvoir et de bonne chère. Il était massif et marchait lentement, le dos un peu courbé.
Les photos encadrées dans son bureau permettaient de mesurer l’effet du temps sur sa figure : de ses longs cheveux bruns soignés, il ne restait plus que des touffes grisonnantes à l’arrière du crâne. Son visage était pâle, ses yeux fatigués. Cependant, quelque chose dans son sourire laissait penser qu’il n’avait rien perdu de ses talents en affaires.
— Ce vieil Arthur, murmura-t-il d’un air sombre. Si on m’avait dit qu’il partirait avant moi…
— Quand avez-vous connu monsieur Klein? demanda Crombez.
— Oh, c’était pendant l’année 88, si ma mémoire est bonne. J’avais créé la B & K deux ans plus tôt. La boîte commençait à grossir et la trésorerie devenait trop lourde pour mon associé et moi. Klein avait la vingtaine, c’était un blanc-bec qui sortait tout juste de l’université. Mais il avait grandi à Paris, dans un quartier pauvre du 19ème, et je connaissais ce quartier pour y avoir bossé comme garçon-coiffeur, du temps où je n’avais pas un rond. Je l’ai choisi pour ça, probablement. Et c’est comme ça qu’il a rejoint le navire.
Kharkov pointa du doigt le logo encadré de B & K, qui représentait une coque en papier filant sur un cours d’eau.
— Je vous sers quelque chose? Un café, peut-être?
— Non, merci, répondis-je.
Crombez secoua la tête.
— Comme vous voudrez, monsieur… Greene. C’est un drôle de nom, si je puis me permettre. Vous avez des racines britanniques?
— Américaines…
Il médita la réponse.
— Mmmh. Alors, nous sommes de la même trempe. Des hommes élevés loin de la terre de leurs ancêtres. C’est douloureux, parfois, mais ça forge le caractère. Je me suis toujours demandé s’il ne fallait pas attribuer une partie de ma réussite à tous ces connards qui m’appelaient le Polack quand j’étais à l’école.
Il promena ses doigts sur la surface du bureau en acajou face auquel nous étions assis.
— Vous n’avez pas regretté d’avoir choisi Klein, par la suite?
— Haha, non, pas une fois. C’est l’inverse que j’aurais pu amèrement regretter. J’ai tout de suite vu qu’il bossait dur, et j’ai du respect pour ceux qui ne ménagent pas leurs efforts. Arthur avait un don peu commun : il avait toujours deux longueurs d’avance sur les chiffres. Il arrivait en fin d’année avec un résultat d’exercice largement positif, et alors que je sortais le champagne, il me montrait que si on ne s’occupait pas sérieusement du compte machin chouette, la boîte coulerait en deux ans maximum, profit ou pas.
— Pour fonder un empire comme le mien, il faut deux qualités : la volonté, et la rigueur. De la volonté, j’en avais à revendre. La rigueur, en revanche, n’a jamais été mon fort. Si Arthur ne m’avait pas guidé, tôt ou tard, je me serais retrouvé criblé de dettes. Et croyez-moi, quand les créanciers du privé veulent récupérer leur fric, ils peuvent avoir plus d’imagination que les hommes d’Escobar.
Son rire se transforma en une longue quinte de toux qui lui secoua le ventre. Il se servit un verre d’eau. Crombez hésita avant de reprendre la parole.
— Pourquoi Arthur a-t-il quitté la B & K?
— Mmmh… La raison officielle est qu’une firme plus grosse que la mienne lui a proposé un poste. Il m’a dit que c’était l’occasion pour lui d’enrichir sa carrière.
— Et la raison non officielle?
Kharkov se frotta le menton, inquiet de devoir aborder le sujet.
— En 2001, j’ai été interrogé pour une affaire de corruption qui, en fait, concernait un grand ponte de la construction, Raymond Gallo, avec qui j’ai fait des affaires dans le temps. La vérité, c’est que Gallo et ses associés allaient tomber, et qu’ils voulaient entraîner le plus de monde possible dans leur chute. Alors, Gallo a déballé son linge sale. Il a craché aux flics tous les noms de patrons qui, selon lui, étaient liés à des organisations mafieuses (et mon nom figurait dans sa liste). Il a remué les vieilles affaires. Sa petite mascarade m’a mené devant les tribunaux, mais en février 2002, on m’a blanchi de toute accusation.
— Et pourtant, Klein a démissionné juste après… remarqua Crombez.
— Oui. En plus de parler aux flics, Gallo a refilé des tuyaux à la presse. Du jour au lendemain, les pisse-copies ont traîné mon nom dans la boue : on a écrit tout et n’importe quoi. J’aurais bâti mon empire avec l’argent de la drogue. J’aurais soudoyé l’administration finlandaise pour ouvrir une usine à Lahti. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, on a diagnostiqué un cancer à mon associé, qui a quitté l’entreprise l’année suivante.
— Vous pensez qu’Arthur a protégé ses arrières?
— Je pense qu’il a cru que B & K ne se relèverait pas de ces coups durs. Alors, il a pris le large. Je lui en ai voulu de me lâcher dans de telles circonstances.
— Avez-vous gardé contact avec lui depuis cette époque?
Je me gardais de préciser que les relevés téléphoniques nous avaient donné une partie de la réponse.
— On s’appelle et on s’écrit de temps en temps. Comme deux amis de longue date.
— Quand avez-vous parlé à Arthur pour la dernière fois?
— Il y a quelques semaines. J’étais en vacances dans le sud; il m’a passé un coup de fil pour prendre des nouvelles.
— Et depuis?
— Nada. On ne se parlait pas souvent.
— Il ne vous a pas paru inquiet?
— Non. En tout cas, ça ne m’a pas frappé.
Je fis un signe à Crombez, qui sortit de son porte-documents un feuillet brun, qu’il tendit à Kharkov.





























