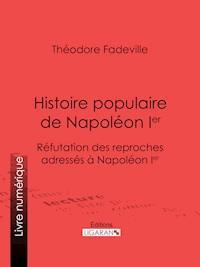
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Peuple Français ! c'est à toi que je dédie cette histoire de l'homme qui, par son ardent désir de te rendre grand et heureux autant que possible, a mérité l'extrême attachement, l'adoration que tu conserves pour sa mémoire : à toi !"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peuple Français ! c’est à toi que je dédie cette histoire de l’homme qui, par son ardent désir de te rendre grand et heureux autant que possible, a mérité l’extrême attachement, l’adoration que tu conserves pour sa mémoire : à toi ! dont le merveilleux bon sens, à travers toutes les calomnies que les puissants du jour entassaient contre son héritier, as su deviner que l’homme qu’il fallait à la France, pour contenir les trois partis qui voulaient la plonger dans l’anarchie comme en 93, ou, renouvelant 1814 et 1815, la jeter flétrie et mutilée sous les pieds des étrangers, était l’homme qui, lorsque les partis par leur coupable ambition, leurs folles espérances ou leurs passions démagogiques, conduisaient la France vers un abîme, disait : Je marche, suivez-moi ! et non point un des chefs de l’anarchie, qui n’ont jamais su dire à leurs partisans que : Marchez, je vous suis ; c’est-à-dire : vous, hommes du Peuple, exposez-vous à la prison, aux balles, à l’échafaud, tandis que nous, abrités par le rempart de vos corps, nous serons à l’abri de tout danger ; mais si vous êtes victorieux, comptez sur nous, nous nous emparerons du pouvoir.
À toi, Peuple ! dont le noble cœur est le sanctuaire où l’honneur national s’est conservé de 1815 à 1848, et qui, le 10 décembre 48, le 20 décembre 51 et le 22 novembre 52, as dit à l’Europe, de ta voix formidable : Je veux la paix, mais une paix honorable ; quoique vous fussiez vingt contre un, la victoire nous avait donné nos frontières naturelles ; la victoire, arrachée de notre camp et conduite désolée dans le vôtre par la trahison (je le prouve dans cet ouvrage), la victoire nous les a ôtées ; sous ce rapport, il n’y a rien d’ignominieux dans l’observation des traités de 1815 ; mais j’aurais été à jamais déshonoré si, le moment venu, je n’avais pas déchiré en mille morceaux la partie de ces traités où l’on me défendait, à moi, Peuple Français ! de choisir pour me gouverner la dynastie sortie de mes entrailles, mon véritable enfant, qui est la personnification de mon entier affranchissement de la féodalité. La meilleure preuve que ma dynastie est le gouvernement qui, mieux que tout autre, peut me rendre heureux, et pour que je sois heureux, il faut que je puisse marcher la tête haute, ce sont les efforts inouïs, bien supérieurs à ceux qui les avaient précédés, que vous avez faits pendant quinze ans pour l’arracher de mes bras.
Peuple Français ! pour conserver la paix, il faut toujours être prêt à faire la guerre : les agresseurs, alors, y regardent à deux fois ; pour les rendre sages, ou pour en triompher s’ils nous attaquaient, il faut leur montrer que tu es décidé à employer le meilleur moyen d’être victorieux.
Toutes les aristocraties n’auraient pas en 92, 1803 et années suivantes, ainsi qu’en 1815, rompu la paix pour plonger l’Europe dans toutes les calamités de la guerre, si elles n’avaient point compté, pour assurer leur triomphe, sur nos dissensions intérieures : c’est là la plaie de la France. Depuis deux mille cinq cents ans que notre histoire est connue, nous avons été souvent vaincus, conquis, et toujours par la même cause, par le concours que d’indignes Français donnaient aux ennemis de leur patrie.
Si ces ennemis nous attaquent de nouveau, ils n’oseront le faire que dans l’espoir d’être encore secondés par les bourboniens des deux branches voulant détruire les principes de 89, malgré toutes les protestations du contraire, et par les tartuffes de républicanisme, voulant renverser de fond en comble la société, pour s’élever sur ses ruines au pouvoir, et se gorger de richesses et d’honneurs. Le vrai républicain se conforme à la volonté de la majorité qui, seule, est la volonté nationale, qu’une minorité ne peut jamais représenter, et il défend à outrance le gouvernement attaqué par les ennemis criant bien haut qu’ils sont les alliés, les amis de la nation, qu’ils n’en veulent qu’à son gouvernement, tandis que si ce gouvernement était antipathique au Peuple, faisait son malheur, bien loin de chercher à le renverser, ils feraient tout pour le maintenir au pouvoir.
Les règles de la vie politique sont les mêmes que celles de la vie privée. Que répondrait un travailleur, n’importe dans quelle partie, à un confrère, et par conséquent à un rival, qui viendrait lui dire : Celui que vous avez chargé de vos affaires les fait très mal, il vous rend très malheureux ; aussi, j’ai la bonté de dépenser beaucoup d’argent et de courir de grands dangers pour le chasser de chez vous ; et, quand cela sera fait, je vous en glisserai un autre à sa place qui prendra bien mieux vos intérêts. Grand merci ! dirait le travailleur au trop rusé confrère ; chacun dans ce monde cherche son bénéfice, seulement, on devrait le faire loyalement. Plus il viendra de chalands chez moi, moins il en ira chez vous. Si l’homme en qui j’ai confiance ne la méritait pas, vous vous garderiez bien de m’en avertir, et surtout de vous exposer à être ruiné et battu pour l’ôter de chez moi. L’homme par lequel vous voulez le remplacer serait votre agent secret, prendrait vos intérêts beaucoup plus que les miens ; il serait forcé d’en agir ainsi, parce que s’il voulait se soustraire à votre ascendant, vous le menaceriez de lui retirer votre protection, de lui susciter des embarras qui finiraient par le faire mettre à la porte, et vous savez fort bien que dans ces changements continuels de mes hommes de confiance, mes affaires iraient de plus en plus mal, et que vous vous engraisseriez à mes dépens.
Les nations sont toujours des confrères, des rivaux courant la même carrière. Plus la prospérité intérieure et extérieure de la France sera grande et plus son commerce deviendra florissant, plus aussi ses rivales feront d’efforts pour jeter sur sa route des pièges qui l’arrêtent dans son heureuse course, et même la précipitent au fond d’un abîme.
Pour réussir dans leurs funestes desseins, elles chercheraient peut-être à se servir de la dynastie féodale, chassée par les Français trois fois dans l’espace de trente-deux ans, en 1815, 1830 et 1848, sans qu’un seul de ses membres ait eu le courage de se mettre à la tête de ceux qui combattaient pour les soutenir.
Nos rivaux verraient encore avec une vive satisfaction la république s’établir une troisième fois en France, parce qu’ils savent fort bien qu’elle traîne toujours à sa suite l’anarchie, qui détruirait notre prospérité, notre commerce intérieur et extérieur, comme c’est arrivé de 92 à 1800, et de février à décembre 48. Si la seconde république n’a pas fait autant de mal que la première, c’est grâce à toi, Peuple ! Pour la faire reculer d’abord, pour la chasser ensuite, trois fois ta souveraine et patriotique voix, retentissant dans le monde entier, a dit : Je veux avoir à ma tête les héritiers de celui qui fit rentrer la république dans le fond des enfers, d’où le génie de la dévastation l’a fait sortir, et qui répara tout le mal dont elle m’avait accablé. Peuple ! tu ajoutais : Je ne sais pas faire de belles phrases, mais j’y vois clair ; je cherche un homme, un véritable homme, pour m’aider à sortir du gouffre où m’ont laissé tomber ceux qui peuvent, à juste titre, prétendre au prix de la course. La Providence me montre du doigt cet homme dont le cœur est impénétrable à la crainte, qui saurait mourir à son poste s’il le fallait, et qui, j’en suis certain, attendra patiemment que la poire soit mûre ; mais aussitôt qu’elle le sera, sa haute intelligence et son grand courage le feront réussir dans un nouveau 18 brumaire. Enfin, disais-tu, il me faut un homme qui ait le courage civil, la fermeté de caractère, la résolution prompte et vigoureuse dont sont totalement privés les princes de la branche cadette des Bourbons.
Peuple ! l’on te dit chaque jour que si le prince de Joinville, le duc d’Aumale s’étaient trouvés à Paris en février 48, ils n’auraient pas fait comme leurs frères, ils ne se seraient pas sauvés sous de ridicules déguisements, en laissant entre les mains des émeutiers leurs enfants et leurs femmes dont une, toute jeune, était enceinte.
Pour juger les hommes, leurs paroles ne signifient rien : les tartuffes de toutes les espèces prononcent les plus beaux discours ; ce sont les actions qu’il faut considérer. Le duc d’Aumale était gouverneur de l’Algérie ; il avait sous ses ordres une armée de cent mille hommes ; le prince de Joinville était auprès de lui. Le 25 février, un membre du gouvernement provisoire, Arago, leur écrit que la veille il y a eu une révolution, que leur famille est chassée de France, que la république est proclamée, et il ordonne en même temps au duc d’Aumale de remettre le commandement de l’Algérie et de l’armée au général de brigade Cavaignac, le menaçant dans le cas où il n’obéirait pas sur-le-champ. C’est le 3 mars, il faut bien remarquer les dates, que cette dépêche parvient au duc d’Aumale ; à peine l’a-t-il reçue qu’il prépare un ordre du jour pour annoncer qu’il s’en va, et qu’en attendant l’arrivée du général Cavaignac, absent d’Alger, il remet tous ses pouvoirs au général Changarnier. Des militaires, des personnes de l’ordre civil, font des représentations aux deux princes sur un si prompt abandon. On leur dit, et avec raison, que Paris n’est point toute la France : que la république rappelle de si affreux souvenirs, qu’il se peut fort bien que les départements la repoussent avec horreur ; qu’à Paris même, il n’y aurait rien d’étonnant que les partisans de leur famille réunis à ceux dont les intérêts, les sentiments sont opposés au régime républicain, se soient comptés, ralliés, et que peut-être il est arrivé ce qu’on avait vu seulement quelques années avant à Lyon où l’émeute, maîtresse de la ville pendant plusieurs jours, fut vaincue à son tour. Votre père, ou au moins vos frères, ajoutait-on, auront sans doute été se mettre à la tête des troupes qui sont dans les provinces, pour offrir un point d’appui aux Français lassés de ces révolutions continuelles. Rien de fâcheux ne peut naître de la détermination de l’armée d’attendre, pour connaître avec certitude la volonté de la France qui, le 25 février, n’avait même pas pu être consultée sur les évènements de la veille. Si elle répudie votre famille, si elle accepte la république, aussitôt que vous le saurez, vous devrez sans nul doute lui obéir, mais alors votre retraite sera noble et digne, au lieu que maintenant elle ressemblerait trop à un sauve qui peut. Quelle fut la réponse des deux princes à ces raisonnables observations ? Le duc d’Aumale, approuvé par le prince de Joinville, se hâte de publier son ordre du jour. En même temps il en instruit le gouvernement provisoire, ce qui voulait dire : J’ai été bien obéissant ainsi que mon frère ; ne nous punissez donc pas, laissez-nous nos immenses richesses.
Dans cet ordre du jour du 3 mars, le duc d’Aumale se disait : « soumis à la volonté nationale ; » mais il était de la dernière évidence que le 25 février, jour du départ de la dépêche de Paris, la nation n’avait point pu faire connaître sa volonté ; ce n’est donc pas à elle que le prince de Joinville et le duc d’Aumale obéissaient, mais c’est à l’émeute qu’ils rendaient leurs épées. Une chose n’est bonne que faite à propos ; quinze jours plus tard, cet ordre du jour du duc d’Aumale aurait été convenable et digne, mais le 3 mars, il n’avait d’autre but que de cacher, sous la noblesse des expressions, un sauve qui peut très précipité, et qui prouve que si le prince de Joinville et le duc d’Aumale se fussent trouvés à Paris, ils eussent agi exactement comme leurs frères, et qu’ils auraient, eux aussi, dit à la nation : Débrouille-toi comme tu pourras du bourbier où nous t’avons mise ; pour nous, montrant que nos jambes sont excellentes, nous allons bravement en Angleterre jouir de notre immense fortune.
Le prince de Joinville aurait dû d’autant plus s’exposer pour préserver la France et sa famille des suites funestes de la révolution de février, que, par l’opposition qu’il faisait à son père, il a beaucoup contribué à cette révolution. Malheureusement on oublie très vite en France ; mais qu’on se reporte par la pensée en arrière de cinq ans, et l’on entendra encore les discours que tenaient ceux qui travaillaient à bouleverser la France. Ils disaient : Peut-on mettre en doute que Louis-Philippe suit de très mauvais conseils, lorsqu’on voit son propre fils, le prince de Joinville, forcé de le proclamer, et être exilé en Algérie à cause de cela. Ce raisonnement a fait que beaucoup de personnes ont agi contre Louis-Philippe, et beaucoup d’autres n’ont rien fait pour le soutenir.
L’histoire de tous les peuples, et particulièrement celle de notre révolution, montrait au prince de Joinville quels sont les résultats de ces déclamations contre l’entourage du chef de l’État. Les Girondins, non seulement ne voulaient pas la mort de Louis XVI, mais ils ne voulaient même pas sa déchéance ; tout ce qu’ils voulaient, c’était de se mettre à la place de ceux qui avait la confiance du roi, de ceux qui l’entouraient. Châteaubriant, Hyde de Neuville, de Lalot, étaient des ultra-légitimistes, et cependant, par leur acharnement contre l’entourage de Charles X, auxquels ils voulaient s’imposer, ils ont amené la chute de ce roi et de sa postérité. Après de pareils exemples, le cœur d’un bon fils aurait fait voir au prince de Joinville le sort qu’il préparait à son père et à sa famille. Celui qui n’a point été soumis, respectueux envers son père, ferait un très mauvais chef de gouvernement. Je le répète, il aurait dû tout faire pour réparer sa faute, ayant de si cruelles suites pour sa famille ; mais lui, comme tous ses frères, n’a pensé qu’à se mettre à l’abri de tout danger.
Et ce sont ces princes qui n’ont pensé qu’à leur sûreté personnelle au moment même où, dans toute la France, il se trouvait des hommes décidés à les soutenir de leur petite bourse et de leur personne (j’étais du nombre), quoique les sympathies de ces hommes fussent pour un autre pouvoir ; mais afin de garantir la France de la république démocratique qu’ils savaient fort bien devoir engendrer l’anarchie, ainsi que cela a toujours eu lieu dans tous les pays, à toutes les époques ; et ce sont ces princes, dis-je, lorsqu’un autre a fait ce qu’ils n’ont pas eu le courage même d’essayer, lorsqu’un autre a sauvé la patrie, ce sont eux qui emploient tous les moyens possibles, concurremment avec les anarchistes, pour porter le trouble, semer la division, faire naître la guerre civile dans la France, afin que les industries et les aristocraties européennes, encouragées par la certitude d’être secondées par d’indignes Français, rompent la paix dont le maintien est si fortement désiré par le gouvernement : à la vérité, il veut une paix honorable et non une paix à tout prix. Si la guerre éclatait, tout le prouve, ce serait encore une guerre de principe et de prospérité industrielle. Ruiner notre commerce, nous ravir les conquêtes de 89, voilà quel serait le but de nos ennemis.
Peuple français, dans ce pressant danger, l’histoire et ta propre expérience te disent ce qu’il faudrait faire. La république romaine, gravement menacée, se confiait à un homme et non pas à son sénat, quoiqu’il fût composé de personnes à haute capacité, à vrai patriotisme, à grand courage. C’est par le pouvoir illimité d’un seul homme que Rome a été sauvée si souvent !
La république des États-Unis d’Amérique, pendant tout le temps de l’indépendance, eut un chef toujours le même, Washington, et elle triompha.
Le pouvoir illimité que prit la Convention fut la seule cause qui empêcha l’envahissement de notre patrie ; mais comme ce dictateur, au lieu de n’avoir qu’une seule tête, en avait plusieurs, des factions se formèrent dans son sein ; chacun de ses membres voulut être le premier, dominer les autres ; pour y réussir, ils s’envoyaient réciproquement à l’échafaud. L’anarchie, née n’abord dans la Convention, se répandit dans toute la France, et créa l’épouvantable régime de la terreur. Si, à cette époque, il y avait eu un homme assez haut placé dans l’opinion publique par les preuves de capacité, de courage moral et de patriotisme qu’il aurait données, un pouvoir sans limites lui aurait été décerné, l’affreuse anarchie n’aurait pas en lieu, et nos triomphes sur les étrangers auraient été encore plus grands, car ces triomphes furent souvent compromis par les meurtrières dissensions de la Convention, et par la mort de bons généraux que la faction dominante envoyait à l’échafaud.
Domestiques, ouvriers, paysans, militaires roturiers de tout grade, vous êtes tous des parvenus, car vous ne datez que de 1800 ; ce n’est que sous le consulat et l’empire que le suffrage universel vous a réellement donné l’existence politique ; elle vous fut ravie de juillet 1815 en février 1848. Les républicains, ou plutôt ceux qui en usurpent le nom, ont rétabli le suffrage universel ; mais le voulaient-ils réellement ? C’est aux faits à nous l’apprendre. D’abord, au lieu d’en appeler, comme ils l’avaient promis, à la nation pour qu’elle se prononçât sur la forme de gouvernement qui lui convenait le mieux, eux seuls ont proclamé la république, manquant ainsi aux solennelles promesses faites seulement quelques jours avant.
L’assemblée constituante ouvre ses séances le 4 mai 48. Onze jours après, le 15 mai, les républicains veulent la renverser. Repoussés ce jour-là, ils reviennent à la charge au mois de juin, et pendant quatre jours, au nom de la fraternité, ils font couler des torrents de sang pour détruire l’assemblée qui venait d’être élue par le suffrage universel. C’est ce même suffrage qui avait nommé, en 49, la chambre des représentants, et cependant, quelques jours après son installation, les républicains, agissant comme en mai et juin 48, voulurent employer la force des baïonnettes pour la détruire.
En outre, les républicains, à la tribune et dans leurs journaux, ont souvent dit et écrit : que la nation n’avait point le droit de se donner une autre forme de gouvernement que la république démocratique, qui était au-dessus du suffrage universel.
Ces quatre exemples, ces discours et ces écrits, prouvent que les républicains n’ont jamais voulu la sincérité du suffrage universel ; qu’ils comptaient s’en servir pour se conserver ou parvenir au pouvoir leur donnant des richesses et des honneurs ; qu’à leurs yeux le peuple n’était qu’un imbécile mouton qui, même sans bêler, se laisserait traîner à l’anarchique abattoir où, pour la seconde fois, on voulait le conduire. Pendant la terreur, sur trois victimes, il y en avait deux appartenant à la classe des paysans, des ouvriers et des domestiques voulant sauver leurs maîtres. Mais, lorsque les républicains ont vu que ce mouton était un aigle aux puissantes serres, dont les yeux étincelants et pénétrants lui faisaient, promptement, découvrir le chemin qu’il devait suivre pour échapper à l’anarchie qui l’avait frappé à coups redoublés, de 92 à 1800, alors les républicains ont maudit et maudissent chaque jour le suffrage universel, se repentant très amèrement de l’avoir établi, et se promettant bien de le détruire si jamais ils reviennent au pouvoir. Du reste, ils seraient forcés d’en agir ainsi, car ils savent fort bien que malgré tous leurs efforts pour égarer ou intimider le suffrage universel, sa puissante et patriotique voix pousserait toujours le même cri qu’au 10 décembre 48, prononcerait toujours le même nom : Napoléon !
Travailleurs de tous les genres, habitants des chaumières et des ateliers, militaires roturiers de tout grade, vous le savez, le même jour, le même instant a vu naître votre existence politique et celle de la famille Bonaparte. Son chef proclama le suffrage universel, et le suffrage universel en 1800, 1802, 1804 et 1815, le fit successivement consul pour dix ans, consul à vie, empereur héréditaire. En 48, 51 et 52, les mêmes circonstances ont ramené les mêmes faits. Le suffrage universel et les Bonaparte sont donc des frères jumeaux qui, comme les frères Siamois, sont attachés si fortement ensemble, que leur mort suivrait immédiatement leur séparation.
Peuple ! il y a maintenant en France trois parvenus : toi, ton empereur et sa digne compagne. Napoléon Ier te rehaussait lorsque, en 1810, il prouvait que l’homme sorti de ton sein n’avait qu’à faire un signe, pour que les souverains des plus antiques et orgueilleuses races et commandant aux plus vastes États, se disputassent l’honneur de placer dans son lit une de leurs sœurs ou une de leurs filles. Cette preuve donnée une fois par ta dynastie suffisait à ta gloire. Napoléon III n’a dû penser, dans le choix d’une épouse, qu’à ton bonheur d’abord, au sien ensuite. Pour votre bonheur à tous les deux, il fallait que sa compagne eût les mêmes sentiments que lui : que, comme lui, elle aimât excessivement la classe des travailleurs et celle qui souffre. Il fallait aussi que, par sa grâce, son esprit, sa noble amabilité, elle fût digne de représenter la France et d’être la fille et la petite fille d’Hortense et de Joséphine. Mais il fallait en même temps que dans son cœur, à côté de la bonté se trouvât le courage, l’énergie dont son époux est si fortement doué, afin qu’elle fût digne aussi d’être la nièce du héros d’Arcole et du 18 brumaire. Toutes ces qualités se sont trouvées réunies dans la fille d’un homme qui, lorsque l’Espagne était partagée en deux camps, l’un, celui de l’ancien régime, reconnaissant pour chef Ferdinand, dont l’armée combattait avec les Anglais et était sous leurs ordres, tandis que l’autre, celui de l’abolition du système féodal, celui de l’égalité politique et de l’admission de tous à tous les emplois, marchait sous les lois de Joseph, du frère de notre empereur ; le père, dis-je, de cette jeune fille était venu dès le premier moment se placer dans le camp sur le drapeau duquel étaient gravés nos principes de 89, et jusqu’au dernier moment fidèle à ces populaires principes, il avait, au milieu de l’École polytechnique, sur les hauteurs de Montmartre, tiré le dernier coup de canon contre les aristocraties européennes.
Grâce à ce mariage, sur le trône français sont assis deux êtres ayant les mêmes sentiments, les mêmes qualités, et si des mauvais jours devaient renaître encore pour la France, tandis que l’un, à la tête des armées défendrait la patrie et les conquêtes de 89, l’autre, si l’ennemi s’approchait de nouveau de Paris, se placerait à la tête des soldats, du peuple, des gardes nationales, et cet ennemi n’étant plus secondé par la trahison déjouée par la présence, l’intelligence et le courage de notre impératrice, payerait cher sa témérité d’avoir marché sur notre capitale. C’est ce qu’ont bien compris les trois partis qui ne pourraient triompher que par la trahison. Aussi ; quels cris de rage ont-ils poussés ! Quel infect venin ont-ils essayé de lancer ! Mais toi, noble et patriotique Peuple ! tu as tout de suite compris que les nouvelles calomnies partaient de la même source que celles de 48, et le regard méprisant et indigné que tu as lancé sur les serpents qui cherchaient à mordre la lime, leur a promptement fermé la bouche et fait baisser les yeux.
Mais, si les étrangers, excités par ces trois partis, voulaient te barrer le chemin de l’honneur et de la prospérité, où, conduit par la puissante main de ton empereur, tu marches d’un pas si fier et si ferme, alors lui, patriotiquement inspiré, se mettrait à ta tête, et toi, Peuple, tu lui dirais : Je remets entre tes mains, pendant tout le temps de la guerre, ma souveraineté qui ne peut pas avoir de bornes ; repousse les ennemis comme en 93, mais en me préservant de l’horrible anarchie qui me fit tant de mal à cette époque ; paralyse en même temps les efforts de ces indignes Français qui, en profanant le nom de la liberté, voudraient me diviser en plusieurs camps ennemis et déchirer le drapeau national en plusieurs parties, ainsi qu’ils l’ont fait en 1814 et 1815, afin que les aristocraties européennes se décorant, comme autrefois, du nom d’alliées, pussent de nouveau me précipiter, flétri et mutilé, sous les roues de leur char de triomphe traîné par le mensonge et la trahison.
Depuis le commencement de 1769, la Corse était devenue province française. C’est dans cette île, à Ajaccio, que Napoléon Bonaparte naquit le 15 août 1769, anniversaire du jour où Louis XIII plaça la France sous la protection de la sainte Vierge.
En Corse, le régime féodal n’a jamais existé ; il n’y avait point de noblesse, mais il y avait de l’illustration, c’est-à-dire qu’une famille dont un membre avait rendu des services à la patrie, ou bien, en se distinguant sur le continent, avait fait rejaillir sur elle un reflet glorieux, conservait, par le souvenir, une prépondérance toute morale, et si, à cet avantage, cette famille joignait assez d’aisance pour être tout à fait indépendante, elle devenait le centre, le point de réunion d’une partie de ses concitoyens qui se plaçaient sous ses ordres, et formaient ainsi une piève ou canton. Ces cantons, souvent ennemis, se réunissaient sur-le-champ contre les étrangers qui voulaient les assujettir, et comme ces guerres pour l’indépendance nationale se renouvelaient souvent, il y avait très peu de famille corse qui n’eût produit un homme remarquable, et ne jouît par conséquent de cette illustration dont je viens de parler.
L’égalité politique existait donc complètement dans cette île : aussi le marquis de Maillebois chargé de former le régiment royal-corse, éprouva d’assez grandes difficultés, parce que les plus simples paysans aspiraient au grade d’officier, et appuyaient leurs prétentions sur des preuves que des membres de leurs familles les avaient illustrées.
Par de grands services rendus à sa patrie dans les guerres pour l’indépendance nationale, ainsi que par la gloire acquise sur le continent, même dans des temps déjà fort anciens, la famille de Napoléon possédait cette illustration, accrue encore par son père, Charles Bonaparte, et par sa mère Létizia Ramolini, femme dont la grande beauté était le moindre avantage. Énergique et courageuse, souvent elle partageait les périls des expéditions de son mari qui, en 1757, avait puissamment contribué à la guerre contre Gênes attaquant sans cesse, depuis six cents ans, la Corse pour la mettre sous son joug.
Charles Bonaparte joignait aux avantages extérieurs une éducation très soignée, beaucoup d’intelligence, un ardent patriotisme et un grand courage ; il était placé haut dans l’estime de ses concitoyens : aussi, lorsqu’en 1779, la province de Corse envoya une députation à Versailles, Charles Bonaparte fut choisi, avec quelques autres, pour figurer l’ordre de la noblesse, Louis XV voulant qu’il y eût trois ordres en Corse comme dans les autres provinces. C’est alors que Napoléon entra à l’école militaire de Brienne. En 1783, il passa à celle de Paris au moyen d’une dispense d’âge et d’une faveur d’examen, que lui fit obtenir l’inspecteur des écoles militaires qui, dans ses tournées antérieures, avait conçu pour lui une vive affection. Dans une note sur Napoléon, il disait au ministre : « Caractère soumis, honnête et reconnaissant ; conduite très régulière. »
Le brillant examen subi par Napoléon lui fit obtenir, à seize ans, une lieutenance en second au régiment de La Fère. Bientôt après, il entra, comme lieutenant en premier, dans le quatrième régiment d’artillerie en garnison à Valence, où il était lorsque la révolution de 89 brisa les chaînes féodales dont les roturiers étaient encore chargés. En 92, le 6 février, il fut nommé capitaine d’artillerie, et en septembre, il était en congé auprès de sa famille. C’est alors qu’il fut soumis à une de ces épreuves presque au-dessus des forces humaines, et à laquelle il aurait infailliblement succombé si son cœur n’avait pas été entièrement français.
Pascal Paoli, accueilli, en 1790, avec le plus grand enthousiasme par l’assemblée nationale et les Parisiens, fut un an après nommé gouverneur de la Corse. Dévoré d’ambition, il forma le projet de s’en faire roi ; mais lorsqu’il vit qu’il ne réussirait pas, il tourna les yeux vers l’Angleterre pour l’aider à séparer violemment le département de la Corse de la mère-patrie.
Paoli était frère d’armes et ami intime du père de Napoléon, ainsi que de toute sa famille. Dès sa première jeunesse, Napoléon avait été en correspondance avec lui ; il l’aimait, le respectait, l’admirait excessivement. Paoli, de son côté, affectant d’avoir pour Napoléon la tendresse du meilleur des pères, emploie tous les moyens, si puissants sur le cœur, l’esprit et la vanité d’un jeune homme, pour le séduire et l’attacher à son parti ; mais lorsque Napoléon voit que Paoli est à la tête du parti de l’Angleterre, son cœur tout français ne balance point un seul instant, et, quoique souffrant horriblement de la nécessité de rompre tous les liens qui, depuis son enfance, l’attachaient à Paoli, il se met à la tête du parti national et combat énergiquement celui des Anglais. Toute la famille Bonaparte, entièrement dévouée comme lui à la France, le seconde autant qu’elle peut.
Dans cette guerre Napoléon court de très grands dangers, mais il sait échapper aux pièges tendus par Paoli pour s’emparer de sa personne ; il dérobe aussi à sa vengeance toute sa famille, bannie, ainsi que lui, de la Corse ; leurs biens sont pillés et incendiés.
La famille de Napoléon, débarquée à Marseille, tandis que lui combattait encore, s’y trouve dans le plus grand dénuement ; mais l’énergique mère des Bonaparte demande à son travail et à celui de ses filles le nécessaire que ne peuvent plus leur procurer leurs biens confisqués, ni les faibles secours en assignats accordés aux exilés : elles se font ouvrières.
À peu près dans le même temps, les enfants qui, deux ans après, devaient être le beau-fils et la belle-fille de Napoléon, ayant perdu leur père sur l’échafaud, et leur mère étant en prison, deviennent aussi ouvriers : ils sont placés en apprentissage, Eugène chez un menuisier ; Hortense, âgée de dix ans, la mère de Napoléon III, chez une lingère.
Les cœurs bien placés trouvent dans les misères qu’ils ont éprouvées un puissant motif qui ajoute aux bons sentiments qu’ils ont reçus de la nature, pour les porter à soulager, autant qu’il leur est possible, ceux qui souffrent à leur tour ; voilà pourquoi les familles Bonaparte et Beauharnais ont toujours ressenti et ressentent encore une vive sympathie pour les paysans et les ouvriers.
Celui dont Napoléon épousa la veuve, le vicomte de Beauharnais, avait combattu en Amérique pour l’affranchissement des États-Unis. Il y fut témoin du bonheur que donne à un peuple l’égalité politique, l’égalité devant la loi : ce noble principe se grava dans son cœur. En 89, il fut élu député aux États généraux, qui devinrent peu de temps après l’Assemblée nationale. Il engagea très fortement l’ordre de la noblesse à renoncer à ses privilèges féodaux, à se fondre dans le peuple, à ne faire qu’un seul corps avec lui, et, lorsqu’il vit qu’elle repoussait ses sages et patriotiques avis, qui auraient évité tant de malheurs à la France et aux nobles eux-mêmes, il fut, le 26 juin, se placer dans les rangs du tiers état.
Le hasard avait fait naître le grand-père maternel de Napoléon III dans l’ordre de la noblesse, mais son cœur, son bon sens, son vrai patriotisme en firent un roturier. C’est dans les rangs du peuple qu’il courut se placer lorsque les étrangers et les émigrés, en 92, attaquèrent la France. Par son courage et les talents militaires qu’il avait acquis en Amérique, il parvint promptement aux premiers grades de l’armée. Il fut nommé général en chef de celle du Rhin, qui remplit dignement sa mission, en retardant, autant que possible, la prise de Mayence.
Robespierre, qui ne trouvait pas que l’armée fût assez désorganisée par l’émigration des officiers ayant appris en Amérique l’art de la guerre, fit rendre un décret pour que les ex-nobles, malgré les preuves qu’ils avaient données de leur amour pour la patrie, ne pussent plus la servir et fussent éloignés des armées et des frontières : Beauharnais se retira dans un bien qu’il possédait dans l’intérieur. Heureusement, Napoléon, n’étant point noble, ne fut pas atteint par ce décret.
Robespierre ne se contentait pas de destituer les nobles qui s’étaient faits roturiers et combattaient pour le triomphe des idées de 89, il les envoyait à l’échafaud. L’amour pour le peuple que le général Beauharnais avait montré dès l’ouverture des États généraux, rendait son supplice inévitable : il périt courageusement le 5 thermidor an II, et ses biens furent confisqués.
Napoléon, ne pouvant plus combattre en Corse les ennemis de la France, est assez heureux pour leur échapper ; il débarque à Marseille en mai 93, et se rend à Paris. Après la proclamation de la République, il ne restait plus que deux partis : celui de la contre-révolution, du rétablissement du système féodal, ou bien le parti qui lui était opposé. La République, aussi cruelle, aussi destructive de toute liberté et de toute garantie sociale que l’aurait été l’émigration si elle avait triomphé, combattait au moins pour conserver la plus précieuse des conquêtes de 89, l’égalité politique, ainsi que l’indépendance nationale sans laquelle il n’y a que honte et malheur : la Pologne le prouve. Entre ces deux partis, le choix de Napoléon ne pouvait pas être un seul instant douteux : il fut républicain.
Le 28 août 93, les comités insurrectionnels de Toulon livrent cette ville à l’amiral Hood, commandant les escadres anglaise, espagnole et napolitaine, ayant à leur bord quatorze mille soldats. Le premier soin de l’amiral anglais est de désarmer la garde nationale et tous les autres habitants, quoiqu’ils eussent proclamé Louis XVII et arboré le drapeau blanc. Les Espagnols, se fondant sur ce que leur roi est un Bourbon, demandent que le commandant de Toulon soit pris parmi eux ; les habitants, de leur côté, expriment le désir que l’oncle de Louis XVII, Monsieur, régent du royaume, puisse venir à Toulon ; mais l’amiral Hood refuse les demandes des uns et des autres, prouvant par là que les Anglais veulent faire pour Toulon ce qu’ils avaient fait pour Gibraltar, remis seulement comme dépôt entre leurs mains par le parti espagnol combattant le parti français, mais qu’ils n’ont point restitué à l’Espagne lorsque la guerre fut terminée.
Napoléon, chef de bataillon, est envoyé le 12 septembre à l’armée destinée à l’attaque de Toulon ; il y commande en chef l’artillerie, qu’il trouve manquant absolument, tant en personnel qu’en matériel, de tout ce qui est nécessaire pour un siège. Par sa prodigieuse activité, il la pourvoit promptement de tout ce qui lui est nécessaire.
En août 93, la France était dans une position très critique. Les étrangers et les émigrés la pressaient de toute part ; l’insurrection de la Vendée était dans toute sa force ; les royalistes, en trompant les Lyonnais sur leurs desseins, étaient parvenus à les soulever ; Marseille et presque tout le Midi s’insurgeaient ouvertement en leur faveur ; Toulon, comme nous venons de le voir, proclamait Louis XVII et arborait le drapeau blanc. La vue de ce drapeau si longtemps celui de la France, pouvait avoir un effet contagieux sur toutes les parties du Midi et de l’Ouest, tranquilles encore, mais si mal disposées ; il fallait donc se hâter de le faire disparaître.
Si le commandant de l’artillerie de l’armée devant Toulon avait été un homme ordinaire, il eût exécuté les ordres donnés par le général en chef et les représentants du peuple. On eût fait le siège suivant les règles en attaquant le corps de la place ; ce siège eût nécessairement traîné en longueur, et qui sait les évènements politiques qui auraient pu en résulter ? Napoléon, en homme supérieur, vit sur-le-champ l’endroit vulnérable, et les autres le voyaient si peu que ce ne fut qu’à force de ténacité, par l’ascendant que donne le génie et en engageant sa tête, qu’il put faire adopter ses plans : Toulon fut promptement repris. Voilà le premier service, non seulement militaire, mais politique, qu’il rendit à la révolution.
Bientôt après il fut comme général de brigade à l’armée d’Italie ; celui qui la commandait, Dumerbion, qui était malade, sentait son incapacité, et se laissa conduire par Napoléon : il essaya dès lors ces extraordinaires manœuvres qui deux ans plus tard nous valurent la conquête de l’Italie. Grâce à lui, cette armée, quoique démoralisée, en tombant souvent comme la foudre sur les ennemis, parvint à les contenir et à les empêcher de venir appuyer les royalistes du Midi.
Les thermidoriens, comme tous les gens sans capacité et sans caractère, avaient essayé du système de bascule. Par là ils s’étaient aliéné le peuple. Pour annuler son influence, ils avaient fait la constitution de l’an III afin que les élections appartinssent à la haute classe de la société ; celle-ci composait à Paris la garde nationale réorganisée qui n’était point opposée à la révolution ; mais, épouvantée de l’ombre de 93, et sans se bien rendre compte de la marche qu’on lui faisait suivre, elle se laissait conduire par les royalistes couverts d’un vernis de patriotisme. Les thermidoriens, pour contrebalancer les chances qu’ils avaient données à ceux-ci par les élections, avaient décidé qu’un tiers seulement des représentants pourraient être étrangers à la Convention, mais que les deux autres tiers seraient nécessairement choisis parmi les conventionnels, espérant avant l’élection d’un autre tiers détruire l’influence royaliste qu’eux-mêmes avaient fait renaître contre leur volonté et par leur maladresse.
La Convention ordonna qu’il n’y aurait qu’un seul vote appliqué à ce décret et à la constitution que le peuple était appelé à sanctionner, de sorte qu’il fallait, pour rejeter le décret, ne point accepter la constitution.
Les gardes nationales de Paris, comme le reste de la France, désirant vivement la fin de la dictature des conventionnels, acceptaient donc avec empressement la constitution ; mais en même temps, pour entrer tout de suite en possession de l’influence qu’elle leur donnait, elles voulaient contraindre, par la force des armes, la convention à rapporter son décret sur la manière dont la première élection serait faite, et le 12 vendémiaire elles s’insurgèrent.
Le général Menou, nommé par la Convention chef de la force armée chargée de s’opposer à leurs tentatives, leur donna une grande force morale en parlementant avec elles, et en disposant tellement ses troupes, que sans combattre et par une retraite précipitée, il donna aux gardes nationales l’escendant de la victoire.
Le 13 vendémiaire la Convention fut attaquée par la garde nationale, renfermant dans son sein beaucoup de chouans et d’émigrés venus secrètement à Paris, et conduite par des chefs royalistes qui savaient bien que, dans tout, le premier pas est le plus difficile à faire faire, et ce premier pas une fois obtenu, ils espéraient avec raison conduire la garde nationale beaucoup plus loin qu’elle ne voulait aller. Cette garde nationale, menée par les royalistes dont elle ne voulait pas, criait : Vive la liberté des élections ! aussi fortement que la garde nationale de février 48, faisant la courte échelle aux républicains, dont elle ne voulait pas non plus, criait : Vive la réforme !
Dans la nuit du 12 au 13, le commandant de l’artillerie de Toulon remplaça Menou, brave et bon général, tout dévoué à la révolution, mais qui, inférieur à cette haute mission, avait plié sous le faix dont il se trouvait chargé. Napoléon, par son activité, par ses dispositions aussi rapides que le coup d’œil de l’aigle, par le feu qu’il communiquait à ceux placés sous ses ordres, répara tout le temps et l’ascendant qu’avait perdu Menou. Lorsque les royalistes se présentèrent à la tête de la garde nationale, ils furent promptement vaincus, et sans grande effusion de sang, parce que Napoléon, aussitôt qu’il les vit ébranlés par ses premières décharges, ne fit plus que tirer à poudre, le bruit seul étant suffisant pour achever leur déroute.
Le moindre résultat que les royalistes auraient obtenu du triomphe de la garde nationale (et il aurait pu conduire immédiatement à la contre-révolution, si leur chef s’était trouvé un homme supérieur, puisque ce triomphe aurait coïncidé avec celui des armées étrangères et la trahison de Pichegru), le moindre résultat, dis-je, aurait été de donner dans le corps législatif, chargé de nommer les membres du Directoire, une très grande majorité aux royalistes, puisque, un an après, ils obtinrent cette majorité, ou au moins en approchèrent de très près, quoiqu’il restât encore dans les conseils un tiers de conventionnels, et la contre-révolution se serait opérée par des moyens légaux. Le service que Napoléon rendit à cette époque à la cause patriotique de 89 fut donc immense.
Jusqu’ici Napoléon n’était apprécié que de ceux qui avaient pu le voir de près ; ses services militaires et politiques, quoique grands, n’avaient point encore cet éclat dont les yeux de tout un peuple sont frappés ; mais appelé bientôt après le 13 vendémiaire au commandement de l’armée d’Italie, il va dissiper les ténèbres qui l’environnent encore, et, semblable au soleil s’élançant de l’horizon, éclipser tous ceux qui brillaient avant son apparition, et fixer sur lui seul les regards du monde entier.
Pour rendre une justice complète à Napoléon, pour bien se rendre compte de tout ce qu’il a fait pour le triomphe des idées de 89, il faut examiner la situation de la France lorsqu’il apparut réellement sur la scène politique.





























