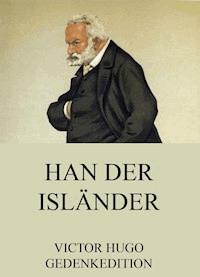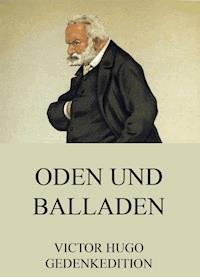Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre numérique comprend des oeuvres majeures de Victor Hugo pendant l'exil. L'édition est méticuleusement éditée et formatée. Victor Hugo (1802-1885), est un poète, dramaturge et prosateur romantique considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l'Histoire du xixe siècle. L'exil est un épisode de la vie de l'homme de lettres français Victor Hugo au cours duquel il réside hors de son pays, donc en exil, en réaction au coup d'État du 2 décembre 1851, perpétré par Louis-Napoléon Bonaparte. Le poète, dramaturge et romancier s'établit en Belgique puis dans les îles Anglo-Normandes. Il ne rentre en France qu'après la bataille de Sedan en septembre 1870. Entre temps, il publie certaines de ces œuvres majeures, parmi lesquelles Les Châtiments et Les Misérables. Contenu: Napoléon Le Petit Les Châtiments Les Contemplations La Légende des siècles Les Misérables Les Travailleurs de la mer Histoire d'un crime
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 5651
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hugo En Exil: Oeuvres Majeures
Table des matières
Napoléon le Petit (1852)
Livre Premier – L’Homme
I. Le 20 décembre 1848
Le jeudi 20 décembre 1848, l’Assemblée constituante, entourée en ce moment-là d’un imposant déploiement de troupes, étant en séance, à la suite d’un rapport du représentant Waldeck-Rousseau, fait au nom de la commission chargée de dépouiller le scrutin pour l’élection à la présidence de la République, rapport où l’on avait remarqué cette phrase qui en résumait toute la pensée : « C’est le sceau de son inviolable puissance que la nation, par cette admirable exécution donnée à la loi fondamentale, pose elle-même sur la Constitution pour la rendre sainte et inviolable » ; au milieu du profond silence des neuf cents constituants réunis en foule et presque au complet, le président de l’Assemblée nationale constituante, Armand Marrast, se leva et dit :
« Au nom du peuple français,
« Attendu que le citoyen Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, né à Paris, remplit les conditions d’éligibilité prescrites par l’article 44 de la Constitution ;
« Attendu que, dans le scrutin ouvert sur toute l’étendue du territoire de la République pour l’élection du président, il a réuni la majorité absolue des suffrages ;
« En vertu des articles 47 et 48 de la Constitution, l’Assemblée nationale le proclame président de la République depuis le présent jour jusqu’au deuxième dimanche de mai 1852. »
Un mouvement se fit sur les bancs et dans les tribunes pleines de peuple ; le président de l’Assemblée constituante ajouta :
« Aux termes du décret, j’invite le citoyen président de la République à vouloir bien se transporter à la tribune pour y prêter serment. »
Les représentants qui encombraient le couloir de droite remontèrent à leurs places et laissèrent le passage libre. Il était environ quatre heures du soir, la nuit tombait, l’immense salle de l’Assemblée était plongée à demi dans l’ombre, les lustres descendaient des plafonds, et les huissiers venaient d’apporter les lampes sur la tribune. Le président fit un signe et la porte de droite s’ouvrit.
On vit alors entrer dans la salle et monter rapidement à la tribune un homme jeune encore, vêtu de noir, ayant sur l’habit la plaque et le grand cordon de la légion d’honneur.
Toutes les têtes se tournèrent vers cet homme. Un visage blême dont les lampes à abat-jour faisaient saillir les angles osseux et amaigris, un nez gros et long, des moustaches, une mèche frisée sur un front étroit, l’oeil petit et sans clarté, l’attitude timide et inquiète, nulle ressemblance avec l’empereur ; c’était le citoyen Charles-Louis-Napoléon Bonaparte. Pendant l’espèce de rumeur qui suivit son entrée, il resta quelques instants la main droite dans son habit boutonné, debout et immobile sur la tribune dont le frontispice portait cette date : 22, 23, 24 février, et au-dessus de laquelle on lisait ces trois mots : Liberté, Égalité, Fraternité.
Avant d’être élu président de la République, Charles-Louis-Napoléon Bonaparte était représentant du peuple. Il siégeait dans l’Assemblée depuis plusieurs mois, et, quoiqu’il assistât rarement à des séances entières, on l’avait vu assez souvent s’asseoir à la place qu’il avait choisie sur les bancs supérieurs de la gauche, dans la cinquième travée, dans cette zone communément appelée la Montagne, derrière son ancien précepteur, le représentant Vieillard. Cet homme n’était pas une nouvelle figure pour l’Assemblée, son entrée y produisit pourtant une émotion profonde. C’est que pour tous, pour ses amis comme pour ses adversaires, c’était l’avenir qui entrait, un avenir inconnu. Dans l’espèce d’immense murmure qui se formait de la parole de tous, son nom courait mêlé aux appréciations les plus diverses. Ses antagonistes racontaient ses aventures, ses coups de main, Strasbourg, Boulogne, l’aigle apprivoisé et le morceau de viande dans le petit chapeau. Ses amis alléguaient son exil, sa proscription, sa prison, un bon livre sur l’artillerie, ses écrits à Ham, empreints, à un certain degré, de l’esprit libéral, démocratique et socialiste, la maturité d’un âge plus sérieux ; et à ceux qui rappelaient ses folies ils rappelaient ses malheurs.
Le général Cavaignac, qui, n’ayant pas été nommé président, venait de déposer le pouvoir au sein de l’Assemblée avec ce laconisme tranquille qui sied aux républiques, assis à sa place habituelle en tête du banc des ministres à gauche de la tribune, à côté du ministre de la justice Marie, assistait, silencieux et les bras croisés, à cette installation de l’homme nouveau.
Enfin le silence se fit, le président de l’Assemblée frappa quelques coups de son couteau de bois sur la table, les dernières rumeurs s’éteignirent, et le président de l’Assemblée dit :
— Je vais lire la formule du serment.
Ce moment eut quelque chose de religieux. L’Assemblée n’était plus l’Assemblée, c’était un temple. Ce qui ajoutait à l’immense signification de ce serment, c’est qu’il était le seul qui fût prêté dans toute l’étendue du territoire de la République. Février avait aboli, avec raison, le serment politique, et la Constitution, avec raison également, n’avait conservé que le serment du président. Ce serment avait le double caractère de la nécessité et de la grandeur ; c’était le pouvoir exécutif, pouvoir subordonné, qui le prêtait au pouvoir législatif, pouvoir supérieur ; c’était mieux que cela encore ; à l’inverse de la fiction monarchique où le peuple prêtait serment à l’homme investi de la puissance, c’était l’homme investi de la puissance qui prêtait serment au peuple. Le président, fonctionnaire et serviteur, jurait fidélité au peuple souverain. Incliné devant la majesté nationale visible dans l’Assemblée omnipotente, il recevait de l’Assemblée la Constitution et lui jurait obéissance. Les représentants étaient inviolables, et lui ne l’était pas. Nous le répétons, citoyen responsable devant tous les citoyens, il était dans la nation le seul homme lié de la sorte. De là, dans ce serment unique et suprême, une solennité qui saisissait le coeur. Celui qui écrit ces lignes était assis sur son siège à l’Assemblée le jour où ce serment fut prêté. Il est un de ceux qui, en présence du monde civilisé pris à témoin, ont reçu ce serment au nom du peuple, et qui l’ont encore dans leurs mains. Le voici :
« En présence de Dieu et devant le peuple français représenté par l’Assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la République démocratique une et indivisible et de remplir tous les devoirs que m’impose la Constitution. »
Le président de l’Assemblée, debout, lut cette formule majestueuse ; alors, toute l’assemblée faisant silence et recueillie, le citoyen Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, levant la main droite, dit d’une voix ferme et haute :
— Je le jure !
Le représentant Boulay (de la Meurthe), depuis vice-président de la République, et qui connaissait Charles-Louis-Napoléon Bonaparte dès l’enfance, s’écria : — C’est un honnête homme ; il tiendra son serment !
Le président de l’Assemblée, toujours debout, reprit, et nous ne citons ici que des paroles textuellement enregistrées au Moniteur : — Nous prenons Dieu et les hommes à témoin du serment qui vient d’être prêté. L’Assemblée nationale en donne acte, ordonne qu’il sera transcrit au procès-verbal, inséré au Moniteur, publié et affiché dans la forme des actes législatifs.
Il semblait que tout fût fini ; on s’attendait à ce que le citoyen Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, désormais président de la République jusqu’au deuxième dimanche de mai 1852, descendit de la tribune. Il n’en descendit pas ; il sentit le noble besoin de se lier plus encore, s’il était possible, et d’ajouter quelque chose au serment que la Constitution lui demandait, afin de faire voir à quel point ce serment était chez lui libre et spontané ; il demanda la parole. — Vous avez la parole, dit le président de l’Assemblée.
L’attention et le silence redoublèrent.
Le citoyen Louis-Napoléon Bonaparte déplia un papier et lut un discours. Dans ce discours il annonçait et il installait le ministère nommé par lui, et il disait :
« Je veux, comme vous, citoyens représentants, rasseoir la société sur ses bases, raffermir les institutions démocratiques, et rechercher tous les moyens propres à soulager les maux de ce peuple généreux et intelligent qui vient de me donner un témoignage si éclatant de sa confiance[1]. »
Il remerciait son prédécesseur au pouvoir exécutif, le même qui put dire plus tard ces belles paroles : Je ne suis pas tombé du pouvoir, j’en suis descendu, et il le glorifiait en ces termes :
« La nouvelle administration, en entrant aux affaires, doit remercier celle qui l’a précédée des efforts qu’elle a faits pour transmettre le pouvoir intact, pour maintenir la tranquillité publique[2]. »
« La conduite de l’honorable général Cavaignac a été digne de la loyauté de son caractère et de ce sentiment du devoir qui est la première qualité du chef de l’État[3]. »
L’Assemblée applaudit à ces paroles ; mais ce qui frappa tous les esprits, et ce qui se grava profondément dans toutes les mémoires, ce qui eut un écho dans toutes les consciences loyales, ce fut cette déclaration toute spontanée, nous le répétons, par laquelle il commença :
« Les suffrages de la nation et le serment que je viens de prêter commandent ma conduite future.
« Mon devoir est tracé. Je le remplirai en homme d’honneur.
« Je verrai des ennemis de la patrie dans tous ceux qui tenteraient de changer, par des voies illégales, ce que la France entière a établi. »
Quand il eut fini de parler, l’Assemblée constituante se leva et poussa d’une seule voix ce grand cri : Vive la République !
Louis-Napoléon Bonaparte descendit de la tribune, alla droit au général Cavaignac, et lui tendit la main. Le général hésita quelques instants à accepter ce serrement de main. Tous ceux qui venaient d’entendre les paroles de Louis Bonaparte, prononcées avec un accent si profond de loyauté, blâmèrent le général.
La Constitution à laquelle Louis-Napoléon Bonaparte prêta serment le 20 décembre 1848 « à la face de Dieu et des hommes » contenait, entre autres articles, ceux-ci :
« ART. 36. Les représentants du peuple sont inviolables.
« ART. 37. Ils ne peuvent être arrêtés en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivis qu’après que l’Assemblée a permis la poursuite.
« ART. 68. Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l’Assemblée nationale, la proroge, ou met obstacle à l’exercice de son mandat, est un crime de haute trahison.
« Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions, les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance ; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l’Assemblée nationale. Les juges de la haute cour se réunissent immédiatement à peine de forfaiture ; ils convoquent les jurés dans le lieu qu’ils désignent pour procéder au jugement du président et de ses complices ; ils nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions du ministère public. »
Moins de trois ans après cette journée mémorable, le 2 décembre 1851, au lever du jour, on put lire, à tous les coins des rues de Paris, l’affiche que voici :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
« Décrète :
« ART. 1er. L’Assemblée nationale est dissoute.
« ART. 2. Le suffrage universel est rétabli. La loi du 31 mai est abrogée.
« ART. 3. Le peuple français est convoqué dans ses comices.
« ART. 4. L’état de siège est décrété dans toute l’étendue de la première division militaire.
« ART. 5. Le conseil d’État est dissous.
« ART. 6. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.
« Fait au palais de l’Élysée, le 2 décembre 1851.
« LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. »
En même temps Paris apprit que quinze représentants du peuple, inviolables, avaient été arrêtés chez eux, dans la nuit, par ordre de Louis-Napoléon Bonaparte.
II. Mandat des représentants
Ceux qui ont reçu en dépôt pour le peuple, comme représentants du peuple, le serment du 20 décembre 1848, ceux surtout qui, deux fois investis de la confiance de la nation, le virent jurer comme constituants et le virent violer comme législateurs, avaient assumé en même temps que leur mandat deux devoirs. Le premier, c’était : le jour où ce serment serait violé, de se lever, d’offrir leurs poitrines, de ne calculer ni le nombre ni la force de l’ennemi, de couvrir de leurs corps la souveraineté du peuple, et de saisir, pour combattre et pour jeter bas l’usurpateur, toutes les armes, depuis la loi qu’on trouve dans le code jusqu’au pavé qu’on prend dans la rue. Le second devoir, c’était, après avoir accepté le combat et toutes ses chances, d’accepter la proscription et toutes ses misères ; de se dresser éternellement debout devant le traître, son serment à la main ; d’oublier leurs souffrances intimes, leurs douleurs privées, leurs familles dispersées et mutilées, leurs fortunes détruites, leurs affections brisées, leur coeur saignant, de s’oublier eux-mêmes, et de n’avoir plus désormais qu’une plaie, la plaie de la France ; de crier justice ! de ne se laisser jamais apaiser ni fléchir, d’être implacables ; de saisir l’abominable parjure couronné, sinon avec la main de la loi, du moins avec les tenailles de la vérité, et de faire rougir au feu de l’histoire toutes les lettres de son serment et de les lui imprimer sur la face !
Celui qui écrit ces lignes est de ceux qui n’ont reculé devant rien, le 2 décembre, pour accomplir le premier de ces deux grands devoirs ; en publiant ce livre, il remplit le second.
III. Mise en demeure
Il est temps que la conscience humaine se réveille.
Depuis le 2 décembre 1851, un guet-apens réussi, un crime odieux, repoussant, infâme, inouï, si l’on songe au siècle où il a été commis, triomphe et domine, s’érige en théorie, s’épanouit à la face du soleil, fait des lois, rend des décrets, prend la société, la religion et la famille sous sa protection, tend la main aux rois de l’Europe, qui l’acceptent, et leur dit : mon frère ou mon cousin. Ce crime, personne ne le conteste, pas même ceux qui en profitent et qui en vivent, ils disent seulement qu’il a été « nécessaire » ; pas même celui qui l’a commis, il dit seulement, que, lui criminel, il a été « absous ». Ce crime contient tous les crimes, la trahison dans la conception, le parjure dans l’exécution, le meurtre et l’assassinat dans la lutte, la spoliation, l’escroquerie et le vol dans le triomphe ; ce crime traîne après lui, comme parties intégrantes de lui-même, la suppression des lois, la violation des inviolabilités constitutionnelles, la séquestration arbitraire, la confiscation des biens, les massacres nocturnes, les fusillades secrètes, les commissions remplaçant les tribunaux, dix mille citoyens déportés, quarante mille citoyens proscrits, soixante mille familles ruinées et désespérées. Ces choses sont patentes. Eh bien ! ceci est poignant à dire, le silence se fait sur ce crime ; il est là, on le touche, on le voit, on passe outre et l’on va à ses affaires ; la boutique ouvre, la Bourse agiote, le commerce, assis sur son ballot, se frotte les mains, et nous touchons presque au moment où l’on va trouver cela tout simple. Celui qui aune de l’étoffe n’entend pas que le mètre qu’il a dans la main lui parle et lui dit : « C’est une fausse mesure qui gouverne. » Celui qui pèse une denrée n’entend pas que sa balance élève la voix et lui dit : « C’est un faux poids qui règne. » Ordre étrange que celui-là, ayant pour base le désordre suprême, la négation de tout droit ! l’équilibre fondé sur l’iniquité !
Ajoutons, ce qui, du reste, va de soi, que l’auteur de ce crime est un malfaiteur de la plus cynique et de la plus basse espèce.
À l’heure qu’il est, que tous ceux qui portent une robe, une écharpe ou un uniforme, que tous ceux qui servent cet homme le sachent, s’ils se croient les agents d’un pouvoir, qu’ils se détrompent. Ils sont les camarades d’un pirate. Depuis le 2 décembre, il n’y a plus en France de fonctionnaires, il n’y a que des complices. Le moment est venu que chacun se rende bien compte de ce qu’il a fait et de ce qu’il continue de faire. Le gendarme qui a arrêté ceux que l’homme de Strasbourg et de Boulogne appelle des « insurgés », a arrêté les gardiens de la Constitution. Le juge qui a jugé les combattants de Paris ou des provinces, a mis sur la sellette les soutiens de la loi. L’officier qui a gardé à fond de cale les « condamnés », a détenu les défenseurs de la République et de l’État. Le général d’Afrique qui emprisonne à Lambessa les déportés courbés sous le soleil, frissonnants de fièvre, creusant dans la terre brûlée un sillon qui sera leur fosse, ce général-là séquestre, torture et assassine les hommes du droit. Tous, généraux, officiers, gendarmes, juges, sont en pleine forfaiture. Ils ont devant eux plus que des innocents, des héros ! plus que des victimes, des martyrs !
Qu’on le sache donc, et qu’on se hâte, et, du moins, qu’on brise les chaînes, qu’on tire les verrous, qu’on vide les pontons, qu’on ouvre les geôles, puisqu’on n’a pas encore le courage de saisir l’épée ! Allons, consciences, debout ! éveillez-vous, il est temps !
Si la loi, le droit, le devoir, la raison, le bon sens, l’équité, la justice, ne suffisent pas, qu’on songe à l’avenir. Si le remords se tait, que la responsabilité parle !
Et que tous ceux qui, propriétaires, serrent la main d’un magistrat ; banquiers, fêtent un général ; paysans, saluent un gendarme ; que tous ceux qui ne s’éloignent pas de l’hôtel où est le ministre, de la maison où est le préfet, comme d’un lazaret ; que tous ceux qui, simples citoyens, non fonctionnaires, vont aux bals et aux banquets de Louis Bonaparte et ne voient pas que le drapeau noir est sur l’Élysée, que tous ceux-là le sachent également, ce genre d’opprobre est contagieux ; s’ils échappent à la complicité matérielle, ils n’échappent pas à la complicité morale. Le crime du 2 décembre les éclabousse.
La situation présente, qui semble calme à qui ne pense pas, est violente, qu’on ne s’y méprenne point. Quand la moralité publique s’éclipse, il se fait dans l’ordre social une ombre qui épouvante.
Toutes les garanties s’en vont, tous les points d’appui s’évanouissent.
Désormais il n’y a pas en France un tribunal, pas une cour, pas un juge qui puisse rendre la justice et prononcer une peine, à propos de quoi que ce soit, contre qui que ce soit, au nom de quoi que ce soit.
Qu’on traduise devant les assises un malfaiteur quelconque, le voleur dira aux juges : Le chef de l’État a volé vingt-cinq millions à la Banque ; le faux témoin dira aux juges : Le chef de l’État a fait un serment à la face de Dieu et des hommes, et ce serment, il l’a violé ; le coupable de séquestration arbitraire dira : Le chef de l’État a arrêté et détenu contre toutes les lois les représentants du peuple souverain ; l’escroc dira : Le chef de l’État a escroqué son mandat, escroqué le pouvoir, escroqué les Tuileries ; le faussaire dira : Le chef de l’État a falsifié un scrutin ; le bandit du coin du bois dira : Le chef de l’État a coupé leur bourse aux princes d’Orléans ; le meurtrier dira : Le chef de l’État a fusillé, mitraillé, sabré et égorgé les passants dans les rues ; — et tous ensemble, escroc, faussaire, faux témoin, bandit, voleur, assassin, ajouteront : — Et vous, juges, vous êtes allés saluer cet homme, vous êtes allés le louer de s’être parjuré, le complimenter d’avoir fait un faux, le glorifier d’avoir escroqué, le féliciter d’avoir volé et le remercier d’avoir assassiné ! qu’est-ce que vous nous voulez ?
Certes, c’est là un état de choses grave. S’endormir sur une telle situation, c’est une ignominie de plus.
Il est temps, répétons-le, que ce monstrueux sommeil des consciences finisse. Il ne faut pas qu’après cet effrayant scandale, le triomphe du crime, ce scandale plus effrayant encore soit donné aux hommes : l’indifférence du monde civilisé.
Si cela était, l’histoire apparaîtrait un jour comme une vengeresse ; et dès à présent, de même que les lions blessés s’enfoncent dans les solitudes, l’homme juste, voilant sa face en présence de cet abaissement universel, se réfugierait dans l’immensité du mépris.
IV. On se réveillera
Mais cela ne sera pas ; on se réveillera.
Ce livre n’a pas d’autre but que de secouer ce sommeil. La France ne doit pas même adhérer à ce gouvernement par le consentement de la léthargie ; à de certaines heures, en de certains lieux, à de certaines ombres, dormir, c’est mourir.
Ajoutons qu’au moment où nous sommes, la France, chose étrange à dire et pourtant réelle, ne sait rien de ce qui s’est passé le 2 décembre et depuis, ou le sait mal, et c’est là qu’est l’excuse. Cependant, grâce à plusieurs publications généreuses et courageuses, les faits commencent à percer. Ce livre est destiné à en mettre quelques-uns en lumière, et, s’il plaît à Dieu, à les présenter tous sous leur vrai jour. Il importe qu’on sache un peu ce que c’est que M. Bonaparte. À l’heure qu’il est, grâce à la suppression de la tribune, grâce à la suppression de la presse, grâce à la suppression de la parole, de la liberté et de la vérité, suppression qui a eu pour résultat de tout permettre à M. Bonaparte, mais qui a en même temps pour effet de frapper de nullité tous ses actes sans exception, y compris l’inqualifiable scrutin du 20 décembre, grâce, disons-nous, à cet étouffement de toute plainte et de toute clarté, aucune chose, aucun homme, aucun fait, n’ont leur vraie figure et ne portent leur vrai nom ; le crime de M. Bonaparte n’est pas crime, il s’appelle nécessité ; le guet-apens de M. Bonaparte n’est pas guet-apens, il s’appelle défense de l’ordre ; les vols de M. Bonaparte ne sont pas vols, ils s’appellent mesures d’État ; les meurtres de M. Bonaparte ne sont pas meurtres, ils s’appellent salut public ; les complices de M. Bonaparte ne sont pas des malfaiteurs, ils s’appellent magistrats, sénateurs et conseillers d’État ; les adversaires de M. Bonaparte ne sont pas les soldats de la loi et du droit, ils s’appellent jacques, démagogues et partageux. Aux yeux de la France, aux yeux de l’Europe, le 2 décembre est encore masqué. Ce livre n’est pas autre chose qu’une main qui sort de l’ombre et qui lui arrache le masque.
Allons, nous allons exposer ce triomphe de l’ordre ; nous allons peindre ce gouvernement vigoureux, assis, carré, fort ; ayant pour lui une foule de petits jeunes gens qui ont plus d’ambition que de bottes, beaux fils et vilains gueux ; soutenu à la Bourse par Fould le juif, et à l’église par Montalembert le catholique ; estimé des femmes qui veulent être filles et des hommes qui veulent être préfets ; appuyé sur la coalition des prostitutions ; donnant des fêtes ; faisant des cardinaux ; portant cravate blanche et claque sous le bras, ganté beurre frais comme Morny, verni à neuf comme Maupas, frais brossé comme Persigny, riche, élégant, propre, doré, brossé, joyeux, né dans une mare de sang.
Oui, on se réveillera !
Oui, on sortira de cette torpeur qui, pour un tel peuple, est la honte ; et quand la France sera réveillée, quand elle ouvrira les yeux, quand elle distinguera, quand elle verra ce qu’elle a devant elle et à côté d’elle, elle reculera, cette France, avec un frémissement terrible, devant ce monstrueux forfait qui a osé l’épouser dans les ténèbres et dont elle a partagé le lit.
Alors l’heure suprême sonnera.
Les sceptiques sourient et insistent ; ils disent : « — N’espérez rien. Ce régime, selon vous, est la honte de la France. Soit ; cette honte est cotée à la Bourse. N’espérez rien. Vous êtes des poètes et des rêveurs si vous espérez. Regardez donc ; la tribune, la presse, l’intelligence, la parole, la pensée, tout ce qui était la liberté a disparu. Hier cela remuait, cela vivait, aujourd’hui cela est pétrifié. Eh bien ! on est content, on s’accommode de cette pétrification, on en tire parti, on y fait ses affaires, on vit là-dessus comme à l’ordinaire. La société continue, et force honnêtes gens trouvent les choses bien ainsi. Pourquoi voulez-vous que cette situation change ? pourquoi voulez-vous que cette situation finisse ? Ne vous faites pas illusion, ceci est solide, ceci est stable, ceci est le présent et l’avenir. »
Nous sommes en Russie. La Néva est prise. On bâtit des maisons dessus ; de lourds chariots lui marchent sur le dos. Ce n’est plus de l’eau, c’est de la roche. Les passants vont et viennent sur ce marbre qui a été un fleuve. On improvise une ville, on trace des rues, on ouvre des boutiques, on vend, on achète, on boit, on mange, on dort, on allume du feu sur cette eau. On peut tout se permettre. Ne craignez rien, faites ce qu’il vous plaira, riez, dansez, c’est plus solide que la terre ferme. Vraiment, cela sonne sous le pied comme du granit. Vive l’hiver ! vive la glace ! en voilà pour l’éternité. Et regardez le ciel, est-il jour ? est-il nuit ? Une lueur blafarde et blême se traîne sur la neige ; on dirait que le soleil meurt.
Non, tu ne meurs pas, liberté ! Un de ces jours, au moment où on s’y attendra le moins, à l’heure même où on t’aura le plus profondément oubliée, tu te lèveras ! — ô éblouissement ! on verra tout à coup ta face d’astre sortir de terre et resplendir à l’horizon. Sur toute cette neige, sur toute cette glace, sur cette plaine dure et blanche, sur cette eau devenue bloc, sur tout cet infâme hiver, tu lanceras ta flèche d’or, ton ardent et éclatant rayon ! la lumière, la chaleur, la vie ! — Et alors, écoutez ! entendez-vous ce bruit sourd ? entendez-vous ce craquement profond et formidable ? c’est la débâcle ! c’est la Néva qui s’écroule ! c’est le fleuve qui reprend son cours ! c’est l’eau vivante, joyeuse et terrible qui soulève la glace hideuse et morte et qui la brise ! — C’était du granit, disiez-vous ; voyez, cela se fend comme une vitre ! c’est la débâcle, vous dis-je ! c’est la vérité qui revient ; c’est le progrès qui recommence, c’est l’humanité qui se remet en marche et qui charrie, entraîne, arrache, emporte, heurte, mêle, écrase et noie dans ses flots, comme les pauvres misérables meubles d’une masure, non-seulement l’empire tout neuf de Louis Bonaparte, mais toutes les constructions et toutes les oeuvres de l’antique despotisme éternel ! Regardez passer tout cela. Cela disparaît à jamais. Vous ne le reverrez plus. Ce livre à demi submergé, c’est le vieux code d’iniquité ! Ce tréteau qui s’engloutit, c’est le trône ! cet autre tréteau qui s’en va, c’est l’échafaud !
Et pour cet engloutissement immense, et pour cette victoire suprême de la vie sur la mort, qu’a-t-il fallu ? Un de tes regards, ô soleil ! un de tes rayons, ô liberté !
V. Biographie
Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, né à Paris le 20 avril 1808, est fils d’Hortense de Beauharnais, mariée par l’empereur à Louis-Napoléon, roi de Hollande. En 1831, mêlé aux insurrections d’Italie, où son frère aîné fut tué, Louis Bonaparte essaya de renverser la papauté. Le 30 octobre 1835 il tenta de renverser Louis-Philippe. Il avorta à Strasbourg, et, gracié par le roi, s’embarqua pour l’Amérique, laissant juger ses complices derrière lui. Le 11 novembre il écrivait : « Le roi, dans sa clémence, a ordonné que je fusse conduit en Amérique » ; il se déclarait « vivement touché de la générosité du roi », ajoutant : « Certes nous sommes tous coupables envers le gouvernement d’avoir pris les armes contre lui, mais le plus coupable, c’est moi », et terminait ainsi : « J’étais coupable envers le gouvernement ; or le gouvernement a été généreux envers moi[4]. » Il revint d’Amérique en Suisse, se fit nommer capitaine d’artillerie à Berne et bourgeois de Salenstein en Turgovie, évitant également, au milieu des complications diplomatiques causées par sa présence, de se déclarer français et de s’avouer suisse, et se bornant, pour rassurer le gouvernement français, à affirmer, par une lettre du 20 août 1838, qu’il vit « presque seul » dans la maison « où sa mère est morte », et que sa ferme volonté « est de rester tranquille ». Le 6 août 1840, il débarqua à Boulogne, parodiant le débarquement à Cannes, coiffé du petit chapeau[5], apportant un aigle doré au bout d’un drapeau et un aigle vivant dans une cage, force proclamations, et soixante valets, cuisiniers et palefreniers, déguisés en soldats français avec des uniformes achetés au Temple et des boutons du 42e de ligne fabriqués à Londres. Il jette de l’argent aux passants dans les rues de Boulogne, met son chapeau à la pointe de son épée, et crie lui-même : vive l’empereur ; tire à un officier[6] un coup de pistolet qui casse trois dents à un soldat, et s’enfuit. Il est pris, on trouve sur lui cinq cent mille francs en or et en bank-notes[7] ; le procureur général Franck-Carré lui dit en pleine cour des pairs : « Vous avez fait pratiquer l’embauchage et distribuer l’argent pour acheter la trahison. » Les pairs le condamnent à la prison perpétuelle. On l’enferme à Ham. Là son esprit parut se replier et mûrir ; il écrivit et publia des livres empreints, malgré une certaine ignorance de la France et du siècle, de démocratie et de progrès : l’Extinction du paupérisme, l’Analyse de la question des sucres, les Idées napoléoniennes, où il fit l’empereur « humanitaire ». Dans un livre intitulé Fragments historiques, il écrivit : « Je suis citoyen avant d’être Bonaparte. » Déjà en 1832, dans son livre des Rêveries politiques, il s’était déclaré « républicain ». Après six ans de captivité, il s’échappa de la prison de Ham, déguisé en maçon, et se réfugia en Angleterre. Février arriva, il acclama la République, vint siéger comme représentant du peuple à l’Assemblée constituante, monta à la tribune le 21 septembre 1848, et dit : « Toute ma vie sera consacrée à l’affermissement de la République », publia un manifeste qui peut se résumer en deux lignes : liberté, progrès, démocratie, amnistie, abolition des décrets de proscription et de bannissement ; fut élu président par cinq millions cinq cent mille voix, jura solennellement la Constitution le 20 décembre 1848, et, le 2 décembre 1851, la brisa. Dans l’intervalle il avait détruit la République romaine et restauré en 1849 cette papauté qu’il voulait jeter bas en 1831. Il avait en outre pris on ne sait quelle part à l’obscure affaire dite Loterie des lingots d’or ; dans les semaines qui ont précédé le coup d’État, ce sac était devenu transparent et l’on y avait aperçu une main qui ressemblait à la sienne. Le 2 décembre et les jours suivants, il a, lui pouvoir exécutif, attenté au pouvoir législatif, arrêté les représentants, chassé l’Assemblée, dissous le conseil d’État, expulsé la haute cour de justice, supprimé les lois, pris vingt-cinq millions à la Banque, gorgé l’armée d’or, mitraillé Paris, terrorisé la France ; depuis il a proscrit quatrevingt-quatre représentants du peuple, volé aux princes d’Orléans les biens de Louis-Philippe leur père, auquel il devait la vie, décrété le despotisme en cinquante-huit articles sous le titre de Constitution, garrotté la République, fait de l’épée de la France un bâillon dans la bouche de la liberté, brocanté les chemins de fer, fouillé les poches du peuple, réglé le budget par ukase, déporté en Afrique et à Cayenne dix mille démocrates, exilé en Belgique, en Espagne, en Piémont, en Suisse et en Angleterre quarante mille républicains, mis dans toutes les âmes le deuil et sur tous les fronts la rougeur.
Louis Bonaparte croit monter au trône, il ne s’aperçoit pas qu’il monte au poteau.
VI. Portrait
Louis Bonaparte est un homme de moyenne taille, froid, pâle, lent, qui a l’air de n’être pas tout à fait réveillé. Il a publié, nous l’avons rappelé déjà, un traité assez estimé sur l’artillerie, et connaît à fond la manoeuvre du canon. Il monte bien à cheval. Sa parole traîne avec un léger accent allemand. Ce qu’il y a d’histrion en lui a paru au tournoi d’Eglington. Il a la moustache épaisse et couvrant le sourire comme le duc d’Albe, et l’oeil éteint comme Charles IX.
Si on le juge en dehors de ce qu’il appelle « ses actes nécessaires » ou « ses grands actes », c’est un personnage vulgaire, puéril, théâtral et vain. Les personnes invitées chez lui, l’été, à Saint-Cloud, reçoivent, en même temps que l’invitation, l’ordre d’apporter une toilette du matin et une toilette du soir. Il aime la gloriole, le pompon, l’aigrette, la broderie, les paillettes et les passequilles, les grands mots, les grands titres, ce qui sonne, ce qui brille, toutes les verroteries du pouvoir. En sa qualité de parent de la bataille d’Austerlitz, il s’habille en général.
Peu lui importe d’être méprisé, il se contente de la figure du respect.
Cet homme ternirait le second plan de l’histoire, il souille le premier. L’Europe riait de l’autre continent en regardant Haïti quand elle a vu apparaître ce Soulouque blanc. Il y a maintenant en Europe, au fond de toutes les intelligences, même à l’étranger, une stupeur profonde, et comme le sentiment d’un affront personnel ; car le continent européen, qu’il le veuille ou non, est solidaire de la France, et ce qui abaisse la France humilie l’Europe.
Avant le 2 décembre, les chefs de la droite disaient volontiers de Louis Bonaparte : C’est un idiot. Ils se trompaient. Certes ce cerveau est trouble, ce cerveau a des lacunes, mais on peut y déchiffrer par endroits plusieurs pensées de suite et suffisamment enchaînées. C’est un livre où il y a des pages arrachées. Louis Bonaparte a une idée fixe, mais une idée fixe n’est pas l’idiotisme. Il sait ce qu’il veut, et il y va. À travers la justice, à travers la loi, à travers la raison, à travers l’honnêteté, à travers l’humanité, soit, mais il y va.
Ce n’est pas un idiot. C’est un homme d’un autre temps que le nôtre. Il semble absurde et fou parce qu’il est dépareillé. Transportez-le au seizième siècle en Espagne, et Philippe Il le reconnaîtra ; en Angleterre, et Henri VIII lui sourira ; en Italie, et César Borgia lui sautera au cou. Ou même bornez-vous à le placer hors de la civilisation européenne, mettez-le, en 1817, à Janina, Ali Tepeleni lui tendra la main.
Il y a en lui du moyen âge et du bas-empire. Ce qu’il fait eût semblé tout simple à Michel Ducas, à Romain Diogène, à Nicéphore Botoniate, à l’eunuque Narsès, au vandale Stilicon, à Mahomet II, à Alexandre VI, à Ezzelin de Padoue, et lui semble tout simple à lui. Seulement il oublie ou il ignore qu’au temps où nous sommes ses actions auront à traverser ces grands effluves de moralité humaine dégagées par nos trois siècles lettrés et par la Révolution française, et que, dans ce milieu, ses actions prendront leur vraie figure et apparaîtront ce qu’elles sont, hideuses.
Ses partisans — il en a — le mettent volontiers en parallèle avec son oncle, le premier Bonaparte. Ils disent : « L’un a fait le 18 brumaire, l’autre a fait le 2 décembre ; ce sont deux ambitieux. » Le premier Bonaparte voulait réédifier l’empire d’occident, faire l’Europe vassale, dominer le continent de sa puissance et l’éblouir de sa grandeur, prendre un fauteuil et donner aux rois des tabourets, faire dire à l’histoire : Nemrod, Cyrus, Alexandre, Annibal, César, Charlemagne, Napoléon, être un maître du monde. Il l’a été. C’est pour cela qu’il a fait le 18 brumaire. Celui-ci veut avoir des chevaux et des filles, être appelé monseigneur, et bien vivre. C’est pour cela qu’il a fait le 2 décembre. Ce sont deux ambitieux ; la comparaison est juste.
Ajoutons que, comme le premier, celui-ci veut aussi être empereur. Mais ce qui calme un peu les comparaisons, c’est qu’il y a peut-être quelque différence entre conquérir l’empire et le filouter.
Quoi qu’il en soit, ce qui est certain, et ce que rien ne peut voiler, pas même cet éblouissant rideau de gloire et de malheur sur lequel on lit : Arcole, Lodi, les Pyramides, Eylau, Friedland, Sainte-Hélène, ce qui est certain, disons-nous, c’est que le 18 brumaire est un crime dont le 2 décembre a élargi la tache sur la mémoire de Napoléon.
M. Louis Bonaparte se laisse volontiers entrevoir socialiste. Il sent qu’il y a là pour lui une sorte de champ vague, exploitable à l’ambition. Nous l’avons dit, il a passé son temps dans sa prison à se faire une quasi-réputation de démocrate. Un fait le peint. Quand il publia, étant à Ham, son livre sur l’Extinction du paupérisme, livre en apparence ayant pour but unique et exclusif de sonder la plaie des misères du peuple et d’indiquer les moyens de la guérir, il envoya l’ouvrage à un de ses amis avec ce billet, qui a passé sous nos yeux : « Lisez ce travail sur le paupérisme, et dites-moi si vous pensez qu’il soit de nature à me faire du bien. »
Le grand talent de M. Louis Bonaparte, c’est le silence.
Avant le 2 décembre, il avait un conseil des ministres qui s’imaginait être quelque chose, étant responsable. Le président présidait. Jamais, ou presque jamais, il ne prenait part aux discussions. Pendant que MM. Odilon Barrot, Passy, Tocqueville, Dufaure ou Faucher parlaient, il construisait avec une attention profonde, nous disait un de ses ministres, des cocottes en papier, ou dessinait des bonshommes sur les dossiers.
Faire le mort, c’est là son art. Il reste muet et immobile, en regardant d’un autre côté que son dessein, jusqu’à l’heure venue. Alors il tourne la tête et fond sur sa proie. Sa politique vous apparaît brusquement à un tournant inattendu, le pistolet au poing, ut fur. Jusque-là, le moins de mouvement possible. Un moment, dans les trois années qui viennent de s’écouler, on le vit de front avec Changarnier, qui, lui aussi, méditait de son côté une entreprise. Ibant obscuri, comme dit Virgile. La France considérait avec une certaine anxiété ces deux hommes. Qu’y a-t-il entre eux ? L’un ne rêve-t-il pas Cromwell ? l’autre ne rêve-t-il pas Monk ? On s’interrogeait et on les regardait. Chez l’un et chez l’autre même attitude de mystère, même tactique d’immobilité. Bonaparte ne disait pas un mot, Changarnier ne faisait pas un geste ; l’un ne bougeait point, l’autre ne soufflait pas ; tous deux semblaient jouer à qui serait le plus statue.
Ce silence, cependant, Louis Bonaparte le rompt quelquefois. Alors il ne parle pas, il ment. Cet homme ment comme les autres hommes respirent. Il annonce une intention honnête, prenez garde ; il affirme, méfiez-vous ; il fait un serment, tremblez.
Machiavel a fait des petits. Louis Bonaparte en est un.
Annoncer une énormité dont le monde se récrie, la désavouer avec indignation, jurer ses grands dieux, se déclarer honnête homme, puis, au moment où l’on se rassure et où l’on rit de l’énormité en question, l’exécuter. Ainsi il a fait pour le coup d’État, ainsi pour les décrets de proscription, ainsi pour la spoliation des princes d’Orléans ; ainsi il fera pour l’invasion de la Belgique et de la Suisse, et pour le reste. C’est là son procédé ; pensez-en ce que vous voudrez ; il s’en sert, il le trouve bon, cela le regarde. Il aura à démêler la chose avec l’histoire.
On est de son cercle intime ; il laisse entrevoir un projet qui semble, non immoral, on n’y regarde pas de si près, mais insensé et dangereux, et dangereux pour lui-même ; on élève des objections ; il écoute, ne répond pas, cède quelquefois pour deux ou trois jours, puis reprend son dessein, et fait sa volonté.
Il y a à sa table, dans son cabinet de l’Élysée, un tiroir souvent entr’ouvert. Il tire de là un papier, le lit à un ministre, c’est un décret. Le ministre adhère ou résiste. S’il résiste, Louis Bonaparte rejette le papier dans le tiroir où il y a beaucoup d’autres paperasses, rêves d’homme tout-puissant, ferme ce tiroir, en prend la clef, et s’en va sans dire un mot. Le ministre salue et se retire charmé de la déférence. Le lendemain matin, le décret est au Moniteur.
Quelquefois avec la signature du ministre.
Grâce à cette façon de faire, il a toujours à son service l’inattendu, grande force ; et, ne rencontrant en lui-même aucun obstacle intérieur dans ce que les autres hommes appellent conscience, il pousse son dessein, n’importe à travers quoi, nous l’avons dit, n’importe sur quoi, et touche son but.
Il recule quelquefois, non devant l’effet moral de ses actes, mais devant l’effet matériel. Les décrets d’expulsion de quatrevingt-quatre représentants, publiés le 6 janvier par le Moniteur, révoltèrent le sentiment public. Si bien liée que fût la France, on sentit le tressaillement. On était encore très près du 2 décembre ; toute émotion pouvait avoir son danger. Louis Bonaparte le comprit. Le lendemain, 10, un second décret d’expulsion devait paraître, contenant huit cents noms. Louis Bonaparte se fit apporter l’épreuve duMoniteur, la liste remplissait quatorze colonnes du journal officiel. Il froissa l’épreuve, la jeta au feu, et le décret ne parut pas. Les proscriptions continuèrent, sans décret.
Dans ses entreprises il a besoin d’aides et de collaborateurs ; il lui faut ce qu’il appelle lui-même « des hommes ». Diogène les cherchait tenant une lanterne, lui il les cherche un billet de banque à la main. Il les trouve. De certains côtés de la nature humaine produisent toute une espèce de personnages dont il est le centre naturel et qui se groupent nécessairement autour de lui selon cette mystérieuse loi de gravitation qui ne régit pas moins l’être moral que l’atome cosmique. Pour entreprendre « l’acte du 2 décembre », pour l’exécuter et pour le compléter, il lui fallait de ces hommes ; il en eut. Aujourd’hui il en est environné ; ces hommes lui font cour et cortège ; ils mêlent leur rayonnement au sien. À de certaines époques de l’histoire, il y a des pléiades de grands hommes ; à d’autres époques, il y a des pléiades de chenapans.
Pourtant, ne pas confondre l’époque, la minute de Louis Bonaparte, avec le dix-neuvième siècle ; le champignon vénéneux pousse au pied du chêne, mais n’est pas le chêne.
M. Louis Bonaparte a réussi. Il a pour lui désormais l’argent, l’agio, la banque, la bourse, le comptoir, le coffre-fort, et tous ces hommes qui passent si facilement d’un bord à l’autre quand il n’y a à enjamber que de la honte. Il a fait de M. Changarnier une dupe, de M. Thiers une bouchée, de M. de Montalembert un complice, du pouvoir une caverne, du budget sa métairie. On grave à la Monnaie une médaille, dite médaille du 2 décembre, en l’honneur de la manière dont il tient ses serments. La frégate la Constitution a été débaptisée, et s’appelle la frégate l’Élysée. Il peut, quand il voudra, se faire sacrer par M. Sibour et échanger la couchette de l’Élysée contre le lit des Tuileries. En attendant, depuis sept mois, il s’étale ; il a harangué, triomphé, présidé des banquets, donné des bals, dansé, régné, paradé et fait la roue ; il s’est épanoui dans sa laideur à une loge d’Opéra, il s’est fait appeler prince-président, il a distribué des drapeaux à l’armée et des croix d’honneur aux commissaires de police. Quand il s’est agi de se choisir un symbole, il s’est effacé et a pris l’aigle ; modestie d’épervier.
VII. Pour faire suite aux panégyriques
Il a réussi. Il en résulte que les apothéoses ne lui manquent pas. Des panégyristes, il en a plus que Trajan. Une chose me frappe pourtant, c’est que dans toutes les qualités qu’on lui reconnaît depuis le 2 décembre, dans tous les éloges qu’on lui adresse, il n’y a pas un mot qui sorte de ceci : habileté, sang-froid, audace, adresse, affaire admirablement préparée et conduite, instant bien choisi, secret bien gardé, mesures bien prises. Fausses clefs bien faites. Tout est là. Quand ces choses sont dites, tout est dit, à part quelques phrases sur la « clémence » ; et encore est-ce qu’on n’a pas loué la magnanimité de Mandrin qui, quelquefois, ne prenait pas tout l’argent, et de Jean l’Écorcheur qui, quelquefois, ne tuait pas tous les voyageurs !
En dotant M. Bonaparte de douze millions, plus quatre millions pour l’entretien des châteaux, le sénat, doté par M. Bonaparte d’un million, félicite M. Bonaparte d’avoir « sauvé la société », à peu près comme un personnage de comédie en félicite un autre d’avoir « sauvé la caisse ».
Quant à moi, j’en suis encore à chercher, dans les glorifications que font de M. Bonaparte ses plus ardents apologistes, une louange qui ne conviendrait pas à Cartouche et à Poulallier après un bon coup ; et je rougis quelquefois, pour la langue française et pour le nom de Napoléon, des termes vraiment un peu crus et trop peu gazés et trop appropriés aux faits, dans lesquels la magistrature et le clergé félicitent cet homme pour avoir volé le pouvoir avec effraction de la Constitution et s’être nuitamment évadé de son serment.
Après que toutes les effractions et tous les vols dont se compose le succès de sa politique ont été accomplis, il a repris son vrai nom ; chacun alors a reconnu que cet homme était un monseigneur. C’est M. Fortoul[8], disons-le en son honneur, qui s’en est aperçu le premier.
Quand on mesure l’homme et qu’on le trouve si petit, et qu’ensuite on mesure le succès et qu’on le trouve si énorme, il est impossible que l’esprit n’éprouve pas quelque surprise. On se demande : comment a-t-il fait ? On décompose l’aventure et l’aventurier, et, en laissant à part le parti qu’il tire de son nom et certains faits extérieurs dont il s’est aidé dans son escalade, on ne trouve au fond de l’homme et de son procédé que deux choses, la ruse et l’argent.
La ruse ; nous avons caractérisé déjà ce grand côté de Louis Bonaparte, mais il est utile d’y insister.
Le 27 novembre 1848, il disait à ses concitoyens dans son manifeste :
« Je me sens obligé de vous faire connaître mes sentiments et mes principes. Il ne faut pas qu’il y ait d’équivoque entre vous et moi. Je ne suis pas un ambitieux… Élevé dans les pays libres, à l’école du malheur, je resterai toujours fidèle aux devoirs que m’imposeront vos suffrages et les volontés de l’Assemblée.
« Je mettrai mon honneur à laisser, au bout de quatre ans, à mon successeur, le pouvoir affermi, la liberté intacte, un progrès réel accompli. »
Le 31 décembre 1849, dans son premier message à l’Assemblée, il écrivait : « Je veux être digne de la confiance de la nation en maintenant la Constitution que j’ai jurée. » Le 12 novembre 1850, dans son second message annuel à l’Assemblée, il disait : « Si la Constitution renferme des vices et des dangers, vous êtes libres de les faire ressortir aux yeux du pays ; moi seul, lié par mon serment, je me renferme dans les strictes limites qu’elle a tracées. » Le 4 septembre de la même année, à Caen, il disait : « Lorsque partout la prospérité semble renaître, il serait bien coupable, celui qui tenterait d’en arrêter l’essor par le changement de ce qui existe aujourd’hui. » Quelque temps auparavant, le 22 juillet 1849, lors de l’inauguration du chemin de fer de Saint-Quentin, il était allé à Ham, il s’était frappé la poitrine devant les souvenirs de Boulogne, et il avait prononcé ces paroles solennelles :
« Aujourd’hui qu’élu par la France entière je suis devenu le chef légitime de cette grande nation, je ne saurais me glorifier d’une captivité qui avait pour cause l’attaque contre un gouvernement régulier.
« Quand on a vu combien les révolutions les plus justes entraînent de maux après elles, on comprend à peine l’audace d’avoir voulu assumer sur soi la terrible responsabilité d’un changement ; je ne me plains donc pas d’avoir expié ici, par un emprisonnement de six années, ma témérité contre les lois de ma patrie, et c’est avec bonheur que, dans ces lieux mêmes où j’ai souffert, je vous propose un toast en l’honneur des hommes qui sont déterminés, malgré leurs convictions, à respecter les institutions de leur pays. »
Tout en disant cela, il conservait au fond de son coeur, et il l’a prouvé depuis à sa façon, cette pensée écrite par lui dans cette même prison de Ham : « Rarement les grandes entreprises réussissent du premier coup[9]. »
Vers la mi-novembre 1851, le représentant F, élyséen, dînait chez M. Bonaparte :
— Que dit-on dans Paris et à l’Assemblée ? demanda le président au représentant.
— Hé, prince !
— Eh bien ?
— On parle toujours…
— De quoi ?
— Du coup d’État.
— Et l’Assemblée, y croit-elle ?
— Un peu, prince.
— Et vous ?
— Moi, pas du tout.
Louis Bonaparte prit vivement les deux mains de M. F., et lui dit avec attendrissement :
— Je vous remercie, monsieur F. ; vous, du moins vous ne me croyez pas un coquin !
Ceci se passait quinze jours avant le 2 décembre.
À cette époque, et dans ce moment-là même, de l’aveu du complice Maupas, on préparait Mazas.
L’argent ; c’est là l’autre force de M. Bonaparte.
Parlons des faits prouvés juridiquement par les procès de Strasbourg et de Boulogne.
À Strasbourg, le 30 octobre 1836, le colonel Vaudrey, complice de M. Bonaparte, charge les maréchaux des logis du 4ème régiment d’artillerie de « partager entre les canonniers de chaque batterie deux pièces d’or ».
Le 5 août 1840, dans le paquebot, nolisé par lui, la Ville d’Édimbourg, en mer, M. Bonaparte appelle autour de lui les soixante pauvres diables, ses domestiques, qu’il avait trompés en leur faisant accroire qu’il allait à Hambourg en excursion de plaisir ; il les harangue du haut d’une de ses voitures accrochées sur le pont, leur déclare son projet, leur jette leurs déguisements de soldats, et leur donne à chacun cent francs par tête ; puis il les fait boire. Un peu de crapule ne gâte pas les grandes entreprises. — « J’ai vu, a dit devant la cour des pairs le témoin Hobbs, garçon de barre, j’ai vu dans la chambre beaucoup d’argent. Les passagers me paraissaient lire des imprimés… Les passagers ont passé toute la nuit à boire et à manger. Je ne faisais rien autre chose que de déboucher des bouteilles et servir à manger. » Après le garçon de barre, voici le capitaine. Le juge d’instruction demande au capitaine Crow : — « Avez-vous vu les passagers boire ? » — Crow : « Avec excès ; je n’ai jamais vu semblable chose. » On débarque, on rencontre le poste de douaniers de Wimereux. M. Louis Bonaparte débute par offrir au lieutenant de douaniers une pension de douze cents francs. Le juge d’instruction : — « N’avez-vous pas offert au commandant du poste une somme d’argent s’il voulait marcher avec vous ? — Le prince : « Je la lui ai fait offrir, mais il l’a refusée[10]. »
On arrive à Boulogne. Ses aides de camp — il en avait dès lors — portaient suspendus à leur cou des rouleaux de fer-blanc pleins de pièces d’or. D’autres suivaient avec des sacs de monnaie à la main. On jette de l’argent aux pêcheurs et aux paysans en les invitant à crier : vive l’empereur ! « Il suffit de trois cents gueulards », avait dit un des conjurés[11].
Louis Bonaparte aborde le 42e, caserné à Boulogne. Il dit au voltigeur Georges Koehly : Je suis Napoléon ; vous aurez des grades et des décorations. Il dit au voltigeur Antoine Gendre : Je suis le fils de Napoléon ; nous allons à l’hôtel du Nord commander un dîner pour moi et pour vous. Il dit au voltigeur Jean Meyer : Vous serez bien payés ; il dit au voltigeur Joseph Mény : Vous viendrez à Paris, vous serez bien payés.
Un officier à côté de lui tenait à la main son chapeau plein de pièces de cinq francs qu’il distribuait aux curieux, en disant : Criez : vive l’empereur !
Le grenadier Geoffroy, dans sa déposition, caractérise en ces termes la tentative faite sur sa chambrée par un officier et par un sergent, du complot : « Le sergent portait une bouteille, et l’officier avait le sabre à la main. » Ces deux lignes, c’est tout le 2 décembre.
Poursuivons.
« Le lendemain, 17 juin, le commandant Mésonan, que je croyais parti, entre dans mon cabinet, annoncé toujours par mon aide de camp. Je lui dis : Commandant, je vous croyais parti. — Non, mon général, je ne suis pas parti. J’ai une lettre à vous remettre. — Une lettre ! et de qui ? — Lisez, mon général.
« Je le fais asseoir ; je prends la lettre ; mais, au moment de l’ouvrir, je m’aperçus que la suscription portait : À M. le commandant Mésonan. Je lui dis :
« Mais, mon cher commandant, c’est pour vous, ce n’est pas pour moi. — Lisez, mon général ! — J’ouvre la lettre et je lis :
« — Mon cher commandant, il est de la plus grande nécessité que vous voyiez de suite le général en question ; vous savez que c’est un homme d’exécution et sur qui on peut compter. Vous savez aussi que c’est un homme que j’ai noté pour être un jour maréchal de France. Vous lui offrirez 100,000 francs de ma part, et vous lui demanderez chez quel banquier ou chez quel notaire il veut que je lui fasse compter 300,000 francs, dans le cas où il perdrait son commandement. »
« Je m’arrêtai, l’indignation me gagnant ; je tournai le feuillet, et je vis que la lettre était signée : Louis-Napoléon…
… « Je remis cette lettre au commandant, en lui disant que c’était un parti ridicule et perdu. »
Qui parle ainsi ? le général Magnan. Où ? en pleine cour des pairs. Devant qui ? Quel est l’homme assis sur la sellette, l’homme que Magnan couvre de « ridicule », l’homme vers lequel Magnan tourne sa face « indignée » ? Louis Bonaparte.
L’argent, et avec l’argent l’orgie, ce fut là son moyen d’action dans ses trois entreprises, à Strasbourg, à Boulogne, à Paris. Deux avortements, un succès. Magnan, qui se refusa à Boulogne, se vendit à Paris. Si Louis Bonaparte avait été vaincu le 2 décembre, de même qu’on a trouvé sur lui, à Boulogne, les cinq cent mille francs de Londres, on aurait trouvé à l’Élysée les vingt-cinq millions de la Banque.
Il y a donc eu en France, il faut en venir à parler froidement de ces choses, en France, dans ce pays de l’épée, dans ce pays des chevaliers, dans ce pays de Hoche, de Drouot et de Bayard, il y a eu un jour où un homme, entouré de cinq ou six grecs politiques, experts en guet-apens et maquignons de coups d’État, accoudé dans un cabinet doré, les pieds sur les chenets, le cigare à la bouche, a tarifé l’honneur militaire, l’a pesé dans un trébuchet comme denrée, comme chose vendable et achetable, a estimé le général un million et le soldat un louis, et a dit de la conscience de l’armée française : cela vaut tant.
Et cet homme est le neveu de l’empereur.
Du reste, ce neveu n’est pas superbe ; il sait s’accommoder aux nécessités de ses aventures, et il prend facilement et sans révolte le pli quelconque de la destinée. Mettez-le à Londres, et, qu’il ait intérêt à complaire au gouvernement anglais, il n’hésitera point, et, de cette même main qui veut saisir le sceptre de Charlemagne, il empoignera le bâton du policeman. Si je n’étais Napoléon, je voudrais être Vidocq.
Et maintenant la pensée s’arrête.
Et voilà par quel homme la France est gouvernée ! Que dis-je, gouvernée ? possédée souverainement !
Et chaque jour, et tous les matins, par ses décrets, par ses messages, par ses harangues, par toutes les fatuités inouïes qu’il étale dans le Moniteur