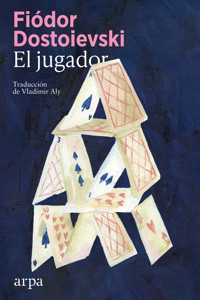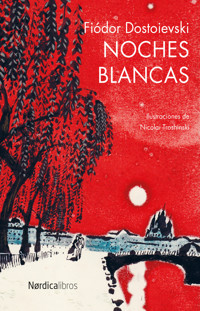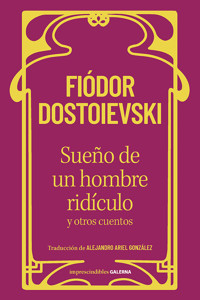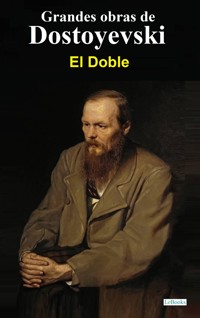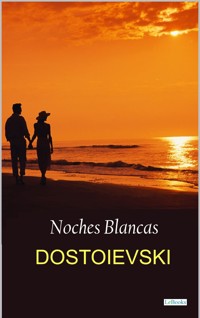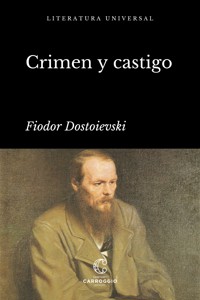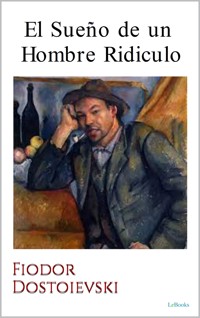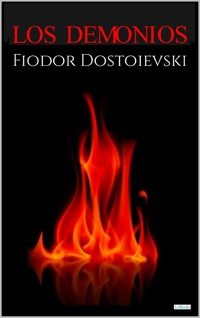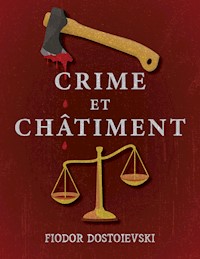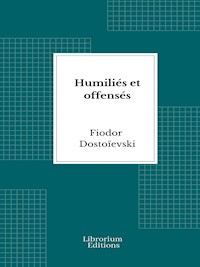
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L’an dernier, le 22 mars au soir, il m’arriva une aventure des plus étranges. Tout le jour, j’avais parcouru la ville à la recherche d’un appartement. L’ancien était très humide et à cette époque déjà j’avais une mauvaise toux. Je voulais déménager dès l’automne, mais j’avais traîné jusqu’au printemps. De toute la journée, je n’avais rien pu trouver de convenable. Premièrement, je voulais un appartement indépendant, non sous-loué ; et, deuxièmement, je me serais contenté d’une chambre, mais il fallait absolument qu’elle fût grande, et bien entendu en même temps le meilleur marché possible. J’ai remarqué que dans un appartement exigu les pensées même se trouvent à l’étroit. En méditant mes futures nouvelles, j’ai toujours aimé à aller et venir dans ma chambre. À propos : il m’a toujours été plus agréable de réfléchir à mes œuvres et de rêver à la façon dont je les composerais que de les écrire et vraiment, ce n’est pas par paresse. D’où cela vient-il donc ?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022