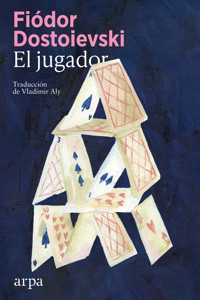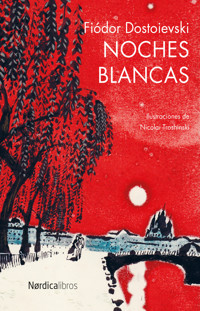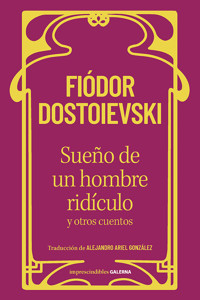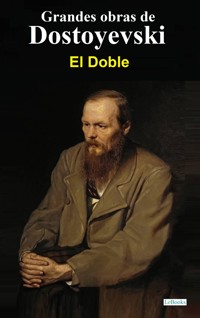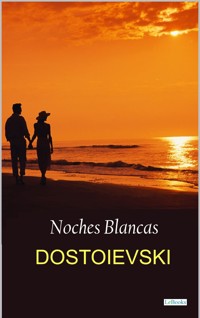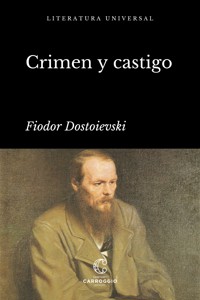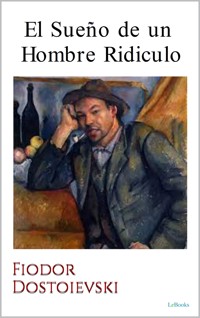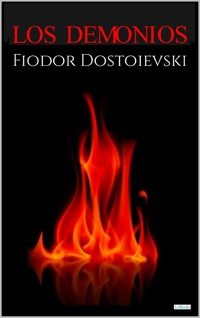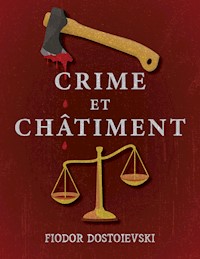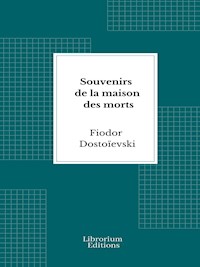
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Au milieu des steppes, des montagnes ou des forêts impraticables des contrées reculées de la Sibérie, on rencontre, de loin en loin, de petites villes d’un millier ou deux d’habitants, entièrement bâties en bois, fort laides, avec deux églises, – l’une au centre de la ville, l’autre dans le cimetière, – en un mot, des villes qui ressemblent beaucoup plus à un bon village de la banlieue de Moscou qu’à une ville proprement dite. La plupart du temps, elles sont abondamment pourvues de maîtres de police, d’assesseurs et autres employés subalternes. S’il fait froid en Sibérie, le service du gouvernement y est en revanche extraordinairement avantageux.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Fiodor Dostoïevski
Souvenirs de la maison des morts
1886
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383837398
Avertissement
On vient enfin de traduire les Souvenirs de la maison des morts, par le romancier russe Dostoïevsky. De courtes indications seront peut-être utiles pour préciser l’origine et la signification de ce livre.
Le public français connaît déjà Dostoïevsky par un de ses romans les plus caractéristiques, le Crime et le châtiment. Ceux qui ont lu cette œuvre ont dû prendre leur parti d’aimer ou de haïr le singulier écrivain. On va nous donner des traductions de ses autres romans. Elles continueront de plaire à quelques curieux, aux esprits qui courent le monde en quête d’horizons nouveaux. Elles achèveront de scandaliser la raison commune, celle qu’on se procure dans les maisons de confections philosophiques ; car ce temps est merveilleux pour tailler aux intelligences comme aux corps des vêtements uniformes, décents, à la portée de tous, un peu étriqués peut-être, mais qui évitent les tracas de la recherche et de l’invention. Ceux qui n’ont pas eu le courage d’aborder le monstre sont néanmoins renseignés sur sa façon de souffrir et de faire souffrir. On a beaucoup parlé de Dostoïevsky, depuis un an ; un critique a expliqué en deux mots la supériorité du romancier russe. – « Il possède deux facultés qui sont rarement réunies chez nos écrivains : la faculté d’évoquer et celle d’analyser. »
Oui, avec cela tout le principal est dit. Prenez chez nous Victor Hugo et Sainte-Beuve comme les représentants extrêmes de ces deux qualités littéraires ; derrière l’un ou l’autre, vous pourrez ranger, en deux familles intellectuelles, presque tous les maîtres qui ont travaillé sur l’homme. Les premiers le projettent dans l’action, ils ont toute puissance pour rendre sensible le drame extérieur, mais ils ne savent pas nous faire voir les mobiles secrets qui ont décidé le choix de l’âme dans ce drame. Les seconds étudient ces mobiles avec une pénétration infinie, ils sont incapables de reconstruire pour le mouvement tragique l’organisme délicat qu’ils ont démonté. Il y aurait une exception à faire pour Balzac ; quant à Flaubert, il faudrait entrer dans des distinctions et des réserves sacrilèges ; gardons-les pour le jour où l’on mettra le dieu de Rouen au Panthéon. Toujours est-il que, dans le pays de Tourguénef, de Tolstoï et de Dostoïevsky, les deux qualités contradictoires se trouvent souvent réunies ; cette alliance se paye, il est vrai, au prix de défauts que nous supportons malaisément : la lenteur et l’obscurité.
Mais ce n’est point des romans que je veux parler aujourd’hui. Les Souvenirs de la maison des morts n’empruntent rien à la fiction, sauf quelques précautions de mise en scène, nécessitées par des causes étrangères à l’art. Ce livre est un fragment d’autobiographie, mêlé d’observations sur un monde spécial, de descriptions et de récits très simples ; c’est le journal du bagne, un album de croquis rassemblés dans les casemates de Sibérie. Avant de vous récrier sur l’éloge d’un galérien, écoutez comment Dostoïevsky fut précipité dans cette infâme condition.
Il avait vingt-sept ans en 1848, il commençait à écrire avec quelque succès. Sa vie, pauvre et solitaire, allait par de mauvais chemins ; misère, maladie, tout lui donnait sur le monde des vues noires ; ses nerfs d’épileptique lui étaient déjà de cruels ennemis. Avec cela, un malheureux cœur plein de pitié, d’où est sorti le meilleur de son talent ; cette sensibilité contenue, vite aigrie, qui se change en folles colères devant les aspects d’injustice de l’ordre social. Il regardait autour de lui, cherchant l’idéal, le progrès, les moyens de se dévouer ; il voyait la triste Russie, bien froide, bien immobile, bien dure, tout ulcérée de maux anciens. Sur cette Russie, les idées généreuses du moment passaient et ramassaient à coup sûr de telles âmes. Le jeune écrivain fut entraîné, avec beaucoup d’autres de sa génération littéraire, dans les conciliabules présidés par Pétrachevsky. Cette sédition intellectuelle n’alla pas bien loin ; des récriminations, des menaces vagues, de beaux projets d’utopie. Il y a impropriété de mot à appeler cette effervescence d’idées, comme on le fait habituellement, la conspiration de Pétrachevsky ; de conspiration, il n’y en eut pas, au sens terrible que ce terme a reçu depuis lors en Russie. En tout cas, Dostoïevsky y prit la moindre part ; toute sa faute ne fut qu’un rêve défendu ; l’instruction ne put relever contre lui aucune charge effective. Chez nous, il eut été au centre gauche ; en Russie, il alla au bagne.
Englobé dans l’arrêt commun qui frappa ses complices, il fut jeté à la citadelle, condamné à mort, gracié sur l’échafaud, conduit en Sibérie ; il y purgea quatre ans de fers dans la « section réservée », celle des criminels d’État. Le romancier y laissa des illusions, mais rien de son honneur ; vingt ans après, en des temps meilleurs, les condamnés et leurs juges parlaient de ces souvenirs avec une égale tristesse, la main dans la main ; l’ancien forçat a fait une carrière glorieuse, remplie de beaux livres, et terminée récemment par un deuil quasi officiel. Il était nécessaire de préciser ces points, pour qu’on ne fit pas confusion d’époques ; il n’y eut rien de commun entre le proscrit de 1848 et les redoutables ennemis contre lesquels le gouvernement russe sévit aujourd’hui de la même façon, mais à plus juste titre.
Un des compagnons d’infortune de l’exilé, Yastrjemsky, a consigné dans ses Mémoires le récit d’une rencontre avec Dostoïevsky, au début de leur pénible voyage. Le hasard les réunit une nuit dans la prison d’étapes de Tobolsk, où ils trouvèrent aussi un de leurs complices les plus connus, Dourof. Ce récit peint sur le vif l’influence bienfaisante du romancier. « On nous conduisit dans une salle étroite, froide et sombre. Il y avait là des lits de planches avec des sacs bourrés de foin. L’obscurité était complète. Derrière la porte, sur le seuil, on entendait le pas lourd de la sentinelle, qui marchait en long et en large par un froid de 40 degrés.
« Dourof s’étendit sur le lit de camp, je me pelotonnai sur le plancher à côté de Dostoïevsky. À travers la mince cloison, un tapage infernal arrivait jusqu’à nous : un bruit de tasses et de verres, les cris de gens qui jouaient aux cartes, des injures, des blasphèmes. Dourof avait les doigts des pieds et des mains gelés ; ses jambes étaient blessées par les fers. Dostoïevsky souffrait d’une plaie qui lui était venue au visage dans la casemate de la citadelle, à Pétersbourg. Pour moi, j’avais le nez gelé. – Dans cette triste situation, je me rappelai ma vie passée, ma jeunesse écoulée au milieu de mes chers camarades de l’Université ; je pensai à ce qu’aurait dit ma sœur, si elle m’eût aperçu dans cet état. Convaincu qu’il n’y avait plus rien à espérer pour moi, je résolus de mettre fin à mes jours... Si je m’appesantis sur cette heure douloureuse, c’est uniquement parce qu’elle me donna l’occasion de connaître de plus près la personnalité de Dostoïevsky. Sa conversation amicale et secourable me sauva du désespoir ; elle réveilla en moi l’énergie.
« Contre toute espérance, nous parvînmes à nous procurer une chandelle, des allumettes et du thé chaud qui nous parut plus délicieux que le nectar. La plus grande partie de la nuit s’écoula dans un entretien fraternel. La voix douce et sympathique de Dostoïevsky, sa sensibilité, sa délicatesse de sentiment, ses saillies enjouées, tout cela produisit sur moi une impression d’apaisement. Je renonçai à ma résolution désespérée. Au matin, Dostoïevsky, Dourof et moi, nous nous séparâmes dans cette prison de Tobolsk, nous nous embrassâmes les larmes aux yeux, et nous ne nous revîmes plus.
« Dostoïevsky appartenait à la catégorie de ces êtres dont Michelet a dit que, tout en étant les plus forts mâles, ils ont beaucoup de la nature féminine. Par là s’explique tout un côté de ses œuvres, où l’on aperçoit la cruauté du talent et le besoin de faire souffrir. Étant donné cette nature, le martyre cruel et immérité qu’un sort aveugle lui envoya devait profondément modifier son caractère. Rien d’étonnant à ce qu’il soit devenu nerveux et irritable au plus haut degré. Mais je ne crois pas risquer un paradoxe en disant que son talent bénéficia de ses souffrances, qu’elles développèrent en lui le sens de l’analyse psychologique. »
C’était l’opinion de l’écrivain lui-même, non seulement au point de vue de son talent, mais de toute la suite de sa vie morale. Il parlait toujours avec gratitude de cette épreuve, où il disait avoir tout appris. Encore une leçon sur la vanité universelle de nos calculs ! À quelques degrés de longitude plus à l’ouest, à Francfort ou à Paris, cette incartade révolutionnaire eût réussi à Dostoïevsky, elle l’eût porté sur les bancs d’un Parlement, où il eût fait de médiocres lois ; sous un ciel plus rigoureux, la politique le perd, le déporte en Sibérie ; il en revient avec des œuvres durables, un grand renom, et l’assurance intime d’avoir été remis malgré lui dans sa voie. Le destin rit sur nos revers et nos réussites ; il culbute nos combinaisons et nous dispense le bien ou le mal en raison inverse de notre raison. Quand on écoute ce rire perpétuel, dans l’histoire de chaque homme et de chaque jour, on se trouve niais de souhaiter quelque chose.
Pourtant l’épreuve était cruelle, on le verra de reste en lisant les pages qui la racontent. Notre auteur feint d’avoir trouvé ce récit dans les papiers d’un ancien déporté, criminel de droit commun, qu’il nous représente comme un repenti digne de toute indulgence. Plusieurs des personnages qu’il met en scène appartiennent à la même catégorie. C’étaient là des concessions obligées à l’ombrageuse censure du temps ; cette censure n’admettait pas qu’il y eût des condamnés politiques en Russie. Il faut tenir compte de cette fiction, il faut se souvenir en lisant que le narrateur et quelques-uns de ses codétenus sont des gens d’honneur, de haute éducation. Cette transposition, que le lecteur russe fait de lui-même, est indispensable pour rendre tout leur relief aux sentiments, aux contrastes des situations. Ce qui n’est pas un hommage à la censure, mais un tour d’esprit particulier à l’écrivain, c’est la résignation, la sérénité, parfois même le goût de la souffrance avec lesquels il nous décrit ses tortures. Pas un mot enflé ou frémissant, pas une invective devant les atrocités physiques et morales où l’on attend que l’indignation éclate ; toujours le ton d’un fils soumis, châtié par un père barbare, et qui murmure à peine : « C’est bien dur ! » On appréciera ce qu’une telle contention ajoute d’épouvante à l’horreur des choses dépeintes.
Ah ! il faudra bander ses nerfs et cuirasser son cœur pour achever quelques-unes de ces pages ! Jamais plus âpre réalisme n’a travaillé sur des sujets plus repoussants. Ressuscitez les pires visions de Dante, rappelez-vous, si vous avez pratiqué cette littérature, le Maleus maleficorum, les procès-verbaux de questions extraordinaires rapportés par Llorente, vous serez encore mal préparé à la lecture de certains chapitres ; néanmoins, je conseille aux dégoûtés d’avoir bon courage et d’attendre l’impression d’ensemble ; ils seront étonnés de trouver cette impression consolante, presque douce. Voici, je crois, le secret de cette apparente contradiction.
À son entrée au bagne, l’infortuné se replie sur lui-même : du monde ignoble où il est précipité, il n’attend que désespoir et scandale. Mais peu à peu, il regarde dans son âme et dans les âmes qui l’entourent, avec la minutieuse patience d’un prisonnier. Il s’aperçoit que la fatigue physique est saine, que la souffrance morale est salutaire, qu’elle fait germer en lui d’humbles petites fleurs aux bons parfums, la semence de vertu qui ne levait pas au temps du bonheur. Surtout il examine de très près ses grossiers compagnons ; et voici que, sous les physionomies les plus sombres, un rayon transparaît qui les embellit et les réchauffe. C’est l’accoutumance d’un homme jeté dans les ténèbres : il apprend à voir, et jouit vivement des pâles clartés reconquises. Chez toutes ces bêtes fauves qui l’effrayaient d’abord, il dégage des parties humaines, et dans ces parties humaines des parcelles divines. Il se simplifie au contact de ces natures simples, il s’attache à quelques-unes, il apprend d’elles à supporter ses maux avec la soumission héroïque des humbles. Plus il avance dans son étude, plus il rencontre parmi ces malheureux d’excellents exemplaires de l’homme. L’horreur du supplice passe bientôt au second plan, adoucie et noyée dans ce large courant de pitié, de fraternité : que de bonnes choses ressuscitées dans la maison des morts ! Insensiblement, l’enfer se transforme et prend jour sur le ciel. Il semble que l’auteur ait prévu cette transformation morale, quand il disait au début de son récit, en décrivant le préau de la forteresse : « Par les fentes de la palissade,... on aperçoit un petit coin de ciel, non plus de ce ciel qui est au-dessus de la prison, mais d’un autre ciel, lointain et libre. »
On comprend maintenant pourquoi cette douloureuse lecture laisse une impression consolante ; beaucoup plus, je vous assure, que tels livres réputés très gais, qui font rire en maint endroit, et qu’on referme avec une incommensurable tristesse ; car ceux-ci nous montrent, dans l’homme le plus heureux, une bête désolée et stupide, ravalée à terre pour y jouir sans but. Dans un autre art, regardez le Martyre de saint Sébastien et l’Orgie romaine de Couture : quel est celui des deux tableaux qui vous attriste le plus ? C’est que la joie et la peine ne résident pas dans les faits extérieurs, mais dans la disposition d’esprit de l’artiste qui les envisage ; c’est qu’il n’y a qu’un seul malheur véritable, celui de manquer de foi et d’espérance. De ces trésors, Dostoïevsky avait assez pour enrichir toute la chiourme. Il les puisait dans l’unique livre qu’il posséda durant quatre ans, dans le petit évangile que lui avait donné la fille d’un proscrit ; il vous racontera comment il apprenait à lire à ses compagnons sur les pages usées. Et l’on dirait, en effet, que les Souvenirs ont été écrits sur les marges de ce volume ; un seul mot définit bien le caractère de l’œuvre et l’esprit de celui qui la conçut : c’est l’esprit évangélique. La plupart de ces écrivains russes en sont pénétrés, mais nul ne l’est au même degré que Dostoïevsky ; assez indifférent aux conséquences dogmatiques, il ne retient que la source de vie morale ; tout lui vient de cette source, même le talent d’écrire, c’est-à-dire de communiquer son cœur aux hommes, de leur répondre quand ils demandent un peu de lumière et de compassion.
En insistant sur ce trait capital, je dois mettre le lecteur en garde contre une assimilation trompeuse. Quelques-uns diront peut-être : Tout ceci n’est pas nouveau, c’est la fantaisie romantique sur laquelle nous vivons depuis soixante ans, la réhabilitation du forçat, une génération de plus dans la nombreuse famille qui va de Claude Gueux à Jean Valjean. – Qu’on regarde de plus près ; il n’y a rien de commun entre les deux conceptions. Chez nous, ce parti pris est trop souvent un jeu d’antithèses qui nous laisse l’impression de quelque chose d’artificiel et de faux ; car on grandit le forçat au détriment des honnêtes gens, comme la courtisane aux dépens des honnêtes femmes. Chez l’écrivain russe, pas l’ombre d’une antithèse ; il ne sacrifie personne à ses clients, il ne fait pas d’eux des héros ; il nous les montre ce qu’ils sont, pleins de vices et de misères ; seulement, il persiste à chercher en eux le reflet divin, à les traiter en frères déchus, dignes encore de charité. Il ne les voit pas dans un mirage, mais sous le jour simple de la réalité ; il les dépeint avec l’accent de la vérité vivante, avec cette juste mesure qu’on ne définit point à l’avance, mais qui s’impose peu à peu au lecteur et contente la raison.
Une autre catégorie de modèles pose devant le peintre : les autorités du bagne, fonctionnaires et gens de police, les tristes maîtres de ce triste peuple. On retrouvera dans leurs portraits la même sobriété d’indignation, la même équanimité. Rien ne trahit chez Dostoïevsky l’ombre d’un ressentiment personnel, ni ce que nous appellerions l’esprit d’opposition. Il explique, il excuse presque la brutalité et l’arbitraire de ces hommes par la perversion fatale qu’entraîne le pouvoir absolu. Il dit quelque part : « Les instincts d’un bourreau existent en germe dans chacun de nos contemporains. » L’habitude et l’absence de frein développent ces instincts, parallèlement à des qualités qui forcent la sympathie. Il en résulte un bourreau bon garçon, une réduction de Néron, c’est-à-dire un type foncièrement vrai. On remarquera dans ce genre l’officier Smékalof, qui prend tant de plaisir à voir administrer les verges ; les forçats raffolent de lui, parce qu’il les fustige drôlement.
– C’est un farceur, un cœur d’or, disent-ils à l’envi.
Qui expliquera les folles contradictions de l’homme, surtout de l’homme russe, instinctif, primesautier, plus près qu’un autre de la nature ?
J’ai rencontré un de ces tyranneaux des mines sibériennes. Au mois d’octobre 1878, je me trouvais au célèbre couvent de Saint-Serge, près de Moscou. Des religieux erraient indolemment dans les cours, sous la robe noire des basiliens. Mon guide, un petit frère lai très dégourdi, m’indiqua, avec une nuance de respect, un vieux moine accoudé sur la galerie du réfectoire, d’où il émiettait le reste de son pain de seigle aux pigeons qui s’abattaient des bouleaux voisins. – « C’est le père un tel, un ancien maître de police en Sibérie. » – Je m’approchai du cénobite. Il reconnut un étranger et m’adressa la parole en français. Sa conversation, bien que très réservée, dénotait une ouverture d’horizon fort rare dans le monde où il vivait. Je laissai tomber le nom d’un des proscrits de décembre 1825, dont l’histoire m’était familière, « L’auriez-vous rencontré en Sibérie ? demandai-je à mon interlocuteur. – Comment donc, il a été sous ma juridiction. » J’étais fixé. Je savais ce qu’avait été cette juridiction. Peu d’hommes dans tout l’empire eussent pu trouver dans leur mémoire les lourds secrets et les douloureuses images qui devaient hanter la conscience de ce moine. Quelle impulsion mystérieuse l’avait amené dans ce couvent, où il psalmodiait paisiblement les litanies depuis de longues années ? Était-ce piété, remords, lassitude ? – « En voilà un qui a beaucoup à expier, dis-je à mon guide : il a vu et fait des choses terribles ; le repentir l’ai poussé ici, peut-être ! » – Le petit frère convers me regarda d’un air étonné ; évidemment, la vocation de son ancien ne s’était jamais présentée à son esprit sous ce point de vue. – « Nous sommes tous pécheurs ! » répondit-il. Il ajouta, en clignant de l’œil vers le vieillard avec une nuance encore plus marquée de respect et d’admiration : « Sans doute, qu’il se repent : on raconte qu’il a beaucoup aimé les femmes. »
Dostoïevsky parcourt en tous sens ces âmes complexes. Le grand intérêt de son livre, pour les lettrés curieux de formes nouvelles, c’est qu’ils sentiront les mots leur manquer, quand ils voudront appliquer nos formules usuelles aux diverses faces de ce talent. Au premier abord, ils feront appel à toutes les règles de notre catéchisme littéraire, pour y emprisonner ce réaliste, cet impassible, cet impressionniste ; ils continueront, croyant l’avoir saisi, et Protée leur échappera ; son réalisme farouche découvrira une recherche inquiète de l’idéal, son impassibilité laissera deviner une flamme intérieure ; cet art subtil épuisera des pages pour fixer un trait de physionomie et ramassera en une ligne tout le dessin d’une âme. Il faudra s’avouer vaincu, égaré sur des eaux troubles et profondes, dans un grand courant de vie qui porte vers l’aurore.
Je ne me dissimule point les défauts de Dostoïevsky, la lenteur habituelle du trait, le désordre et l’obscurité de la narration, qui revient sans cesse sur elle-même, l’acharnement de myope sur le menu détail, et parfois la complaisance maladive pour le détail répugnant. Plus d’un lecteur en sera rebuté, s’il n’a pas la flexibilité d’esprit nécessaire pour se plier aux procédés du génie russe, assez semblables à ceux du génie anglais. À l’inverse de notre goût, qui exige des effets rapides, pressés, pas bien profonds par exemple, ces consciencieux ouvriers du Nord, un Thackeray ou un Dostoïevsky, accumulent de longues pages pour préparer un effet tardif. Mais aussi quelle intensité dans cet effet, quand on a la patience de l’attendre ! Comme le boulet est chassé loin par cette pesante charge de poudre, tassée grain à grain ! Je crois pouvoir promettre de délicates émotions à ceux qui auront cette patience de lecture, si difficile à des Français.
Il y a bien un moyen d’apprivoiser le public ; on ne l’emploie que trop. C’est d’étrangler les traductions de ces œuvres étrangères, de les « adapter » à notre goût. On a impitoyablement écarté plusieurs de ces fantaisies secourables, on a attendu, pour nous offrir les Souvenirs de la maison des morts, une version qui fût du moins un décalque fidèle du texte russe. Eût-il été possible, tout en satisfaisant à ce premier devoir du traducteur, de donner au récit et surtout aux dialogues une allure plus conforme aux habitudes de notre langue ? C’est un problème ardu que je ne veux pas examiner, n’ayant pas mission de juger ici la traduction de M. Neyroud. Je viens de parler de l’écrivain russe d’après les impressions que m’a laissées son œuvre originale ; je n’ose espérer que ces impressions soient aussi fortes sur le lecteur qui va les recevoir par intermédiaire.
Mais j’ai hâte de laisser la parole à Dostoïevsky. Quelle que soit la fortune de ses Souvenirs, je ne regretterai pas d’avoir plaidé pour eux. C’est si rare et si bon de recommander un livre où l’on est certain que pas une ligne ne peut blesser une âme, que pas un mot ne risque d’éveiller une passion douteuse ; un livre que chacun fermera avec une idée meilleure de l’humanité, avec un peu moins de sécheresse pour les misères d’autrui, un peu plus de courage contre ses propres misères. Voilà, si l’on veut bien y réfléchir, un divin mystère de solidarité. Une affreuse souffrance fut endurée, il y a trente ans, par un inconnu, dans une geôle de Sibérie, presque à nos antipodes ; conservée en secret depuis lors, elle vit, elle sert, elle vient de si loin assainir et fortifier d’autres hommes. C’est la plante aux sucs amers, morte depuis longtemps dans quelque vallée d’un autre hémisphère, et dont l’essence recueillie guérit les plaies de gens qui ne l’ont jamais vue fleurir. Oui, nulle souffrance ne se perd, toute douleur fructifie, il en reste un arôme subtil qui se répand indéfiniment dans le monde. Je ne donne point cette vérité pour une découverte ; c’est tout simplement l’admirable doctrine de l’Église sur le trésor des souffrances des saints. Ainsi de bien d’autres inventions qui procurent beaucoup de gloire à tant de beaux esprits ; changez les mots, grattez le vernis de « psychologie expérimentale », reconnaissez la vieille vérité sous la rouille théologique ; des philosophes vêtus de bure avaient aperçu tout cela, il y a quelques centaines d’années, en se relevant la nuit dans un cloître pour interroger leur conscience.
Enfin, ce n’est pas d’eux qu’il s’agit, mais de ce forçat sibérien, de ce petit apôtre laïque au corps ravagé, à l’âme endolorie, toujours agité entre d’atroces visions et de doux rêves. Je crois le voir encore dans ses accès de zèle patriotique, déblatérant contre l’abomination de l’Occident et la corruption française. Comme la plupart des écrivains étrangers, il nous jugeait sur les grimaces littéraires que nous leur montrons quelquefois. On l’eût bien étonné, si on lui eût prédit qu’il irait un matin dans Paris pour y réciter son étrange martyrologe ! – Allez et ne craignez rien, Féodor Michaïlovitch. Quelque mal qu’on ait pu vous dire de notre ville, vous verrez comme on s’y fait entendre en lui parlant simplement, avec la vérité qu’on tire de son cœur.
Vicomte E. M. de Vogüé.
Première partie
Au milieu des steppes, des montagnes ou des forêts impraticables des contrées reculées de la Sibérie, on rencontre, de loin en loin, de petites villes d’un millier ou deux d’habitants, entièrement bâties en bois, fort laides, avec deux églises, – l’une au centre de la ville, l’autre dans le cimetière, – en un mot, des villes qui ressemblent beaucoup plus à un bon village de la banlieue de Moscou qu’à une ville proprement dite. La plupart du temps, elles sont abondamment pourvues de maîtres de police, d’assesseurs et autres employés subalternes. S’il fait froid en Sibérie, le service du gouvernement y est en revanche extraordinairement avantageux. Les habitants sont des gens simples, sans idées libérales ; leurs mœurs sont antiques, solides et consacrées par le temps. Les fonctionnaires, qui forment à bon droit la noblesse sibérienne, sont ou des gens du pays, Sibériens enracinés, ou des arrivants de Russie. Ces derniers viennent tout droit des capitales, séduits par la haute paye, par la subvention extraordinaire pour frais de voyage et par d’autres espérances non moins tentantes pour l’avenir. Ceux qui savent résoudre le problème de la vie restent presque toujours en Sibérie et s’y fixent définitivement. Les fruits abondants et savoureux qu’ils récoltent plus tard les dédommagent amplement ; quant aux autres, gens légers et qui ne savent pas résoudre ce problème, ils s’ennuient bientôt en Sibérie et se demandent avec regret pourquoi ils ont fait la bêtise d’y venir. C’est avec impatience qu’ils tuent les trois ans, – terme légal de leur séjour ; – une fois leur engagement expiré, ils sollicitent leur retour et reviennent chez eux en dénigrant la Sibérie et en s’en moquant. Ils ont tort, car c’est un pays de béatitude, non seulement en ce qui concerne le service public, mais encore à bien d’autres points de vue. Le climat est excellent ; les marchands sont riches et hospitaliers ; les Européens aisés y sont nombreux. Quant aux jeunes filles, elles ressemblent à des roses fleuries ; leur moralité est irréprochable. Le gibier court dans les rues et vient se jeter contre le chasseur. On y boit du champagne en quantité prodigieuse ; le caviar est étonnant ; la récolte rend quelquefois quinze pour un. En un mot, c’est une terre bénie dont il faut seulement savoir profiter, et l’on en profite fort bien !
C’est dans l’une de ces petites villes, – gaies et parfaitement satisfaites d’elles-mêmes, dont l’aimable population m’a laissé un souvenir ineffaçable, – que je rencontrai un exilé, Alexandre Pétrovitch Goriantchikof, ci-devant gentilhomme-propriétaire en Russie. Il avait été condamné aux travaux forcés de la deuxième catégorie, pour avoir assassiné sa femme. Après avoir subi sa condamnation, – dix ans de travaux forcés, – il demeurait tranquille et inaperçu en qualité de colon dans la petite ville de K... À vrai dire, il était inscrit dans un des cantons environnants, mais il vivait à K..., où il trouvait à gagner sa vie en donnant des leçons aux enfants. On rencontre souvent dans les villes de Sibérie des déportés qui s’occupent d’enseignement. On ne les dédaigne pas, car ils enseignent la langue française, si nécessaire dans la vie, et dont on n’aurait pas la moindre idée sans eux, dans les parties reculées de la Sibérie. Je vis Alexandre Pétrovitch pour la première fois chez un fonctionnaire, Ivan Ivanytch Gvosdikof, respectable vieillard fort hospitalier, père de cinq filles qui donnaient les plus belles espérances. Quatre fois par semaine, Alexandre Pétrovitch leur donnait des leçons à raison de trente kopeks (argent) la leçon. Son extérieur m’intéressa. C’était un homme excessivement pâle et maigre, jeune encore, – âgé de trente-cinq ans environ, – petit et débile, toujours fort proprement habillé à l’européenne. Quand vous lui parliez, il vous fixait d’un air très attentif, écoutait chacune de vos paroles avec une stricte politesse et d’un air réfléchi, comme si vous lui aviez posé un problème ou que vous vouliez lui extorquer un secret. Il vous répondait nettement et brièvement, mais en pesant tellement chaque mot, que l’on se sentait tout à coup mal à son aise, sans savoir pourquoi, et que l’on se félicitait de voir la conversation terminée. Je questionnai Ivan Ivanytch à son sujet ; il m’apprit que Goriantchikof était de mœurs irréprochables, sans quoi, lui, Ivan Ivanytch, ne lui aurait pas confié l’instruction de ses filles, mais que c’était un terrible misanthrope, qui se tenait à l’écart de tous, fort instruit, lisant beaucoup, parlant peu et se prêtant assez mal à une conversation à cœur ouvert.
Certaines personnes affirmaient qu’il était fou, mais on trouvait que ce n’était pas un défaut si grave ; aussi les gens les plus considérables de la ville étaient-ils prêts à témoigner des égards à Alexandre Pétrovitch, car il pouvait être fort utile, au besoin, pour écrire des placets. On croyait qu’il avait une parenté fort honorable en Russie, – peut-être même dans le nombre y avait-il des gens haut placés, – mais on n’ignorait pas que depuis son exil il avait rompu toutes relations avec elle. En un mot, il se faisait du tort à lui-même. Tout le monde connaissait son histoire et savait qu’il avait tué sa femme par jalousie, – moins d’un an après son mariage, – et, qu’il s’était livré lui-même à la justice, ce qui avait beaucoup adouci sa condamnation. Des crimes semblables sont toujours regardés comme des malheurs, dont il faut avoir pitié. Néanmoins, cet original se tenait obstinément à l’écart et ne se montrait que pour donner des leçons.
Tout d’abord je ne fis aucune attention à lui ; puis sans que j’en sus moi-même la cause, il m’intéressa : il était quelque peu énigmatique. Causer avec lui était de toute impossibilité. Certes, il répondait à toutes mes questions : il semblait même s’en faire un devoir, mais une fois qu’il m’avait répondu, je n’osais l’interroger plus longtemps ; après de semblables conversations, on voyait toujours sur son visage une sorte de souffrance et d’épuisement. Je me souviens que par une belle soirée d’été, je sortis avec lui de chez Ivan Ivanytch. Il me vint brusquement à l’idée de l’inviter à entrer chez moi, pour fumer une cigarette ; je ne saurais décrire l’effroi qui se peignit sur son visage ; il se troubla tout à fait, marmotta des mots incohérents, et soudain, après m’avoir regardé d’un air courroucé, il s’enfuit dans une direction opposée. J’en fus fort étonné. Depuis, lorsqu’il me rencontrait, il semblait éprouver à ma vue une sorte de frayeur, mais je ne me décourageai pas. Il avait quelque chose qui m’attirait ; un mois après, j’entrai moi-même chez Goriantchikof, sans aucun prétexte. Il est évident que j’agis alors sottement et sans la moindre délicatesse. Il demeurait à l’une des extrémités de la ville, chez une vieille bourgeoise dont la fille était poitrinaire. Celle-ci avait une petite enfant naturelle âgée de dix ans, fort jolie et très joyeuse. Au moment où j’entrai, Alexandre Pétrovitch était assis auprès d’elle et lui enseignait à lire. En me voyant, il se troubla, comme si je l’avais surpris en flagrant délit. Tout éperdu, il se leva brusquement et me regarda fort étonné. Nous nous assîmes enfin ; il suivait attentivement chacun de mes regards, comme s’il m’eût soupçonné de quelque intention mystérieuse. Je devinai qu’il était horriblement méfiant. Il me regardait avec dépit, et il ne tenait à rien qu’il me demandât : – Ne t’en iras-tu pas bientôt ?
Je lui parlai de notre petite ville, des nouvelles courantes ; il se taisait ou souriait d’un air mauvais : je pus constater qu’il ignorait absolument ce qui se faisait dans notre ville et qu’il n’était nullement curieux de l’apprendre. Je lui parlai ensuite de notre contrée, de ses besoins : il m’écoutait toujours en silence en me fixant d’un air si étrange que j’eus honte moi-même de notre conversation. Je faillis même le fâcher en lui offrant, encore non coupés, les livres et les journaux que je venais de recevoir par la dernière poste. Il jeta sur eux un regard avide, mais il modifia aussitôt son intention et déclina mes offres, prétextant son manque de loisir. Je pris enfin congé de lui ; en sortant, je sentis comme un poids insupportable tomber de mes épaules. Je regrettais d’avoir harcelé un homme dont le goût était de se tenir à l’écart de tout le monde. Mais la sottise était faite. J’avais remarqué qu’il possédait fort peu de livres ; il n’était donc pas vrai qu’il lût beaucoup. Néanmoins, à deux reprises, comme je passais en voiture fort tard devant ses fenêtres, je vis de la lumière dans son logement. Qu’avait-il donc à veiller jusqu’à l’aube ? Écrivait-il, et, si cela était, qu’écrivait-il ?
Je fus absent de notre ville pendant trois mois environ. Quand je revins chez moi, en hiver, j’appris qu’Alexandre Pétrovitch était mort et qu’il n’avait pas même appelé un médecin. On l’avait déjà presque oublié. Son logement était inoccupé. Je fis aussitôt la connaissance de son hôtesse, dans l’intention d’apprendre d’elle ce que faisait son locataire et s’il écrivait. Pour vingt kopeks, elle m’apporta une corbeille pleine de papiers laissés par le défunt et m’avoua qu’elle avait déjà employé deux cahiers à allumer son feu. C’était une vieille femme morose et taciturne ; je ne pus tirer d’elle rien d’intéressant. Elle ne sut rien me dire au sujet de son locataire. Elle me raconta pourtant qu’il ne travaillait presque jamais et qu’il restait des mois entiers sans ouvrir un livre ou toucher une plume : en revanche, il se promenait toute la nuit en long et en large dans sa chambre, livré à ses réflexions ; quelquefois même, il parlait tout haut. Il aimait beaucoup sa petite fille Katia, surtout quand il eut appris son nom ; le jour de la Sainte-Catherine, il faisait dire à l’église une messe de Requiem pour l’âme de quelqu’un. Il détestait qu’on lui rendît des visites et ne sortait que pour donner ses leçons : il regardait même de travers son hôtesse, quand, une fois par semaine, elle venait mettre sa chambre en ordre ; pendant les trois ans qu’il avait demeuré chez elle, il ne lui avait presque jamais adressé la parole. Je demandai à Katia si elle se souvenait de son maître. Elle me regarda en silence et se tourna du côté de la muraille pour pleurer. Cet homme s’était pourtant fait aimer de quelqu’un !
J’emportai les papiers et je passai ma journée à les examiner. La plupart n’avaient aucune importance : c’étaient des exercices d’écoliers. Enfin je trouvai un cahier assez épais, couvert d’une écriture fine, mais inachevé. Il avait peut-être été oublié par son auteur. C’était le récit – incohérent et fragmentaire – des dix années qu’Alexandre Pétrovitch avait passées aux travaux forcés. Ce récit était interrompu çà et là, soit par une anecdote, soit par d’étranges, d’effroyables souvenirs, jetés convulsivement, comme arrachés à l’écrivain. Je relus quelquefois ces fragments et je me pris à douter s’ils avaient été écrits dans un moment de folie. Mais ces mémoires d’un forçat, Souvenirs de la maison des morts, comme il les intitule lui-même quelque part dans son manuscrit, ne me semblèrent pas privés d’intérêt. Un monde tout à fait nouveau, inconnu jusqu’alors, l’étrangeté de certains faits, enfin quelques remarques singulières sur ce peuple déchu, – il y avait là de quoi me séduire, et je lus avec curiosité. Il se peut que je me sois trompé : je publie quelques chapitres de ce récit : que le public juge...
I
La maison des morts
Notre maison de force se trouvait à l’extrémité de la citadelle, derrière le rempart. Si l’on regarde par les fentes de la palissade, espérant voir quelque chose, – on n’aperçoit qu’un petit coin de ciel et un haut rempart de terre, couvert des grandes herbes de la steppe. Nuit et jour, des sentinelles s’y promènent en long et en large ; on se dit alors que des années entières s’écouleront et que l’on verra, par la même fente de palissade, toujours le même rempart, toujours les mêmes sentinelles et le même petit coin de ciel, non pas de celui qui se trouve au-dessus de la prison, mais d’un autre ciel, lointain et libre. Représentez-vous une grande cour, longue de deux cents pas et large de cent cinquante, enceinte d’une palissade hexagonale irrégulière, formée de pieux étançonnés et profondément enfoncés en terre : voilà l’enceinte extérieure de la maison de force. D’un côté de la palissade est construite une grande porte, solide et toujours fermée, que gardent constamment des factionnaires, et qui ne s’ouvre que quand les condamnés vont au travail. Derrière cette porte se trouvaient la lumière, la liberté ; là vivaient des gens libres. En deçà de la palissade on se représentait ce monde merveilleux, fantastique comme un conte de fées : il n’en était pas de même du nôtre, – tout particulier, car il ne ressemblait à rien ; il avait ses mœurs, son costume, ses lois spéciales : c’était une maison morte-vivante, une vie sans analogue et des hommes à part. C’est ce coin que j’entreprends de décrire.
Quand on pénètre dans l’enceinte, on voit quelques bâtiments. De chaque côté d’une cour très vaste s’étendent deux constructions de bois, faites de troncs équarris et à un seul étage : ce sont les casernes des forçats. On y parque les détenus, divisés en plusieurs catégories. Au fond de l’enceinte on aperçoit encore une maison, la cuisine, divisée en deux chambrées (artel1) ; plus loin encore se trouve une autre construction qui sert tout à la fois de cave, de hangar et de grenier. Le centre de l’enceinte, complètement nu, forme une place assez vaste. C’est là que les détenus se mettent en rang. On y fait la vérification et l’appel trois fois par jour : le matin, à midi et le soir, et plusieurs fois encore dans la journée, si les soldats de garde sont défiants et habiles à compter. Tout autour, entre la palissade et les constructions, il reste une assez grande surface libre où quelques détenus misanthropes ou de caractère sombre aiment à se promener, quand on ne travaille pas : ils ruminent là, à l’abri de tous les regards, leurs pensées favorites. Lorsque je les rencontrais pendant ces promenades, j’aimais à regarder leurs visages tristes et stigmatisés, et à deviner leurs pensées. Un des forçats avait pour occupation favorite, dans les moments de liberté que nous laissaient les travaux, de compter les pieux de la palissade. Il y en avait quinze cents, il les avait tous comptés et les connaissait même par cœur. Chacun d’eux représentait un jour de réclusion : il décomptait quotidiennement un pieu et pouvait, de cette façon, connaître exactement le nombre de jours qu’il devait encore passer dans la maison de force. Il était sincèrement heureux quand il avait achevé un des côtés de l’hexagone : et pourtant, il devait attendre sa libération pendant de longues années ; mais on apprend la patience à la maison de force. Je vis un jour un détenu qui avait subi sa condamnation et que l’on mettait en liberté, prendre congé de ses camarades. Il avait été vingt ans aux travaux forcés. Plus d’un forçat se souvenait de l’avoir vu arriver jeune, insouciant, ne pensant ni à son crime ni au châtiment : c’était maintenant un vieillard à cheveux gris, au visage triste et morose. Il fit en silence le tour de nos six casernes. En entrant dans chacune d’elles, il priait devant l’image sainte, saluait profondément ses camarades, en les priant de ne pas garder un mauvais souvenir de lui. Je me rappelle aussi qu’un soir on appela vers la porte d’entrée un détenu qui avait été dans le temps un paysan sibérien fort aisé. Six mois auparavant, il avait reçu la nouvelle que sa femme s’était remariée, ce qui l’avait fort attristé. Ce soir-là, elle était venue à la prison, l’avait fait appeler pour lui donner une aumône. Ils s’entretinrent deux minutes, pleurèrent tous deux et se séparèrent pour ne plus se revoir. Je vis l’expression du visage de ce détenu quand il rentra dans la caserne... Là, en vérité, on peut apprendre à tout supporter.
Quand le crépuscule commençait, on nous faisait rentrer dans la caserne, où l’on nous enfermait pour toute la nuit. Il m’était toujours pénible de quitter la cour pour la caserne. Qu’on se figure une longue chambre, basse et étouffante, éclairée à peine par des chandelles et dans laquelle traînait une odeur lourde et nauséabonde. Je ne puis comprendre maintenant comment j’y ai vécu dix ans entiers. Mon lit de camp se composait de trois planches : c’était toute la place dont je pouvais disposer. Dans une seule chambre on parquait plus de trente hommes. C’était surtout en hiver qu’on nous enfermait de bonne heure ; il fallait attendre quatre heures au moins avant que tout le monde fût endormi, aussi était-ce un tumulte, un vacarme de rires, de jurons, de chaînes qui sonnaient, une vapeur infecte, une fumée épaisse, un brouhaha de têtes rasées, de fronts stigmatisés, d’habits en lambeaux, tout cela encanaillé, dégoûtant ; oui, l’homme est un animal vivace ! on pourrait le définir : un être qui s’habitue à tout, et ce serait peut-être là la meilleure définition qu’on en ait donnée.
Nous étions en tout deux cent cinquante dans la maison de force. Ce nombre était presque invariable, car lorsque les uns avaient subi leur peine, d’autres criminels arrivaient, il en mourait aussi. Et il y avait là toute sorte de gens. Je crois que chaque gouvernement, chaque contrée de la Russie avait fourni son représentant. Il y avait des étrangers et même des montagnards du Caucase. Tout ce monde se divisait en catégories différentes, suivant l’importance du crime et par conséquent la durée du châtiment. Chaque crime, quel qu’il soit, y était représenté. La population de la maison de force était composée en majeure partie de déportés aux travaux forcés de la catégorie civile (fortement condamnés, comme disaient les détenus). C’étaient des criminels privés de tous leurs droits civils, membres réprouvés de la société, vomis par elle, et dont le visage marqué au fer devait éternellement témoigner de leur opprobre. Ils étaient incarcérés dans la maison de force pour un laps de temps qui variait de huit à douze ans ; à l’expiration de leur peine, on les envoyait dans un canton sibérien en qualité de colons. Quant aux criminels de la section militaire, ils n’étaient pas privés de leurs droits civils, – c’est ce qui a lieu d’ordinaire dans les compagnies de discipline russes, – et n’étaient envoyés que pour un temps relativement court. Une fois leur condamnation purgée, ils retournaient à l’endroit d’où ils étaient venus, et entraient comme soldats dans les bataillons de ligne sibériens2. Beaucoup d’entre eux nous revenaient bientôt pour des crimes graves, seulement ce n’était plus pour un petit nombre d’années, mais pour vingt ans au moins ; ils faisaient alors partie d’une section qui se nommait « à perpétuité ». Néanmoins, les perpétuels n’étaient pas privés de leurs droits. Il existait encore une section assez nombreuse, composée des pires malfaiteurs, presque tous vétérans du crime, et qu’on appelait la « section particulière ». On envoyait là des condamnés de toutes les Russies. Ils se regardaient à bon droit comme détenus à perpétuité, car le terme de leur réclusion n’avait pas été indiqué. La loi exigeait qu’on leur donnât des tâches doubles et triples. Ils restèrent dans la prison jusqu’à ce qu’on entreprit en Sibérie les travaux de force les plus pénibles. « Vous n’êtes ici que pour un temps fixe, disaient-ils aux autres forçats ; nous, au contraire, nous y sommes pour toute notre vie. » J’ai entendu dire plus tard que cette section a été abolie. On a éloigné en même temps les condamnés civils, pour ne conserver que les condamnés militaires que l’on organisa en compagnie de discipline unique. L’administration a naturellement été changée. Je décris, par conséquent, les pratiques d’un autre temps et des choses abolies depuis longtemps...
Oui, il y a longtemps de cela ; il me semble même que c’est un rêve. Je me souviens de mon entrée à la maison de force, un soir de décembre, à la nuit tombante. Les forçats revenaient des travaux : on se préparait à la vérification. Un sous-officier moustachu m’ouvrit la porte de cette maison étrange où je devais rester tant d’années, endurer tant d’émotions dont je ne pourrais me faire une idée même approximative si je ne les avais pas ressenties. Ainsi, par exemple, aurais-je jamais pu m’imaginer la souffrance poignante et terrible qu’il y a à ne jamais être seul même une minute pendant dix ans ? Au travail sous escorte, à la caserne en compagnie de deux cents camarades, jamais seul, jamais ! Du reste, il fallait que je m’y fisse.
Il y avait là des meurtriers par imprudence, des meurtriers de métier, des brigands et des chefs de brigands, de simples filous, maîtres dans l’industrie de trouver de l’argent dans la poche des passants ou d’enlever n’importe quoi sur une table. Il aurait pourtant été difficile de dire pourquoi et comment certains détenus se trouvaient à la maison de force. Chacun d’eux avait son histoire, confuse et lourde, pénible comme un lendemain d’ivresse. Les forçats parlaient généralement fort peu de leur passé, qu’ils n’aimaient pas à raconter ; ils s’efforçaient même de n’y plus penser. Parmi mes camarades de chaîne j’ai connu des meurtriers qui étaient si gais et si insouciants qu’on pouvait parier à coup sûr que jamais leur conscience ne leur avait fait le moindre reproche ; mais il y avait aussi des visages sombres, presque toujours silencieux. Il était bien rare que quelqu’un racontât son histoire, car cette curiosité-là n’était pas à la mode, n’était pas d’usage ; disons d’un seul mot que cela n’était pas reçu. Il arrivait pourtant de loin en loin que par désœuvrement un détenu racontât sa vie à un autre forçat qui l’écoutait froidement. Personne, à vrai dire, n’aurait pu étonner son voisin. « Nous ne sommes pas des ignorants, nous autres ! » disaient-ils souvent avec une suffisance cynique. Je me souviens qu’un jour un brigand ivre (on pouvait s’enivrer quelquefois aux travaux forcés) raconta comment il avait tué et tailladé un enfant de cinq ans : il l’avait d’abord attiré avec un joujou, puis il l’avait emmené dans un hangar où il l’avait dépecé. La caserne tout entière, qui, d’ordinaire, riait de ses plaisanteries, poussa un cri unanime ; le brigand fut obligé de se taire. Si les forçats l’avaient interrompu, ce n’était nullement parce que son récit avait excité leur indignation, mais parce qu’il n’était pas reçu de parler de cela. Je dois dire ici que les détenus avaient un certain degré d’instruction. La moitié d’entre eux, – si ce n’est plus, – savaient lire et écrire. Où trouvera-t-on, en Russie, dans n’importe quel groupe populaire, deux cent cinquante hommes sachant lire et écrire ? Plus tard, j’ai entendu dire et même conclure, grâce à ces données, que l’instruction démoralisait le peuple. C’est une erreur : l’instruction est tout à fait étrangère à cette décadence morale. Il faut néanmoins convenir qu’elle développa l’esprit de résolution dans le peuple, mais c’est loin d’être un défaut. – Chaque section avait un costume différent : l’une portait une veste de drap moitié brune, moitié grise, et un pantalon dont un canon était brun, l’autre gris. Un jour, comme nous étions au travail, une petite fille qui vendait des navettes de pain blanc (kalatchi) s’approcha des forçats ; elle me regarda longtemps, puis éclata de rire : – « Fi ! comme ils sont laids ! s’écria-t-elle. Ils n’ont pas même eu assez de drap gris ou de drap brun pour faire leurs habits. » D’autres forçats portaient une veste de drap gris uni, mais dont les manches étaient brunes. On rasait aussi les têtes de différentes façons ; le crâne était mis à nu tantôt en long, tantôt en large, de la nuque au front ou d’une oreille à l’autre.
Cette étrange famille avait un air de ressemblance prononcé que l’on distinguait du premier coup d’œil ; même les personnalités les plus saillantes, celles qui dominaient involontairement les autres forçats, s’efforçaient de prendre le ton général de la maison. Tous les détenus, – à l’exception de quelques-uns qui jouissaient d’une gaieté inépuisable et qui, par cela même, s’attiraient le mépris général, – tous les détenus étaient moroses, envieux, effroyablement vaniteux, présomptueux, susceptibles et formalistes à l’excès. Ne s’étonner de rien était à leurs yeux une qualité primordiale, aussi se préoccupaient-ils fort d’avoir de la tenue. Mais souvent l’apparence la plus hautaine faisait place, avec la rapidité de l’éclair, à une plate lâcheté. Pourtant il y avait quelques hommes vraiment forts : ceux-là étaient naturels et sincères, mais, chose étrange ! ils étaient le plus souvent d’une vanité excessive et maladive. C’était toujours la vanité qui était au premier plan. La majorité des détenus était dépravée et pervertie, aussi les calomnies et les commérages pleuvaient-ils comme grêle. C’était un enfer, une damnation que notre vie, mais personne n’aurait osé s’élever contre les règlements intérieurs de la prison et contre les habitudes reçues ; aussi s’y soumettait-on bon gré, mal gré. Certains caractères intraitables ne pliaient que difficilement, mais pliaient tout de même. Des détenus qui, encore libres, avaient dépassé toute mesure, qui, souvent poussés par leur vanité surexcitée, avaient commis des crimes affreux, inconsciemment, comme dans un délire, et qui avaient été l’effroi de villes entières, étaient matés en peu de temps par le régime de notre prison. Le nouveau qui cherchait à s’orienter remarquait bien vite qu’ici il n’étonnerait personne ; insensiblement il se soumettait, prenait le ton général, une sorte de dignité personnelle dont presque chaque détenu était pénétré, absolument comme si la dénomination de forçat eût été un titre honorable. Pas le moindre signe de honte ou de repentir, du reste, mais une sorte de soumission extérieure, en quelque sorte officielle, qui raisonnait paisiblement la conduite à tenir. « Nous sommes des gens perdus, disaient-ils, nous n’avons pas su vivre en liberté, maintenant nous devons parcourir de toutes nos forces la rue verte3, et nous faire compter et recompter comme des bêtes. » « Tu n’as pas voulu obéir à ton père et à ta mère, obéis maintenant à la peau d’âne ! » « Qui n’a pas voulu broder, casse des pierres à l’heure qu’il est. » Tout cela se disait et se répétait souvent en guise de morale, comme des sentences et des proverbes, sans qu’on les prît toutefois au sérieux. Ce n’étaient que des mots en l’air. Y en avait-il un seul qui s’avouât son iniquité ? Qu’un étranger, – pas un forçat, – essaye de reprocher à un détenu son crime ou de l’insulter, les injures de part et d’autre n’auront pas de fin. Et quels raffinés que les forçats en ce qui concerne les injures ! Ils insultent finement, en artistes. L’injure était une vraie science ; ils ne s’efforçaient pas tant d’offenser par l’expression que par le sens, l’esprit d’une phrase envenimée. Leurs querelles incessantes contribuaient beaucoup au développement de cet art spécial.
Comme ils ne travaillaient que sous la menace du bâton, ils étaient paresseux et dépravés. Ceux qui n’étaient pas encore corrompus en arrivant à la maison de force, s’y pervertissaient bientôt. Réunis malgré eux, ils étaient parfaitement étrangers les uns aux autres. – « Le diable a usé trois paires de lapti4 avant de nous rassembler », disaient-ils. Les intrigues, les calomnies, les commérages, l’envie, les querelles, tenaient le haut bout dans cette vie d’enfer. Pas une méchante langue n’aurait été en état de tenir tête à ces meurtriers, toujours l’injure à la bouche.
Comme je l’ai dit plus haut, parmi eux se trouvaient des hommes au caractère de fer, endurcis et intrépides, habitués à se commander. Ceux-là, on les estimait involontairement ; bien qu’ils fussent fort jaloux de leur renommée, ils s’efforçaient de n’obséder personne, et ne s’insultaient jamais sans motif ; leur conduite était en tous points pleine de dignité ; ils étaient raisonnables et presque toujours obéissants, non par principe ou par conscience de leurs devoirs, mais comme par une convention mutuelle entre eux et l’administration, convention dont ils reconnaissaient tous les avantages. On agissait du reste prudemment avec eux. Je me rappelle qu’un détenu, intrépide et résolu, connu pour ses penchants de bête fauve, fut appelé un jour pour être fouetté. C’était pendant l’été ; on ne travaillait pas. L’adjudant, chef direct et immédiat de la maison de force, était arrivé au corps de garde, qui se trouvait à côté de la grande porte, pour assister à la punition. (Ce major était un être fatal pour les détenus, qu’il avait réduits à trembler devant lui. Sévère à en devenir insensé, il se « jetait » sur eux, disaient-ils ; mais c’était surtout son regard, aussi pénétrant que celui du lynx, que l’on craignait. Il était impossible de rien lui dissimuler. Il voyait, pour ainsi dire, sans même regarder. En entrant dans la prison, il savait déjà ce qui se faisait à l’autre bout de l’enceinte ; aussi les forçats l’appelaient-ils « l’homme aux huit yeux ». Son système était mauvais, car il ne parvenait qu’à irriter des gens déjà irascibles ; sans le commandant, homme bien élevé et raisonnable, qui modérait les sorties sauvages du major, celui-ci aurait causé de grands malheurs par sa mauvaise administration. Je ne comprends pas comment il put prendre sa retraite sain et sauf ; il est vrai qu’il quitta le service après qu’il eut été mis en jugement.)
Le détenu blêmit quand on l’appela. D’ordinaire, il se couchait courageusement et sans proférer un mot, pour recevoir les terribles verges, après quoi, il se relevait en se secouant. Il supportait ce malheur froidement, en philosophe. Il est vrai qu’on ne le punissait qu’à bon escient, et avec toutes sortes de précautions. Mais cette fois, il s’estimait innocent. Il blêmit, et tout en s’approchant doucement de l’escorte de soldats, il réussit à cacher dans sa manche un tranchet de cordonnier. Il était pourtant sévèrement défendu aux détenus d’avoir des instruments tranchants, des couteaux, etc. Les perquisitions étaient fréquentes, inattendues et des plus minutieuses ; toutes les infractions à cette règle étaient sévèrement punies ; mais comme il est difficile d’enlever à un criminel ce qu’il veut cacher, et que, du reste, des instruments tranchants se trouvaient nécessairement dans la prison, ils n’étaient jamais détruits. Si l’on parvenait à les ravir aux forçats, ceux-ci s’en procuraient bien vite de nouveaux. Tous les détenus se jetèrent contre la palissade, le cœur palpitant, pour regarder à travers les fentes. On savait que cette fois-ci, Pétrof refuserait de se laisser fustiger et que la fin du major était venue. Mais au moment décisif, ce dernier monta dans sa voiture et partit, confiant le commandement de l’exécution à un officier subalterne : « Dieu l’a sauvé ! » dirent plus tard les forçats. Quant à Pétrof, il subit tranquillement sa punition ; une fois le major parti, sa colère était tombée. Le détenu est soumis et obéissant jusqu’à un certain point, mais il y a une limite qu’il ne faut pas dépasser. Rien n’est plus curieux que ces étranges boutades d’emportement et de désobéissance. Souvent un homme qui supporte pendant plusieurs années les châtiments les plus cruels, se révolte pour une bagatelle, pour un rien. On pourrait même dire que c’est un fou... C’est du reste ce que l’on fait.
J’ai déjà dit que pendant plusieurs années je n’ai pas remarqué le moindre signe de repentance, pas le plus petit malaise du crime commis, et que la plupart des forçats s’estimaient dans leur for intérieur en droit d’agir comme bon leur semblait. Certainement la vanité, les mauvais exemples, la vantardise ou la fausse honte y étaient pour beaucoup. D’autre part, qui peut dire avoir sondé la profondeur de ces cœurs livrés à la perdition et les avoir trouvés fermés à toute lumière ? Enfin il semble que durant tant d’années, j’eusse dû saisir quelque indice, fût-ce le plus fugitif, d’un regret, d’une souffrance morale. Je n’ai positivement rien aperçu. On ne saurait juger le crime avec des opinions toutes faites, et sa philosophie est un peu plus compliquée qu’on ne le croit. Il est avéré que ni les maisons de force, ni les bagnes, ni le système des travaux forcés, ne corrigent le criminel ; ces châtiments ne peuvent que le punir et rassurer la société contre les attentats qu’il pourrait commettre. La réclusion et les travaux excessifs ne font que développer chez ces hommes une haine profonde, la soif des jouissances défendues et une effroyable insouciance. D’autre part, je suis certain que le célèbre système cellulaire n’atteint qu’un but apparent et trompeur. Il soutire du criminel toute sa force et son énergie, énerve son âme qu’il affaiblit et effraye, et montre enfin une momie desséchée et à moitié folle comme un modèle d’amendement et de repentir. Le criminel qui s’est révolté contre la société, la hait et s’estime toujours dans son droit : la société a tort, lui non. N’a-t-il pas du reste subi sa condamnation ? aussi est-il absous, acquitté à ses propres yeux. Malgré les opinions diverses, chacun reconnaîtra qu’il y a des crimes qui partout et toujours, sous n’importe quelle législation, seront indiscutablement crimes et que l’on regardera comme tels tant que l’homme sera homme. Ce n’est qu’à la maison de force que j’ai entendu raconter, avec un rire enfantin à peine contenu, les forfaits les plus étranges, les plus atroces. Je n’oublierai jamais un parricide, – ci-devant noble et fonctionnaire. Il avait fait le malheur de son père. Un vrai fils prodigue. Le vieillard essayait en vain de le retenir par des remontrances sur la pente fatale où il glissait. Comme il était criblé de dettes et qu’on soupçonnait son père d’avoir, – outre une ferme, – de l’argent caché, il le tua pour entrer plus vite en possession de son héritage. Ce crime ne fut découvert qu’au bout d’un mois. Pendant tout ce temps, le meurtrier, qui du reste avait informé la justice de la disparition de son père, continua ses débauches. Enfin, pendant son absence, la police découvrit le cadavre du vieillard dans un canal d’égout recouvert de planches. La tête grise était séparée du tronc et appuyée contre le corps, entièrement habillé ; sous la tête, comme par dérision, l’assassin avait glissé un coussin. Le jeune homme n’avoua rien : il fut dégradé, dépouillé de ses privilèges de noblesse et envoyé aux travaux forcés pour vingt ans. Aussi longtemps que je l’ai connu, je l’ai toujours vu d’humeur très insouciante. C’était l’homme le plus étourdi et le plus inconsidéré que j’aie rencontré, quoiqu’il fût loin d’être sot. Je ne remarquai jamais en lui une cruauté excessive. Les autres détenus le méprisaient, non pas à cause de son crime, dont il n’était jamais question, mais parce qu’il manquait de tenue. Il parlait quelquefois de son père. Ainsi un jour, en vantant la robuste complexion héréditaire dans sa famille, il ajouta : « Tenez, mon père, par exemple, jusqu’à sa mort, n’a jamais été malade. » Une insensibilité animale portée à un aussi haut degré semble impossible : elle est par trop phénoménale. Il devait y avoir là un défaut organique, une monstruosité physique et morale inconnue jusqu’à présent à la science, et non un simple délit. Je ne croyais naturellement pas à un crime aussi atroce, mais des gens de la même ville que lui, qui connaissaient tous les détails de son histoire, me la racontèrent. Les faits étaient si clairs, qu’il aurait été insensé de ne pas se rendre à l’évidence. Les détenus l’avaient entendu crier une fois, pendant son sommeil : « Tiens-le ! tiens-le ! coupe-lui la tête ! la tête ! la tête ! »
Presque tous les forçats rêvaient à haute voix ou déliraient pendant leur sommeil ; les injures, les mots d’argot, les couteaux, les haches revenaient le plus souvent dans leurs songes. « Nous sommes des gens broyés, disaient-ils, nous n’avons plus d’entrailles, c’est pourquoi nous crions la nuit. »
Les travaux forcés dans notre forteresse n’étaient pas une occupation, mais une obligation : les détenus accomplissaient leur tâche ou travaillaient le nombre d’heures fixé par la loi, puis retournaient à la maison de force. Ils avaient du reste ce labeur en haine. Si le détenu n’avait pas un travail personnel auquel il se livre volontairement avec toute son intelligence, il lui serait impossible de supporter sa réclusion. De quelle façon ces gens, tous d’une nature fortement trempée, qui avaient largement vécu et désiraient vivre encore, qui avaient été réunis contre leur volonté, après que la société les avait rejetés, auraient-ils pu vivre d’une façon normale et naturelle ?
Grâce à la seule paresse, les instincts les plus criminels, dont le détenu n’aurait jamais même conscience, se développeraient en lui.