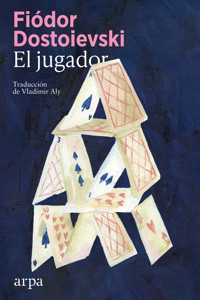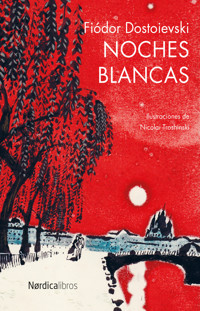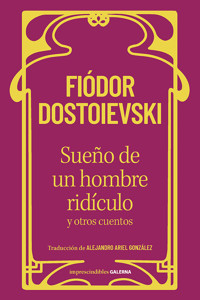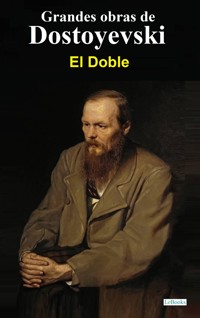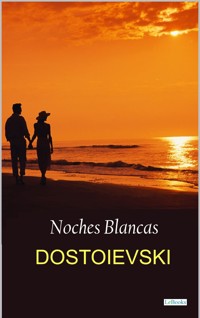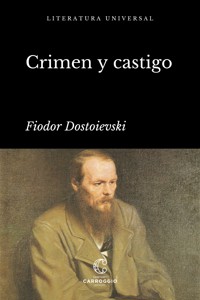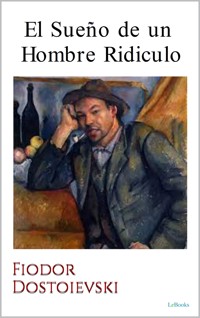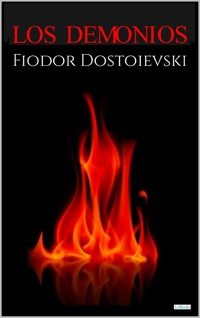0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ordinov se décida enfin à changer de chambre. Sa logeuse, pauvre veuve d’un fonctionnaire d’État, avait été par des circonstances imprévues contrainte de quitter Pétersbourg pour se retirer au fond de sa province, chez ses parents, avant même l’échéance des loyers en cours. Le jeune homme, qui pensait attendre la fin de son terme, regrettait de quitter si brusquement son vieux coin. Et puis !... il était pauvre, et les logements coûtent cher. Cependant, dès le lendemain du départ de sa logeuse, il prit son chapeau et alla flâner dans les rues, en examinant les écriteaux qui annoncent les locations, choisissant les maisons les plus délabrées et les plus habitées, – celles où il pouvait le plus vraisemblablement trouver un propriétaire presque aussi pauvre que lui-même.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Fiodor Dostoïevski
L’esprit souterrain
1886
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383837381
Première partie
Katia1
I
Ordinov se décida enfin à changer de chambre. Sa logeuse, pauvre veuve d’un fonctionnaire d’État, avait été par des circonstances imprévues contrainte de quitter Pétersbourg pour se retirer au fond de sa province, chez ses parents, avant même l’échéance des loyers en cours. Le jeune homme, qui pensait attendre la fin de son terme, regrettait de quitter si brusquement son vieux coin. Et puis !... il était pauvre, et les logements coûtent cher. Cependant, dès le lendemain du départ de sa logeuse, il prit son chapeau et alla flâner dans les rues, en examinant les écriteaux qui annoncent les locations, choisissant les maisons les plus délabrées et les plus habitées, – celles où il pouvait le plus vraisemblablement trouver un propriétaire presque aussi pauvre que lui-même.
Il cherchait depuis longtemps déjà, tout à son projet : mais peu à peu il se sentait envahi par des sensations inconnues. Distraitement d’abord, puis attentivement et enfin avec une extrême curiosité, il se mit à regarder autour de lui. La foule, la vie extérieure, le bruit, le mouvement, la variété des spectacles, toute cette médiocrité des choses de la rue, tout ce quotidien de la vie qui fatigue tant les affairés de Pétersbourg toujours en quête – si vainement, mais si activement ! – du repas à conquérir par le travail ou autrement, toute cette banale prose et tout cet ennui évoquaient dans l’esprit d’Ordinov une joie sereine. Ses joues, pâles à l’ordinaire, se coloraient d’une faible rougeur, ses yeux s’illuminaient d’un soudain espoir ; il respirait avec avidité l’air frais et froid ; il était extraordinairement léger.
Il menait une existence monotone et solitaire. Trois ans auparavant, ayant obtenu un grade universitaire et s’étant ainsi rendu relativement indépendant, il était allé chez un certain vieillard qu’il ne connaissait encore que de nom. Les domestiques en livrée l’avaient longtemps fait attendre avant de consentir à l’annoncer pour la seconde fois ; enfin il était entré dans un salon vaste, obscur et presque sans meubles, tel qu’on en trouve encore dans les anciennes maisons du temps des châteaux. Là, il avait aperçu un personnage tout chamarré de décorations et la tête couverte de cheveux gris : l’ami et le collègue du père d’Ordinov et le tuteur de celui-ci. Le vieillard lui remit une somme insignifiante, reliquat d’un héritage vendu aux enchères. Ordinov reçut cette somme avec indifférence, fit ses derniers adieux à son tuteur et sortit. – C’était un soir d’automne, morne et triste. Ordinov réfléchissait. Il se sentait le cœur plein d’une désolation sans cause, ses yeux brillaient de fièvre, et il avait des frissons sans cesse alternés de chaud et de froid. Il calculait qu’il pourrait, avec cette somme, vivre deux ou trois ans, quatre peut-être en faisant la part de la faim... Mais l’heure s’avançait, la pluie tombait ; il loua la première chambre venue et en une heure y fut installé. Ce fut pour lui une façon d’ermitage : il y vécut dans un isolement absolu. Deux ans après il était devenu tout à fait sauvage.
Il était devenu sauvage sans s’en douter. Il ne se rendait point compte qu’il y eût une autre existence, extérieure, bruyante, mouvementée, toujours renouvelée et qui vous appelle sans cesse et fatalement vous reprend tôt ou tard. Il ne pouvait sans doute l’ignorer tout à fait, mais il ne savait rien d’elle et ne s’en était jamais soucié. Dès l’enfance il s’était fait un vague isolement intérieur : à cette heure, l’isolement s’était précisé, défini et fortifié par la plus profonde des passions, celle qui épuise toutes les forces vitales sans laisser à des êtres comme Ordinov aucune préoccupation de la banalité pratique de l’existence, cette passion entre toutes inassouvible : la science. Elle minait sa jeunesse comme un poison lent et comme une lente ivresse, détruisait son sommeil, le dégoûtait de la nourriture saine et même de l’air frais qui ne pénétrait jamais dans son étroite retraite. Et Ordinov, dans son exaltation, ne voulait point remarquer tout cela. Jeune, il ne rêvait, pour l’instant, nul autre bonheur que celui de contenter cette passion qui faisait de lui un enfant pour la conduite de la vie et le rendait incapable de se concilier la sympathie des gens et d’arriver parmi eux à quelque situation. Car la science, chez les habiles, est un capital ; mais la passion d’Ordinov était une arme qu’il tournait contre lui-même.
C’était, d’ailleurs, plutôt une sorte d’enthousiasme hasardeux qu’un dessein raisonné d’apprendre et de savoir. Dès l’enfance il s’était fait une réputation de singularité. Il n’avait pas connu ses parents, son caractère étrange et « à part » lui attirait du fait de ses camarades de mauvais traitements et des brutalités. Ainsi délaissé, il devint morose, plus « à part » encore et peu à peu tout à fait exclusif. C’est dans de telles dispositions qu’il s’était laissé séduire par sa passion, et il s’y livrait solitairement, sans ordre ni système arrêté. Ce n’avait été jusqu’alors que la première fougue et la première fièvre d’un artiste. Mais en lui maintenant se dressait une idée, et il la contemplait avec amour, toute vague encore et confuse qu’elle fût. Il la voyait peu à peu prendre corps et s’éclairer : il lui semblait que cette apparence implorait une réalisation. Ce désir dévorait l’âme d’Ordinov, mais il ne sentait encore que trop peu nettement l’originalité de son idée, sa vérité et sa personnalité. La création se manifestait déjà, elle se limitait et se condensait, mais le terme était encore loin, très loin peut-être : peut-être ne devait-il jamais venir !...
Et il allait à travers les rues comme un réfractaire, ou plutôt comme un ascète qui aurait brusquement quitté sa muette solitude pour entrer dans une ville agitée et retentissante. Tout était pour lui bizarre et nouveau, et (tant il était étranger à ces bruyantes foules, à ce monde en ébullition) il ne pouvait même pas s’étonner de son étonnement. Il ne remarquait pas davantage sa propre sauvagerie, pris au contraire d’une joie et d’une ivresse comparables à celles d’un affamé qui romprait un long jeûne. – N’était-il pourtant pas bien curieux qu’un changement de logement, un accident si mince, pût émouvoir et troubler un Pétersbourgeois, fût-il Ordinov ? – Il est vrai qu’il n’avait jamais eu l’occasion de sortir pour affaires.
Il se complaisait de plus en plus en sa flânerie d’observateur.
Fidèle à ses habitudes d’esprit, il lisait dans les tableaux qui se déroulaient clairement en lui comme entre les lignes d’un livre. Tout l’intéressait, il ne perdait pas une impression. Avec ses yeux intérieurs il examinait les visages des passants, regardait attentivement la physionomie des choses, tout en écoutant avec sympathie le langage du peuple, comme s’il eût contrôlé les conclusions où l’avaient amené les calmes méditations de ses nuits solitaires. Souvent quelque futilité l’arrêtait, lui suggérant une idée, et pour la première fois il se dépitait de s’être ainsi retranché du monde dans une cellule. Tout ici, en lui comme en dehors de lui, allait plus vite ; son pouls battait largement et vivement ; son esprit, qu’avait comprimé la solitude, aiguisé maintenant, élevé par l’exaltation de l’activité, travaillait avec précision, calme et énergie. Maintenant il aurait voulu s’introduire dans cette vie qu’il ne connaissait pas encore ou, pour mieux dire, qu’il ne connaissait qu’en artiste. Son cœur battit involontairement dans une angoisse de sympathie universelle. Il se prit à considérer plus attentivement les gens qui le frôlaient : mais c’étaient des passants absorbés et inquiets !... et peu à peu son insouciance disparaissait, la réalité l’oppressait déjà, lui donnant une sorte d’horreur et en même temps d’estime pour la vie, et il commençait à se lasser de cette extraordinaire abondance d’impressions nouvelles, comme un malade qui fait ses premiers pas et qui tombe, ébloui par la clarté du jour, étourdi par l’effervescence de l’activité humaine, envertiginé par le bruit et la variété de la foule qui s’agite autour de lui. Tout à coup il fut saisi d’une morne tristesse. Il en venait à douter de la direction de sa vie et même de son avenir. Une pensée encore acheva de le troubler : il revit tout son passé, isolé, sans échange d’affection... Quelques passants avec lesquels il avait d’abord essayé d’engager la conversation s’étaient détournés de lui avec un air brutal et étrange. On le prenait pour un fou, du moins pour quelque grand original, – en quoi l’on ne se trompait guère. Et Ordinov se rappela que sa confiance avait toujours été ainsi repoussée, et que pendant son enfance tout le monde le fuyait à cause de son entêtement et de son allure absorbée, que sa sympathie n’avait jamais su se révéler que par des dehors ambigus et pénibles, sans égalité morale. Ç’avait été la grande souffrance de son enfance de constater qu’il ne ressemblait pas à ses petits camarades. Et il était obsédé par le sentiment de cette incurable solitude.
Distraitement il s’échoua dans un endroit très excentrique. Après avoir dîné dans un restaurant médiocre, il reprit sa promenade errante. De nouveau les rues et les places se succédèrent. Puis il longea de hauts murs gris et jaunes : là s’arrêtaient les maisons riches. C’était maintenant un contraste de vieilles petites baraques et de grands bâtiments, fabriques énormes aux murs rongés et noircis, aux cheminées monumentales. Personne dans les chemins, tout était morne et hostile.
Le soir tombait. Par une longue ruelle, Ordinov parvint à une place où se dressait une église. Il y entra presque sans remarquer ce qu’il faisait. L’office finissait à peine, et l’église était presque vide. Deux femmes seulement restaient encore agenouillées près du seuil. Le bedeau, un petit vieux, éteignait les cierges. Les rayons du soleil couchant coulaient par larges ondes à travers les étroits vitraux de la coupole, inondant une des nefs d’un océan de clartés. Elles allaient faiblissant, et plus s’épaississait l’ombre, – cette ombre qui s’amasse sous les arceaux, – plus étincelaient les images dorées aux lueurs intermittentes des lampes et des cierges. En proie à une angoisse profondément troublante et à une grandissante oppression, Ordinov s’accota au mur, dans un des coins les plus sombres, et s’oublia dans ses pensées. Le pas régulier et sourd de deux paroissiens le rappela à lui. Il les regarda, et une indéfinissable curiosité s’empara de son esprit. C’étaient un vieillard et une jeune femme. Le vieillard, de haute taille, droit encore et énergique, mais amaigri et maladivement pâle, eût pu passer pour un marchand venu d’une province reculée. Il portait un long et noir cafetan fourré, déboutonné, et, sous ce cafetan, une redingote russe exactement serrée du haut en bas. Son cou nu était négligemment entouré d’un foulard écarlate ; à la main il tenait une toque fourrée. Une longue barbe à demi blanche tombait sur sa poitrine, et, sous ses sourcils épais et froncés, le regard brillait d’un éclat fiévreux, un hautain, un pénétrant regard. La femme pouvait avoir vingt ans. Une beauté merveilleuse ! Elle était vêtue d’une riche fourrure bleu clair ; un fichu en satin blanc couvrait sa tête et se nouait sous le menton. Elle marchait les yeux baissés, et une sorte de gravité réfléchie s’affirmait nettement et tristement dans les lignes douces et tendres de son visage d’enfant. Il y avait quelque chose d’étrange dans la soudaine apparition de ce couple.
Le vieillard s’arrêta au milieu de l’église et salua des quatre côtés, bien qu’il n’y eût plus personne. Sa compagne l’imita, puis il la prit par la main et la conduisit vers la grande image de la Vierge, patronne de l’église. Cette image étincelait, près de l’autel, d’un feu aveuglant qui se reflétait parmi l’or et les pierreries des ornements. Le bedeau salua avec déférence l’étranger, qui lui rendit légèrement son salut. Sa compagne tomba à genoux devant l’image ; le vieillard prit l’extrémité de la nappe d’église et lui en couvrit la tête. De sourds sanglots retentirent.
Intrigué par la solennité de cette scène, Ordinov en attendait impatiemment la fin. Deux minutes après, la femme releva la tête, et de nouveau son beau visage fut éclairé par la vive lumière de la lampe. Ordinov tressaillit et fit en avant deux pas. Elle avait déjà repris le bras du vieillard, et tous deux lentement se dirigeaient vers la porte. Les larmes brûlaient ses sombres yeux bleus dont les longs cils baissés tranchaient sur la blancheur laiteuse de son teint. Les larmes coulaient sur ses joues pâlies. Ses lèvres souriaient, mais son visage conservait les traces d’une terreur puérile et mystérieuse. Toute frémissante d’émotion, elle se serrait avec confiance contre le vieillard.
Agité, comme fouetté par une sensation inconnue, douce et excitante, Ordinov les suivit vivement, et, sur le parvis, passa devant eux. Le vieillard lui adressa un regard hostile. Elle aussi le regarda, mais sans prendre garde à lui, comme enfouie dans ses pensées. Sans se rendre exactement compte des mobiles de son action, Ordinov continua à les suivre, de loin, dans l’ombre maintenant très avancée du crépuscule. Le couple s’engagea dans une large et sale rue d’artisans, pleine de magasins de farines et d’auberges, et qui aboutissait aux remparts de la ville. De là, il tourna dans une ruelle étroite et longue, bordée de hautes barrières ; au bout se dressait le grand mur sombre d’une maison de quatre étages dont l’allée communiquait de cette ruelle à une autre. Ils approchaient tous trois de la maison, quand le vieillard se retourna et dévisagea Ordinov avec impatience. Le jeune homme s’arrêta, comme cloué sur place ; son entraînement lui parut à lui-même inconvenant. Le vieillard se retourna une fois encore, sans doute pour se convaincre que sa menace silencieuse avait produit son effet, puis, avec la jeune femme, pénétra dans la cour de la maison. Ordinov reprit le chemin de son logement.
Il était de très mauvaise humeur et se reprochait cette fatigante journée, gaspillée sans profit et qu’il avait terminée par une sottise, en prêtant à une circonstance plus que banale les couleurs d’une aventure.
Malgré le mécontentement que lui avait causé, le matin de ce même jour, la constatation de sa sauvagerie, son esprit conservait l’habitude de fuir instinctivement tout ce qui pouvait le distraire ou l’émouvoir sans ébranlement utile pour la pensée. Et il se prit à songer tristement et avec une sorte de repentir à son vieux coin où il était si sûrement à l’abri de semblables accidents ; puis une angoisse s’empara de lui à la pensée des tracas d’un déménagement et de l’ennui d’être encore dans l’indécision à ce sujet. En même temps il se trouvait humilié de tant s’occuper d’une telle vétille. Enfin fourbu, incapable de lier deux idées, il remarqua avec surprise qu’il avait dépassé sa maison sans s’en apercevoir. Étourdi, hochant la tête en songeant à cette anormale distraction, il l’attribua à la fatigue, et, gravissant l’escalier, entra dans sa mansarde. Là, il alluma une bougie ; mais aussitôt l’image de la jeune femme éplorée s’offrit très nettement à son imagination. Si ardente et si forte fut cette impression, son cœur suivait avec une telle prédilection les doux et tendres traits de ce visage bouleversé par une terreur et un attendrissement mystérieux, baigné par des larmes d’exaltation ou de puéril repentir, que les yeux d’Ordinov se troublèrent et qu’il sentit un feu s’allumer dans ses veines. Mais l’apparition s’évanouit. Après le transport vint la réflexion, puis le dépit, puis une sorte de colère impuissante ; sans se déshabiller, il s’enveloppa dans sa couverture et se jeta sur son rude lit...
La matinée était avancée quand il s’éveilla, à la fois accablé et confus. Il fit rapidement sa toilette en s’efforçant de penser à ces soins quotidiens, et sortit, en prenant la direction opposée à celle qu’il avait prise la veille. Pour en finir, il choisit un logement chez un pauvre Allemand nommé Schpis, qui demeurait avec sa fille Tinchen. Schpis, aussitôt les arrhes reçues, ôta l’écriteau cloué à la porte et félicita Ordinov pour son amour de la science. Il lui promit de s’occuper lui-même de son service. Ordinov déclara qu’il emménagerait dans la soirée, puis il reprit le chemin de son ancienne chambre. Mais en route il réfléchit et tourna du côté opposé. L’audace lui revenait, et il sourit en lui-même de sa curiosité. La route, dans son impatience, lui parut très longue. Il parvint enfin à l’église de la veille. On officiait. Il choisit une place d’où il pût voir tous les fidèles : mais ceux qu’il cherchait n’y étaient pas. Après une longue attente, il sortit, un peu honteux. Il s’entêta fortement à tâcher de fixer son esprit sur des sentiments indifférents pour changer le cours de ses pensées. Et comme il réfléchissait aux banalités de la vie, il vint à songer que c’était l’heure du dîner. Effectivement, il avait faim. Il entra donc dans le restaurant où il avait déjà dîné la veille : plus tard il ne se souvint pas comment il en était sorti. Longtemps et inconsciemment il erra à travers les rues, les ruelles pleines de gens et les places vides, et parvint à un endroit complètement désert, sans maisons et où s’étendaient des champs jaunissants. Le calme mortel du lieu, en lui donnant une sensation nouvelle ou dès longtemps oubliée, le rappela à lui. La journée était sèche, il gelait : un véritable octobre pétersbourgeois. À quelque distance, on voyait une izba, tout auprès deux meules de foin ; un petit cheval crépu, la tête basse et la lèvre pendante, se tenait, dételé, près d’une charrette et semblait méditer. Un chien de garde, en grondant, rongeait un os auprès d’une roue cassée. Un enfant de trois ans, vêtu seulement d’une chemise, en grattant sa tête blonde et touffue, considérait avec étonnement le citadin égaré dans ces parages. Derrière l’izba s’étendaient des champs et des potagers. Au bout des cieux bleus, des bois sombres ; du côté opposé accouraient des nuages de neiges amoncelées : on eût dit qu’ils chassaient devant eux des bandes d’oiseaux migrateurs, sans cri, et l’un après l’autre enfilant le ciel. Tout était calme, tout était empreint d’une tristesse solennelle, tout souffrait de la secrète et navrante venue de la nuit... Ordinov s’en alla plus loin, plus loin encore. Mais enfin la solitude lui pesa. Il rentra dans la ville, et soudain il entendit les puissants accents de la cloche appelant à la prière du soir. Il doubla le pas, et bientôt il entra de nouveau dans l’église qui depuis un jour lui était si familière.
L’inconnue s’y trouvait déjà.
Elle était agenouillée près de l’entrée, dans la foule des fidèles. Ordinov se fraya un chemin à travers les rangs serrés des mendiants, des vieilles femmes déguenillées, des malades et des infirmes qui attendaient l’aumône à la porte, et s’agenouilla à côté de la jeune femme. Leurs vêtements se touchaient. Il entendait la respiration inégale qui s’échappait avec une ardente prière de ses lèvres entrouvertes. Ses traits, comme la veille, trahissaient une émotion et une piété infinies. Comme la veille, des larmes ne cessaient de couler et de se consumer sur les joues brûlantes, comme pour laver quelque terrible crime. L’endroit était sombre. Par instants seulement la flamme d’une lampe agitée par le vent éclairait d’une intermittente lueur le visage de l’inconnue dont chaque trait se gravait dans la mémoire d’Ordinov, dans son regard et dans son cœur. Enfin, n’y tenant plus, la poitrine convulsivement oppressée, il éclata en sanglots et heurta de sa tête en feu les dalles glacées. Il n’entendit, il ne sentit rien, sauf au cœur, comme s’il allait cesser de battre, un spasme très douloureux.
Était-ce la solitude qui avait développé en lui cette extrême impressionnabilité et laissé ainsi ses sens sans défense, comme à découvert ? S’était-elle amassée, cette effervescence, dans l’angoisse des insomnies sans bruit et sans air ? Avait-il fallu tous ces efforts désordonnés et toutes ces impatientes émotions de l’esprit pour qu’enfin le cœur pût s’ouvrir, trouver une issue et prendre son élan ? Ou bien était-ce simplement que l’heure eût sonné et que les choses dussent s’accomplir ainsi, soudainement, comme dans un jour de chaleur étouffante le ciel s’obscurcit tout à coup, puis se décharge sur la terre altérée en pluie chaude qui suspend des perles aux branches vermeilles, et froisse l’herbe des champs, et courbe au ras du sol les corolles délicates des fleurs : mais au premier rayon du soleil tout renaît, tout se relève, tout s’élance au-devant de la lumière et solennellement lui envoie jusqu’au ciel, pour fêter cette renaissance, d’abondants et doux effluves de joie et de santé... Ordinov ne pouvait se rendre compte de son état, il avait à peine conscience de lui-même... Il ne s’aperçut presque pas de la fin de l’office. Alors pourtant il se releva et suivit la jeune femme à travers la foule des paroissiens qui se portaient vers l’entrée. Il rencontra plus d’une fois son regard tranquille tout ensemble et étonné. Plus d’une fois arrêtée par les reflux de la foule, elle se retourna vers lui ; son étonnement s’accroissait visiblement, et tout à coup ses joues s’empourprèrent. Alors se montra le vieillard qui la prit par la main. Ordinov subit de nouveau le regard moqueur et menaçant, et une sorte d’étrange rancune lui serra le cœur. Mais bientôt il perdit de vue les deux inconnus, et, rassemblant toute son énergie dans un effort surnaturel, il s’élança en avant et sortit de l’église.
L’air frais put à peine le rafraîchir. Sa respiration était difficile, il suffoquait. Son cœur battait lentement et fortement à lui rompre la poitrine. Il chercha en vain à retrouver ses inconnus : ni dans la rue ni dans la ruelle, personne. Mais en sa tête naissait une pensée et se formait un de ces plans décisifs et bizarres qui, bien qu’insensés, réussissent toujours en de telles circonstances.
Le lendemain matin, à huit heures, il vint par la ruelle à la maison qu’habitaient le vieillard et la jeune femme, et entra dans une cour étroite, sale, infecte comme une fosse d’ordures. Le dvornik, petit de taille, d’origine tartare, un homme d’environ vingt-cinq ans avec un visage vieilli et ridé, travaillait dans cette cour. Il s’arrêta, appuya son menton sur le manche de sa pelle en apercevant Ordinov, le regarda des pieds à la tête et lui demanda ce qu’il désirait.
– Je cherche un logement, répondit Ordinov, d’un ton bref.
– Lequel ? demanda le dvornik avec un sourire.
Il regardait Ordinov comme s’il eût été au courant de ses pensées.
– Je cherche une sous-location, répondit encore Ordinov.
– Sur cette cour-là il n’y en a pas, dit le dvornik en indiquant d’un regard malicieux une cour voisine.
– Et ici ?
– Ici non plus.
Et le dvornik se remit à son travail.
– Peut-être y en a-t-il tout de même, reprit Ordinov en lui glissant dans la main une pièce de vingt kopecks.
Le Tartare regarda Ordinov, prit la pièce, se remit de nouveau au travail et, après un silence, déclara :
– Non, il n’y a pas de logement.
Mais le jeune homme ne l’écoutait plus. Il se dirigeait, en marchant sur les planches fléchissantes et à demi pourries qu’on avait jetées sur les flaques d’eau, vers l’unique entrée qui donnât sur cette cour noire, dégoûtante et croupie dans la boue. Au rez-de-chaussée vivait un pauvre fabricant de cercueils. Dépassant l’atelier de ce « garçon d’esprit », Ordinov s’engagea dans un escalier tournant, ruineux et glissant, et parvint à l’étage supérieur. En tâtonnant dans l’ombre, il trouva une porte épaisse en bois non équarri et couverte de nattes d’osier en loques. Il chercha le loquet et le tourna. Il ne s’était pas trompé : devant lui se tenait le vieillard qui le regardait fixement, au comble de la surprise.
– Que veux-tu ? demanda-t-il d’une voix rude et basse.
– Y a-t-il un logement ? murmura Ordinov sans savoir exactement ce qu’il disait : derrière les épaules du vieux il venait d’apercevoir la jeune femme.
Le vieillard, sans répondre, se mit à fermer la porte en poussant Ordinov dehors. Mais tout à coup Ordinov entendit la voix caressante de la jeune femme murmurer :
– Il y a une chambre.
– Je n’ai besoin que de très peu de place, dit Ordinov en se hâtant de rentrer et en s’adressant à la belle.
Mais il s’arrêta, stupéfait, en regardant son futur logeur. Sous ses yeux se jouait un drame muet. Le vieillard était mortellement pâle, prêt à tomber inanimé. Il faisait peser sur la jeune femme un regard de plomb, immobile et perçant. Elle aussi pâlit d’abord, mais brusquement tout son sang lui monta au visage, et ses yeux brillèrent d’un étrange éclat.
Elle conduisit Ordinov dans la pièce voisine.
Tout le logement se composait d’une seule et vaste chambre divisée par deux cloisons en trois parties. Du vestibule on passait dans une très petite pièce. En face, dans la cloison, s’ouvrait une porte qui menait évidemment à la chambre à louer. Elle était étroite, avec deux fenêtres basses très rapprochées l’une de l’autre. Tout était embarrassé par les menus objets essentiels à un ménage. Tout était pauvre, mesquin, mais extrêmement propre. Une table en bois blanc, deux chaises vulgaires, deux bancs le long du mur formaient tout le mobilier. Dans un coin l’on avait mis une grande image pieuse ornée d’une couronne dorée et soutenue par une planche. Devant l’image brûlait une lampe. La chambre à louer partageait avec la pièce voisine un grand et incommode poêle russe. Il était clair que trois personnes ne pouvaient vivre dans un tel logement.
Ils discutèrent les conditions. Mais leurs voix étaient entrecoupées, ils se comprenaient à peine. Ordinov, à deux pas d’elle, entendait battre son cœur. Elle était tremblante, et à son émotion se mêlait une sorte de terreur. Enfin l’accord se fit. Le jeune homme déclara qu’il emménagerait aussitôt et revint au vieillard. Il se tenait encore près de la porte, debout et toujours très pâle, mais un sourire calme, un sourire réfléchi s’était fait jour sur ses lèvres. En apercevant Ordinov, il fronça de nouveau le sourcil.
– As-tu un passeport ? lui demanda-t-il brusquement, d’une voix haute et dure, tout en ouvrant la porte.
– Oui, répondit Ordinov un peu déconcerté.
– Qui es-tu ?
– Vassili Ordinov, noble, sans emploi. Je m’occupe de certains travaux, répliqua Ordinov, sur le même ton que le vieillard.
– Et moi aussi ; je suis Ilia Mourine, mechtchanine2. C’est assez, va-t’en.
Une heure plus tard, Ordinov était installé, à son propre étonnement, – et à celui de M. Schpis, qui commençait à soupçonner, avec sa douce Tinchen, que son locataire s’était moqué de lui. Ordinov ne comprenait guère comment tout cela avait pu arriver, mais il ne tenait pas à le comprendre.
II
Son cœur battait si fort que ses yeux se troublaient et sa tête tournait. Machinalement il entreprit de mettre ses affaires en ordre. Il dénoua le paquet de ses hardes ; puis il ouvrit sa malle de livres et voulut les ranger. Mais bientôt ce travail le lassa. À chaque instant s’offrait à ses yeux éblouis l’image de cette jeune femme dont l’apparition avait bouleversé son âme et vers qui tout son cœur se portait dans un irrésistible élan. Tant de bonheur désorientait sa pâle existence, ses pensées s’obscurcissaient ; il éprouvait comme une agonie d’incertitude et d’espérance.
Il prit son passeport et le porta au logeur, espérant voir la jeune femme. Mais Mourine entrouvrit à peine la porte, prit le papier et dit :
– C’est bien ; vis en paix. Et la porte se referma.
Ordinov resta un instant étonné. Sans s’expliquer pourquoi l’aspect de ce vieillard, au regard empreint de haine et de méchanceté, lui était pénible. Mais l’impression désagréable se dissipa bientôt. Depuis trois jours, Ordinov vivait dans un véritable tourbillon, qui contrastait singulièrement avec son ancienne tranquillité. Il ne pouvait ni ne voulait réfléchir. C’était une sorte de confusion. Il sentait sourdement que sa vie venait de se briser en deux parts. Maintenant il n’avait qu’un désir, qu’une passion, et nulle autre pensée ne pouvait le troubler.
Il rentra dans sa chambre et y trouva près du poêle où cuisait le dîner une petite vieille bossue, si sale et si déguenillée qu’il fut pris de compassion pour elle. Elle paraissait très méchante. De temps à autre elle marmonnait, en remuant sa bouche édentée et son nez. C’était la domestique. Ordinov essaya de lui parler, mais elle se tut évidemment par malice. À l’heure du dîner, elle sortit du poêle des stchi3, des pâtés, de la viande, et les porta chez ses maîtres, puis elle en apporta autant à Ordinov. Après le dîner, un silence complet régna dans la maison.
Ordinov prit un livre et le feuilleta, s’efforçant de comprendre et n’y parvenant pas malgré plusieurs lectures. Impatienté, il jeta le livre et de nouveau voulut mettre ses affaires en ordre. Enfin il prit son chapeau, son manteau, et sortit. Il allait au hasard, sans voir la route, tâchant de se recueillir, de concentrer quelques pensées éparses et de se rendre compte de sa situation. Mais cet effort ne réussit qu’à augmenter ses souffrances. Le froid et le chaud l’envahissaient alternativement, et il avait parfois de tels battements de cœur qu’il était obligé de s’appuyer au mur. « Non, mieux vaut la mort », pensait-il, « mieux vaut la mort », murmura-t-il de ses lèvres tremblantes et enflammées, sans songer à ce qu’il disait.
Il marcha très longtemps. Enfin il s’aperçut qu’il était mouillé jusqu’aux os et remarqua pour la première fois que la pluie tombait à verse. Il retourna chez lui. Non loin de la maison il aperçut le dvornik et crut voir que le Tartare le regardait fixement et avec curiosité, puis fit mine de s’éloigner en voyant qu’Ordinov l’avait aperçu.
– Bonsoir, lui dit Ordinov en l’atteignant. Comment t’appelle-t-on ?
– On m’appelle dvornik, répondit l’autre en souriant.
– Y a-t-il longtemps que tu es dvornik ici ?
– Longtemps.
– Mon logeur est un mechtchanine ?
– Mechtchanine, s’il te l’a dit.
– Que fait-il ?
– Il est malade, il vit, il prie Dieu.
– C’est sa femme ?...
– Quelle femme ?
– Celle qui habite avec lui.
– Sa fa-a-me, s’il te l’a dit. Adieu, barine.
Le Tartare toucha sa casquette et pénétra dans sa loge.
Ordinov rentra chez lui. La vieille, en marmonnant et en grognant toute seule, lui ouvrit la porte, la ferma au verrou et monta sur le poêle où elle achevait son siècle4. La nuit venait. Ordinov alla chercher de la lumière, mais la porte des logeurs était fermée à clef. Il appela la vieille qui, dressée sur son coude, le regardait fixement et paraissait inquiète de le voir près de cette serrure. Elle lui jeta sans rien dire un paquet d’allumettes, et il entra dans sa chambre. Pour la centième fois il essaya de mettre en ordre ses effets et ses livres. Mais bientôt, sans s’expliquer ce qui lui arrivait, il fut obligé de s’asseoir sur un banc et tomba dans un bizarre engourdissement. Par instants, il revenait à lui et se rendait compte que son sommeil n’était pas un sommeil, mais une torpeur maladive. Il entendit une porte s’ouvrir et comprit que les logeurs rentraient de la prière du soir. Il lui vint à l’esprit qu’il avait quelque chose à leur demander, il se leva et eut la sensation qu’il marchait, mais il fit un faux pas et tomba sur un tas de bois que la vieille avait jeté dans la chambre. Il resta là, inanimé, et quand il ouvrit les yeux, longtemps après, il s’étonna d’être couché sur le banc, tout habillé : sur lui, avec une tendre sollicitude, se penchait un visage de femme, un adorable visage tout humide de larmes douces et comme maternelles. Il sentit qu’on déposait un oreiller sous sa tête, qu’on le couvrait de quelque chose de chaud et qu’une main fraîche touchait son front brûlant. Il aurait voulu dire : Merci ! Il aurait voulu prendre cette main, la porter à ses lèvres arides, l’arroser de ses larmes et l’embrasser, l’embrasser toute une éternité ! Il aurait voulu dire bien des choses, mais il ne savait quoi. Surtout il aurait voulu mourir en cet instant. Ses mains étaient de plomb, il ne pouvait les mouvoir, il était inerte et entendait seulement son sang battre dans ses artères avec une extraordinaire violence. Il sentit encore qu’on lui mouillait les tempes... Enfin il s’évanouit.
Le soleil cinglait d’une gerbe de rayons d’or les carreaux de la chambre quand Ordinov s’éveilla, vers huit heures du matin. Une sensation délicieuse de calme, de repos, de bien-être, caressait ses membres. Puis il lui sembla que quelqu’un était naguère auprès de lui, et il acheva de s’éveiller en cherchant anxieusement cet être invisible. Il aurait tant voulu étreindre son amie et lui dire pour la première fois de la vie : « Salut à toi, mon amour ! »
– Mais que tu dors longtemps ! dit une légère voix de femme.
Ordinov tourna la tête, et le visage de sa belle logeuse se pencha vers lui avec un affable sourire, clair comme le jour.
– Tu as été longtemps malade ! reprit-elle. Mais c’est assez, lève-toi. Pourquoi rester ainsi en prison ? La liberté est meilleure que le pain, plus belle que le soleil. Allons, lève-toi, mon mignon, lève-toi.
Ordinov saisit et serra fortement la main de la jeune fille. Il pensait rêver encore.
– Attends, dit-elle, je vais te faire du thé. En veux-tu ? Prends-en, va, ça te fera du bien : je le sais, moi, j’ai été malade aussi.
– Oui, donne-moi à boire, dit Ordinov d’une voix faible en se levant. Il était sans forces. Un frisson lui parcourut le dos ; tous ses membres étaient endoloris, comme rompus. Mais il avait le cœur en fête, et le soleil l’échauffait comme un feu de joie. Une vie nouvelle, puissante, inconnue, commençait pour lui. La tête lui tournait faiblement.
– On t’appelle Vassili, n’est-ce pas ? demanda-t-elle. J’ai mal entendu, ou c’est le nom que le logeur te donnait hier.
– Oui, Vassili, et toi ? dit Ordinov.
Il voulut s’approcher d’elle, mais il se soutenait à peine et chancela. Elle le retint par la main, en riant.
– Moi, je m’appelle Catherine.
De ses grands et clairs yeux bleus elle plongeait au fond du regard d’Ordinov. Tous deux se tenaient fortement les mains, sans plus parler.
– Tu as quelque chose à me demander, dit-elle enfin.
– Oui... Je ne sais, répondit Ordinov, et il eut un éblouissement.
– Comme tu es, vois ! Assez, mon mignon, ne te chagrine pas. Mets-toi ici, au soleil, près de la table... Reste tranquille et ne me suis pas, ajouta-t-elle en le voyant faire un mouvement pour la retenir. Je vais revenir, tu auras tout le temps de me voir.
Un instant après, elle apporta le thé, le posa sur la table et s’assit en face d’Ordinov.
– Prends, dit-elle, bois. Eh bien ! as-tu toujours mal à la tête ?
– Non, maintenant, non... Je ne sais pas, peut-être ai-je mal... Mais je ne veux plus... J’en ai assez !... Ah ! je ne sais pas ce que j’ai, ajouta-t-il, suffoqué ; et reprenant la main de Catherine : Reste ici, ne t’éloigne pas. Donne, donne-moi tes mains... Tu m’éblouis, je te regarde comme un soleil ! s’écria-t-il comme arrachant ces mots de son cœur. Les sanglots lui serraient la gorge.
– Mon pauvre ! Tu n’as probablement pas vécu avec de bonnes gens. Tu es seul, tout seul ? N’as-tu pas de parents ?
– Non, personne. Je suis seul... Mais ça m’est égal. Maintenant ça va mieux... Je suis bien, maintenant ! dit Ordinov avec le ton du délire.
Il lui semblait que la chambre tournait autour de lui.
– Moi aussi j’ai longtemps vécu toute seule... Comme tu me regardes !... dit-elle après un silence. Eh bien... et après ? On dirait que mes yeux te brûlent ! Tu sais, quand on aime quelqu’un... Moi, dès le premier moment je t’ai pris dans mon cœur. Si tu es malade, je te soignerai comme moi. Mais il ne faut plus être malade, non, Quand tu iras mieux, nous vivrons comme frère et sœur, veux-tu ? Une sœur, c’est difficile à trouver quand Dieu ne vous en a pas donné.
– Qui es-tu ? D’où es-tu ? murmura Ordinov.
– Je ne suis pas d’ici... De quoi t’occupes-tu ?... Tu sais ce conte : il y avait une fois douze frères dans une grande forêt. Une jolie fille s’y égara ; elle entra dans leur maison, y mit tout en ordre, y imprégna toutes choses de sa tendresse. À leur retour, les frères devinèrent qu’une sœur leur était venue, et ils l’appelèrent, et elle se montra. Tous l’appelèrent sœur et lui laissèrent sa chère liberté. Elle fut leur sœur et leur égale... Connaissais-tu ce conte ?
– Je le connais, dit Ordinov.