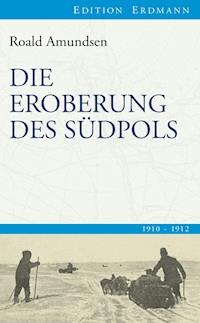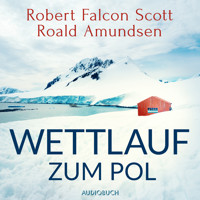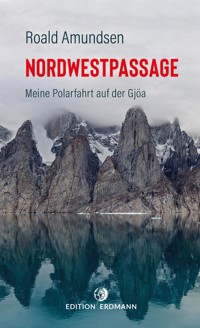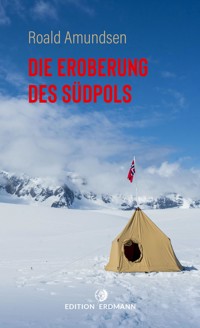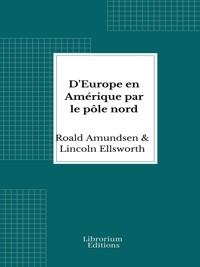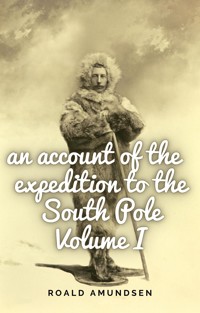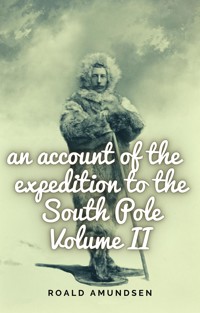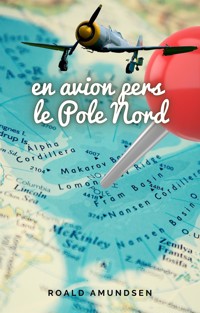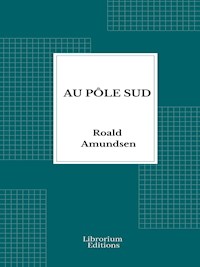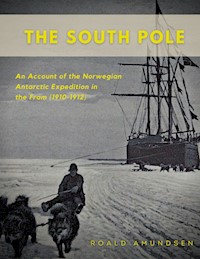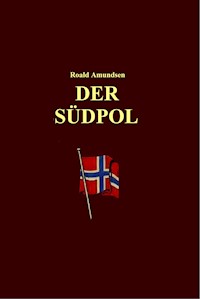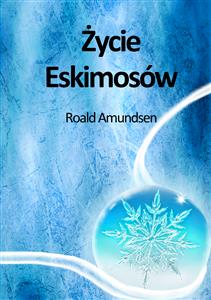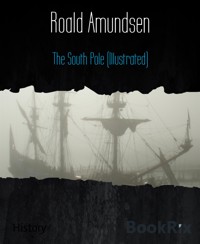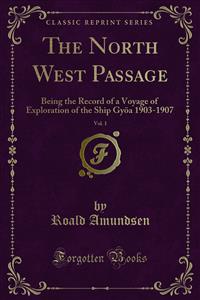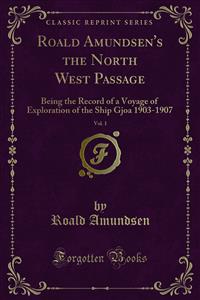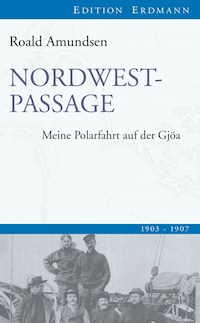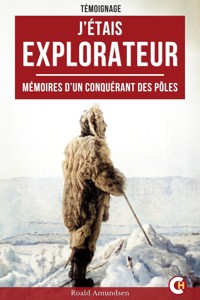
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CurioVox
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
« Aux confins glacés du monde, chaque pas pouvait être le dernier. »
Héros des pôles et pionnier des grandes explorations, Roald Amundsen raconte ici, avec une intensité rare, son incroyable parcours. De sa jeunesse en Norvège, marquée par le rêve d’imiter les héros de l’Arctique, jusqu’aux épreuves les plus extrêmes, il dévoile les coulisses d’une vie vouée à repousser les limites de l’humain.
Dans ces mémoires saisissants, il nous entraîne au cœur de la conquête du passage du Nord-Ouest, puis dans l’odyssée victorieuse qui fit de lui le premier homme à atteindre le pôle Sud. On y découvre les tempêtes, les famines, les naufrages évités de justesse, mais aussi l’endurance, l’ingéniosité et la fraternité qui ont permis à ces expéditions de triompher. Derrière la légende se dessine le portrait d’un homme d’acier, à la volonté inébranlable et à l’esprit visionnaire.
"J’étais Explorateur : Mémoires d’un Conquérant des Pôles" est bien plus qu’un récit d’aventures : c’est une plongée dans les ultimes frontières de l’Histoire humaine, un témoignage authentique sur le courage, la ténacité et le prix du rêve.
Un livre essentiel pour tous les passionnés de grandes explorations, d’histoire polaire et de récits de survie extraordinaires.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Roald Engelbregt Gravning Amundsen naquit le 16 juillet 1872 à Borge en Norvège et mourut le 18 juin 1928 vers l'île aux Ours. Fils d'un petit armateur, il se destina d'abord à la médecine avant d'être saisi d'une vocation irrésistible pour l'exploration polaire.
Le 14 décembre 1911, à 39 ans, il devint le premier homme à atteindre le pôle Sud géographique, devançant de 34 jours l'expédition britannique de Robert Falcon Scott. Sa maîtrise du déplacement à skis et son expertise avec les chiens de traîneaux assurèrent un voyage rapide et sans incident majeur.
Premier homme à avoir navigué par les passages Nord-Ouest et Nord-Est, il fut également le premier individu à s'être rendu aux deux pôles. Ses récits d'expédition, empreints d'un pragmatisme typiquement norvégien, témoignent de sa méthode rigoureuse et de son respect pour les techniques de survie des peuples arctiques. Il disparut tragiquement en 1928 lors d'une mission de sauvetage dans l'Arctique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© CurioVox
Bruxelles - Paris
http://www.curieuseshistoires.net
Les éditions CurieusesHistoires vous invitent à découvrir des milliers d’histoires fascinantes sur https://www.curieuseshistoires.net et à nous rejoindre sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux pour encore plus de contenus captivants ! Collection dirigée par Louis-Jourdan Leclercq.
ISBN : 9782390840046 – EAN : 9782390840046
Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.
Roald Amundsen
J’étais Explorateur Mémoires d’un Conquérant des Pôles
Chapitre I
Premiers souvenirs
À quoi tient-il que je sois devenu explorateur ? Exactement à rien, car, depuis l’âge de quinze ans, je poursuis inflexiblement cette carrière et tends vers un but nettement défini. Toutes les explorations que j’ai accomplies résultent de projets mûris sans cesse, d’une préparation laborieuse et d’un travail consciencieux des plus rudes.
Né en Norvège, à quelques lieues de la capitale, j’avais trois ans lorsque mes parents vinrent s’installer à Oslo où ils pourvurent à mon instruction.
Sans incident particulier, je fis des études régulières à l’école primaire de six à neuf ans ; de neuf à quinze ans au « Gymnasium », et au collège de quinze à dix-huit. Je n’avais que quatorze ans quand mon père mourut ; mes frères, plus âgés que moi, avaient quitté la maison paternelle et cherchaient à se suffire. Aussi restai-je seul avec ma mère qui décida de me faire suivre des cours en vue de me préparer à exercer la médecine. Cependant cette ambition qu’elle s’était forgée toute seule, et pour laquelle je ne partageais pas son enthousiasme, ne devait point se réaliser. J’avais quinze ans lorsque les œuvres de Sir John Franklin, le grand explorateur anglais, me tombèrent sous la main. Cette lecture me passionna, à tel point qu’elle influença le reste de mon existence. Parmi tous les héroïques Anglais qui, depuis quatre cents ans, ont dépensé sans compter leur fortune, leur courage et leur esprit d’initiative dans des tentatives hardies pour franchir le passage du Nord-Ouest, aucun ne montra plus d’héroïsme que Sir John Franklin. La description qu’il fait du retour d’une de ses expéditions m’émut au-delà de tout ce que j’avais lu jusqu’alors. Il raconte de quelle manière, durant trois semaines, lui et sa petite troupe se sont débattus contre la glace et les tempêtes, sans autre nourriture que quelques os trouvés dans un camp indien abandonné, et comment, avant d’atteindre l’avant-poste de la civilisation, ils avaient été réduits à manger le cuir de leurs chaussures afin de s’empêcher de mourir de faim.
Chose étrange, le passage qui, dans le récit de Sir John, me frappa tout particulièrement, fut celui où il relate les souffrances que ses hommes et lui eurent à supporter. Je me sentis brûler de la curieuse ambition d’endurer les mêmes souffrances. Peut-être l’idéalisme de la jeunesse qui souvent ne recule pas, même devant le martyre, me fit-il considérer comme une croisade une exploration dansla mer arctique. Moi aussi, je souffrirais dans l’intérêt d’une cause, non pas en franchissant le brûlant désert sur la route de Jérusalem, mais dans les régions glaciales du Nord, sur le chemin des découvertes dans des domaines ignorés.
Quoi qu’il en soit, les descriptions que Sir John nous a laissées de son voyage ont décidé de ma carrière. Sans en parler à personne – car je n’aurais même pas osé communiquer mon projet à ma mère qui, je le savais, le désapprouverait – je pris la résolution définitive de devenir explorateur des régions arctiques.
C’est pourquoi je commençai aussitôt à m’entraîner pour cette carrière. En Norvège, dans mon jeune temps, les sports athlétiques n’étaient pas organisés comme ils le sont partout de nos jours on ne connaissait que le football et le ski. Sans être un fervent adepte du football, je m’y adonnai comme à un sport qui, pour sa part, habituerait mon corps à la souffrance. Quant au ski, je le pratiquais tout naturellement avec un vif enthousiasme. Chaque fois que, de novembre à avril, l’école m’accordait des libertés, j’allais vivre en plein air ; j’explorais les collines et les montagnes dressées tout autour d’Oslo ; ainsi je développai le talent que j’avais de courir sur la glace et la neige, et j’endurcis mes muscles pour les grandes aventures de demain.
À cette époque-là, on tenait les demeures hermétiquement closes en hiver ; aussi me considéra-t-on comme un révolutionnaire et presque comme un anormal, quand j’insistai pour dormir avec les fenêtres de ma chambre grandes ouvertes, même par les temps les plus rudes. Ma mère, inquiète de me voir prendre cette habitude, ne cessait de me gronder. Je lui expliquai, ce qui était vrai, que j’aimais l’air frais ; mais, au fond, cette habitude faisait partie du programme d’endurance que j’observais à la lettre.
À dix-huit ans, je sortis du collège avec mon diplôme et, conformément au désir de ma mère, je me fis inscrire à l’Université avec l’intention de suivre les cours de médecine. Semblable à toutes les mères qui raffolent de leurs enfants, la mienne tenait pour un phénix un fils qui pourtant faisait des études plus que médiocres. Sa mort, deux ans plus tard, quand j’atteignis ma vingt et unième année, lui épargna la triste et immanquable découverte que mon ambition ne concordait pas avec la sienne, et que, dans la voie qu’elle m’avait choisie, je n’avais guère fait de progrès. Avec un gros soupir de soulagement, je quittai bientôt l’Université et m’abandonnai corps et âme à la réalisation du rêve de ma vie.
Mais, avant que j’y aie pris garde il me fallut, comme tous les jeunes gens norvégiens, faire mon service militaire. À cela, je tenais particulièrement pour deux raisons : d’abord, parce que je voulais me conduire en bon citoyen, et ensuite parce que je sentais que l’entraînement auquel m’astreignait ce service me serait d’un grand profit dans la carrière de mes rêves. J’avais cependant une infirmité sérieuse, insoupçonnée de la plupart de mes camarades, et qui aurait pu m’éviter d’être soldat. Doué d’une assez bonne vue, je souffrais pourtant d’une myopie qui, malgré sa légère atténuation, n’a pas même aujourd’hui complètement disparu. Si le major avait découvert mon infirmité, certainement il m’aurait réformé. Heureusement que j’avais toujours refusé de porter des lunettes, bien qu’on me l’eût rigoureusement prescrit.
Le jour du conseil de révision, je fus introduit dans une salle où, assis derrière une table, se trouvait le président de la commission flanqué de deux aides. Ce président, médecin d’un certain âge, avait, ainsi que je ne tardai pas à m’en apercevoir, à ma très grande gêne, un véritable culte pour le corps humain. On me fit complètement dévêtir, et le vieux docteur m’inspecta de la tête aux pieds ; il ne put s’empêcher d’exprimer, à haute voix, son admiration pour mon développement physique. Évidemment, mes huit années d’entraînement consciencieux avaient produit leur effet : « Jeune homme, me dit-il, comment diable avez-vous pu vous faire de pareils muscles ? » Je lui expliquai que j’avais toujours raffolé de culture physique, et que j’avais largement satisfait ma passion. Le vieux major parut tellement ravi d’une telle découverte, extraordinaire à ses yeux, qu’il pria un groupe d’officiers qui se tenaient dans la chambre voisine de venir voir un phénomène. Inutile de dire que cette exhibition de toute ma personne me faisait presque souhaiter d’être à mille pieds sous terre.
Toutefois, cet incident eut son bon côté. Enthousiasmé par ma corpulence, le bon docteur oublia absolument de m’examiner les yeux. Aussi fus-je déclaré bon sur toute la ligne, et aussitôt commença mon instruction militaire.
En Norvège, le service militaire ne prend que quelques semaines dans l’année ; ainsi avais-je tout mon temps pour me préparer spécialement à mon futur métier d’explorateur. Une aventure, survenue au cours de cette dernière préparation, faillit à jamais clore ma carrière, car j’y affrontai des dangers et des privations qui ne le cédaient en rien à ceux que je connus plus tard durant mes expéditions polaires.
J’avais vingt-deux ans quand cela m’advint. Je m’étais mis dans la tête d’effectuer une sorte de traversée arctique, à quelques lieues d’Oslo même. À l’ouest de la capitale, se dresse une chaîne de montagnes aux flancs abrupts et que couronne un plateau à une hauteur d’environ deux mille mètres. Ce plateau s’étend vers l’ouest presque jusqu’au rivage de la mer, dans le voisinage de Bergen, et se distingue à cet endroit par un flanc encore plus abrupt d’un accès si difficile qu’il n’existe que deux chemins sûrs de descente. En été, ce plateau était fréquenté par des pâtres lapons qui venaient y faire paître leurs troupeaux de rennes. On n’y rencontrait pas de fermiers et le seul semblant d’habitation visible dans un rayon de plusieurs lieues, était une cabane construite par les pâtres et servant d’abri contre les froides pluies torrentielles de l’automne. En hiver, les Lapons descendaient dans les vallées, et le plateau restait désert. De mémoire d’homme, on ne connaissait personne ayant fait l’hiver la traversée de ce plateau depuis la ferme de montagne, appelée Mogen, à l’est, jusqu’à la ferme nommée Garen, sur la côte, à l’ouest. Je résolus de tenter l’expérience.
À un seul compagnon de mon choix, je proposai de risquer l’aventure. Il y consentit, et nous quittâmes Oslo pendant les vacances de Noël. Rapidement nous franchîmes en ski le champ de neige qui nous amena à Mogen. Là, nous fîmes halte, car c’était la dernière habitation que nous comptions rencontrer au cours de tout le voyage. Dans cette minuscule cabane, composée d’une seule pièce, s’entassaient un vieillard, sa femme et leurs deux fils mariés ; six personnes en tout. Naturellement, ces gens étaient du type paysan le plus simple. En ce temps-là, ils ne voyaient point de touristes, à aucune époque de l’année : aussi notre apparition au milieu d’eux leur eût elle causé une grande surprise, en n’importe quelle saison ; mais nous voyant arriver au cœur de l’hiver, ils ne purent guère en croire leurs yeux. Nous n’eûmes aucune difficulté à obtenir la permission de passer la nuit sous leur toit.
C’étaient des gens hospitaliers, et ils nous firent de la place, sur le sol, autour du feu. Enveloppés dans nos sacs de couchage en peau de renne, nous dormîmes bientôt comme des loirs.
Cependant, au matin, il neigeait, et cette tourmente se changea en un véritable blizzard qui dura une semaine ; nous dûmes demeurer tout ce temps à la ferme.
Bien entendu, nos hôtes voulurent, savoir ce qui nous avait conduits dans leur maison isolée. Quand nous leur eûmes exposé que notre plan consistait à monter sur le plateau et à le traverser jusqu’à la côte, ils restèrent d’abord incrédules, puis s’alarmèrent fort pour notre vie. Les trois hommes, très familiers avec ces parages, s’accordèrent pour nous conseiller sérieusement de ne pas nous embarquer en hiver dans une pareille aventure. On ne l’avait jamais tentée encore et, certainement, on la tenterait en vain. Néanmoins, nous avions décidé de tout risquer et de ne point revenir sur nos pas ; aussi, le neuvième jour, les trois hommes nous accompagnèrent-ils jusqu’au pied du plateau, à l’extrémité de la vallée, et là ils nous indiquèrent le meilleur chemin de montée. D’un air triste, ils nous dirent adieu, et nous comprîmes qu’ils craignaient de ne plus nous revoir.
Je reconnais que nous nous étions témérairement lancés dans cette aventure. À nos yeux, toutefois, elle semblait assez simple. Le plateau n’a guère que cent dix kilomètres de large environ, et, tablant sur notre adresse de skieurs et sur des conditions atmosphériques moyennement favorables, nous espérions faire la traversée en deux jours au plus. Confiants dans nos pronostics, nous avions constitué notre équipement ; il était, de ce fait, des plus rudimentaires. Outre nos skis et nos bâtons de skieurs, nous portions sur le dos chacun un sac de couchage en peau de renne. Nous ne nous étions pas munis de tente ; chacun de nous avait une musette renfermant les provisions et une petite lampe à alcool. La musette était roulée dans le sac de couchage. En fait de vivres, nous avions des biscuits, des tablettes de chocolat et un peu de beurre. Tout allant au mieux, cela constituait une maigre pitance pouvant durer à peine huit jours. À notre bagage, je dois ajouter une boussole de poche et une carte de la région, imprimée sur papier. Nous n’eûmes aucune difficulté à parvenir sur le plateau. Nous ne nous trouvâmes point en présence d’une plaine parfaitement plate, mais, en ne considérant que les possibilités d’orientation d’un voyageur, elle aurait tout aussi bien pu l’être, car elle ne laissait voir aucun point de repère permettant de se guider. On ne percevait rien d’autre qu’un chapelet infini de petits monticules indistincts.
Nous nous dirigeâmes à l’aide de la boussole. Le but de notre première étape était une cabane de pâtre, située vers le milieu du plateau. En Norvège, à cette époque de l’année, la lumière du jour n’est guère meilleure que la lueur du crépuscule, mais, grâce à notre boussole, nous avançâmes tout de même, et, de bonne heure dans la soirée, nous rencontrâmes la cabane.
La joie que nous procura cette découverte ne dura que quelques instants, car nous nous aperçûmes aussitôt qu’on avait solidement clos porte et fenêtre, avec des clous, et bouché le tuyau de la cheminée à l’aide de lourdes planches. Nous étions presque à bout d’énergie après les fatigues de la journée ; par surcroît, le vent avait recommencé à souffler et le thermomètre marquait environ 10 degrés Fahr. au-dessous de zéro. Ainsi handicapés, il nous fallut employer le reste de nos forces d’abord à fracturer la porte, ensuite à monter sur le toit pour déboucher le tuyau de la cheminée et pouvoir allumer du feu. À ce travail, nous eûmes tous les deux les doigts gelés, et mon compagnon, pendant quelques semaines, courut le sérieux danger de perdre un des siens.
Nous eûmes la bonne fortune de trouver dans la cabane un tas de bois, mais il nous fallut quelque temps avant de pouvoir en tirer profit. Si jamais vous avez essayé de faire du feu dans une cheminée froide, – le thermomètre étant tombé au-dessous de zéro, – vous aurez une idée de la difficulté que nous éprouvâmes à créer un courant d’air : une colonne de glace s’installe sur votre feu comme un éteignoir et il s’agit, néanmoins, de produire une flamme qui suffise à l’expulser du tuyau. Pendant ce temps, bien entendu, par suite de nos efforts variés vers ce but, la cabane s’était remplie d’une fumée qui nous entrait dans les yeux, dans la gorge, et nous incommodait fortement.
Nous nous sentîmes plus à l’aise dès que le feu se décida à flamber et que nous eûmes fini de souper. Enfin, enveloppés dans nos sacs de couchage, nous nous installâmes dans des hamacs attachés au mur, où nous dormîmes du sommeil du juste.
Le matin, nous nous aperçûmes que nos déboires ne faisaient que commencer. Le vent, qui soufflait la veille au soir, ne s’était point calmé et la neige tombait maintenant à lourds flocons. La tempête était si forte que c’eût été folie que de s’y risquer. Aussi, décidâmes-nous, les pieds au feu, d’attendre que la tempête se fût dissipée. Poussant nos investigations dans tous les recoins de la cabane, nous fîmes une heureuse trouvaille.
C’était un petit sac de farine de seigle que des pâtres avaient laissé. Nous rendant compte, actuellement, qu’il nous fallait économiser nos vivres, nous préparâmes un potage léger avec cette farine, et le fîmes cuire dans une bouilloire en fer, au-dessus de la flamme. Nous demeurâmes deux jours sous notre abri, et notre nourriture, pendant ce temps, se borna, en tout et pour tout, à ce brouet de Spartiate. Même réussi, ce plat n’était pas très nourrissant, ni d’ailleurs fort agréable au palais.
Le troisième jour, la tempête s’étant quelque peu calmée, nous décidâmes de reprendre notre avance vers l’ouest, dans la direction de Garen. Nous dûmes alors fixer avec soin notre itinéraire, car il n’y avait que deux endroits sur le versant occidental par où l’on pouvait tenter de descendre du plateau, et, ces deux endroits étant à plusieurs kilomètres l’un de l’autre, il nous fallut définitivement adopter l’un d’eux. Ce choix fait, nous nous mîmes en route.
Nous n’avions pas avancé loin que la neige recommença de tomber et que la température s’adoucit. Fréquemment, nous dûmes consulter la carte afin de déterminer notre position, mais les flocons, tombant sur le papier fragile, l’humectèrent, rapidement et le changèrent en une bouillie inutilisable, par suite de quoi il nous fallut avancer de notre mieux, à l’aide de notre seule boussole.
La nuit nous surprit avant que nous eussions atteint le bord du plateau, et, bien entendu, il ne nous resta plus qu’à camper où nous nous trouvions, en plein air. Cette nuit faillit nous être fatale. Nos sacs de couchage une fois déroulés, nous prîmes nos musettes et les déposâmes à nos pieds. À côté, nous plantâmes nos bâtons de skieurs ; grâce à cela, nous pourrions, le matin, découvrir l’endroit où nous avions déposé nos musettes, au cas où la neige les aurait recouvertes pendant notre sommeil. C’est dans un inconfort extrême que nous passâmes la nuit. La neige molle, fondant sur nos vêtements, les avait saturés d’eau. Quand nous nous fourrâmes dans nos sacs de couchage, la chaleur de notre corps fit évaporer tellement d’humidité, qu’elle en imprégna tout l’intérieur de notre literie. L’épreuve était des plus désagréables. Le pire, c’est qu’il se remit à faire froid pendant la nuit. En pleine obscurité, je me réveillai à moitié gelé, et me sentis si mal à l’aise que je ne pus me rendormir. Finalement, l’idée me vint qu’en me levant et en buvant un peu de l’alcool à brûler contenu dans ma musette, je rétablirais la circulation de mon sang. Je me glissai hors de mon lit et me mis à tâter tout autour de moi, dans le noir, jusqu’à ce que j’eusse retrouvé mon bâton de skieur ; puis, déblayant la neige, je cherchai à dégager ma musette. Surpris et navré, je ne la retrouvai plus. Aux premières lueurs du matin, mon compagnon et moi nous reprîmes les recherches, et nous ne réussîmes à découvrir ni l’une ni l’autre de nos musettes. Je ne suis pas encore parvenu, aujourd’hui, à faire une conjecture raisonnable qui aidât à éclaircir ce mystère. Fait indubitable, les musettes avaient disparu !
À cette heure, l’affaire menaçait de tourner au vilain. Au cas où nous n’arriverions pas rapidement à nous procurer abri et nourriture, certainement nous mourrions de froid. Avec cette perspective alarmante, de nouveau, nous nous dirigeâmes vers l’ouest, dans l’espoir d’atteindre le bord du plateau avant la tombée de la nuit.
La chance nous fut encore contraire. Bientôt, il se mit à neiger si dru que nous ne pouvions pas distinguer notre chemin à plus d’un ou deux mètres devant nous. Alors, nous comprîmes que nous n’avions plus qu’à faire demi-tour et à traverser de nouveau le plateau vers l’est, jusqu’à notre point de départ. À peine avions-nous parcouru quelques kilomètres dans cette direction, que la nuit vint nous surprendre encore une fois.
Et, encore une fois, la nuit fut humide. Nous étions complètement trempés, et nos sacs, toujours imprégnés d’eau, pesaient très lourd. La neige n’avait cessé de tomber. À la nuit, nous avions gravi un petit pic qui se dressait sur le plateau. Nous cherchâmes le côté abrité du vent, persuadés que nous serions relativement bien si nous pouvions éviter la bise. Nous sentîmes, en effet une amélioration fort sensible. Je me décidai à faire encore mieux. À cet effet, je creusai la neige et façonnai un trou à peine plus grand que mon corps ; dans ce trou, je m’introduisis la tête la première, en tirant mon sac après moi. Bientôt, je me félicitai de mon idée, car j’avais ainsi complètement évité les rafales soufflant au dehors.
La nuit, la température se refroidit subitement. La neige fondue s’était entassée sur moi, à l’entrée du trou, au-dessus de mes pieds. À la chute de la température, la neige se changea en glace. Au milieu de la nuit, je me réveillai couché sur le dos, le poignet droit sur les yeux et la paume de ma main à découvert, ainsi qu’on dort souvent pour s’abriter de la lumière du matin. Je sentis mes muscles tout engourdis et, d’un mouvement instinctif, je cherchai à changer de position. Impossible de bouger d’un pouce. J’étais littéralement enseveli à l’intérieur d’un solide bloc de glace ! Avec l’énergie du désespoir, je m’efforçai de me dégager ; mais, vains efforts ! De toutes mes forces, j’appelai mon compagnon ; évidemment, il ne m’entendait point.
Je fus alors saisi d’horreur. Dans mon effroi, je pensai que mon compagnon avait dû, lui aussi, être, pris dans la neige fraîche et molle qui était tombée pendant la nuit, et qu’il se trouvait dans la même situation que moi. Si une débâcle ne survenait pas instantanément, nous étions condamnés tous deux à périr de froid, dans nos effroyables cercueils de glace !
Mes cris ne tardèrent pas à s’éteindre, car j’étais incapable de respirer profondément. Je compris qu’il me fallait choisir entre me tenir tranquille ou suffoquer. Était-ce la lourdeur de la petite quantité d’air que j’avais à respirer ? Était-ce pour un tout autre motif ? Toujours est-il que je m’endormis, ou plutôt que je perdis connaissance. Quand j’eus retrouvé mes esprits, je pus entendre de faibles bruits. Mon compagnon n’avait, pas été enseveli vivant. Peut-être l’unique raison pour laquelle il ne s’était pas, suivant mon exemple, construit une cavité, la veille au soir, était-elle la trop grande fatigue qu’il avait ressentie ; étant trop épuisé, il n’avait pas jugé bon de se donner cette peine. En tout cas, en faisant à sa tête, il nous avait sauvé la vie à tous deux. À son réveil, il regarda autour de lui et s’aperçut qu’il était seul au milieu d’un océan de neige. Il m’appela, mais ne reçut point de réponse. Alors, pris d’affolement, il se mit en quête d’une trace lui indiquant par où j’avais disparu. Une seule avait persisté, et, providentiellement, son regard tomba dessus quelques poils de la peau de mon sac perçaient à travers la neige. Il commença aussitôt à creuser avec ses mains et son bâton pour, m’exhumer de ma tombe. Ce ne fut qu’au bout de trois heures qu’il me ramena à l’air.
Nous étions alors tous deux très affaiblis, et il faisait encore nuit quand mon compagnon me désensevelit ; mais nous étions trop bouleversés pour songer à nous reposer plus longtemps. Malgré la nuit, et grâce à la clarté du ciel, nous pûmes nous fixer une direction et nous guider par les étoiles. Nous marchions depuis deux heures, mon compagnon en tête, quand, tout à coup, il disparut comme si la terre l’eût englouti. Dans l’espace d’un éclair, je compris qu’il était tombé dans un précipice et, instinctivement, je songeai à me sauver ; je me jetai à plat ventre. L’instant d’après, j’entendis une voix qui criait : « N’avancez pas je suis tombé dans un précipice ! » Mon compagnon avait, en effet, fait une chute d’environ ; dix mètres. Heureusement, il était tombé sur le dos, en sorte que le sac, qu’il portait sur les épaules comme un paquetage, avait amorti la violence de la chute, et mon camarade ne souffrit que d’une sérieuse secousse. Bien entendu, nous n’essayâmes pas de continuer notre chemin avant qu’il fît jour ; alors, cheminant avec peine dans la neige, nous poursuivîmes notre voyage, en apparence désespéré.
Il y avait quatre jours que nous étions sans nourriture et, pendant les deux jours précédents, notre régime de maigre potage au seigle ne nous avait guère fortifiés. Nous nous sentions presque à bout de forces ; la seule chose qui nous évita la prostration complète fut la facilité que nous eûmes de nous fournir d’eau portable. Il y avait sur le plateau de nombreux petits lacs réunis par de minuscules canaux, et, grâce à ceux-ci, nous pûmes nous remplir l’estomac, et éviter ainsi les conséquences fatales du manque de nourriture.
À la tombée de la nuit, nous arrivâmes en présence d’une petite masure remplie de foin ; aux alentours de cet abri on apercevait des empreintes de ski. Cette découverte nous redonna du courage et nous prouva que, certainement, nous étions revenus près d’un endroit civilisé. Nous nous prîmes à espérer que, si nous ne nous laissions pas abattre, nous pourrions, le lendemain, trouver de la nourriture et un gîte. Le foin nous offrit un lit délicieux, où nous passâmes la nuit, blottis jusque par-dessus le nez.
Le jour suivant, je sortis afin d’explorer le voisinage. Mon compagnon était épuisé et découragé à un point tel que tout effort lui semblait impossible ; je le laissai couché sur son tas de foin, tandis que moi je suivais les traces des skis.
Après une heure de marche pénible, j’aperçus un homme à une certaine distance ; je conjecturai – et ma conjecture tomba juste – que c’était un fermier qui, en tournée d’inspection, examinait ses pièges à ptarmigans. Je le hélai d’une voix forte ; il me lança un regard effrayé et, à ma grande consternation, se mit à s’enfuir loin de moi, à toutes jambes. Ces paysans solitaires sont des gens superstitieux ; alors qu’ils ne manquent pas de courage en présence d’un véritable danger, ils se forgent, dans des situations anodines, des chimères effroyables. Sans doute, mon paysan eut-il d’abord l’impression que j’étais une apparition fantomatique venant hanter le plateau désert.
Je le hélai à nouveau et mis toute mon âme dans ce cri. Ma voix devait avoir l’accent du désespoir, car l’homme s’arrêta de courir et, après quelques hésitations, revint à ma rencontre. Je le mis au courant de notre situation et lui demandai en quel endroit nous nous trouvions. Ce n’est pas sans difficulté que je compris ses explications, et même alors, je faillis douter de mes sens, car il résultait de ses paroles que nous n’étions pas à plus d’une heure de marche de la ferme, au-dessus de Mogen, d’où, huit jours auparavant, nous nous étions embarqués pour cette équipée.
Réconforté par ce renseignement, je revins vivement auprès de mon compagnon. Cette nouvelle lui donna aussi un regain de vigueur et, bientôt, sans trop de difficulté, nous nous dirigeâmes vers la ferme déjà connue de nous, au fond de la petite vallée. Nous heurtâmes à la porte ; on nous invita à entrer, ce que nous fîmes aussitôt. L’accueil froid que nous reçûmes nous surprit fort, jusqu’au moment où nous aperçûmes nos visages dans un miroir. Dans l’unique salle de la ferme, les femmes étaient occupées à filer au fuseau et les hommes à sculpter du bois. Tous levèrent vers nous un regard hospitalier ; mais se bornèrent à nous saluer d’un sec : « Comment ça va-t-il ? » On eût dit qu’ils s’adressaient à des personnes absolument étrangères. Bientôt, il fut évident qu’on ne nous reconnaissait pas. Rien d’étonnant à cela, car le miroir nous avait révélé que notre barbe avait poussé drue, que nos yeux étaient hagards et caves, nos joues creuses, et que notre teint, naguère vermeil, avait pris une couleur jaune cadavérique. Vraiment, nous offrions un sinistre spectacle. D’abord, nos hôtes se refusèrent à croire que nous étions les deux jeunes gens qui les avaient quittés, huit jours auparavant ; ils ne voyaient aucune ressemblance entre leurs visiteurs d’alors et les spectres efflanqués qui se dressaient devant eux. À la fin, nous réussîmes à les convaincre de notre identité et ils nous comblèrent de gentillesses. Chez eux, nous passâmes une couple de jours, à manger et dormir jusqu’à ce que nous eussions récupéré nos forces. Alors, après leur avoir donné nouveaux témoignages de notre gratitude, nous prîmes congé de nos hôtes et dirigeâmes nos pas vers Oslo que nous atteignîmes sans autre incident.
La suite de mon histoire, je ne l’ai connue moi-même qu’un an plus tard, lorsque j’appris que le propriétaire de la ferme de Garen, sise à l’extrémité ouest du plateau, à l’endroit exact d’où partait le sentier de descente, était sorti de chez lui un matin et qu’il avait découvert, à quelques mètres de sa porte, des empreintes de skis, venant de l’est et non de l’ouest. Il ne put en croire ses yeux, car il savait que cet hiver personne n’était venu de ce côté et il se croyait l’objet d’une illusion. Ces empreintes, cependant, ne pouvaient être que les nôtres, car la date fixée par le fermier concordait avec celle de notre passage.
Quelle malchance ! À notre insu, arrivés à deux doigts de notre but, nous avions fait demi-tour et retraversé le plateau, alors qu’après dix minutes de marche, nous aurions rencontré un confortable abri en haut du versant occidental.
Ainsi que je l’ai dit au début de ce récit, dans cette simple aventure, les souffrances et les dangers que je dus affronter pouvaient se comparer à ceux que je connus plus tard, au cours de mes expéditions polaires. D’ailleurs, cette expérience contribua pour sa part à l’entraînement que je m’étais imposé. Encore fut-elle plus sérieuse que je ne l’avais escomptée, car elle faillit clore définitivement ma carrière avant même que je l’eusse commencée.
Chapitre II
Bloqués dans les glaces de l’Antarctique
Mon service militaire terminé, je me décidai à franchir une nouvelle étape d’entraînement aux explorations arctiques. Je venais de lire, sur ce sujet, tous les livres qui m’étaient tombés sous la main, et j’avais remarqué que les recherches arctiques précédentes péchaient sur un point, à savoir que les commandants n’avaient pas toujours été des capitaines au long cours. Le plus souvent, ils avaient compté, pour la direction de leur navire, sur des marins expérimentés. La conséquence fâcheuse de cette malheureuse pratique, c’était qu’une fois en mer, l’expédition n’avait pas un chef, mais deux. Invariablement, cela aboutissait à un partage des responsabilités entre le commandant et le capitaine ; de là s’ensuivaient de continuels conflits des différences d’avis et un affaissement dans le moral du personnel subalterne. D’où, également, la scission des personnes à bord en deux camps l’un, comprenant le commandant et le groupe scientifique ; l’autre, le capitaine et l’équipage. Aussi étais-je décidé à ne jamais entreprendre d’expédition si je ne pouvais parer à ce défaut. Le seul moyen d’y remédier était d’acquérir les connaissances d’un marin et d’obtenir le brevet de capitaine au long cours. Ainsi, je saurais diriger moi-même mes recherches, aussi bien comme explorateur que comme capitaine, et empêcher la naissance de cette scission désastreuse.
Mais, en vue d’obtenir mon diplôme de marin, il me fallait faire plusieurs années d’apprentissage sous les ordres d’un capitaine breveté. Dans ce but, pendant les étés de 1894 et de 1895, je m’engageai comme matelot à bord d’un voilier. Grâce à cela, non seulement j’eus la possibilité d’arriver au grade de second et de me préparer pour le brevet de capitaine, mais encore je fis un premier voyage dans mon Arctique bien-aimé, et tout ce que j’y appris me servit d’entraînement à la carrière que j’avais en vue.
En 1897, j’eus l’heureuse chance qu’on m’autorisât à me joindre à l’expédition antarctique belge qui s’était donné pour mission d’étudier le pôle Sud magnétique. Bien que je n’eusse que vingt-cinq ans, on m’avait choisi comme second, avant que le Belgica n’eût quitté l’Europe. L’expédition avait incontestablement un caractère international. Le commandant, un Belge, avait fait son apprentissage de marin ; le capitaine, officier d’artillerie de même nationalité, avait servi dans la marine française et possédait une science maritime de premier ordre. Le second, c’était moi-même. Le docteur Cook qui, par la suite, conquit aux pôles une gloire éclatante, était le médecin de bord. Le savant à la tête de l’expédition était Roumain ; celui qui travaillait sous ses ordres, Polonais. Cinq membres de l’équipage étaient Norvégiens ; les autres Belges.
Le pôle Sud magnétique est sur le continent antarctique, loin au sud de l’Australie, dans le Pacifique sud. Pourtant, le plan de notre commandant était de s’y diriger, non pas en passant par l’Australie, mais en doublant le cap Horn. Nous arrivâmes au détroit de Magellan en l’hiver 1897 qui, bien entendu, sous cette latitude, était l’été de l’année. Nous cinglâmes dans la direction sud, vers la Terre de Feu. On n’était guère riche alors en connaissances scientifiques sur cette région, et notre commandant fut tellement séduit par des possibilités de découvertes que nous nous attardâmes plusieurs semaines dans ces parages, à recueillir des spécimens originaux d’histoire naturelle, à tracer la carte des côtes et à noter les observations météorologiques. Ce retard eut de sérieuses conséquences, comme on le verra sous peu.
Cinglant plus loin vers le sud, nous croisâmes les îles Shetland du sud et arrivâmes en vue du continent antarctique, connu dans cette région sous le nom de terre de Graham. On n’avait aucun relevé de cette côte, et nous dûmes passer quelque temps à l’établir. Après avoir franchi un passage qui en interrompait le dessin, nous débouchâmes dans le Pacifique.
L’hiver approchait alors et il nous fallait parcourir une distance considérable avant d’atteindre notre destination, au sud de l’Australie. Aussi partîmes-nous vers l’ouest, et bientôt il nous arriva une aventure qui faillit nous coûter la vie. Un jour, venant sur la passerelle relever le capitaine pour le quart de l’après-midi, je m’aperçus que nous luttions contre une formidable tempête, accompagnée de neige et de grésil. Des icebergs surgissaient dans toutes les directions. Le capitaine m’en désigna un, pas très loin vers le nord, et m’expliqua que, pendant tout le temps qu’il était de garde, il avait manœuvré de façon que le navire se tînt du côté de l’iceberg à l’abri du vent, et, se protégeant ainsi des plus forts assauts de la tempête et de la houle, il lui avait été possible d’éviter d’être poussé à la dérive. Il me donna pour instructions de continuer cette manœuvre jusqu’à ce qu’on me relevât pour le quart de la nuit, et de passer le même mot d’ordre à mon successeur, ce que je fis ; mon remplaçant fut le jeune Belge. Enfoncé dans mon hamac, je sentis que le mouvement du bateau suivait le rythme de la houle ; non point le balancement formidable que l’on ressent au cœur du Pacifique, mais le roulis qui se modifiait en contournant l’iceberg avant de nous atteindre ! Bercé par ce mouvement, je m’endormis. Imaginez ma surprise à mon réveil, au matin, quand je vis que le navire ne bougeait plus ! Certain qu’il était survenu quelque chose d’extraordinaire, j’enfilai mes habits à la hâte et courus vers la passerelle. Là, je constatai que nous étions immobilisés dans un petit bassin, clos de toutes parts par une ceinture d’énormes icebergs. Je demandai au jeune Belge comment diable nous avions pu nous fourrer dans une telle impasse. Il me répondit qu’il ignorait autant que moi ce qui avait pu se passer. Dans l’obscurité de la nuit, et dans la forte tourmente de neige, il avait fini par perdre l’iceberg de vue ; le bateau, alors, chassé par le vent, avait vogué à la dérive et, porté par l’une de ces puissantes houles du Pacifique, il s’était glissé par une ouverture entre deux icebergs et nous avait déposés au sein de ce calme plat où nous demeurions immobiles en ce moment. Seul un miracle du hasard nous avait évité d’être brisés en mille morceaux par les blocs de glace entre lesquels nous avions été portés sur le dos de cette énorme vague de fond.
Malgré cette chance invraisemblable notre nouvelle situation, même vue sous un jour des plus favorables, ne laissait pas d’être plus périlleuse que la précédente. Certes, nous devions nous estimer heureux d’avoir échappé au choc mortel de l’iceberg ; mais nous voilà, à cet instant même, menacés d’un autre genre de mort, irréparablement pris comme nous l’étions dans un cercle d’icebergs. Par bonheur pour nous, grâce à une habile manœuvre, nous réussîmes à nous en sortir.
Nous n’avions pas avancé bien loin que le danger auquel nous nous étions soustrait nous poursuivit sous une forme encore : plus terrible, et ce danger, nous le courûmes, non point par suite d’un accident involontaire, mais faute d’une connaissance suffisante de la navigation polaire. Longeant la banquise de l’Antarctique, alors que nous nous dirigions vers l’ouest, nous dûmes affronter une nouvelle tempête effroyable soufflant du nord. Nous courions le danger imminent d’être jetés contre le mur de glace dressé au sud de l’endroit où nous naviguions. L’instinct d’un navigateur, accoutumé aux mers polaires, eût été de chercher par tous les moyens à s’échapper vers le nord, et de déboucher dans la mer libre. Cela, certes, nous aurions pu le faire. Mais, en cette conjoncture, mes deux officiers supérieurs, percevant une brèche dans la banquise, résolurent de laisser la tempête en arrière et de profiter de l’issue.
Ils ne pouvaient guère commettre une plus grosse faute. Je m’en rendis compte aussitôt et compris pleinement l’effroyable danger auquel ils exposaient tout l’équipage ; mais on ne me demanda pas mon avis, et la discipline exigeait de moi le silence. L’éventualité que je redoutais se produisit. Pour nous mettre à l’abri des menaces de la tempête, il nous fallut parcourir plus de cent cinquante kilomètres à l’intérieur de la banquise. En nous éveillant un matin, nous nous aperçûmes que le chemin parcouru s’était refermé derrière nous. Et nous voilà emprisonnés dans les glaces antarctiques, poussés à la dérive, au début de l’hiver polaire, dans les mers méridionales, au tracé encore inconnu !
Notre situation était bien plus périlleuse qu’elle ne le semblait, car nous n’étions point équipés pour hiverner dans les régions antarctiques. À l’origine, le plan de notre expédition était de s’avancer, durant l’été, jusqu’à la région du pôle magnétique Sud, dans la terre de Victoria du Sud, et de fixer là un camp où on laisserait quatre hommes avec des provisions suffisantes, tandis que le navire et le reste de l’expédition iraient passer l’hiver dans les régions civilisées. Au printemps suivant, le navire reviendrait chercher les quatre camarades, laissés sur le continent antarctique ; ces quatre personnes devaient être le savant roumain, l’aide polonais, le docteur Cook et moi-même.
Cependant, tous les gens à bord, sans exception, durent se faire à l’idée d’un hiver dans l’Antarctique, sans vêtement de saison, sans provisions suffisantes pour tant d’hommes, et même sans lampes pour éclairer les différents endroits où l’on se logerait.