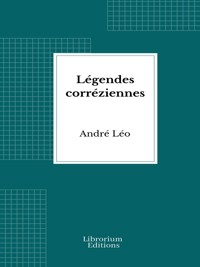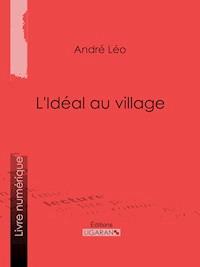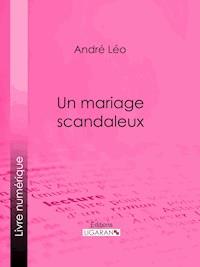Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Madame, si vous avez conservé quelques bons souvenirs du pensionnat Orréard, ne vous rappellerez-vous point cette Elise Mayot, votre meilleure amie d'alors, une grande fille blonde et mince qu'on appelait le peuplier ; qui, plus âgée que vous de deux ans, je crois, vous expliquais vos leçons et recevait vos confidences, quand nous nous promenions, les bras entrelacés, aux heures des récréations, le long du grand mur tapissé de lierre ?"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Roche-Néré, 20 décembre 186…
MADAME,
Si vous avez conservé quelques bons souvenirs du pensionnat Orréard, ne vous rappellerez-vous point cette Élise Mayot, votre meilleure amie d’alors, une grande fille blonde et mince qu’on appelait le peuplier ; qui, plus âgée que vous de deux ans, je crois, vous expliquait vos leçons et recevait vos confidences, quand nous nous promenions, les bras entrelacés, aux heures des récréations, le long du grand mur tapissé de lierre ?
C’est Élise qui vous écrit, mais non plus le peuplier, car bien des années se sont écoulées depuis le temps que je vous rappelle. Ma taille s’est épaissie, mes cheveux blanchissent, et vous auriez peine sans doute à me reconnaître. Moi-même, en considérant ces frais souvenirs de l’adolescence, je ne me reconnais guère. À l’intérieur comme à l’extérieur, la vie opère en nous bien des changements.
Depuis que j’ai appris, madame, la nomination de votre mari au poste de recteur de notre université, j’ai eu le désir de vous aller voir et de renouveler l’aimable connaissance de notre jeunesse ; mais je quitte notre village bien rarement ; puis… je vous crois heureuse, madame ; vous avez conservé tous vos enfants ; moi j’ai le cœur brisé par une douleur si profonde, qu’il me semble que je n’ai pas le droit de troubler les heureux par ma présence.
J’ai perdu ma fille ; elle avait seize ans… Mais ce n’est pas d’un malheur sans remède que je viens vous entretenir. Il s’agit, au contraire, d’affligés que vous pouvez consoler. Hier encore, nous nous trouvions enserrés, perdus, dans un réseau de basses et méchantes intrigues, et nous désespérions, quand l’idée m’est venue de m’adresser à vous. Depuis ce temps je respire et j’espère. Notre cause est si juste que, j’en suis certaine, vous la comprendrez, et que vous voudrez bien vous charger de la faire comprendre à M. le recteur, abusé par de faux rapports.
Ceux pour lesquels je demande votre protection, madame, l’instituteur et l’institutrice de ce village, ont été noircis, également, aux yeux de l’évêque, et vous voyez, à ce qu’on m’a dit, la baronne de Riochain, si influente à l’évêché, et qui possède ici des terres considérables. Vous pourriez donc peut-être aussi, par l’entremise de cette dame, apaiser nos ennemis. – Mais je vous demande beaucoup, et vous ne savez rien encore de ce dont il s’agit. Permettez-moi de vous raconter en détail toute cette histoire. Je n’ai pas d’autre moyen de vous faire connaître et aimer ces pauvres jeunes gens. La vérité a son accent, que vous reconnaîtrez dans mes paroles. Veuillez vous rappeler aussi qu’Élise Mayot ne mentait jamais.
Probablement, depuis mon départ de la pension, vous n’avez pas entendu parler de moi. Je me suis mariée, à dix-neuf ans, avec un bien honnête homme, que j’aimais beaucoup, M. Vaillant, médecin dans ce bourg de la Roche-Néré, que nous habitons encore. Depuis vingt-deux ans, nous n’avons jamais eu, mon mari et moi, de querelle sérieuse ; et, tout en subissant les modifications qu’apportent l’âge et l’habitude, nous sommes restés nécessaires l’un à l’autre, autant que nous l’étions dans les premiers jours de notre union.
Deux enfants nous sont nés : Alphonse, qui étudie la médecine à Paris, et Caroline, maintenant l’éternelle absente…
Ma chère fille avait en grande amitié sa sœur de lait, Suzanne Meslin, fille d’une fermière de ce pays, à laquelle, atteinte d’une longue et grave maladie, j’avais été forcée de confier mon enfant. Caroline n’avait pas de plus grand bonheur, ses devoirs faits, que de courir à la ferme et d’en ramener sa chère Suzanne. Elles passaient ensemble le dimanche à la maison ; il me semblait presque dans ce temps-là que j’avais deux filles.
Quand elles arrivèrent à l’adolescence, leur amitié ne fit qu’augmenter. Je les vois encore se promenant entrelacées dans le jardin, leurs deux têtes penchées l’une vers l’autre avec un air de mystère, comme si elles se faisaient des confidences, ou plutôt se communiquaient de naïfs étonnements.
Suzanne a failli mourir de la perte de son amie, et l’une des dernières paroles de ma pauvre enfant fut celle-ci : « Mère, tu garderas Suzanne avec toi. »
Nous décidâmes en effet les Meslin, qui ont beaucoup d’enfants, à nous confier Suzanne ; mais ce fut naturellement à la condition d’un gage, et comme nous ne sommes pas riches et que l’éducation de notre fils nous coûte beaucoup, je ne pris pas d’autre bonne. Elle était habituée aux travaux du ménage, et même à d’autres plus rudes ; ce ne fut point une peine pour elle, mais seulement pour moi, qui aurais voulu l’adopter entièrement et la traiter mieux.
Il en résulta que sa situation chez moi fut un peu équivoque, et en quelque sorte double. Je m’arrangeai avec une voisine pour lui épargner les travaux les plus pénibles ; je partageais la plupart des autres, et, dans ses intervalles de loisir, assise auprès de moi dans notre petit salon, elle devenait ma compagne, ou plutôt ma fille. Je m’occupais de son instruction, je développais ses idées, je formais ses manières…
N’était-ce pas naturel, madame ? Et par quelle étrange réserve me serais-je attachée à conserver à cette enfant, que j’aimais, son langage rustique, ses façons brusques, son ignorance ? Ma conduite à l’égard de Suzanne fut cependant fort blâmée à la Roche-Néré. On s’écria que j’en voulais faire une demoiselle, et pour cette audace on nous dénigra toutes deux.
J’hésitai quelque temps, puis j’en pris mon parti. D’abord, je ne faisais que seconder la nature, qui avait donné à cette jeune fille une distinction réelle. J’aurais cessé de l’instruire que, par l’effet seul d’un milieu favorable, elle se serait développée elle-même. Au nom de quelle utilité d’ailleurs et de quel droit aurais-je arrêté ses progrès ? À quoi le mauvais et le laid peuvent-ils être bons ?
On déclarerait odieuse et stupide l’action d’envelopper de ligaments le bouton d’une fleur pour l’empêcher d’épanouir ses pétales et d’exhaler ses parfums ; mais pour empêcher l’éclosion de l’être humain, mille maximes de sagesse banale ont cours dans le monde. « Elle serait bien plus heureuse de ne rien savoir, » me disait-on ; « vous lui donnez des idées qui la rendront malheureuse. » Et le fils d’un gros paysan, M. Bonafort, devenu notaire et très fier de l’être, s’écriait qu’il ne fallait jamais tirer les gens de leur condition.
Mais je voyais ma petite grandir en esprit, heureuse et émerveillée. Elle trouvait à apprendre un si grand charme, qu’elle accomplissait en cela sa destinée ; on le voyait bien. À peine avait-elle pu savonner ses pauvres mains rouges, qu’elle accourait de la cuisine auprès de moi, me réjouissait l’âme d’un regard et prenait son livre. Ce n’était pas un enseignement bien régulier. Ignorante moi-même des méthodes, nous butinions un peu au hasard. En définitive, madame, je ne lui ai guère appris que ce que je sais, et c’est peu de chose. Mais c’est encore plus que ne savent les bourgeois d’ici, et voilà tout le crime de Suzanne à leurs yeux. N’est-ce pas cependant une jalousie bien basse que de chercher une ombre de supériorité dans l’abaissement d’autrui ?
Ma Suzanne devenait de plus en plus gracieuse et intelligente. Un jour, en lisant une belle poésie, elle se mit à pleurer ; et, se jetant dans mes bras, me remercia passionnément d’avoir fait pour elle, en lui donnant une nouvelle vie, plus que n’avait fait sa mère. À partir de ce jour, quand nous étions seules, le nom de maman vint de nouveau me rafraîchir le cœur, prononcé par une voix presque aussi douce que celle de Caroline.
Je ne m’en défends point, madame, il nous faut pour vivre un peu de bonheur. Tandis que mon mari va, souvent à plusieurs lieues, porter ses soins aux malades, et en l’absence de mon fils, qui désormais n’apparaîtra plus que par intervalles sous notre toit, Suzanne était toute ma joie et l’est encore. Je cédais au besoin si naturel d’embellir ce que nous aimons, et, tout en résistant à bien des envies, de temps en temps je lui accordais (à moi-même plutôt) quelque brimborion qui la rendait plus gentille. Puis il y a des femmes, vous le savez, qui semblent parées avec les plus simples choses, et Suzanne est de celles-là.
Un ruban de plus va la rendre éblouissante. Quand elle sort de sa chambre, dans son costume de tous les jours, on se dit : « Comme la voilà belle ! qu’a-t-elle donc aujourd’hui ? » – Rien que sa robe d’indienne, un fichu blanc et son tablier ; mais les plis de cette robe et ce fichu ont une grâce particulière ; sa coiffure est toujours charmante, et de toute sa personne émane quelque chose de pur et d’harmonieux. Ce n’est pas cette beauté qu’on entend généralement, la beauté des belles statues ; non, c’est comme de la candeur et de l’innocence visibles, qui donnent aux lignes assez peu régulières de son visage un charme pénétrant.
Si vous la voyiez madame, vous ne comprendriez pas qu’on pût éprouver pour elle autre chose que cet intérêt, mêlé de respect, qu’inspirent les jeunes êtres ignorants du mal. Malheureusement il se trouve des gens pour lesquels admirer est une souffrance au lieu d’un bonheur. On jugea que c’était trop de hardiesse à ma Suzanne d’oser être si jolie, et le nom de coquette lui fut infligé, avant même qu’elle se fût doutée qu’elle était belle.
Un des graves évènements qui soulevèrent contre Suzanne toute la bourgeoisie de la Roche-Néré fut son changement de coiffure. Elle avait d’admirables cheveux châtains, d’une nuance indéfinissable et naturellement bouclés ; mais cette abondante parure, emprisonnée sous un bonnet depuis l’enfance, n’avait jamais été qu’une gêne pour elle. Il y avait une année environ que Suzanne était chez nous, quand elle éprouva de violents maux de tête, dont mon mari attribua la cause au poids réuni des cheveux et de la coiffure, et à la concentration d’une trop grande chaleur autour du cerveau.
Il ordonna donc à Suzanne de se découvrir la tête. J’avoue que je pris grand plaisir à rendre à la lumière ces beaux cheveux qu’elle inondait de reflets, et que je m’étudiai à les relever le plus gracieusement possible, les roulant d’abord en une grosse torsade, puis laissant leur extrémité retomber en grappes bouclées.
Mais ce fut, madame, un cri général. On nous traita, moi de folle, et l’enfant d’impudente. Au lieu des empressements et des chatteries, dont se compose d’ordinaire l’accueil de ces dames, nous ne rencontrâmes plus que paroles froides et visages sévères. Derrière nous on chuchotait, et, le dimanche qui suivit, M. le curé fit un sermon sur le danger des parures et de la vanité, pendant lequel tous les yeux furent braqués sur nous. Insultée dans la rue par ses compagnes, Suzanne en pleurant me redemanda sa lourde coiffure. La mère Meslin, tout inquiète, vint aussi me rapporter qu’on faisait bruit de la chose dans le pays ; et madame Bonafort me fut députée, pour m’adresser, au nom de la société, de sérieuses représentations.
Le bonnet fut donc remis ; mais les maux de tête recommencèrent, plus violents que jamais ; et un jour que la petite, toute pâle, pleurait de souffrance, mon mari en colère fit voler le bonnet à l’autre bout du salon, en déclarant à madame Bonafort qu’elle pouvait, s’il lui plaisait tant, s’en coiffer elle-même, mais qu’il défendait à Suzanne de le reprendre. Cela nous tint brouillés avec les Bonafort pendant quelques mois ; mais ils nous revinrent. On a tant besoin les uns des autres dans les petites villes ! non pour s’entraider, mais seulement pour se dévorer un peu.
Un autre grief non moins violent fut un tablier de soie noire que mon fils avait envoyé à Suzanne pour ses étrennes. Ces dames, qui se parent le dimanche d’un tablier de soie, ne purent supporter que la petite Meslin en fît autant.
Mais en voilà bien assez, madame, pour vous faire comprendre la jalousie dont ma fille d’adoption était l’objet déjà, quand vint s’établir à la Roche-Néré l’instituteur actuel, Jacques Galéron.
Cette installation était un grave évènement dans notre village. L’ancien instituteur était un rustre à peine décrassé ; celui-ci un beau garçon, timide, mais bien élevé, qui se tenait convenablement, s’exprimait bien, et qu’on disait très instruit ; de plus, à marier. Tout cela fournissait ample matière à préoccupations pour des gens dont l’esprit ne vit que de faits journaliers et du soin des affaires d’autrui.
On parlait de lui depuis un mois quand il arriva. Dès lors ce fut bien pis : on attendit sa visite avec ardeur ; on courait à la fenêtre pour le voir passer. On disait des choses fantastiques de son grand-père, vieux soldat qui l’avait élevé et vivait avec lui. M. le curé, qui le patronnait alors, le conduisit dès le lendemain chez les Bonafort et chez mademoiselle Prudence. Toujours accompagné du curé, il se présenta aussi chez nous, quelques jours après, avec son grand-père. Je causai avec celui-ci, autant que le curé voulut le permettre, tandis que mon mari s’entretenait avec Jacques.
Le père Galéron est un bon et curieux vieillard. Il a fait, comme conscrit, la dernière guerre de l’Empire en Allemagne. Ne pouvant se résigner à vivre dans la France envahie, très jeune encore, il passa en Égypte, à Alexandrie, où il devint capitaine instructeur. La nostalgie le ramena en France ; il se maria ; mais devenu veuf bientôt, il partit pour l’Algérie, où l’ancien capitaine de Méhémet-Ali gagna le grade de maréchal des logis et la croix.
À cinquante ans on le mit à la retraite. Il avait eu un fils, élevé par la famille de sa femme, et qu’il ne connaissait guère. Ce fils, cultivateur, marié à dix-huit ans, était mort, laissant un enfant. Quand Galéron revint dans son village, il trouva le petit Jacques assez malheureux dans la maison d’un beau-père. Il le prit chez lui et l’éleva.
Ce ne fut pas sans peine ; le vieux soldat n’avait que sa pension. Il se fit écrivain public, et en outre monta une fabrique de bijoux arabes, faits de grains de riz coloriés et de cocos.
Ce bonhomme parle avec originalité de ce qu’il a vu. Suzanne, qui l’écoutait bouche béante, ne s’occupa guère ce jour-là du jeune instituteur.
– C’est un garçon intelligent, me dit mon mari après leur départ. Et il a de beaux yeux et une jolie moustache, ajouta-t-il gaiement en se tournant vers Suzanne.
– Oui, dit la petite d’un air convaincu, il est fort gentil.
Mais elle se remit à parler du père, et ne fut tout d’abord occupée que de celui-ci.
Il n’y avait pas huit jours que les Galéron étaient à la Roche-Néré, quand madame Bonafort donna un dîner en leur honneur. Ils étaient comblés de prévenances ; on en raffolait. Mademoiselle Prudence envoyait des œufs de ses poules au vieux Galéron ; je voyais tous les jours passer sous nos fenêtres le curé courant à l’école ; et comme elle touche à notre maison, soit en allant, soit en revenant, il entrait nous dire un bonjour ; ou bien, s’il nous apercevait dans le jardin, il en avait pour une heure à causer par-dessus le mur, exercice assez fatigant et que je n’aime guère ; mais notre curé causerait des heures entières, un pied en l’air ; il en oublie tout, même sa messe, au grand détriment de son estomac et de celui de mademoiselle Prudence, qui, communiant tous les jours, ne déjeune jamais qu’après midi.
On parle beaucoup, madame, du respect dû au caractère du prêtre. Je consens à l’observer ; mais ceux qui distinguent dans un individu deux êtres différents et irresponsables l’un de l’autre sont plus habiles que je ne sais l’être. Je parlerai du curé Babillot sans animosité, quoiqu’il nous ait fait beaucoup de mal. La gloire de Dieu lui sert probablement d’excuse intérieure, et je reconnais d’ailleurs qu’il fut poussé par des influences perfides et par la pente naturelle de son caractère bavard et brouillon. Nul de nous n’étant parfait, je ne commets pas la folie de demander à un prêtre la perfection.
Et même, si on le compare aux curés des environs, certes M. Babillot est un des meilleurs : il n’est ni joueur comme celui de Corellet, ni avare comme celui de Babellorie ; ce n’est point un de ces ambitieux pour qui l’autel est un marchepied, et rien des honteux scandales qui ont éclaté en ces derniers temps dans quelques localités n’a eu lieu dans notre paroisse.
Mais il faut que la nature humaine retrouve quelque part ses droits ; il faut qu’un homme sans famille vive de quelque chose ; et comme l’esprit du curé Babillot est un de ceux qui peuvent le moins habiter les sommets de l’abstraction religieuse et philosophique, où nul d’ailleurs ne peut se maintenir toujours, il est conduit naturellement à s’occuper de ce qui se passe dans les familles qui l’entourent. Le foyer de commérages le plus actif et le plus dévot est nécessairement son centre d’attraction.
M. le curé, donc, ne m’entretenait en ce temps-là que de notre nouvel instituteur et de son vieux père, qu’il allait voir tous les jours, ne les pouvant assez attirer chez lui, et dans le but de parler d’eux avec de nouveaux détails chez mademoiselle Prudence et madame Bonafort. Il trouvait alors excellente la méthode de l’instituteur, exaltait son savoir, les progrès de ses élèves, la bonne tenue de l’école. Un jour il nous dit que ce jeune homme ferait bien de se fixer définitivement dans la commune en s’y mariant.