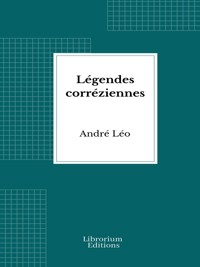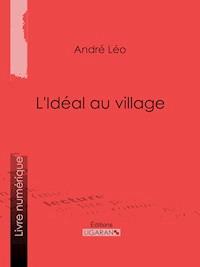
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il y a quelques années, la mort subite de M. Marlotte, conseiller à la Cour de cassation, fut un événement pénible pour tous ceux qui avaient connu de près cet homme excellent et distingué. Profondément instruit, doux, simple, préférant les joies de l'étude et de la famille à tout plaisir comme à toute vanité..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Il y a quelques années, la mort subite de M. Marlotte, conseiller à la Cour de cassation, fut un évènement pénible pour tous ceux qui avaient connu de près cet homme excellent et distingué. Profondément instruit, doux, simple, préférant les joies de l’étude et de la famille à tout plaisir comme à toute vanité, il était du petit nombre de ceux qui placent la justice au-dessus des accidents politiques et des arrangements sociaux.
Ses goûts et son caractère paisible l’avaient toujours écarté des luttes publiques ; mais il n’en élaborait que plus scrupuleusement, dans un silence où la voix seule de la conscience était écoutée, des jugements empreints du sens moral le plus large et le plus pur. À l’encontre de tous les usages reçus, M. Marlotte ne s’était élevé que par son talent et par l’influence d’un caractère énergiquement probe. On a peut-être aussi trop érigé en axiomes de misanthropiques vérités. Non seulement il n’est pas bon de persuader à tous que le succès ne s’achète qu’aux dépens de la conscience ; mais encore le respect et la sécurité qu’inspire une âme droite sont, malgré tout, des sentiments doux au cœur de l’homme et sur lesquels on aime, au moins quelquefois, à se reposer.
Veuf depuis longtemps, M. Marlotte laissait orphelins un fils et une fille, âgés, l’une de vingt ans, l’autre de vingt-cinq. Lucien Marlotte, repoussant toute autre carrière, s’était voué à la peinture : au dernier Salon, il avait exposé deux tableaux de genre qu’un de ses amis avait critiqués assez vivement, qu’un autre avait très chaudement défendus, et devant lesquels la foule, injuste ou non, passait indifférente.
Ce n’était pas sans regret que M. Marlotte avait vu son fils choisir la carrière d’artiste, peu sûre, pensait-il, pour son avenir ; mais la vocation de Lucien était si bruyante, si décidée, que le père fit taire ses appréhensions. M. Marlotte n’avait que cinquante ans ; il était robuste de corps et d’esprit, et, bien que son capital fût des plus modestes, les revenus de sa place devaient lui permettre, selon toute apparence, de subvenir longtemps aux besoins de ses enfants. Les amis de Lucien parlaient de son génie. Indécis à cet égard, le conseiller s’en remit à l’évènement et ne s’occupa désormais que de marier sa fille Cécile.
Un jeune avocat de province, dont les débuts à Caen avaient été brillants, et qui rêvait ces grands succès de réputation et de fortune que Paris seul peut donner, demanda la main de Mlle Marlotte et l’obtint. On achetait la corbeille, quand, un soir, à l’heure du dîner, la femme de chambre, en allant prévenir M. Marlotte, le trouva mort dans son cabinet.
Ce fut un coup terrible pour les deux enfants, qui adoraient leur père et, depuis qu’ils étaient au monde, s’en remettaient à lui de tout soin. Ils ne sentirent d’abord que la perte de cette tendresse et de cette intelligence pure qui les entouraient comme d’une chaude et lumineuse atmosphère ; puis ils s’aperçurent qu’ils venaient en même temps de perdre le bien-être auquel ils étaient accoutumés, et ils durent s’avouer que leur vie, jusque-là si riante et si facile, devenait tout à coup troublée, pleine d’obstacles et d’inquiétudes. Cette royauté intellectuelle qu’exerce tout homme éminent, et dont sa famille partage les douceurs, dans les illusions naïves du droit divin, ne devait plus exister pour eux que vis-à-vis de quelques fidèles, courtisans du malheur, amants du souvenir. Cependant, Lucien et Cécile, aussi confiants l’un que l’autre, eussent été longtemps à se rendre compte de leur situation, sans un fait brutal qui la dévoila, comme un éclair montre un abîme. Le jeune avocat normand épousait l’influence et les relations du conseiller bien plus que Cécile Marlotte. Il reprit sa parole.
Si profond fut l’étonnement de Cécile, qu’il domina tout autre sentiment. Ce jeune cœur blessé laissa bien tomber quelques larmes ; le premier choc passé toutefois, elle s’écria :
« Quel bonheur que je n’aie pas été mariée à cet homme ! »
Lucien, furieux, avait provoqué le parjure ; mais, au nom même de Cécile, de sages amis empêchèrent une rencontre. Quand les affaires eurent été réglées et qu’il eut été constaté que l’héritage se montait à peine à quatre-vingt mille francs, les deux orphelins, tout meurtris de tant d’épreuves si inattendues et si cruelles, se retirèrent ensemble dans un petit appartement de la rue d’Assas, où s’entassa malaisément le mobilier paternel, et confièrent leur ménage aux soins d’une seule bonne.
Après les premières visites de deuil, peu d’assidus leur restèrent. Ils ne virent bientôt plus que quelques gens honorables qui n’étaient pas tous de leurs intimes, mais qui, par dignité personnelle et par intérêt pour ces jeunes gens, les visitèrent comme autrefois. C’était relativement une solitude ; Cécile, cependant, attristée et pensive, n’en demandait pas davantage. Quant aux amis particuliers de Lucien, qui étaient presque tous des artistes, il continua de les voir au dehors et de les recevoir dans son atelier.
Mais Lucien s’aperçut bientôt qu’il n’avait plus pour eux le même prestige. C’était un cœur franc que ce jeune homme, et une intelligence vive ; mais il avait jusque-là trouvé la vie si facile qu’il n’avait pris la peine de réfléchir que tout juste assez pour avoir de l’esprit dans le monde. Cela n’allait pas très loin et ne lui servit qu’à déblatérer avec grâce tout d’abord contre les obstacles ; puis il s’en irrita. La difficulté jusqu’alors s’était écartée de lui ; quand il la vit en face, lui montrant les dents et résolue à lui barrer le passage, il entra en fureur, lui jeta tout à la tête et se désespéra. Cette couronne du génie qu’on lui avait décernée, qu’il avait portée en rêve, il ne la voyait plus, ne la sentait plus ; et personne ne lui en parlait et n’avait l’air d’y songer. Comprenant alors que l’abaissement de sa fortune l’avait abaissé lui-même dans l’opinion, cette colère concentrée qu’on nomme la misanthropie s’amassa en lui. Il devint défiant et rogue, souvent sans cause. Lucien n’eut bientôt plus à la bouche que des aphorismes de mépris contre l’humanité tout entière. Il avait ses raisons, raisons personnelles, qui n’eussent pas dû servir de base à des jugements généraux ; mais il n’en va guère autrement, et c’est une des causes de la diversité des opinions humaines.
Nous devons justifier les amis de Lucien : ils n’y avaient mis ni lâcheté ni malice, mais seulement beaucoup de légèreté. Ils n’avaient pas marchandé l’éloge tant que Lucien n’avait travaillé qu’en amateur et en homme du monde ; mais du moment où il demandait à l’art ses moyens d’existence et n’avait plus d’autre espoir, la chose devenait sérieuse et méritait qu’on y regardât. Leur langage, devenu plus consciencieux, n’en était pour cela même que plus amical, et ils n’étaient réellement coupables que de trop de complaisance dans le passé. Lucien ne le comprit pas ainsi. Ne l’en blâmons pas trop, il fit comme tout le monde ; il est mille fois plus naturel, et bien plus facile, d’accuser ses amis que de se juger soi-même.
Ces fougues, ces amertumes et ces désespoirs du jeune artiste jetèrent beaucoup de trouble dans le ménage fraternel. Très différente de son frère, Cécile était calme et réfléchie. Le trait distinctif de son caractère était une absence de personnalité, rare en ce temps-ci. Absence d’excès, voulons-nous dire ; mais ce mot personnalité s’emploie, on le sait, par euphémisme, pour exprimer les prétentions exagérées de l’égoïsme. La personnalité de Cécile, fort décidée en elle-même, cherchait son objet en dehors d’elle, dans les êtres et dans la vie, et s’en tenait là, sans rapporter et soumettre tout à soi. C’est pourquoi elle était comparativement calme, quoique sensible, les aiguillons de la vanité blessée et de l’ambition déçue ne mêlant pas d’amertume et d’irritation à ses jugements ou à ses douleurs.
Physiquement, c’était un de ces types élégants et fins que l’on rencontre surtout à Paris, où tout favorise leur développement. Belle sans beautés bien précises, jolie sans éclat, charmante sans conteste, elle avait cette grâce exquise, ces gentilles façons que l’on reconnaît aux Parisiennes, mais qui chez celle-ci, heureusement, étaient pures de toute affectation et de toute copie. Son père, qui intimement l’admirait, l’avait laissée croître à l’aise sans défenses et sans préceptes, dans sa liberté, et cette heureuse nature s’était guidée elle-même, par des intuitions aussi sûres que de longues méditations. N’aimant point à être remarquée, elle se conformait à l’usage dans les petites choses, mais pour les grandes n’agissait et ne parlait que selon sa raison et ses sentiments. Presque en tous points elle partageait les idées de son père, dont elle recherchait avec ardeur la conversation et qu’elle vénérait comme une intelligence supérieure.
Après la mort, ce devint un culte. Cécile s’empara de tout ce qui portait l’empreinte d’une pensée de son père : livres, papiers, lettres, manuscrits, cherchant à le retrouver encore. Seule presque toute la journée, elle causait avec sa chère ombre, et parfois le croyait là. Souvent des larmes baignaient ses joues, mais sans transports ni sanglots ; et dans ces moments-là, si elle entendait rentrer son frère, elle essuyait son visage et allait au-devant de lui, en l’accueillant, sans effort, d’un tendre sourire.
Il était rare que Lucien ne rapportât pas quelque mécontentement ou quelque blessure. Sa sœur, par les consolations de sa tendresse, ou par ses raisonnements, lui rendait un peu de calme. Elle partageait d’ailleurs volontiers les illusions du jeune artiste, et rêvait avec lui la fortune et la renommée. Lucien, malgré tout, y comptait si bien, que, de temps à autre, escomptant son avenir, il se permettait des fantaisies peu en rapport avec leur maigre fortune. Ses exigences rendirent impossible à Cécile, comme elle le voulait, de conformer leurs dépenses à leur revenu. C’était difficile d’ailleurs, impossible même, avec leurs habitudes et les relations qu’ils gardaient encore.
Au bout de l’année, Cécile, en groupant les chiffres, s’effraya. Mais Lucien haussa les épaules. Il allait exposer ; il rêvait un triomphe, et la prudence vulgaire de sa sœur lui faisait pitié. Trois mois encore, et ils se vengeaient ensemble, à la face du monde entier, des dégoûts qu’ils avaient subis : ensemble, car, il ne séparait pas l’avenir de Cécile du sien, et s’il l’eût ruinée, c’eût été en toute innocence et générosité de cœur.
Ils attendirent, lui s’exaltant de plus en plus, elle espérant aussi, mais se demandant parfois comment, en cas de défaite, elle pourrait consoler Lucien. Elle montait fréquemment à l’atelier, contemplait le tableau, cherchait les critiques à faire, et quand son frère lui avait révélé naïvement les beautés de son œuvre, elle embrassait l’artiste et redescendait plus confiante.
Malheureusement le tableau ne fut pas reçu.
Cette année-là, le chœur d’imprécations qui accompagne chaque décision du jury fut à coup sûr, grâce à Lucien, plus sonore et plus rugissant. Il accusa tour à tour l’injustice de ses juges et leur ânerie ; il reconnut l’existence d’un complot formé contre lui. Ses emportements avaient effrayé Cécile ; elle le fut plus encore du dégoût et du marasme qui leur succédèrent. Plus d’une fois il lui sembla voir dans l’œil sombre de son frère des projets sinistres. Lucien, effectivement, doutant de lui-même, songea au suicide. Ce pauvre enfant, qui depuis plusieurs années se croyait une couronne au front, ne pouvait consentir à la perdre sans mourir. Imprégné des traditions de l’école, il ne comprenait à la vie d’autre but que la gloire du peintre. Il en est peu d’ailleurs, parmi nous, qui ne rêvent un sceptre quelque part ; la monarchie, quoi qu’on dise, se porte à merveille : elle est encore et partout l’âme du corps social.
À vingt-six ans, toutefois, la vie est si forte dans l’être, que Lucien se laissa ranimer aux consolations de sa sœur. Elle avait appris par cœur la liste des échecs subis par les maîtres et la lui répétait. Elle oubliait tout pour lui et voulait l’emmener à Rome. Il refusa cependant et ressaisit ses pinceaux. Mais fréquemment le découragement le reprenait ; il laissait là sa toile ou changeait d’idée ; il travaillait mal.
Lucien avait juré de ne plus s’exposer aux refus et de travailler seulement en vue de ce public d’élite que rêve tout artiste. Mais, dans sa misanthropie toujours croissante, comme il avait à peu près rompu avec le cercle d’artistes qu’il fréquentait d’abord, son atelier restait inconnu aux amateurs. Incapable d’user de charlatanisme et de réclames, il se desséchait dans la solitude.
Une nouvelle année s’écoula dans ces douloureuses intermittences, à la fin de laquelle Cécile, chargée seule de la comptabilité du ménage, constata que, l’écart entre le chiffre des dépenses et celui des recettes devenant chaque jour plus large, ils allaient avec une rapidité merveilleuse à une ruine complète.
Elle différa quelque temps d’en prévenir son frère, de peur d’ébranler le calme relatif dont il jouissait ; mais elle savait peu feindre, et Lucien, qui volontiers s’en remettait à elle du soin de varier et d’animer l’entretien, remarqua bientôt que sa sœur avait moins d’entrain qu’à l’ordinaire. « Elle s’ennuie et regrette le monde, » pensa-t-il, et il voulut la conduire au concert et au spectacle. Sur le refus de Cécile, une explication eut lieu, et dès lors ils s’occupèrent à méditer tristement ce problème financier, toujours le même en termes différents, qui du grand au petit, si diversement et d’une manière si semblable, fait l’embarras général.
Bien des combinaisons avaient échoué déjà, quand un beau jour, au retour d’une excursion à Saint-Cloud, Lucien s’écria :
« Nous sommes fous ! Ce n’est pas à Paris que nous devons vivre, mais à la campagne. C’est là que règne la vie facile et simple et, qui plus est, l’idéal du beau. C’est là que nous trouverons le rajeunissement de l’âme, la source enchantée, l’ombre, la fraîcheur, la paix ! Que faisions-nous ici, mon Dieu ! Nous y sommes pauvres, et là-bas nous serons riches. Là-bas je serai moi-même ; je me retrouverai, je le sens. Paris m’écœure. Ses bruits, ses idées, son langage, ses niais engouements, ses haines insensées, ses jugements stupides, tout cela m’est odieux, me fait mal aux nerfs. Partons.
– Partons, » répondit Cécile.
Elle ne connaissait de la campagne que la villégiature autour de Paris ; mais elle aimait la nature. Elle entra donc avidement dans le projet de son frère, et ils ne songèrent plus qu’à l’exécuter.
Il s’agissait tout d’abord de choisir le lieu de leur séjour champêtre. Lucien pensa de suite à un parent de son père, qui exerçait les fonctions de notaire dans un gros bourg, à soixante lieues de Paris, et chez lequel il était allé passer, à la fin de ses études, il y avait sept ans déjà, deux mois de vacances. Malheureusement ils avaient négligé d’entretenir aucune relation avec cette famille depuis la mort de M. Marlotte, et ils avaient même laissé sans réponse la lettre de condoléance écrite à cette occasion par l’oncle Darbault ; chose d’autant plus fâcheuse que le post-scriptum de cette lettre mentionnait l’arrivée prochaine à Paris du fils Darbault, et donnait l’adresse de l’institution où il entrait comme aspirant à l’école polytechnique.
« Bah ! dit Lucien, l’oncle Darbault nous excusera ; c’est un si brave homme ! Il nous sera plus avantageux d’avoir pied d’avance quelque part, et puis Loubans est un délicieux pays. »
Il en fit à sa sœur un tableau merveilleux, et de son consentement écrivit. Peu de jours après, il recevait cette réponse :
« Mon cher neveu,
Mieux vaut tard que jamais, et je suis bien content d’avoir enfin de vos nouvelles. Nous serons tous charmés de vous voir, et nous vous sommes très obligés d’avoir pensé à venir de notre côté. Les femmes en sont tout sens dessus dessous et s’évertuent en projets pour vous mieux recevoir. On se souvient à merveille du gentil garçon que tu étais, et l’on désire vivement connaître ta sœur.
Je t’avoue que cela nous a un peu étonnés de ne pas entendre parler de vous par Arthur, qui est depuis deux ans à Paris ; nous comprenons bien les regrets que vous devez éprouver de la grande perte que vous avez faite ; mais c’est pousser un peu loin le goût de la retraite que de cesser d’être en relation avec sa famille. Tu me diras qu’Arthur pouvait vous aller voir ; mais je l’ai envoyé de suite à l’institution pour éviter les frais d’hôtel, et il n’en pouvait sortir qu’avec un correspondant ; tu savais son adresse, et nous avons pensé que ce n’est pas une raison parce qu’on a des parents riches et bien posés, de se jeter à leur tête.
Enfin je ne t’en veux pas, et c’est seulement pour te dire qu’Arthur est entré l’année suivante, le cent cinquantième, à l’école polytechnique, et le voilà qui, avant de revenir nous voir, va aller passer une partie de ses vacances chez un duc dont le fils est son camarade. C’est un garçon, comme tu le vois, qui nous fait honneur et que voilà bien lancé. Marius va bientôt sortir du collège ; Lilia, dont je vous ai annoncé dans le temps le mariage, demeure toujours près de nous, et Agathe n’est pas encore mariée.
Quant à moi, la confiance du gouvernement m’a fait maire depuis six ans, ce qui ne diminue pas ma besogne ; mais il faut bien faire quelque chose pour son pays.
Voilà pour la famille. Quant aux autres renseignements que tu me demandes, venez vous établir chez nous, où vous serez reçus, sinon très bien, du moins de grand cœur, et vous verrez par vous-mêmes les ressources que peut offrir le pays. Je crois qu’on pourra vous trouver, moyennant réparations, un logement convenable, surtout si vous n’êtes pas trop difficiles et ne demandez pas un palais. Loubans a d’ailleurs beaucoup changé depuis ton voyage ici. On y trouve à peu près toutes les commodités désirables ; car le chemin de fer passe maintenant à une demi-lieue de la ville, et l’on pourrait même faire venir son dîner de Paris, si l’on voulait, en ayant soin de ne pas le commander chaud. Donc, faites vos malles ; nous préparons vos chambres. Présente nos compliments et nos amitiés à ta sœur.
Ton vieil ami, FÉLICIEN DARBAULT. »
« Quel excellent homme ! s’écria Lucien. Ne m’écrit-il pas comme ferait un frère de mon père ? Ils n’étaient cependant que cousins issus de germains. Tu vois que la parenté n’est pas grande. Mais ceci n’est rien et le cœur est tout. Eh bien, faisons nos malles et donnons congé de l’appartement.
– Tu es donc bien décidé à te fixer là-bas ? demanda Cécile, qui craignait un retour de l’imagination ardente et mobile de Lucien.
– Parfaitement, et je ne comprendrais pas que nous pussions hésiter. En deux ans et quelques mois, ici, tout en menant la vie la plus stupide et la plus gênée, n’avons-nous pas dévoré le quart de notre patrimoine ? De ce pas où allons-nous ? C’est facile à voir. Là-bas, au contraire, je me le rappelle, tout est pour rien. C’est une abondance de tout : volaille, gibier, laitage, que sais-je ? Les fruits, ça ne se vend pas, on les ramasse. Nous ne dépenserons presque rien. Moi, d’abord, j’achète un coutil : ça me fait l’année ; de gros souliers, un chapeau de paille… Avec cette petite robe de barège, tu éblouiras les gens. – Et puis, ce que j’adore, vois-tu, moi, c’est la simplicité. Là-bas, on est comme on est, et nul n’y trouve à redire. Les paysans qui passent vous ôtent leur chapeau. On est seigneur de village… À peu de frais nous serons trouvés magnifiques. Enfin, nous serons libres ; nous ferons à notre guise et selon nos moyens, tandis qu’ici, pour quelques visites que tu reçois, il nous faut une maison tenue sur un certain pied, mensonge misérable, vanité fausse et stupide, à laquelle on sacrifie toute raison, toute sécurité. »
Cécile ne voulut pas interrompre son frère pour observer que lui seul l’avait empêchée de réformer leurs dépenses, et Lucien continua sur ce ton pendant une heure. Il pressentait que la nature champêtre allait lui fournir des inspirations sublimes ; un jour, Paris reverrait ses tableaux, et peut-être alors… Il l’accablait pourtant, ce Paris, de ses anathèmes ; Paris, c’était la mort, l’écrasement du génie. Il étouffait désormais dans ces murs maudits, et Cécile eut beaucoup de peine à lui faire comprendre que leurs préparatifs de départ exigeaient au moins quinze jours.
Dans cette attente, que Lucien remplissait des plus beaux rêves, toute sa gaieté revint, ses yeux reprirent leur éclat, et Cécile, heureuse, l’embrassait en lui disant : « Te revoilà, le bon garçon d’autrefois est retrouvé. Tu redeviens beau. »
« À quoi penses-tu ? » lui demanda-t-elle un jour qu’elle le voyait tout rêveur, penché, un demi-sourire aux lèvres.
Il sourit d’un air mystérieux qui excita la curiosité de la jeune fille.
« Oh ! dit-elle en éveillant d’un sourire ses jolis traits, si c’est un secret, je veux le savoir. »
Et, quittant sa place, elle alla s’asseoir sur les genoux de son frère, et, le fixant dans les yeux :
« À quoi pensez-vous ? » demanda-t-elle d’un petit air souverain.
Il se fit prier comme lorsqu’on désire parler, saut quelque pudeur qui retient. Et quand, feignant le dépit, Cécile alla reprendre sa place dans l’embrasure de la fenêtre, où le jour tombait, il vint à son tour auprès d’elle, et, s’asseyant sur un tabouret, à ses pieds, il appuya sa tête sur les genoux de sa sœur.
« Des niaiseries de jeunesse ! dit-il.
– Vraiment ? Oh ! conte-moi cela, petit frère. Il y a si longtemps qu’on ne m’a rien conté !
– Ce ne sera pas long… Je songeais tout simplement à Loubans, où le paysage est splendide, la race vigoureuse… avec de très beaux types çà et là. On y voit aussi des mares vertes, avec des canards de toutes couleurs.
– As-tu bientôt fini de te moquer de moi ? Laissons-là ces canards ; il s’agit de tout autre chose, si j’en juge par le sourire rêveur et charmé que tu avais tout à l’heure.
– Finette ! il n’y a que les jeunes filles pour flairer d’aussi loin les histoires d’amour. »
Cécile poussa un petit cri, en disant : « J’en étais sûre ! » et frappa dans ses mains d’un air ravi.
« Ah ! c’est ainsi, monsieur ? Et vous ne m’en aviez jamais rien dit !
– Doucement, doucement ! Ne va pas rêver une passion ; il s’agit seulement d’une silhouette, d’un rêve, d’une aube, de ce qu’il y a de plus frais, de plus pur, de plus vivant dans la vie, le premier éveil d’amour dans le cœur d’un écolier.
– Vraiment ? dit la jeune fille, sur le front de laquelle une aurore fugitive passa. Il y a donc longtemps ? Quel âge avais-tu alors ?
– Dix-neuf ans, et elle quinze au plus. C’était à Loubans. Tiens, dit-il en posant le doigt sur son front, j’ai là un tableau que je n’essayerai jamais de transporter sur la toile, et dont aucun maître n’égalera jamais la fraîcheur : de grands chênes, une haie chargée de mûres, des nuages blancs qui passaient ; moi, dans les épines du fossé, lui cueillant les petits fruits noirs, et elle, souriante, émue, flattée, me regardant de tous ses beaux yeux, tandis que ses dents blanches éclataient entre ses lèvres. Elle mangea seulement une mûre ou deux, puis me dit, la coquette, en s’essuyant la bouche : "Cela noircit. " Ensuite, elle se mit à marcher dans le chemin, lentement, et je la suivis. Je ne savais que lui dire, n’osant lui dire combien je la trouvais délicieuse à voir. Un oiseau vola devant nous, et nous, le suivîmes des yeux, de peur de nous regarder. Mais en marchant ainsi, les yeux en l’air, elle fit un faux pas dans le chemin rempli de pierres. Je l’entourai de mon bras pour la soutenir et la gardai ainsi pressée contre moi, sans qu’elle s’y opposât ; nous ne parlions pas. Malheureusement, je n’y voyais plus, si bien que nous allâmes nous butter, tout en marchant, contre un tronc d’arbre. Rose alors se dégagea de mes bras et rentra chez elle ; car nous étions près de son jardin. J’étais fou ; je voulais absolument l’épouser.
– C’est tout ? demanda Cécile, avec un peu d’embarras, à Lucien qui se taisait.
– Pas tout à fait. À quelques jours de là, il y eut échange de baisers et de serments. Elle doutait bien un peu, la chère petite, et me disait : "Vous m’oublierez à Paris. "
– En effet, c’est mal, Lucien.
– Ah ! je t’assure qu’en partant j’avais bien l’intention de lui rester fidèle et de revenir selon ma promesse. Mais ce fut impossible. Ce pauvre amour si naïf s’était laissé voir, et M. Darbault en écrivit à mon père. L’année suivante, je demandai vainement à retourner à Loubans, et, quand je laissai voir mon chagrin, mon cher père me parla tendrement, me priant d’attendre, de mûrir mon caractère et mon jugement avant de prendre un parti si grave que celui de m’engager à une paysanne.
– C’était une paysanne ! s’écria Cécile.
– Oui… c’est-à-dire qu’elle en porte à peu près le vêtement. Cependant, jamais créature plus belle et plus distinguée par la nature… Si tu avais vu près d’elle nos cousines, quelle différence ! »
Mais Cécile paraissait un peu déconcertée. Lucien se leva :
« Je ne sais guère ce que maintenant elle peut être devenue, dit-il d’un ton dégagé. Mariée, sans doute, car elle doit avoir plus de vingt ans. Je la reverrais avec intérêt, voilà tout. Pauvre Rose !
– Elle se nomme Rose ?
– Oui, Rose Deschamps. Tu la verras probablement là-bas. Elle a dû conserver ses relations avec la famille, car elle était amie d’enfance de notre cousine Agathe, la plus jeune des deux. Elles allaient ensemble au jardin ; moi, je ne les quittais guère… »
Et Lucien continua de retracer les souvenirs de cette excursion au village, à dix-neuf ans. Sa sœur l’écoutait rêveuse. La belle paysanne l’inquiétait un peu.
Quelques jours après, au commencement d’août, ils quittaient Paris et s’arrêtaient, vers cinq heures du soir, à la station la plus proche de Loubans. Au sortir de la gare, ils aperçurent, près d’un cabriolet mal décrotté, attelé d’une jument blanche peu étrillée, un grand garçon de dix-huit ans à peu près, coiffé d’un képi et qui s’avança vers eux en disant à Lucien :
« Seriez-vous monsieur Marlotte ?
– Oui, monsieur.
– Mon père m’envoie vous chercher.
– Marius ! s’écria Lucien. Comme te voilà grand ! »
En rougissant, le jeune collégien embrassa Lucien et Cécile. Puis on s’occupa des malles. Une seule pouvait trouver place derrière la voiture, et Lucien et Marius s’occupaient de l’y fixer, avec assez de peine, quand un homme s’approcha d’eux en disant :
« Je crois, messieurs, que vous avez besoin d’un coup de main.
– Ah ! c’est vous, Deschamps ? dit le jeune Darbaut ; ma foi oui, aidez-nous ; ce sera plus tôt fait. »
Le nom de Deschamps frappa Cécile, et elle regarda l’homme avec attention. C’était un paysan d’une cinquantaine d’années, qui avait dû être beau dans sa jeunesse. Ses traits étaient réguliers et sa physionomie intelligente, mais sans noblesse. Bien qu’il portât le costume ordinaire des paysans, blouse et pantalon de toile bleue, ses moustaches, sa barbe longue, son air insolent et flâneur, lui donnaient plutôt l’apparence d’un demi-bourgeois, ou d’un artisan en goguette.
« Ce doit être le père de Rose, » se dit Cécile en voyant l’air dont Lucien salua cet homme, qui dit aussitôt familièrement :
« Eh ! ma foi, c’est M. Lucien Marlotte. Je ne vous reconnaissais pas ; il y avait longtemps qu’on ne vous avait vu.
– Très longtemps, père Deschamps ; mais cela ne m’a pas empêché de vous reconnaître.
– C’est que je n’ai pas grandi, moi, monsieur Lucien ; mais nous nous sommes assez vus, il y a sept ans, quand vous veniez chez moi goûter mon cassis, et que nous faisions des parties de billard ensemble, chez la mère Lentu. Je vous ai gagné bien des petits verres, au moins, quoique vous ne fussiez pas un mauvais joueur.
– Ça n’est pas étonnant, car vous êtes de première force, dit Marius ; mais aussi vous ne faites que ça.
– Allons, allons ! monsieur Marius, faut pas me taquiner. Je mène aussi ma maison, et ça n’y va pas si mal. C’est une fameuse ménagère que ma femme, et mes filles sont les meilleures ouvrières du pays, et, sans me vanter, les plus jolies.
– C’est vrai, répliqua Marius ; mais si vous appelez ça prendre de la peine…
– Ah ! mais en effet, dit Lucien assez gauchement. Je me rappelle vos filles… Mlle Christine…
– Il n’y a plus que Mlle Rose, reprit le père en lui lançant un regard sournois ; Mlle Christine est mariée.
– Ah ! fit Lucien.
– Oui, monsieur, avec un marchand d’épiceries d’à deux lieues d’ici ; nous n’avons plus que Rose à la maison. »
Ce nom de Rose sembla intimider tout le monde, car le silence se fit. Le nez baissé, Lucien et le collégien, chacun de son côté, nouaient un bout de corde. Quand la malle fut solidement attachée enfin, et que Marius offrit la main à Cécile pour monter en voiture :
« Eh bien ! messieurs et dames, dit Deschamps, au revoir. Vous serez plus vite arrivés que moi. Ma foi ! si j’avais aussi ma voiture, ça m’irait. Je viens déjà des Saulées.
– Vous faites toujours la partie de M. de Pontvigail ?
– Mon Dieu, oui, monsieur, faut tenir compagnie à ses amis. Et puis, quoique je ne sois qu’un paysan, moi, j’ai toujours aimé la société des messieurs ; on y a de l’agrément, sans compter les bons morceaux. Allons, on se retrouvera au billard, n’est-ce pas ? Donc, sans adieu ! »
La voiture fila sur une route vicinale toute neuve bordée de jeunes ormeaux, et tandis que Lucien, aidé de Marius, rappelait ses souvenirs, Cécile, tout en écoutant, contemplait le paysage. C’était une succession interminable de champs, de haies, de prairies, qui se précipitaient vers le fond d’une vallée, marqué par des rangs sinueux de peupliers ; sur le versant opposé, du milieu d’un fouillis de verdure, s’élevait le clocher pointu du bourg de Loubans. Aux rayons du soleil couchant, tous ces guérets, avec leurs différentes cultures et leurs diverses nuances, les prés, les grands chênes, les peupliers du vallon, les bois et les champs de l’autre colline, les toits de tuile rouge ou d’ardoise qui apparaissaient entre les arbres, et les vitres qui flamboyaient, tout cela formait un ensemble plein d’harmonie, qui charmait et éblouissait à la fois. Cécile en fut émue d’admiration, et Lucien s’épancha en exclamations enthousiastes.
On allait descendre une côte assez rapide quand tout à coup la jument s’arrêta.
« Allez donc ! allez, Colombe ! » fit Marius.
Colombe ne bougea, et, comme son jeune conducteur insistait à grands coups de fouet, Colombe se montra décidée à la révolte jusqu’au point de lancer un coup de pied dans le tablier de la voiture.
« Mon cousin, descendons, je vous en prie ! s’écria Cécile en voyant Marius couleur d’écarlate et aussi furieux qu’embarrassé.
– Voilà les habitudes que donnent les femmes, dit Marius. C’est ma sœur Agathe avec ses nerfs… Il faudra pourtant que cette bête cède, » reprit-il en fouettant Colombe de nouveau.
Mais Colombe se cabra, et, malgré les assurances de Marius, qui, disait-il, répondait de tout, Lucien insista sévèrement pour que Cécile descendît.
Ils étaient à peine tous les deux sur le chemin que Marius, resté dans le véhicule, se mit à frapper sa bête avec une telle fureur qu’elle partit à fond de train.
« Il va tout casser, dit Lucien. Voilà les enfants. J’aurais fait comme cela précisément à son âge. Eh bien, petite sœur, que te semble de ce pays ?
– Je le trouve ravissant, dit-elle, et tout plein d’une senteur sauvage qui me plaît.
– Tu vas devenir ici encore plus jolie, si j’en crois ta mine fraîche et ravie en ce moment. Que regardes-tu ?
– Mais ce sont des bruyères ! dit-elle en s’approchant d’un bois qui bordait la route, de vraies bruyères venues là toutes seules ! Sont-elles bonnes et charmantes ! vois ! »
Elle avait franchi le passage qui donnait accès dans le bois, et cueillait, agenouillée, les fleurs sauvages. Un sentier s’enfonçait dans le taillis, côtoyant la route ; Cécile se mit à le suivre.
« Tu oublies notre brave et entêté conducteur, dit Lucien.
– Ce ne sera guère plus long.
– Pardon, le sentier tourne.
– Mais sous cette voûte de feuillage on est si bien ! D’ailleurs, nous pouvons courir. »
Et, sans égard à sa chaussure parisienne, Cécile se mit à bondir dans le sentier rocailleux, entrecoupé çà et là de vieilles racines qui perçaient le sol. Lucien la suivait d’une allure plus modérée, quand tout à coup il la vit se rejeter en arrière en poussant un léger cri, et, accourant en hâte auprès d’elle, il aperçut une sorte de chasseur, d’assez mauvaise tournure, qui, suivi de son chien, s’éloignait à grands pas.
« Eh bien ! qu’y a-t-il ? » s’écria très haut le frère de Cécile.
Mais l’inconnu ne détourna pas la tête et disparut dans le bois.
« Il ne m’a pas adressé la moindre parole, dit la jeune fille ; mais quand je me suis trouvée subitement en face de cet homme, qui me fixait avec un étrange regard, j’ai été si surprise que je n’ai pu retenir un cri. Sais-tu qu’il n’est guère poli ce monsieur ? car, aussitôt après avoir crié, je lui ai demandé pardon ; mais il n’a rien répondu, et, me tournant le dos, il s’est enfui en portant gauchement la main à son chapeau.
– C’est quelque braconnier, dit Lucien, car il porte un fusil et la chasse n’est pas ouverte.
– Non, c’est plutôt un bourgeois : il porte du linge fin ; et puis, l’expression de son regard…
– Eh bien ! s’ils ont tous ici la même fleur de politesse… »
Ils revinrent sur la route en plaisantant de la sauvagerie des gens du pays, et retrouvèrent au bas de la colline le collégien et sa bête qui s’impatientaient. Un quart d’heure après, au milieu du bourg de Loubans, ils s’arrêtaient en face d’une maison bourgeoise dont le portail s’ouvrait devant eux.
À peine la voiture avait-elle pénétré dans une grande cour gazonnée, que cinq ou six personnes sortirent en courant de la maison et entourèrent les nouveaux venus. Un grand et gros homme, qui devait être l’oncle Darbault, aida Cécile à descendre et l’embrassa joue sur joue ; après quoi, il la poussa dans les bras d’une grosse dame, qui s’écria :
« Vous devez avoir bien chaud, ma nièce ? vous êtes bien fatiguée ? vous devez avoir bien besoin de vous rafraîchir ? vous allez être bien mal chez nous ! ce n’est pas ici comme à Paris ; mais enfin nous ferons de notre mieux ; il ne faudra pas vous gêner ; venez donc vous reposer.
– Je suis votre cousine Lilia, dit une grande jeune femme en tendant ses joues à Cécile et en lui présentant une petite fille âgée de cinq à six ans.
– Me sera-t-il permis de me présenter à mon tour ? » dit la voix flûtée d’une jeune personne vêtue avec l’élégance d’une poupée de modes et dans laquelle Cécile devina la seconde fille de son oncle, Agathe.
La jeune Parisienne, un peu étourdie, balbutiait des réponses à tant d’interpellations, quand elle se trouva en face d’un monsieur qui, le chapeau à la main, réclamait aussi son accolade, et par lequel elle se laissa encore embrasser désespérément, sans savoir pourquoi.
« C’est mon mari, se hâta de dire Lilia, – car il ne prend pas la peine de vous prévenir, ajouta-t-elle d’un ton un peu sec, du droit qu’il a de vous traiter en parente.
– Assez de cérémonies ! cria M. Darbault, et mettons-nous à table, où nous ferons connaissance plus largement. »
Et, donnant le bras à Cécile, ils entrèrent dans la maison.
« Tu en parles bien à ton aise, s’écria Mme Darbault, mais le dîner n’est pas encore prêt. »
Et, s’adressant à Cécile :
« J’ai mille excuses à vous faire, ma nièce ; j’ai une servante qui n’en finit à rien. Je lui avais dit ce matin : Je tiens extrêmement à ce que mon neveu et ma nièce trouvent le dîner prêt. Mais rien n’y fait, aussi je suis d’une colère !… Je lui aide pourtant depuis ce matin ; il m’a fallu faire vos chambres moi-même afin que rien n’y manquât…
– Maman ! fit Agathe en poussant d’un air mortifié le coude de sa mère.
– Eh bien ! quoi ? Mon Dieu ! Cécile et Lucien verront bien que nous sommes sans cérémonie : mal traités de bon cœur, vous savez.
– Mais, ma tante, je ne sais pourquoi vous nous supposez exigeants, observa Lucien ; nous sommes venus ici au contraire pour vivre de lait et de miel, comme des bergers d’Arcadie. »
Agathe et Lilia sourirent d’approbation, et M. Darbault s’écria :
« Bah ! un bon gigot à l’ail n’y gâtera rien. Seulement activez-nous un peu ça, mesdames. Quand on vient de Paris… »
C’était dans le salon que s’échangeaient ces dernières paroles, un salon un peu sombre, à une seule fenêtre, drapée d’un rideau rouge et d’un rideau blanc. L’ameublement se composait d’un canapé carré, d’un vieux style, et de fauteuils semblables. Sur la cheminée, une pendule dorée, surmontée d’un troubadour avec sa guitare, et deux bouquets de fleurs artificielles sous des globes.
De chaque côté de la cheminée se trouvait une table de jeu, et les murs étaient ornés de tableaux à cadres dorés représentant M. Darbault en habit noir et en cravate blanche, Mme Darbault en toilette de bal, Esther allant trouver Assuérus, et le supplice d’Aman. Tout cela était d’une propreté immobile et scrupuleuse ; pas un pli, pas une ligne qui dépassât l’autre ; rien de travers, ni même qui pût être dérangé, sauf des écrans posés en regard l’un de l’autre, avec tant de précision, qu’on sentait bien que c’eût été manquer à des lois sacrées que de les incliner à droite ou à gauche.
Mme Darbault et sa fille aînée s’étaient portées au secours de la cuisinière ; Agathe, assise en face de Cécile, s’apprêta, d’un air composé, à soutenir la conversation et débuta par cette phrase :
« Vous devez, ma cousine, trouver notre pays bien laid ?
– Pas du tout ; je le trouve ravissant au contraire. Mais seriez-vous assez bonne pour me montrer ma chambre en attendant le dîner ?
– En effet, dit Agathe en s’empressant, j’aurais dû songer… »
Elle fit traverser à Cécile le corridor, et s’arrêtant aux premières marches d’un escalier assez mal éclairé :
« Mon Dieu ! ma cousine, je vous demande mille pardons de vous faire passer par ici, car c’est si obscur…
– Il y a un autre escalier ? demanda Cécile sans aucune malice.
– Mais non, répondit Agathe étonnée.
– Eh bien ! reprit en riant la jeune Parisienne, de quoi vous excusez-vous alors ? Nous n’avons pas à choisir. »
En entrant dans sa chambre, Cécile tout d’abord ne vit rien, tant les contrevents étaient bien fermés ; son premier soin fut de les ouvrir.
« Quoi ! vous ouvrez ? dit Agathe. Il fait encore du soleil ; je croyais que vous n’aimiez que le demi-jour.
– J’aime les belles vues, dit Cécile en contemplant avec ravissement la vallée, qui déroulait sous la fenêtre ses plis profonds, et la colline opposée, où le soleil éteignait lentement ses derniers feux.
– Oui, la vue est très belle, » répondit froidement Agathe.
Mais elle semblait attendre avec impatience que sa cousine cessât de contempler le paysage et voulût bien donner un coup d’œil à la chambre qu’on lui avait destinée, et qui était la plus belle de la maison. Cécile, par malheur, n’y jeta qu’un regard distrait, et, quittant son chapeau, se mit à lisser devant la glace les blondes touffes de ses cheveux.
« Vous n’avez pu apporter qu’une de vos malles ? dit Agathe.
– Oui ; mais les autres doivent arriver ce soir.
– Vous en avez beaucoup sans doute ? On dit que les Parisiennes ne voyagent pas sans cela.
– Trois en tout seulement, pour mon frère et pour moi. Vous voyez qu’il n’y a là rien d’extraordinaire.
– Vous n’avez rien à prendre dans votre malle ? demanda Agathe, qui mourait d’envie de connaître le contenu de la boîte parisienne.
– J’ai bien envie de secouer la poussière du voyage ; mais il me faudrait changer des pieds à la tête, et je ne sais trop si j’aurai le temps.
– Oh ! je le pense.
– Alors… » dit Cécile.
Elle ouvrit sa malle, pensant qu’Agathe allait se retirer ; mais il est admis généralement à la campagne que les femmes ne doivent pas avoir de secrets les unes pour les autres ; ce qui, vu les intelligences des deux camps, revient à n’en avoir pour personne. Agathe resta. La malle une fois ouverte, d’ailleurs, elle ne fût partie pour rien au monde, et tous les objets de toilette que Cécile exhiba subirent une revue pleine de commentaires qui dura jusqu’à l’appel du dîner.
En bas, Cécile rencontra son frère occupé de recevoir le commissionnaire qui apportait le reste de leur bagage. Après reconnaissance des objets :
« Combien vous faut-il, mon brave homme ? demanda Lucien.
– Ce qu’il plaira à la générosité de monsieur, répondit le commissionnaire en soulevant humblement son chapeau. Il fait bien chaud, ajouta-t-il en s’essuyant le front.
– As-tu de la monnaie ? demanda Lucien à sa sœur.
– Que te faut-il ?
– Bah ! dit-il à demi-voix, il faut être magnifique. Donne-moi trente sous. »
Mais en les recevant, l’homme fit une grimace et resta la main ouverte en regardant l’argent d’un air de mépris :
« Ça vaut plus que ça, dit-il. Je me suis éreinté pour vos malles ; ça n’est pas payé. »
Agathe, présente à cette scène, eut un air si mortifié que Lucien rougit.
« En vous donnant le prix d’une journée dans ce pays, dit-il, je pensais…
– Oh ! ça n’est pas tout ça. Je ne suis pas à la journée ; c’est un service. Je pensais que monsieur serait généreux et me donnerait la pièce ronde ; mais puisqu’il faut faire son prix, ça vaut au moins cinquante sous. »
Et il énuméra les peines qu’il avait eues à la descente et à la montée, et tous les cailloux du chemin. Son cheval n’en pouvait plus… Lucien, impatienté et déconcerté de l’aventure, lui remit ce qu’il demandait et rentra dans la salle à manger en disant :
« Vos commissionnaires, mon oncle, sont devenus exigeants.
– Ne m’en parle pas, dit M. Darbault. Depuis l’établissement du chemin de fer, tout se paye ici au poids de l’or.
– La tête leur a tourné, s’écria Mme Darbault. C’est une fièvre, une folie ! On ne peut plus se faire servir, et non seulement ils ne se contentent de rien, mais ils prétendent à tout et n’ont plus de respect. Autrefois, ces gens-là étaient humbles, soumis, rangés ; ils vous saluaient chapeau bas et vous regardaient comme des personnes supérieures. Maintenant on ne peut s’imaginer jusqu’où va leur insolence, et ils se regardent comme vos égaux. Autrefois, on les contentait de peu, on les éblouissait facilement, on acquérait à bon marché leur reconnaissance ; mais à présent, à moins qu’on ne soit millionnaire, il ne vous considère point.
– Il faut dire, ajouta l’oncle en riant, qu’en voyant arriver ces deux Parisiens, qu’on attend depuis trois semaines, les gens se sont dit : "Voilà de grands seigneurs qui ont de l’argent en poche et qui doivent en laisser dans le pays. "
– Ils se sont bien trompés, répliqua Cécile ; car ils n’ont affaire qu’à de petites gens qui veulent économiser.
– Vraiment ! » dit la tante d’un air de surprise et d’embarras qui se réfléchit sur toutes les figures.
Et Mme Darbault changea aussitôt l’entretien en se plaignant que son neveu et sa nièce ne mangeaient point, et qu’elle voyait bien que son dîner était détestable. C’était la faute de Françoise et puis encore de tel ou tel fournisseur et de tel et tel accident. On ne pouvait rien faire comme on voulait ; tout cela était déjà bien mesquin, et il fallait en outre que ce fût mauvais. Elle dépréciait chaque plat tour à tour, et les compliments sincères de ses hôtes pouvaient à peine trouver place au milieu de ces doléances. La table cependant était couverte avec profusion. À l’arrivée du rôti, flanqué de quatre nouveaux plats, qui relevaient le premier service, Lucien et Cécile, suffisamment autorisés à donner leur avis, se récrièrent, ce qui parut enfin satisfaire Mme Darbault. Au dessert, qui était splendide et dont la composition, méditée par Agathe, fut vérifiée conforme aux lois de la symétrie, la conversation s’anima, et Lucien excita la plus vive admiration en se livrant à sa verve parisienne. Il fit de son voyage, le moins accidenté du monde pourtant, un récit pittoresque. Marius, Agathe, et Lilia surtout, semblaient suspendus à ses lèvres, et la petite fille elle-même, bien qu’elle ne comprît qu’à moitié, riait de tout son cœur.
Lucien n’eut garde d’oublier la rencontre que Cécile avait faite dans le bois, près de la route, et en émailla le récit d’une foule de plaisanteries sur le caractère présumé des indigènes de Loubans. L’attention fut au plus haut point excitée par cet incident local, et chacun s’évertua à chercher quel pouvait être le compatriote qui se rapprochait du portrait fantastique tracé par Lucien ; on en était même arrivé à la certitude que l’inconnu en question devait être quelque aventurier de passage, quand Cécile prit la parole :
« Avant de vous dépeindre l’homme que j’ai rencontré dans le bois, dit-elle en souriant, Lucien a négligé de vous prévenir qu’il ne l’avait pas vu. »
On éclata de rire, et Cécile fut à son tour questionnée.
« C’est, dit-elle, un homme de taille moyenne, vêtu d’une redingote et d’un pantalon bruns, et portant un fusil et une carnassière. Il a la figure brune, maigre, colorée, des yeux noirs, le regard ardent, les cheveux noirs, et…
– C’est Louis de Pontvigail, interrompit M. Delfons, le mari de Lilia.
– Et, reprit la jeune fille, sous son chapeau de paille se voit, au-dessous du front, une ligne noire qui semble un bandeau.
– C’est M. Louis de Pontvigail ! s’écria-t-on de toutes parts.
– Ma chère, vous avez mis la main du premier coup sur le plus grand original du pays.
– Un maniaque !
– Un ours !
– Un homme tout à fait ridicule ! dit Agathe du bout des lèvres.
– Eh bien ! dit le docteur, car M. Delfons était médecin, Louis de Pontvigail, si vous le voulez, est tout cela ; mais c’est un homme qui a cependant de la valeur. Ce qu’il a d’excentrique vient d’une extrême sensibilité.
– Allons donc, mon gendre, s’écria M. Darbault, votre Pontvigail est un cerveau fêlé ! Me direz-vous, par exemple, pourquoi il se promène toute l’année avec son fusil et sa carnassière, sans jamais tirer aucun gibier ?
– Aussi l’ai-je pris pour un braconnier, la chasse étant prohibée, dit Lucien.
– Bah ! les gendarmes ne s’occupent même pas de lui. Je vous dis qu’il ne tire jamais. On respecte sa manie comme celle d’un fou. Notez qu’autrefois il était le meilleur chasseur du pays. C’était sa passion ; il dépeuplait tout. Puis, subitement, il n’a plus voulu tirer un seul coup de fusil, et l’on m’a dit qu’il prêchait les gens pour les engager à ne plus manger de viande, afin de ne point tuer les animaux. Il ne vit que de légumes. Enfin, pourquoi fuit-il tout le monde ? On ne lui a rien fait.
– J’avoue que tout est porté à l’excès chez lui, reprit le docteur ; mais Louis de Pontvigail est fort malheureux. Avec une sensibilité très vive, la contrainte continuelle, le joug de fer que son père fait peser sur lui…
– Il a encore son père ? demanda Cécile.
– Oui, dit M. Darbault, un vieux despote rapace et rusé comme un juif, et encore très vert. Il n’est pas comme son fils, qui a peur des femmes.
– Louis de Pontvigail, dit le docteur en s’adressant à Cécile, n’a pas quarante ans. »
Des exclamations s’élevèrent du côté d’Agathe, qui s’écria qu’un pareil ours devait avoir au moins cinquante ans.
« Attendez, reprit M. Darbault, je vais vous dire ça au juste. C’était en… dix, quinze, oui, il y a quinze ans que j’ai acheté Colombe au vieux Pontvigail, et son fils tirait à la conscription cette année-là, puisque je me rappelle que le vieil avare me dit en geignant : "Il me faut bien vendre mes pouliches pour acheter un homme à ce diable de garçon…" Louis de Pontvigail a donc trente-cinq ans, ni plus, ni moins.
– Je l’avais pris pour un homme plus âgé, dit Cécile.
– Cela tient au peu de soin, je me trompe, au trop de soin qu’il a de lui-même. Il se croit toutes les maladies, se tient voûté, porte un bonnet de soie noire, comme vous avez vu. C’est le malade imaginaire.
– Pas précisément, dit le docteur. M. Louis éprouve bien réellement les souffrances qu’il accuse, tantôt à la poitrine, tantôt au cœur ou à la tête. C’est l’effet d’une irritation nerveuse des plus intenses qui, se portant alternativement sur tel ou te point, affecte tour à tour les symptômes de telle ou telle maladie. Au reste, il ne doit qu’à sa constitution de fer d’être exempt jusqu’ici de lésions sérieuses ; mais si le vieux Pontvigail vit quinze ans encore, je suis persuadé qu’il enterrera son fils.
– Vous croyez ?
– C’est indubitable. Cet état d’exaspération, de tension continuelle, ne peut durer longtemps sans user les ressorts et causer quelque grave atteinte. Je crains même qu’il n’existe un commencement d’hypertrophie du cœur.
– Est-il possible ? dit Cécile, qui, placée près de M. Delfons, l’avait écouté attentivement. Mais c’est affreux cela ! Un père dont l’existence détruit celle de son fils ! Quelle sorte de monstre est donc ce M. de Pontvigail ?
– Eh ! mon Dieu ! ce n’est point un monstre, répondit M. Darbault, mais un homme avare, exigeant, despote, et qui suit son caractère sans trop savoir quel effet cela fait aux autres. Nous agissons tous un peu comme ça.
– Il me semble, observa Lucien, que le fils aurait pu quitter son père, ne pouvant vivre avec lui.
– Mais il ne possède rien. Le vieux Pontvigail était loin de rendre sa femme heureuse ; ça ne l’a pas empêché pourtant de se faire faire par elle un testament qui lui donne tout l’usufruit de ses biens. Le fils, il est vrai, pouvait attaquer ce testament et revendiquer une part ; il ne l’a pas fait, et peut-être a-t-il eu raison. Un procès entre le fils et le père, c’est toujours vilain ; puis le vieux eût été capable de déshériter son fils.
– Mais, reprit Lucien, M. Louis ne peut-il gagner sa vie de quelque manière ?
– Non, dit M. Delfons, il n’a pas fait d’études suivies, et puis, avec les idées qu’il a, c’est difficile. Une fois il a failli s’engager ; mais c’est un homme qui regarde la guerre comme l’assassinat organisé.