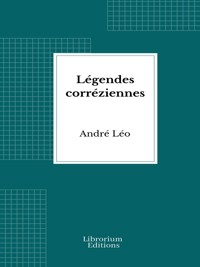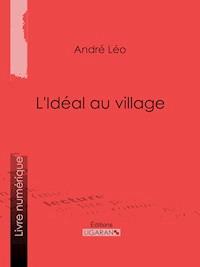Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Sous un ciel gris s'étend une plaine immense. A l'horizon, les objets confus nagent dans un cercle de brume de trois cent trente degrés, brisé seulement vers le sud par un mamelon verdoyant, surmonté d'un clocher."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sous un ciel gris s’étend une plaine immense. À l’horizon, les objets confus nagent dans un cercle de brume de trois cent trente degrés, brisé seulement vers le sud par un mamelon verdoyant, surmonté d’un clocher. Quoique parsemée de massifs et de bois, cette plaine couverte d’une haute chevelure de brandes et de bruyères, de loin, semble inhabitée ; mais en la traversant on découvre çà et là, au détour d’un bouquet d’ormeaux, le toit d’une petite métairie avec son champ rougeâtre et son pré, dont le vert joyeux tranche sur le fond sombre de la lande ; le long du chemin, au bruit de vos pas, des juments, presque enfouies dans l’épaisseur de cette végétation sauvage, relèvent la tête et font cliqueter leurs entraves en sautant lourdement, tandis qu’au-dessus des bruyères, en même temps, surgit une cornette blanche, accompagnée d’une ouille et de deux yeux noirs effarouchés et curieux.
C’est dans une des parties les plus fertiles de la France, en Poitou, que s’étendent ainsi de vastes terrains incultes, pleins d’une beauté poétique toute particulière, mais attristants au point de vue du bien-être des populations.
Une américaine grise et bleue, attelée d’un fin cheval bai, roulait malaisément à travers la plaine. Le chemin était large et gazonné, mais sillonné d’ornières profondes où les roues s’enfonçaient à faire crier l’essieu. En vain le conducteur s’efforçait d’éviter ces ornières, il n’y échappait que pour subir des cabots épouvantables, causés par des touffes de brandes ou par des racines qui bosselaient le chemin.
Ce conducteur était un jeune homme de vingt-huit à trente ans, de belle figure et de mise élégante, à la physionomie empreinte de cette sérénité superbe que possèdent les gens satisfaits d’eux-mêmes et du sort.
Il arrêta un instant pour faire souffler son cheval, qui ruisselait d’impatience plus que de fatigue. Allons, pauvre Gemma ! nous y serons bientôt, dit-il en regardant le mamelon, où de ce point déjà l’on apercevait entre les arbres des maisons et des terrains cultivés.
L’air était doux, quoique vif ; l’herbe, grise de rosée. Une pure lumière sans rayons éclairait le paysage ; on était aux derniers jours de mars.
Assis à côté du maître de Gemma, un homme de cinquante ans, de figure vulgaire et de mine obséquieuse, s’inclinait en souriant chaque fois que le jeune homme parlait. Il répéta complaisamment : oui, pauvre Gemma, nous y serons bientôt ! et il ajouta : quel horrible chemin !
– Ce pays a besoin de tout votre zèle, monsieur Berthoud, observa le jeune homme.
– Aussi le lui consacrerai-je, monsieur l’ingénieur, vous pouvez m’en croire. Avec d’autant plus d’ardeur, ajouta-t-il, que ce sera peut-être travailler… non seulement dans l’intérêt du pays, mais encore dans l’intérêt de M. Fernand Gavel.
– Dans mon intérêt à moi ? Comment cela ?
– Mais c’est que… M. l’ingénieur paraît se plaire assez à visiter Chavagny… Eh ! eh ! eh ! dame, je ne sais pas, moi, mais d’après ce qu’on dit…
– Que dit-on ? demanda Fernand Gavel en fronçant le sourcil.
– On dit que M. l’ingénieur rend hommage à l’une des beautés de ce pays, et…
– Que signifie cette sottise ? Que voulez-vous dire ? s’écria le jeune homme en se tournant vers son compagnon, les yeux étincelants de colère.
– Monsieur ! monsieur ! s’écria Berthoud éperdu, ce n’est pas moi !… On m’avait assuré… Je vous fais, monsieur, un million d’excuses.
– Et moi, monsieur, je vous prie de vous expliquer.
– Volontiers, tout de suite. Quant à moi, je n’y suis pour rien, mais le monde, vous savez, n’a pas le sens commun ; on prétend donc que vous épousez Mlle Bourdon. Certes, c’est un bruit ridicule, et pour ma part…
– Ah ! vraiment ! interrompit M. Gavel, qui, soudainement rasséréné, se prit à sourire. Eh mais, vous n’y pensez pas, monsieur Berthoud, Mlle Bourdon est une personne trop distinguée pour que tout homme ne doive pas être flatté quand on lui fait l’honneur d’une pareille alliance.
– Mais, oui ! s’écria Berthoud abasourdi ; c’est précisément ce que je pensais, et je suis heureux, monsieur… oui, très heureux de…
La voiture s’était remise en marche au petit pas. De distance en distance, près du chemin, on voyait de ces jalons à papier blanc qui désignent le tracé d’une route projetée. L’ingénieur les considérait avec attention.
– Vous avez changé le tracé, demanda-t-il ?
– Oui, certainement, monsieur l’ingénieur, depuis que vous avez témoigné le désir que le chemin passât devant la ferme des Èves. Regardez là-bas, derrière nous, du bois des Berjottes à la ferme, n’est-ce pas un bel alignement ? Grâce à la brande, et, plus haut, grâce aux facilités que nous accorde M. Bourdon, nous avons pu tailler en plein drap.
– C’est très bien, dit M. Gavel, et regardant à sa montre, il poursuivit : Midi et demi ! Nous trouverons le conseil municipal au rendez-vous. Seront-ils d’accord ?
– Je sais, monsieur l’ingénieur, que M. Bourdon a fait l’impossible pour qu’ils entendent raison. Mais il y a toujours le vieux Pernet, dit Bois-sans-soif, qui demande le tracé par la Baguenaudière. Il n’est pas difficile, parbleu, ça longerait toute sa propriété. Mais quoique ce soit le plus court, s’il n’y a que lui…
Nos voyageurs avaient atteint les limites de la brande, sous le mamelon, et le chemin commençait à s’élever. Il était bordé de chaque côté de fossés pleins d’une eau jaunâtre, avec de hauts talus plantés d’ajoncs, où quelques fleurs d’or, échappées à l’hiver, brillaient encore. Ici, partout, prés, champs et pâturages attestaient la présence et les soins de l’homme. Des ormeaux et des chênes qui puisent une forte sève dans cette terre noirâtre s’élèvent superbes du milieu des haies, divisant la campagne en grands carrés inégaux. À peine les gelées printanières avaient cessé d’étreindre le sol, que déjà la verdure avait tout envahi. Déjà les pâquerettes épanouies blanchissaient les prés, et l’épine blanche, ou prunier sauvage, étalait sa neige sur ses rameaux bruns. Déjà les blés d’hiver couvraient à demi les sillons, tandis que dans les guérets, nus encore, le laboureur, courbé sur la charrue, excitait ses bœufs à voix haute, en les appelant par leurs noms.
À mesure que les deux voyageurs gravissaient la colline, des sons épars pleins d’harmonie arrivaient jusqu’à eux. Bientôt le chant complet s’accusa. Il avait quelque chose de sauvage, mais non d’étrange ; les notes fraîches et perlées ruisselaient dans l’air comme une rosée d’avril, et tout dans le rythme, dans l’accent, dans la mélodie, avait des analogies si profondes avec le caractère doux, large et simple de la nature champêtre, qu’en l’écoutant un poète eût demandé sans doute si le génie de ces campagnes avait pris une âme et une voix.
Un vague sourire aux lèvres, l’ingénieur écoutait.
– C’est la petite Lisa Mourillon, dit Berthoud.
– Elle, ou sa sœur, objecta M. Gavel d’un air indifférent.
– Oh ! Marie ne chante pas aussi bien, et n’est pas non plus aussi jolie. Quel admirable brin de fille, hein ! que cette Lisa ! L’automne dernier, vous rappelez-vous, monsieur l’ingénieur, comme on était bien là-bas sous les grands chênes, quand elle apportait la collation ? Ma foi ! vous mangiez avec autant d’appétit que nous le pain noir, les fruits et le fromage frais. Et cette belle haie creuse que vous appeliez votre cabinet, où la petite Lisa vous avait fait un fauteuil de mousse ! Vous n’en sortiez guère que pour venir de temps en temps diriger nos travaux. Avez-vous gardé ce joli portrait que vous fîtes de la bergère et de ses moutons ?
– Je ne crois pas, monsieur, répondit un peu sèchement l’ingénieur.
On entendait maintenant les paroles de la chanson.
Au bruit des roues sur les pierres du chemin, une chienne grise, pelée, aux mamelles pendantes, accourut du pâturage et s’arrêta sur le talus du fossé, les jambes tendues, la gueule en avant et poussant des aboiements furieux. Deux mâtins de quelques mois, l’un roux et l’autre gris, ronds comme des boules qui eussent eu des pattes, arrivèrent après et se mirent à aboyer de même sur un ton plus aigu. La chanson avait cessé. Tant Belle ! ici ! Oh ! ici ! Montagnard ! Grisou ! et bientôt, à son tour, apparut sur le talus, toute rougissante et souriante, une fille d’une beauté si remarquable qu’un artiste l’eût admirée ; d’un éclat si pur et d’une grâce si naïve, que le regard, charmé d’abord, en devenait attendri. À son aspect une flamme brilla dans les yeux de Gavel, tandis qu’un sourire de faune animait les traits de Berthoud.
Cette fille n’était qu’une paysanne. Elle pouvait avoir seize ans. Sa taille mignonne gardait encore quelque chose des attitudes de l’enfance, tout en accusant les formes de la puberté. Vêtue comme les femmes de cette partie du Poitou, sa jupe de bure bleue, très courte, découvrait une jambe chaussée de laine bleue, dont le pied se cachait dans un petit sabot. Un fichu à bouquets bleus et roses se croisait sur sa poitrine en plis symétriques jusqu’au-dessous de la gorge, où le coupait subitement un grand tablier de coton, aussi long que la jupe et presque aussi large. La coiffure est bizarre : c’est un moule évasé de huit à dix pouces de haut qui se termine en deux pointes mousses, couvert de mousseline et garni tout autour du visage d’un double rang de dentelle à gros plis. Rien cependant n’adoucit mieux que cette nuageuse auréole un visage hâlé par le soleil. Mais le visage de Lisa n’avait besoin d’aucune parure : pur ovale aux chairs pleines et fermes, couronné d’abondants cheveux, front large, yeux bleus aux noires prunelles, admirablement fendus, bouche aux lèvres vives et bien découpées, s’ouvrant sur de belles petites dents, que l’eau des fontaines et le pain bis n’avaient point altérées. Sa peau, que la jeunesse et le soleil ensemble faisaient toute rose aux bras et au visage, offrait des teintes de neige sous l’ombre de son fichu. Quant à la pose et à la physionomie de cette jolie créature, elles étaient d’une naïveté intraduisible. Elle semblait aussi peu recueillie dans son individualité qu’une fleur ébahie sous un ciel de printemps, et toutes ses facultés nouvellement écloses s’absorbaient dans la contemplation. Peut-être en était-il ainsi à ce moment surtout. Immobile avec sa cape grise sur les épaules, sa quenouille au côté, ses chiens à ses pieds, elle tenait les yeux fixement attachés sur le bel ingénieur, tandis que Grisou jouait par terre avec le fuseau déroulé.
Un léger mouvement des rênes avait arrêté le docile Gemma.
– Bonjour, Lisa, dit Gavel.
– Bonjour, Lisa, répéta Berthoud.
– Bonjour, monsieur Fernand, dit-elle d’une voix douce et vibrante.
Et, bien que la voiture s’éloignât, elle demeura fixée à cette place, regardant toujours.
– Ces paysans sont d’une familiarité… observa Berthoud.
– Pourquoi ? demanda Gavel. Ah ! parce qu’elle m’a nommé par mon nom de baptême ? C’est l’usage à la campagne. Et puis cette petite me connaît depuis longtemps. Ne savez-vous pas que l’automne dernier, en horreur de l’auberge de Chavagny, j’avais accoutumé de faire halte à la ferme des Èves ? Puis je l’ai retrouvée cet hiver chez M. Bourdon, où elle remplaçait une femme de chambre malade.
– Oh ! dit Berthoud, maintenant M. l’ingénieur n’a plus à s’inquiéter d’une auberge, et je pense bien que ce n’est pas pour le chemin de grande communication que M. l’ingénieur a fait de longues et fréquentes visites à Chavagny cet hiver.
M. Gavel sourit sans répondre, tandis que Berthoud riait à gorge déployée de sa plaisanterie. Un moment après il reprit : Mais cette Lisa devait faire une petite femme de chambre délicieuse, en vérité ? Pas trop gauche, hein ?
– Non, pas trop, il me semble, répondit Gavel. Au reste, j’y ai prêté peu d’attention. Je vous parlais de cette circonstance, monsieur Berthoud, pour vous faire comprendre qu’ayant pris l’habitude de me voir, elle m’appelle M. Fernand, de même qu’elle dit des enfants de M. Bourdon, M. Émile ou Mlle Aurélie.
– Sans doute, monsieur ! mais sans doute ! dit Berthoud. (Il sourit niaisement.) – Oh ! je me serais bien gardé d’y entendre malice, au moins !
– Allons donc ! fit l’ingénieur en haussant les épaules.
Il toucha du bout de sa cravache Gemma qui bondit, et la voiture gravit rapidement le chemin. Quelques minutes après, Berthoud s’écriait :
– Ah ! nous arrivons les derniers. Je crois apercevoir tous ces messieurs là-bas sous les arbres.
La ferme des Èves, qu’on appelait aussi la ferme à M. Bourdon, était située sur un plateau secondaire au-dessous du village. Nos voyageurs apercevaient ses toits en tuiles rouges à travers les grands châtaigniers de son chaume au fin gazon. – Les chaumes sont de grands espaces ombragés qui se trouvent au-devant des fermes et qui servent de pâturages aux brebis les jours de pluie. À gauche de cette chaume, le terrain se creusant en une coupe immense contient une mare bordée de roseaux, nommée la Grande Ève. À droite, sont des prairies entourées d’ormeaux.
Il y avait en effet sur le chaume un groupe d’hommes qui parlaient avec animation, et qui, se retournant au bruit de la voiture, s’écrièrent : Les voici ! Voici M. l’ingénieur et M. l’agent voyer.
L’un de ces hommes alors accourut vers la voiture, monta sur le marchepied, et secoua la main de l’ingénieur, en disant familièrement : Bonjour, mon cher Gavel.
– Bonjour, monsieur, comment se portent Mme et Mlle Bourdon ?
– Fort bien !… on vous attend, répondit M. Bourdon avec un sourire d’intelligence.
– Et M. Grimaud a bien voulu nous apporter ses conseils ? dit Gavel en saluant un petit vieillard grimaçant et ridé, vêtu d’un habit vert, d’un gilet jaune et d’une perruque rousse, et que M. Bourdon appelait mon oncle.
Les autres s’approchaient d’un pas lent et grave. C’étaient des paysans. Arrivés près de l’ingénieur, ils soulevèrent tous en même temps leurs chapeaux de feutre noir à larges bords et à calotte ronde.
– Eh bien ! messieurs, dit Gavel en distribuant à chacun une poignée de main dont chacun parut flatté, nous allons donc étudier à fond et définitivement ce fameux tracé ! Vous plaît-il que nous allions tout de suite sur les lieux.
– Non pas, mon cher Gavel, non pas ! nous dînerons auparavant, s’écria M. Bourdon, qui tenait peut-être à mettre les opinions municipales sous l’influence d’un bon repas. La mère Mourillon est dans tout le feu de la cuisine et il faut manger le rôti cuit à point.
On se dirigea donc vers la ferme.
C’était une maison sans étage, sombre et petite, à côté d’une vaste grange et de belles écuries. Dans la cour, à l’angle le plus apparent, un énorme tas de fumier, où grattaient des poules, s’égouttait jusque dans le chemin en flaques d’un noir bleuâtre, nauséabondes. Au moment où M. Bourdon et ses hôtes pénétraient dans cette cour, un troupeau de dindons salua leur entrée de cris rauques et répétés, qui interrompirent forcément toute conversation, en même temps que de blanches oies, toujours malveillantes pour l’étranger, venaient, les ailes déployées et le cou tendu, siffler à leurs talons. Un petit garçon, qui sortait d’une étable, rentra bien vite en les apercevant ; au seuil de la maison, deux petites filles les regardaient venir d’un air hébété.
– Le dîner est-il prêt, Suzon ? demanda M. Bourdon à l’aînée, âgée de sept à huit ans.
Elle ne répondit point, et tout à coup se mit à rire en se cachant le visage dans son tablier.
L’autre, plus petite, avait envie de pleurer. On l’eût dite fascinée par l’aspect des étrangers, car ses yeux effarés, obstinément attachés sur eux, s’emplissaient de larmes.
La mère accourut, un marmot dans ses bras.
– Entrez donc, messieurs, v’là le dîner prêt. Faut excuser les petites : elles vous connaissent ben, monsieur Bourdon, mais elles n’ont jamais vu tant de monde d’un coup.
Passant devant eux, elle les introduisit dans la chambre où, débarrassant l’une après l’autre chacune des quatre chaises qu’elle possédait, elle les jeta d’un bras vigoureux aux jambes des messieurs. Quant aux paysans, ils se placèrent sur les bancs qui, de chaque côté, flanquaient la table. Le marmot, cramponné des deux mains au fichu de sa mère, grondait sourdement.
Cette chambre, éclairée par une fenêtre de trois pieds carrés, divisée en petits carreaux, recevait aussi du jour par la porte constamment ouverte. Le plancher de terre battue, creux par endroits, à d’autres était percé de pierres. Côte à côte on voyait deux lits à colonnes, garnis de serge verte bordée de jaune ; un vieux bahut, la longue table de chêne bruni avec ses bancs parallèles, un beau buffet luisant de cerisier ciré, surmonté d’une étagère où des assiettes inclinées étalaient orgueilleusement leurs feuillages bleus, jaunes et rouges autour d’un coq superbe peint dans le milieu : tout cela composait un ameublement qui pouvait rivaliser de luxe avec les bonnes maisons du pays, excepté celle de M. le maire. Il ne faudrait pas oublier une demi-douzaine d’images enluminées, collées aux murailles, et qui représentaient des batailles de l’Empire et l’histoire de Geneviève de Brabant. C’est tout ce qu’il y avait de tradition humaine dans cette obscure demeure.
Devant un feu splendide rôtissait un énorme dindon, et des tourtières et des réchauds encombraient le foyer.
– Où sont Marie et Madelon ? cria la ménagère d’une voix retentissante comme un instrument de cuivre fêlé… Ah ! Madelon est au four ; mais qu’est-ce qu’elle peut faire, Marie, pour n’être pas là ?
– Elle est à faire sa toilette, dit Suzon qui avait retrouvé sa langue.
– Va lui dire qu’elle se dépêche. On a ben besoin de sa toilette, vraiment !
Et la Mourillon, posant son marmot dans un coin, déployait la nappe quand Marie, l’aînée de ses filles, entra. Beaucoup moins belle que Lisa, elle était cependant agréable et gentille. Dépouillant aussitôt l’étagère de ses assiettes fleuries, elle mit le couvert en un tour de main, tout en répondant aux agaceries de M. Bourdon, qui semblait s’occuper volontiers des belles filles.
– Où donc est Mourillon ? demanda-t-il.
– À panser les bœufs, sauf vot’respect, not’Mossieur. Nos hommes ont labouré depuis l’éclaircie (le point du jour). Faut pas s’émouvoir d’eux. Et v’là le dindon.
En même temps, la Mourillon posait sur la table le rôti fumant, flanqué d’un canard en sauce et de deux poulets. Les paysans, qui s’étaient assis le dos tourné à la table, passèrent leurs jambes de l’autre côté du banc, et chacun tira lentement un couteau de sa poche, en regardant de côté les volailles odorantes. M. Bourdon se mit à découper ; la Mourillon poussa les enfants dehors et sortit elle-même. On entendit alors dans la cour sa voix glapissante gourmander les enfants, les poules et la servante Madelon.
– Père Pernet, goûtez-moi ça ! dit l’amphitryon en versant à Bois-sans-soif un verre de vieux vin de Bordeaux.
Bois-sans-soif regarda, d’un air de connaisseur, à travers son verre, fit une grimace d’approbation, et toucha légèrement le bord de son chapeau, en disant :
– À vot’santé, monsieur et la compagnie ! puis il goûta lentement ; et, posant le coude sur la table, après avoir d’un air grave regardé tous les convives, il demanda d’un air finaud :
– Ça vient comme ça dans vot’métairie des Èves, monsieur Bourdon ?
– Précisément, mon vieux ; et toutes les fois que vous viendrez me voir, nous en boirons.
– Si c’est comme ça donc, reprit Pernet du même air, vous n’y pensez pas, monsieur Bourdon, de vouloir faire passer un chemin tout au travers de vot’vigne.
– Eh ! eh ! eh ! firent les paysans en riant.
– Taisez-vous, farceur ! Et si je veux faire ce sacrifice à l’avantage de la commune !
– C’est beau de vot’part, mossieur Bourdon. Tant seulement faut-il savoir si de vrai la commune en tirera profit.
– C’est incontestable ; mais on persiste à croire que je suis intéressé dans la question ! Voyons, monsieur le maire, expliquez donc les choses à cet entêté.
– Du temps de mon grand-père, dit avec importance celui des paysans dont la dignité venait d’être ainsi révélée, on disait comme ça que le plus court chemin était le meilleur. À moins que ça n’ait changé au jour d’aujourd’hui…
– Sacrédié ! ça n’est pas le plus court !
– Non, pas pour chez vous, père Pernet ; mais de Chavagny à Poitiers, passant par le chef-lieu du canton, c’est le chemin des oiseaux, quoi !
– C’est le chemin de vos brandes ! cria Pernet.
– Dame ! tous les chemins ne sauraient passer par chez vous.
– Tous les chemins ! reprit Pernet. Quel chemin donc m’a-t-on fait, à moi ? Et pourtant, da ! suis-je pas conseiller municipal comme M. Bourdon ?
– Pernet, mon cher Pernet ! s’écria M. Bourdon d’un ton pénétré, vous sied-il à vous, homme honorable, de répéter les sottises des braillards de Chavagny ? Mais je ne tiens à ce tracé, moi, que parce qu’il est tout à l’avantage de la commune, car il me cause au contraire un tort réel. Ne voyez-vous donc pas qu’il rogne et morcelle mes plus beaux champs, le pâtural aux Biches, le pré des Alizes, les Ebles, les meilleures terres du pays ?
– Pour ça, f… ! c’est dommage, tout sûr, s’écria un des paysans en frappant du poing sur la table. Tous vos chemins, ça n’est bon qu’à ruiner la terre, et si je vote pour celui-ci, moi, d’abord, c’est qu’il se paraît bien qu’on le ferait tout de même. Nous n’avons pas le préfet dans not’manche, nous autres, avec le conseil général. Après encore, si je vote pour ce chemin-là, c’est qu’il ne passe pas sur ma terre. Car, voyez-vous, si l’on voulait m’en rogner tant seulement un lopin, quand même ça ne serait que mes brandes, allez ! allez ! ferait beau voir… J’actionnerais plutôt le préfet, quoi ! Oui, messieurs, ça n’est ma foi guère avisé pour des savants de faire pousser comme ça la pierre en place de blé.
– Vous préférez éreinter vos bœufs et vos charrettes dans de mauvais chemins, dit l’ingénieur.
– Faut-il pas les éreinter pour vos prestations ? On avait aboli la corvée, et v’là qu’on la remet à présent ?
– Mais vous êtes fou, s’écria Berthoud, la prestation n’est pas la corvée. La preuve, c’est que ça ne s’appelle pas du même nom.
– Vous n’avez pas le sens commun, père Voison, dit en grimaçant M. Grimaud.
– Possible, monsieur, possible ! répondit le paysan en portant la main au bord de son chapeau. Mais, quoique ça, faudra voir…
Deux ou trois conseillers municipaux qui ne disaient rien, échangeaient des regards d’intelligence en branlant la tête de haut en bas, et l’un d’eux, se penchant à l’oreille des autres, murmura : Voison n’a pas si grand tort, allez !…
Sur le feu flambant de la cheminée pendait maintenant, accrochée à la crémaillère, une chaudière énorme, où bouillait un affreux mélange d’herbes, de pommes de terre et de fruits gâtés. C’était le dîner des pourceaux de la ferme qu’avait retardé le dîner du conseil municipal. La Mourillon venait de rentrer. Assise auprès du feu, son enfant sur les genoux, elle surveillait cette préparation nouvelle, quand une douce voix lui fit tourner la tête.
– Bonjour, messieurs, disait-on.
C’était Lisa.
– Que viens-tu faire ici, toi ? demanda la Mourillon, qui se dressa comme un ressort en couvrant sa fille d’un regard étincelant.
– C’est que, balbutia l’enfant interdite, j’ai cru comme ça qu’on aurait besoin de moi pour servir à table, et comme ça devenait tout noir par là-bas, j’ai ramené mes ouailles sur le chaume.
– Vilaine menteuse ! s’écria la mère, n’y a pas un nuage au ciel. Retourne aux champs tout d’suite, et dare dare ! On n’a pas besoin de toi par ici.
M. Gavel se pencha vers la fenêtre :
– Mais, dit-il, ne semble-t-il pas en effet que le temps menace ? Nous pourrions avoir de la pluie ?
– Pas le moins du monde, répondit à demi-voix et en souriant M. Bourdon. Cependant il se tourna vers la Mourillon : Ne grondez donc pas comme ça cette petite, voyez-vous, c’est notre chambrière de l’hiver passé. Elle a voulu nous témoigner son zèle et son adresse une fois de plus. Allons, petite femme de chambre des moutons, viens me donner une assiette.
– Je vais vous en donner une, moi, monsieur, fit la Mourillon en arrachant l’assiette des mains de sa fille. Revenir des champs comme ça, en plein jour ! Faut que cette petite ait le diable au corps !
– Madame Mourillon, voulez-vous aussi me donner une assiette, dit l’ingénieur ? Et comme elle se penchait vers lui : Vous avez tort de tant gronder Lisa. On a besoin d’elle, en effet, car tout à l’heure, Marie étant absente, M. Bourdon a dû se lever…
La Mourillon jeta sur M. Gavel un regard dur et perçant et ne lui répondit pas. Cette femme, qui avait quarante ans à peine, était déjà vieille. Une peau jaunie se collait sur ses os, au point qu’endormie elle devait ressembler à un cadavre. Mais au fond de l’orbite desséché, son œil noir brillait d’une ardeur fébrile, et toute sa vie semblait concentrée dans ses yeux. Pendant vingt années d’un travail opiniâtre, sept enfants robustes avaient tari sa sève, et le dernier pendait encore à sa mamelle épuisée. Elle reporta ses regards courroucés sur Lisa, que M. Bourdon avait attirée près de lui, et, bien que par déférence pour le maître elle hésitât un peu, de nouveau elle élevait la voix pour la renvoyer, quand Mourillon entra, suivi de trois grands garçons, dont l’un était son fils aîné, les deux autres ses domestiques. La Mourillon se tut aussitôt et alla s’asseoir en silence près de la cheminée, et Lisa, regardant craintivement son père, s’empressa de paraître occupée, quoiqu’en réalité son occupation se bornât à regarder et à servir le jeune ingénieur.
– Bonjour not’maît et la compagnie.
Ainsi salua Mourillon en ôtant son bonnet de coton blanc, qu’il remit aussitôt sur sa tête, de même que tous les autres paysans avaient conservé leurs chapeaux, tant ces têtes carrées se ferment soigneusement aux impressions extérieures. Puis Mourillon avec ses trois acolytes s’assit au bout de la table, et, après qu’il eût coupé au pain noir une large tranche, tandis que M. Bourdon leur passait les restes du festin :
– Vous allez donc nous faire un beau chemin, Messieurs ? dit-il.
C’était rentrer en matière à la satisfaction de Pernet, qui s’écria :
– Ben sûr qu’on vous le fera, puisque c’est pour vous qu’il se fait ! Serez-vous content, hein ! père Mourillon, d’en faire là des corvées ?…
– Oui, ben, répondit le fermier, pour après mener rondement au marché nos blés et nos foins.
– Ça fait vot’compte, à vous, d’éreinter vos bœufs d’abord pour les ménager après, dit Voison. Joli calcul, ma foi !
– Parions que le père Voison a trouvé moyen de récolter sans faire la semaille, interrompit à demi-voix un des domestiques, beau garçon à la mine intelligente. Il adressait cette phrase à Cadet Mourillon en se penchant vers lui ; mais il fut entendu de M. Bourdon.
– Très bien ! mon garçon, s’écria celui-ci. Voison, ce jeune gars entend les choses mille fois mieux que vous. Ne rougis pas pour cela, mon brave. Il me semble que je connais ta figure ; comment t’appelles-tu ?
– C’est Pierre Michel, monsieur, le fils de la mère Françoise, dit Mourillon. Je l’ai engagé pour les semailles du printemps, parce qu’à nous trois, Cadet, Jean et moi, qui pourtant ne chômons point, nous avions encore trop d’ouvrage.
– Ah ! je le reconnais fort bien à présent, reprit M. Bourdon. Mais tu as quitté le pays quelque temps, Michel, si je ne me trompe ?
– Oui, Monsieur, j’ai resté près de trois ans en place à Château-Bernier.
– Chez le sorcier, dit Voison en riant.
– Tu en es donc sorti avant la Saint-Jean, demanda M. Bourdon.
– Je m’ennuyais du pays, répondit Michel d’un ton bref.
– C’est pas pour ça, reprit encore Voison, et tout le monde se mit à rire ; c’est parce que la fille au sorcier…
– Dites donc, père Voison, interrompit Michel d’une voix calme quoique haute, – mais on voyait son front rougir de colère, – m’est avis que vous causez trop et que vous allez encore donner c’te peine à M. Bourdon de vous remontrer que vous dites des bêtises.
– Eh bien ! eh bien ! de quoi s’agit-il ? demanda M. Bourdon.
– Faut pas l’asticoter, voyez-vous, messieurs, dit Mourillon, il prend tout d’suite la mouche. Mais tout d’même, quoique vif, c’est un bon gars, not’maît’. Voyons, Michel, un peu de patience.
– Voici deux heures et demie, vous plaît-il que nous allions examiner le tracé ? dit en se levant l’ingénieur, peu curieux des secrets de Michel, et qui depuis le commencement du dîner restait silencieux et indifférent, comme un homme ennuyé de la compagnie dans laquelle il se trouve.
– Encore un verre, dit l’amphitryon en débouchant une bouteille de Sillery.
Le vin pétillant, versé à la ronde, réunit toutes les opinions en une approbation unanime ; et comme toute pente, soit bonne, soit mauvaise, entraîne facilement les hommes, cette satisfaction commune produisit des sourires bienveillants et de joyeux propos ; on rit de l’esprit que chacun s’ingéniait d’avoir ; on se fit des compliments ; des poignées de main s’échangèrent, et quand après une seconde rasade on sortit de la ferme, les cœurs ouverts aux émotions les plus douces ne demandaient qu’à s’épancher par de mutuelles concessions.
Le soir même vers quatre heures, sous un beau rayon de soleil, la voiture de l’ingénieur où il se trouvait avec M. Bourdon montait le chemin raboteux qui va de la ferme des Èves à Chavagny. Les deux hommes causaient en riant. Sans doute M. Bourdon avait triomphé des répugnances municipales, et peut-être s’égayaient-ils en ce moment au souvenir de quelque épisode de la discussion.
Le long du chemin, tantôt à gauche et tantôt à droite, se voyaient de petites maisons entre pré, jardin et champ, riants enclos ceints de haies vives, où bourgeonnaient en hâte cerisiers, poiriers et noisetiers, tandis qu’auprès d’eux, malgré les caresses de l’air et du soleil, les grands noyers et les grands ormes restaient immobiles et sombres. Dans les jardins, le paysan, courbé, creusait de sa bêche le sol fumant.
– Je ne me trompe pas, dit Gavel en étendant le bras à droite ; voyez là-bas au milieu des prés : ne sont-ce pas Mme et Mlle Bourdon, avec une troisième personne ?
– Oui, vraiment, répondit M. Bourdon après examen, ce sont elles. La beauté de la soirée les aura engagées à sortir, et j’en suis bien aise, car elles vivent à la campagne un peu trop comme à la ville, craignant toujours le froid ou le chaud, le grand air ou le soleil. Il faudra vous joindre à moi, Gavel, pour activer ces paresseuses. Eh ! mais nous pouvons les rejoindre, elles viennent de ce côté.
– Quelle est donc cette jeune personne qui vient de les quitter et qui semble, elle, si peu frileuse, car elle est sans châle et sans chapeau ?
– Oh ! celle-là, c’est une vraie campagnarde, une bonne et jolie fille, Lucie Bertin, ma nièce à la mode de Bretagne. On vous a parlé de cette famille.
– Oui, et j’ai fait connaissance avec M. Gustave Bertin chez M. Émile, à Poitiers. Mais, comme elle court, votre nièce ! ne semble-t-elle pas une biche à travers prés ? Bon ! la voilà qui passe au travers d’une haie, et qui saute un fossé, ma foi !
– Elle retourne chez elle, à cette maison que vous voyez là-bas en dehors du village. Sans doute elle vient de reconduire ma femme et ma fille qui sortent de chez elle, et qui n’auront pas voulu revenir par Chavagny. Avançons un peu jusqu’à la barrière du pré ; c’est là que madame Bourdon et Aurélie viendront certainement aboutir, car plutôt que de sauter un fossé comme Lucie, elles feraient bien une demi-lieue.
Ils avancèrent au petit pas, et quelques minutes après, effectivement, débouchèrent en face d’eux, par la barrière d’un enclos, deux femmes enveloppées jusqu’aux yeux, malgré la douceur de l’air, de châles et de chapeaux, et les pieds protégés par d’élégants sabots contre l’humidité du sol. Grâce à la fraîcheur de son teint, à l’éclat de ses yeux noirs, à la souplesse de ses mouvements, Mme Bourdon semblait jeune encore, malgré l’énorme embonpoint qui la faisait aussi large que haute, car elle était de petite taille. Sa fille, mince et de taille moyenne, avait, au contraire, malgré sa jeunesse, une roideur naturelle et une réserve étudiée. Elle rougit en apercevant M. Gavel, qu’elle salua cérémonieusement. Celui-ci mit pied à terre et salua ces dames avec une respectueuse familiarité. Il y eut quelque chose de maternel dans l’accueil de Mme Bourdon. Aurélie laissa tomber quelques paroles du bout des lèvres, en baissant les yeux.
– Vous allez monter avec nous, dit M. Bourdon.
– Y penses-tu, répondit sa femme, traverser ainsi Chavagny ! nous allons prendre à gauche par les prés.
– Non ! non ! vous en auriez pour une demi-heure, tandis que nous serons tous ensemble à la maison dans dix minutes. Faut-il se préoccuper d’étiquette à Chavagny ?
– Si tu veux !… dit Mme Bourdon.
– Oh ! maman ! fit Aurélie.
– Il n’y a pas en vérité de quoi vous compromettre, dit M. Gavel en riant ; mais si cela était, ne me feriez-vous pas la grâce de vous compromettre un peu pour moi ?
– Non, certainement ! répondit-elle en se drapant chastement dans son châle.
– Allons, dit M. Bourdon, qui tendit la main à sa femme.
Celle-ci monta, et sa fille la suivit ; mais en s’enveloppant, pour ainsi dire, du voile de toutes ses réserves, et ce fut d’un air sérieux, même un peu gourmé, qu’elle s’appuya sur la main de M. Gavel, tendre et souriant.
Chavagny est un bourg de cent feux environ, situé sur une colline autour de laquelle se plie et se replie la rivière du Clain, verte et profonde. Cette colline qu’enveloppe un air vif, pur et transparent, est couverte d’une végétation vigoureuse, et, quoique le village soit bâti tout au sommet, de loin, pendant l’été, le coq seul du clocher apparaît au-dessus des arbres.
Du haut de ce clocher on découvre un horizon immense. À l’est et au midi, c’est un vaste paysage plein de couleur et de vie : fermes, villages, bois, terrains cultivés, de plus en plus confus et vaporeux, jusqu’à des sortes de nuages immobiles et bleuâtres qui sont les montagnes du Limousin. Du côté du nord, c’est la lande immense et morne, entrecoupée çà et là d’une maison blanche et d’un bouquet d’ormeaux, et qui se fond au loin en teintes grises. Dans cette brume, aux confins de l’horizon, la vue perçante des habitants de Chavagny distingue nettement, assure-t-on, les contours vagues et les flèches des édifices de Poitiers.
Un rez-de-chaussée composé de deux ou trois chambres au plancher de terre battue, éclairées chacune d’une lucarne vitrée dont la hauteur varie d’un à deux pieds ; derrière, un jardinet planté de choux, un fumier à l’entrée, tel est le plan général sur lequel sont établies presque toutes les maisons de Chavagny.
Mais on en compte bien une dizaine appartenant aux riches du pays, qui possèdent un étage avec des fenêtres de cinq pieds, tandis que le sol est garni de dalles ou de larges planches de chêne. On voit des rideaux de coton rouge aux fenêtres de M. le maire, sur la grand-place, et la maison à côté, qui est celle de Mlle Boc, a des contrevents verts et des rideaux blancs. L’auberge est en face, avec son bouchon de houx, et l’on aperçoit derrière l’auberge le clocher de l’église, au-dessous de laquelle est le presbytère. Mais quant à la mairie, on n’en saurait parler, car plus d’un étranger, en passant à côté, l’a prise pour une étable.
C’est au bout d’une avenue de marronniers, à peu de distance du village, que se trouve la maison des Bourdon, appelée le Logis, belle et spacieuse demeure, bâtie en 1770 par l’aïeul des Bourdon, celui dont on parle, qui fut membre de la Constituante et qui périt sur l’échafaud en 93. Il avait cinq enfants : de ses trois fils, un seul échappa aux guerres de l’Empire et devint juge à Poitiers ; quant à ses deux filles, Mmes Grimaud et Bertin, la première était morte sans enfants, l’autre s’était mariée avec un notaire des environs, qui, après avoir dissipé sa fortune en spéculations maladroites, avait vendu son étude et était venu se fixer à Chavagny, dans une petite propriété attenante au village, dot de Mme Bertin, et qui maintenant composait leur seul avoir. Fortuné Bertin, leur fils unique, s’y éleva joyeusement au milieu des petits paysans de Chavagny. Il n’eut d’autres leçons que celles du maître d’école ; mais ses parents y joignirent l’histoire détaillée des faits et gestes de son grand-père et s’attachèrent à lui imprimer l’idée de la dignité de son rang. Son éducation littéraire ne fut pas complètement négligée ; il lut Ducray-Duménil, Delille et Pigault-Lebrun. À vingt ans, par la mort de ses parents, Fortuné Bertin se trouva possesseur d’une vieille maison, d’un petit jardin et de six arpents de terre. Il n’avait jamais manié la bêche ni la charrue ; un Bertin ne le pouvait. Il se fut donc royalement ennuyé si, au goût de la pêche, son amusement favori, ne s’était joint un goût plus vif pour la fille du médecin du village. Ce médecin était un chirurgien retraité, pourvu d’une petite pension viagère, et qui se consolait des malheurs de l’Empire en buvant sec et en jouant à l’écarté. Sa fille, toujours seule, se désennuyait en lisant des romans, car elle avait perdu sa mère de bonne heure, et elle savait à peine raccommoder ses bas. Ils se marièrent et eurent trois enfants : Clarisse, Gustave et Lucie. À l’époque où nous nous trouvons, en 1845, Gustave, âgé de vingt-quatre ans, est employé dans les bureaux de la préfecture à Poitiers, par le crédit de son oncle M. Bourdon.
Celui-ci était le fils du juge. Il avait fait d’heureux débuts comme avocat en 1825, et le zèle éclatant qu’il témoigna tout d’abord pour le gouvernement de la restauration l’aurait fait sans doute parvenir à de hautes dignités si 1830 n’eût changé la dynastie. Déconcerté par cet échec, Antonin Bourdon s’était retiré dans son domaine de Chavagny où, faute de mieux, il se livrait à l’agriculture. Actif, habile, intelligent, il propagea les nouvelles méthodes, acheta des machines, construisit des fours et des moulins, doubla l’étendue de ses terres et en quintupla le produit, si bien qu’il devint l’oracle du département en matière agricole. Au courant de toutes les améliorations et de toutes les découvertes, il était en relation avec les principaux agriculteurs de France, de Belgique et d’Angleterre. Il reçut une médaille du gouvernement, et bientôt recommença de tripoter dans les affaires politiques et départementales, en laissant discrètement de côté ce qu’il avait adoré autrefois. Au milieu de tant de soins il suffisait à tout, et réussissait dans tout. À vingt lieues à la ronde et plus, ses fruits étaient les plus savoureux, ses roses les plus belles, ses champs les plus riches.
M. Bourdon était un homme de petite taille, aux traits vulgaires, au teint rougeaud, et qui au premier abord ne pouvait plaire. Mais ses yeux pétillaient de tant d’esprit, et cet esprit était si vif, si aimable, si caressant pour ses amis, si mordant et si redoutable pour ses ennemis, qu’il fallait bien lui reconnaître une supériorité véritable. Extrêmement vaniteux, profondément absolu, cependant il n’était pas méchant, car il aimait beaucoup à rendre service. On le disait peu fidèle à ses devoirs conjugaux ; il est certain qu’il recherchait la société des femmes, et qu’il était auprès d’elles d’autant plus galant et plus empressé qu’elles étaient plus jolies. Fille d’un président de chambre de Poitiers, Mme Bourdon avait apporté à son mari, outre une belle dot, l’assurance d’un riche héritage. Ainsi que les Bertin, ils avaient trois enfants, Émile, Aurélie et Jules. Peu boudeur de sa nature, surtout contre ses intérêts, M. Bourdon, en cette année 1845, briguait ouvertement pour son fils aîné les faveurs de la maison d’Orléans.
Il était déjà question dans le public, mais vaguement, du mariage de Mlle Aurélie avec l’ingénieur, quand celui-ci passa triomphalement sur la grand-place de Chavagny, conduisant dans sa voiture Mme et Mlle Bourdon.
Ce fut un évènement. Beaucoup de gens se précipitèrent aux portes et beaucoup aux fenêtres. Mais où ce fait causa le plus d’émoi, ce fut dans la petite maison aux rideaux blancs et aux contrevents verts, chez Mlle Boc, fille sexagénaire, qui tenait le bureau de tabac. Au roulement de la voiture, son jaune visage et son bonnet blanc se collèrent incontinent aux vitres de sa fenêtre, mais par malheur elle n’avait pas ses lunettes.
– Francille, viens vite voir qui passe dans cette voiture, cria-t-elle en s’adressant à une petite chambrière de douze ans, occupée à tricoter dans un coin de la chambre.
– M’est avis, dit l’enfant – car la voiture disparaissait déjà – que c’est l’ingénieur avec mam’zelle Aurélie et M. et Mme Bourdon.
– Imbécile que tu es ! Ça n’est pas possible.
– Pardi si, puisque je l’ai vu.
– Prends vite tes sabots et cours au logis. Tu demanderas des œufs et tu parleras à la Mariton. Et fais attention de savoir qui était dans la voiture, sans quoi tu mangeras ton pain sec.
La petite Francille enfonça d’un coup de poing sur ses yeux sa coiffe mal attachée, fixa par une épingle un lambeau flottant de son tablier, prit ses sabots dans sa main, et se mit à courir si vite que sa tête était d’une seconde en avance sur ses talons.
Pendant ce temps, Mlle Boc ayant repris son tricot, murmurait entre ses dents : À moins que le mariage ne soit arrêté ? Moi, j’ai toujours dit qu’il se ferait ; je le soutenais hier encore à M. le curé. Vraiment, je suis bien curieuse de savoir… Est-ce qu’elle ne va pas revenir bientôt, cette petite ? Oh ! non. Elle restera là-bas à regarder et à causer jusqu’à demain, pendant que je suis là, moi, sur des charbons ardents… Cette enfant n’est qu’une ingrate et un mauvais cœur. Oh ! la triste espèce !… Rien ne peut corriger cette créature-là, non, rien ! Aussi faudra-t-il que je la chasse une dernière fois, et qu’elle aille mourir de faim chez ses parents. Oui, oui, soyez trop bon, le loup vous mange ; l’ivraie n’a jamais produit de bon grain ; il vaut mieux arracher la mauvaise herbe avant qu’elle soit grande : car je me connais, moi, je suis trop sotte, je m’y attacherais, et cependant elle ne me payerait que d’ingratitude…
Elle s’entretint de la sorte jusqu’au retour de Francille, qui revint légère comme le vent, portant toujours ses sabots à la main. La vieille fille l’accueillit avec de grands cris en lui reprochant d’user ses bas.
– Il y a huit jours qu’ils n’ont plus de semelles, allégua la petite en montrant le dessous de ses pieds.
– Vous êtes un monstre ! vociféra Mlle Boc ; mais, se ravisant aussitôt : Voyons, dis vite, qui est-ce qui était dans la voiture ?
– Pardine ! ceux que j’avais dit ; mam’zelle Aurélie, M. l’ingénieur, M. Bourdon et Mme Bourdon. La Mariton me l’a dit, et puis je les ai encore vus tous ensemble dans la cour.
– Allons ! c’est bien cela. Et que t’a dit la Mariton ?
– Elle vous apportera les œufs ce soir.
La figure de Mlle Boc exprima une grande satisfaction. Il s’agissait d’un rendez-vous entre bavardes, presque aussi doux que rendez-vous d’une autre sorte eussent pu l’être jadis.
– Puisqu’elle a dit ce soir, ça signifie entre sept et huit heures, il n’en est pas cinq, ajouta Mlle Boc en consultant sa pendule, une pendule à longs poids de cuivre sur le cadran de laquelle s’épanouissaient des fleurs et des amours ; j’ai le temps d’aller chez Mmes Bertin, car il y a huit jours que je n’ai vu cette pauvre Clarisse. Tu vas me faire vingt tours à ton bas, toi, pendant ce temps-là. Et si tu as le malheur de sortir d’ici…
Après avoir changé son bonnet blanc à grosse ruche contre un bonnet pareil, mais plus frais, et mis sur ses épaules un petit châle noir qui descendait à peine au bas de sa taille, Mlle Boc partit en tricotant.
Dans les cas ordinaires, Mlle Boc ne traversait pas le village sans s’arrêter devant chaque commère assise à sa fenêtre ou sur le seuil de sa porte ; car, entre gens de voisinage et de bon accord un simple bonjour est bien sec, et l’on ne doit pas marchander ses paroles. Or, la plus simple question, comment vous portez-vous ? entraîne quelquefois des éclaircissements assez longs : chacun, on le sait, a ses misères et ses soucis, et, comme tout se tient en ce monde, on peut facilement passer des siens propres à ceux de son voisin. Puis il y a des gens qui aiment à dire la même chose de cinq ou six manières différentes ; d’autres qui tout bonnement la répètent de temps en temps, comme le refrain après la chanson. Et cela allonge toujours l’entretien. D’autres encore, à propos de rien, vous racontent tout de suite une histoire. Or, depuis cinquante ans que Mlle Boc passait pour une fille d’esprit, il n’y avait pas eu d’exemple qu’elle fût restée court sur quelque sujet, outre qu’elle savait par cœur beaucoup de maximes et de proverbes, et qu’elle avait vu et entendu bien des choses ! Il n’était pas non plus dans ses manières de quitter les honnêtes gens brusquement, sans leur rendre au moins autant de paroles qu’ils lui en avaient données. Cependant elle ne mit pas cinq minutes à traverser la place avec la rue qui est au bout, et ceux qui ce jour-là virent sa longue échine aussitôt après son nez pointu, pensèrent qu’assurément il y avait quelque chose d’extraordinaire.
Arrivée au chemin qui longe le cimetière et à l’autre bout duquel est la demeure des Bertin, elle s’arrêta pourtant une minute devant la mère Françoise qui filait au rouet sur le seuil de sa porte.
– Ça va bien, mère Françoise ?
– Merci, mam’zelle, et vous ?
– Quel beau temps ce soir ! Votre Michel est donc revenu au pays ? On dit comme ça que c’est un garçon bien dégoûté.
– Eh ! eh ! fit la Françoise en riant, faut-il pas laisser parler le monde ?
– Vous me conterez ça.
– Ma foi, mam’zelle, vous me croirez si vous voulez, mais n’en sais pas plus long que les autres.
– Bah ! vous voulez rire.
– Ma foi, ma loi !
– Allons, mère Françoise, nous causerons de ça. Mais le soleil se couche, et il faut que j’aille voir cette pauvre demoiselle Clarisse.
– Est-ce qu’elle serait plus malade ?
– Mon Dieu, non ; pas que je sache.
– Vous ne passez pas par le sentier, mam’zelle ?
– Merci ! il y a trop d’égaille (rosée), et j’irai aussi vite par le chemin.
Le pré de la Françoise, vis-à-vis du cimetière, s’étend jusqu’au jardin de M. Bertin, et l’on va par un sentier d’une maison à l’autre. C’est la mode à la campagne de pratiquer partout des sentiers, même au bord des chemins, car, si ce n’est pas plus court, c’est toujours plus plaisant, ce qui veut dire au village plus agréable. Les clôtures ne servent guère qu’à délimiter les propriétés, et le droit de parcours est imprescriptible. Ce n’est pas qu’il n’y ait des gens difficiles qui prétendent changer la coutume, disant qu’elle favorise la maraude ; mais ça ne leur sert à rien de boucher les passages, car le premier venu a bientôt fait de les déboucher, et s’il se prend çà et là quelque poire ou quelque noisette, on sait bien après tout qu’il faut que le pauvre monde vive, et que les enfants sont les enfants.
Toujours tricotant, Μlle Boc était arrivée au bout du chemin ; elle avait dépassé la maison de Luret le journalier, et souhaitait le bonsoir à la femme du tailleur qui était à sa fenêtre, quand, par-dessus le mur à demi-écroulé du jardin de M. Bertin, elle aperçut une jeune fille qui sarclait. Bon courage ! ma mignonne, cria-t-elle de sa voix fêlée. Mlle Bertin leva la tête, quitta son travail et vint près de la muraille.
C’était une jeune fille d’environ vingt ans, qui n’avait rien de très remarquable au premier coup d’œil. Les paysans disaient que sa figure était trop blanche, parce qu’elle n’avait pas de vives couleurs ; mais cela ne l’empêchait point d’avoir la peau fine et rosée. Ses traits, assez réguliers, avaient de la délicatesse ; son visage était calme et sérieux. De soyeux cheveux bruns couronnaient bien son front large, et les lignes de sa taille paraissaient élégantes, même sous le corsage froncé d’une petite robe d’indienne brune que bordait au cou un fichu de mousseline blanche. C’était là toute sa toilette, avec un tablier de coton semblable à ceux des paysannes.
Elle répondit à Mlle Boc : La pauvre Clarisse est toujours souffrante. Votre visite lui fera plaisir.
– Ne venez-vous pas, ma mignonne ? demanda Mlle Boc.
– Il faut que j’achève de sarcler ces pois, mademoiselle, mais j’aurai fini tout à l’heure.
– Ah ! si vous ne venez pas tout de suite, mademoiselle Lucie, tant pis pour vous ! J’ai une nouvelle à vous apprendre.
La jeune fille sourit et sembla hésiter. Mais à la campagne, une nouvelle n’étant chose à dédaigner pour qui que ce soit, Lucie posa le sarcloir et se dirigea par les allées du jardin vers sa demeure, tandis que de son côté Mlle Boc s’y rendait par l’entrée principale donnant sur le chemin.
Une barrière vermoulue, scellée à des piliers croulants, s’ouvrait sur une cour pleine d’herbe, au fond de laquelle s’élevait la maison. À gauche, une grange et des étables, puis une porte à claire-voie par laquelle on apercevait dans une prairie les silhouettes tourmentées d’arbres fruitiers en plein vent. À droite, au milieu d’un mur dégradé, se trouvait la porte du jardin. Entre les deux fenêtres du rez-de-chaussée, sous un énorme rosier, il y avait un banc rustique ; au-dessus de l’entrée, des sculptures mutilées représentant deux colombes entourées de guirlandes, avec des carquois et des cœurs enflammés. Sur le toit de beaux pigeons roucoulaient, et dans l’herbe de la cour se pavanaient une douzaine de poules.
Aussitôt que la barrière eût grincé sur ses gonds, une épaisse figure encadrée de favoris se colla aux vitres d’une des fenêtres. Lucie, en même temps, venait à la rencontre de Mlle Boc et l’introduisit dans la maison.
On était déjà levé pour la recevoir, et à peine avait-elle franchi la porte, que Mme Bertin, s’emparant de sa main, la conduisait à une chaise préparée pour elle au coin du feu, tandis que M. Bertin la saluait d’un formidable : Bonjour, ma voisine, et que la malade se soulevant sur son fauteuil tournait vers la visiteuse sa figure enfiévrée, animée d’un pâle sourire.
– Voulez-vous bien vous asseoir tout de suite, mademoiselle Clarisse. Pauvre petite ! Et comment êtes-vous ? Attendez que j’arrange cet oreiller. Vous êtes toujours bien portant, vous, monsieur Bertin, car on vous achèterait de la santé. Et vous, madame, toujours tourmentée, toujours ennuyée à cause de cette chère malade ! Que voulez-vous ?
Ne faut-il pas se résigner à la volonté de Dieu ? C’est une épreuve, elle passera !…
– Mais asseyez-vous donc, mademoiselle Boc ; et qu’êtes-vous devenue ? on ne vous voyait plus.
– Vous m’aviez oubliée, dit la malade en prenant un air câlin.
À voir tant d’empressement pour une vieille femme sotte et vulgaire, on pouvait comprendre combien cette famille était dénuée de toute distraction. Quant à sa pauvreté, le plancher disjoint, le papier en lambeaux, la boiserie vermoulue et trouée, en disaient assez. Mais l’ordre et la propreté luttaient contre ces ruines. À défaut de papier semblable à celui de la tenture, qui d’ailleurs n’avait plus ni couleur ni dessin, on avait collé au-dessus de la boiserie des bandes de papier bleu en guise d’une large bordure. Sur la vaste cheminée de pierre, enguirlandée de sculptures, des tasses de porcelaine peinte se miraient dans une glace fêlée au cadre doré. Un buffet à deux corps en noyer ciré, des chaises de paille, une table à pieds tournés, une pendule à poids enfermée dans sa gaine vernie, tel était l’ameublement, outre qu’au fond de la chambre une alcôve garnie de rideaux à franges, relevés par des patères, laissait voir deux lits à la duchesse en damas fané, lesquels, disait souvent Mme Bertin, avaient coûté bien cher dans le temps.
– Je serais venue plus tôt, mes voisins, dit Mlle Boc en mettant ses pieds sur les tisons, autour desquels bouillaient deux pots et une cafetière, sans cette petite créature qui me ravage le tempérament. C’est les sept péchés capitaux ! Elle me fait dénaître ! Imaginez-vous…
– Mademoiselle Boc, interrompit Lucie, qui s’était mise à broder auprès de la fenêtre, vous m’aviez promis une grande nouvelle.
– On vous la dira, petite curieuse ! mais vous êtes bien pressée.
– Vous le seriez encore plus que moi, mademoiselle Boc, si vous n’étiez pas sur le chapitre de Francille ; mais laissez-la un peu ; voyez, tout le monde attend.
En effet, au mot de nouvelle, une expression d’agréable surprise avait éclairé les visages, et l’attente devenait plus vive à chaque seconde.
– Allons, voisine, allons ; dites-nous ça, demanda M. Bertin.
– Qu’est-ce que ça peut être, ma chère demoiselle ? articula Mme Bertin, qui, malgré sa figure élégiaque et son air absorbé, n’était pas étrangère aux plaisirs du commérage.
– Oh ! vraiment, dit la malade, vous nous apportez une nouvelle ? et qu’est-ce que ça peut être, mademoiselle Boc ?
– Elle va nous faire languir sans pitié, reprit gaiement Lucie qui, toujours penchée sur les vitres où s’éteignaient les dernières lueurs du jour, tirait l’aiguille sans relâche.
– Vous vous arrachez les yeux, ma mignonne, lui dit Mlle Boc.
– Ne vous occupez pas de moi, lui répondit la jeune fille.
– Eh bien ! non, puisque ce n’est pas de vous qu’il s’agit, mais de votre cousine.
– Ah ! ah ! d’Aurélie ? Ah !
Une ombre de vague inquiétude assombrit les visages.
– Eh bien ? demanda M. Bertin.
– Eh bien ? répéta Clarisse avec un peu d’effort.
– Eh bien ! elle se marie décidément avec l’ingénieur.
Il se fit un moment de silence.
– Ah ! est-ce bien sûr ? demanda M. Bertin d’une voix quelque peu enrouée.
– Parfaitement, mon voisin. Tout à l’heure, Mme Bourdon et Mlle Aurélie ont passé sur la place, devant ma fenêtre, dans la voiture de M. Gavel.
– Avec lui ?
– Sans doute ! il conduisait.
– Eh ! eh !
– En effet, dit Mme Bertin, de la voix aigre et sèche qu’elle avait quelquefois, lorsqu’il s’agit d’une femme si sévère sur les convenances qu’est Mme Bourdon, cela peut s’appeler une preuve. Oui…, certainement…, répétait-elle machinalement en regardant Clarisse, dont les pommettes devenues écarlates contrastaient avec son teint livide.
Lucie, quittant doucement sa place, alla faire un verre d’eau sucrée, mêlée de fleurs d’oranger, qu’elle remit à sa sœur.
– Aurélie se marie bien jeune ! dit M. Bertin en allant et venant dans la chambre.
– Bien jeune ! vous n’y pensez pas, mon voisin. N’a-t-elle pas dix-huit ans ? Je voudrais savoir combien de partis elle a déjà refusé ! Oh ! des filles riches comme cela, on n’attend pas longtemps à les marier.
– M. Gavel est riche aussi ?
– Je crois bien ! Sa place d’abord est de six mille francs, et puis son père, le sous-préfet de l’arrondissement, a une très belle fortune, d’autant que sa femme, une demoiselle Marsis, de Vandœuvre, vous savez, lui a bien apporté près de cent mille francs ; et M. Ferdinand Gavel n’a qu’une sœur. Oh ! c’est un brillant mariage ! Ils feront flores à Poitiers.
– Grand bien leur fasse, dit M. Bertin, d’une voix rauque. Je suis content que Bourdon établisse bien sa fille.
– Aurons-nous une belle noce ! reprit Mlle Boc. Oh ! pour moi, je n’ai pas droit d’y être invitée, mais probablement que vous y serez.
– Il ferait beau voir qu’Aurélie n’eût pas ses cousines à sa noce, fit Mme Bertin.
– Ça ne serait pas la faute de M. Bourdon, ma chère dame ; mais sa femme est si… vous savez… Assurément, c’est une aimable femme, et je l’estime beaucoup, mais elle est comme ça, un peu trop… grande. Par exemple, j’ai trouvé ça bien extraordinaire, l’autre jour, quand elle a dit à M. Gavel que vous étiez des parents éloignés.
– Des parents éloignés ! s’écria M. Bertin en faisant un bond dans la chambre.
– Oh ! mais voilà qui est de toute indignité ! exclama sa femme. Je croyais que Mme Bourdon avait de plus nobles sentiments et plus de respect pour le sang de nos ancêtres.
– Elle a dit cela, cette s… pimbêche ! Ah ! bien, je lui arrangerai joliment son orgueil, moi. Des parents éloignés ! Comme si notre grand-père n’était pas le sien. Ma parole d’honneur ! ça ne se passera pas comme ça ; et puisqu’elle met les choses sur ce pied entre nous…
– Grand Dieu ! monsieur Bertin, dit la vieille fille inquiète, si j’avais su que vous le prendriez comme ça…
– Et comment pourrait-on le prendre, ma chère demoiselle ? interrompit aigrement Mme Bertin.
– Sans doute ! sans doute ! Mais promettez-moi de n’en point parler, mon cher monsieur, ni vous, ma chère dame. Vous ne voudriez pas me faire cette peine-là, n’est-ce pas ? Moi qui vous dis tout, moi qui ai tant de confiance en vous !
– C’est impossible, voyez-vous, reprit M. Bertin ; quand j’ai quelque chose sur le cœur…
– Allons donc, mon cher voisin, vous ne voudriez pourtant pas vous brouiller avec la maison Bourdon ?
– Et pourquoi ? réplique M. Bertin d’une voix tonnante. Est-ce que vous croyez que je n’oserais pas ?
– Si c’est, reprend sa femme, parce qu’elle fait cadeau tous les ans à mes filles de deux méchantes robes d’indienne, tandis qu’Aurélie n’a que des robes de soie… on n’y perdrait pas tant !
– Mes chers voisins, s’écria Mlle Boc éperdue, je vous en conjure ! écoutez un peu la raison… C’est une femme d’un grand ton, vous savez, que Mme Bourdon, et à qui l’on est bien obligé de passer quelque chose. Moi, je sais bien ce que j’en pense, allez ! et voyez, je suis comme vous, ce mot-là m’a fait de la peine ; mais on est obligé de se contraindre ; il faut en prendre et en laisser. Entre nous soit dit, si l’on n’avait pas sa maison à Chavagny pour s’amuser un peu et ses dîners du dimanche…
– Ses dîners me pèsent sur l’estomac, tout comme son grand ton, s’écria de nouveau M. Bertin. Je me moque de tout ça, et je ne remets plus les pieds chez elle, ou ce sera pour lui dire son fait.
– Mesdemoiselles, ne trouvez-vous pas ?… dit la Boc en se tournant vers les jeunes filles.
– Il y a longtemps que je connais ma tante, répond Lucie froidement.
– Si le mot est vrai, ma tante serait inexcusable, dit Clarisse avec chagrin.
– Comment ! si c’est vrai, mademoiselle Clarisse !… quand je vous dis…
Elle s’arrête mécontente, mais n’osant renouveler son accusation, de peur de renouveler la colère de M. Bertin.
– Papa, reprend Lucie, tout ce bruit fait mal à Clarisse, laissons Mme Bourdon. Tu sais que mon oncle nous aime.
– C’est vrai ! c’est vrai ! Lui, c’est un bon diable, aussi je veux m’en plaindre à lui.
– Ce serait lui faire de la peine, cher père, et vouloir brouiller leur ménage. Il me semble qu’il serait plus digne à nous de mépriser cette injure.
– Vous parlez comme un oracle, mademoiselle Lucie ; vrai, vous êtes la sagesse même, ma chère enfant. Eh ! mon Dieu ! oui, voyez-vous, le pardon des injures, c’est notre devoir ; c’est par là que nous pouvons nous rendre agréables à Dieu. Vous avez réellement une grande sagesse, ma mignonne.
– Je sais, dit malignement Lucie, qu’il ne faut point en vouloir à son prochain, ni médire de lui.