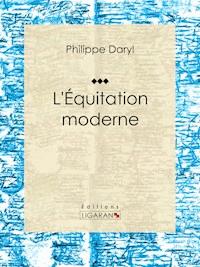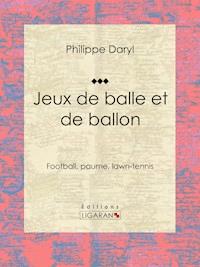
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Les jeux de ballon sont au nombre des plus anciens exercices de plein air que pratique l'humanité. Il n'en est pas de plus amusants, de plus animés, de plus propres à développer l'agilité, la force musculaire, le souffle, la vitesse, l'esprit d'à-propos. Mais précisément parce que ces jeux sont très anciens et ont été cultivés dans tous les temps, leur histoire est assez obscure. Chez les Grecs et les Romains, elle se rattache à celle de la sphéristique..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050578
©Ligaran 2015
Les jeux de balle et de ballon formaient chez les Grecs et après eux chez les Romains une partie de la Gymnastique désignée proprement sous le nom de Sphéristique.
On trouve dans les auteurs latins la trace de quatre sortes de sphéristiques : le ballon ou follis ; la balle, appelée trigonalis ; la balle villageoise, pila paganica, et l’harpastum. Le médecin Cœlius Aurelianus les désigne par l’expression générale de sphæra Italica (paume italienne), et le poète Martial les a toutes comprises dans ce couplet :
Le ballon était de deux espèces, la grande et la petite. On poussait les gros ballons avec le bras, armé d’unbrassard rigide. Le petit ballon, qui était le plus en usage, se poussait avec le poing, d’où son nom de follis pugillaris ou pugillarius. Suétone dit qu’Auguste faisait de ce jeu son passe-temps favori.
La paume, ou trigonalis, se jouait avec une petite balle, appelée trigon, non point à cause de sa forme, qui était sphérique, mais parce que les joueurs étaient habituellement au nombre de trois, disposés en triangle. Ils se renvoyaient la balle, tantôt d’une main, tantôt de l’autre, et celui qui la laissait tomber perdait un point.
La paume de village, pila paganica, n’était nullement abandonnée aux paysans : on la pratiquait dans tous les gymnases et les thermes, avec des balles très dures, faites de plume bien foulée et beaucoup plus grosses que les balles trigones ou même que les ballons grecs et romains. La dureté de ces balles, jointe à leur volume, en rendait le jeu particulièrement difficile et dangereux.
Enfin l’harpastum des Romains (imité de l’harpaston des Grecs) était une petite balle lourde qui servait à un véritable jeu de paume, établi sur une arène sablée.
Tous ces jeux étaient d’un usage courant chez les Romains de l’ère impériale. Il faut y ajouter le jeu de la balle de verre, pratiqué surtout dans les thermes et qui avait le don d’exciter chez les spectateurs un enthousiasme extraordinaire pour ceux qui excellaient à ce sport.
La simple énumération de ces variétés de sphéristiques, dont la trace se retrouve à tout instant dans les auteurs latins et même dans les inscriptions parvenues jusqu’à nous, suffit à démontrer que les modernes n’ont rien inventé à cet égard et perpétuent sous nos yeux une tradition purement grecque dans ses origines.
Les jeux de ballon sont au nombre des plus anciens exercices de plein air que pratique l’humanité. Il n’en est pas de plus amusants, de plus animés, de plus propres à développer l’agilité, la force musculaire, le souffle, la vitesse, l’esprit d’à-propos. Mais précisément parce que ces jeux sont très anciens et ont été cultivés dans tous les temps, leur histoire est assez obscure.
Chez les Grecs et les Romains, elle se rattache à celle de la sphéristique, qui comprenait tous les jeux de balle et de ballon. Autant qu’on peut le savoir, on distinguait alors deux sortes principales de ballons : l’harpastum, petite et dure pelote de cuir remplie de sable, et le follis, ballon léger, formé d’une vessie de bœuf avec ou sans gaine de peau. Le follis, a dit Martial dans une de ses épigrammes, est bon pour les enfants et les vieillards :
Folle decet pueros ludere, folle senes.
Peut-être les soldats de César importèrent-ils ce jeu en Grande-Bretagne, où il est devenu le football ou ballon au pied, ballon au camp, barette, pour lui donner son nom français. Peut-être aussi n’a-t-il franchi le Pas de Calais que beaucoup plus tard et le jeu anglais a-t-il pris son origine de la choule picarde ; on la joue encore à certains jours dans quelques cantons de la Somme et de l’Aisne, et il suffit d’y avoir vu pratiquer ce sport brutal, où le projectile est une énorme et dure pelote de cuir remplie de son, pour s’expliquer les accidents et les colères qu’il causait jadis dans les rues de Londres. Moralistes, prédicateurs, règlements de police et ordonnances royales se sont accordés pendant plusieurs siècles à le condamner.
Par un édit de 1314, Édouard II avait formellement interdit, sous peine d’emprisonnement pour les délinquants, et comme une cause intolérable de désordre, ce qu’il appelait dans le français d’alors, langue officielle de la cour, ces raigeries de grosses pelotes. L’interdiction fut renouvelée en 1349 par Édouard III et en 1401 par Henri IV. De leur côté, les rois d’Écosse n’épargnaient rien pour déraciner la passion du football au cœur de leur peuple. Mais ce fut toujours en vain. Les Stuarts, pas plus que les Tudors et les Lancastres, ne parvinrent à se faire écouter.
Apparemment, ce jeu rude et grossier, où la bête anglo-saxonne se ruait dans toute la violence de ses esprits animaux, lançant à grands coups de pied la vessie de bœuf engainée de cuir bouilli, bousculant tout pour l’atteindre, jouant des coudes et des poings, poussant, colletant et assommant ses rivaux, se grisant de l’ivresse de la lutte et des horions reçus – ce jeu répondait trop bien aux instincts généraux de la race pour être aisément abandonné.
Toujours est-il que les édits restaient impuissants, et que, dans les villages anglais comme dans les faubourgs des villes, en dépit de la prison et même de la hart, le football gardait son prestige.
Pour interrompre la tradition et faire oublier un jeu si populaire, il ne fallut rien de moins que la révolution puritaine. Mais alors, et pour longtemps, le football disparut sous la malédiction des ascètes et des prêcheurs en plein vent qui stigmatisaient les jeux comme frivolités damnables.
Quelques écoles en gardèrent probablement le souvenir, car vers la fin du dix-septième siècle on en retrouve la trace. Un des premiers voyageurs français qui ait écrit sur l’Angleterre, Misson, dit, en 1698, dans ses Mémoires et observations : « En hiver, le football est un exercice utile et charmant ; c’est un ballon de cuir gros comme la tête et rempli de vent ; cela se ballotte avec le pied dans les rues par celui qui le peut attraper : il n’y a point d’autre science. »
Néanmoins, de l’excommunication puritaine et des anathèmes antérieurs il restait sur le football une note d’infamie. Les maîtres de la jeunesse s’accordaient, non sans motif, à le considérer comme un sport de mauvais ton, mieux fait pour des rustres ou des crocheteurs que pour des fils de famille.
Vers 1823, quand on apprit que ce jeu de vilains venait d’être ressuscité à l’école de Rugby, et que non seulement on le permettait, mais on le recommandait aux élèves, un frisson de colère et d’indignation passa sur le Royaume-Uni. Les gazettes s’emparèrent de la question ; la chaire dominicale, aussi friande d’actualité que la presse périodique, saisit la balle au bond et renouvela les homélies puritaines. Mais rien ne put prévaloir contre la mode qui s’était emparée d’un exercice aussi attachant. En dix ou quinze ans, le ballon au pied s’était définitivement implanté dans les mœurs de la jeunesse anglaise et avait conquis le rang de sport national. Il faut dire que des congrès de spécialistes avaient examiné par le menu les règles du jeu, en avaient formulé le code (toujours perfectible) et étaient arrivés à en adoucir dans une large mesure les antiques brutalités.
Aujourd’hui, en Angleterre, on joue le ballon au pied de deux manières : à la mode de Rugby et à la mode de Londres ou, si l’on veut, de l’Association générale pour la réforme du football. C’est la mode de Rugby qui est la vraie, la pure, la traditionnelle. Elle se différencie de l’autre en ce qu’elle autorise l’usage des mains et des pieds pour saisir ou lancer le ballon, tandis que le code de l’Association admet uniquement l’emploi des membres inférieurs.
On reviendra à loisir sur les deux règles. Contentons-nous présentement de décrire le jeu à grands traits. Et d’abord un mot du matériel, qui est des plus simples :
1° Un ballon de 8 à 10 pouces de diamètre, ovoïde à Rugby, parfaitement globulaire ailleurs, formé d’une vessie de caoutchouc dans une forte gaine de cuir de veau ; ce ballon peut coûter une vingtaine de francs et dure quatre ou cinq ans, si l’on a soin de le graisser et de le tenir au sec ;
2° Quelques pieux, perches et guidons pour marquer les limites et les buts.
Le terrain est une esplanade quelconque, gazonnée ou non. On y dessine avec des lignes de pieux et de guidons un parallélogramme de 100 à 200 yards de long sur 50 à 100 yards de large ; puis on marque par une paire de poteaux plantés à 8 yards de distance l’un de l’autre, au milieu de chacun des deux petits côtés du rectangle, ce qu’on appelle les goals ou buts. À Rugby, les deux poteaux sont surmontés d’une barre transversale, par-dessus laquelle il s’agit de faire passer le ballon : le règlement de l’Association substitue à la barre une corde sous laquelle doit passer ledit ballon. Les lignes marquant les deux petits côtés du parallélogramme s’appellent lignes de but ; celles qui dessinent les deux grands côtés s’appellent lignes de touche. L’intervalle qu’elles délimitent est le champ.
Le costume habituel se compose d’un tricot de laine, d’une culotte arrêtée aux genoux, de bas rayés auxquels on peut ajouter des jambières rembourrées pour protéger les tibias contre les coups de pied destinés au ballon, mais qui se trompent souvent d’adresse, enfin d’une paire de gros souliers lacés et d’une casquette de flanelle.
Supposons qu’on joue à la mode de Rugby. Le ballon est ovoïde. Les joueurs, au nombre de trente, se divisent en deux camps de quinze, distingués par la couleur de leur tricot ou par quelque autre indice, et chacun sous le commandement d’un capitaine. On tire à pile ou face pour le choix du côté (celui du vent est le meilleur) et, le choix arrêté, les deux partis prennent position en avant de leur but respectif et dans l’ordre que voici :
Dix joueurs, rangés en ligne de chaque côté, forment l’avant-garde : ce sont les forwards. Deux autres, à quelques pas en arrière, sont dits halfbacks (demi-centres) ; un autre est le three quarters back (trois quarts en arrière) ; enfin deux autres backs forment l’arrière-garde.
Il s’agit, pour chacun des partis, d’arriver à envoyer le ballon par-dessus la barre du but de ses adversaires et de marquer ainsi un point. La partie se compose habituellement de plusieurs reprises, en deux après-midi et dans un temps fixé d’avance.
Les joueurs en place, le capitaine du côté perdant à pile ou face (disons du côté B) place le ballon au milieu du champ, et, d’un coup de pied, l’envoie vers le but adverse. Jusqu’à ce moment, l’avant-garde des deux partis doit être restée à la distance de dix yards au moins du ballon. Mais, dès qu’il a quitté le sol, les évolutions sont libres. Un joueur du côté A saisit le ballon au passage et le renvoie vers le côté B, aussi loin qu’il peut dans la direction du but. Là on le ressaisit de nouveau ; mais, avant que le joueur ait pu donner son coup de pied, il est ordinairement appréhendé au corps, colleté, renversé au besoin par ses adversaires et mis dans l’impuissance d’agir. Si l’opération s’est accomplie dans les règles, il crie : « Down ! » (À bas !) Immédiatement il est relâché, le ballon est laissé à terre et les forwards des deux partis se jettent coude à coude et la tête baissée les uns contre les autres, de manière à former une masse compacte de lutteurs, sous les pieds desquels roule le ballon.
C’est ce qu’on appelle un scrummage, c’est-à-dire une mêlée.
Inutile de dire que, dans cette mêlée, tous les moyens, ou peu s’en faut, sont légitimes pour avoir le dessus et arriver au ballon. Il faudrait être plus sage que nature pour bien mesurer la portée de chaque coup de pied, de chaque effort musculaire, de chaque poussée.
Cependant les backs, ou tirailleurs du centre et de l’arrière-garde, sont restés sur le qui-vive, en dehors de la masse grouillante des forwards, prêts à ramasser le ballon, s’il sort de la bagarre, pour l’emporter en courant vers le but adverse et touch it down, c’est-à-dire faire prendre terre au projectile en arrière de la ligne du but.
Mais les backs de ce camp sont sur la route du porteur pour l’arrêter s’ils peuvent, et cela par un moyen quelconque, pourvu que ce ne soit ni en le saisissant par ses vêtements, ni en lui prenant la jambe au-dessous du genou. (Avant les adoucissements actuels du jeu, il était parfaitement licite de se donner des coups de pied aux tibias : cela s’appelait hacking. Cette pratique est aujourd’hui devenue illégale.)
Il va sans dire que la mêlée des forwards s’est dissoute en s’apercevant que le ballon n’est plus sous ses pieds.
Admettons que le porteur du ballon n’ait été ni arrêté ni appréhendé au corps par ses adversaires, et qu’il ait réussi à envoyer le projectile au-delà de la ligne du but : il a droit à un try ou essai.
Voici comment s’effectue cet essai. Un joueur de son parti relève le ballon et le rapporte jusqu’à la ligne du but, où il marque l’empreinte de son talon ; puis, poursuivant sa marche jusqu’à une distance à peu près égale, en dehors du champ, à celle qu’il vient de mesurer en dedans, il fait une encoche sur le sol et y dépose le ballon ; aussitôt un autre joueur de son camp, qui l’attend, lance la vessie d’un coup de pied vers le but adverse. Passe-t-elle par-dessus la barre, c’est un but à marquer.
Tel est, à grands traits, le football à la mode de Rugby. La règle de l’Association est beaucoup plus simple.
Elle comporte un ballon globulaire et qu’il faut envoyer avec le pied sous la corde du but, sans jamais le toucher avec les mains. Seul, le gardien du but a le droit de s’en servir pour défendre sa position en arrêtant le ballon.
La disposition du terrain est la même qu’à Rugby, sauf qu’il n’y a pas de touche hors de la ligne du but, et, par conséquent, pas d’essais. En d’autres termes, il n’y a qu’une seule manière de marquer un but, c’est d’arrêter à point le ballon et de l’envoyer du pied entre les poteaux et sous la corde du but adverse.
En revanche, s’il arrive que le défenseur du but, en essayant d’arrêter le ballon, l’envoie lui-même derrière sa ligne, il donne à ses adversaires le bénéfice d’un corner kick, ou coup de coin.
On apporte le ballon dans l’un des angles voisins du but : les assaillants se forment en ligne devant ce but ; un des leurs envoie le ballon vers eux, et ils s’efforcent de lui faire franchir la porte dessinée par les poteaux et la corde.
On reviendra plus loin et en détail sur les règles actuelles des deux jeux anglais, selon le rite de Rugby et selon le rite de l’Association. Il ne s’agit ici que d’en donner une première idée générale et en quelque sorte historique.
En France, le jeu de ballon a toujours été joué, dans le Midi, sur les champs de paume et à l’aide d’un brassard de bois ; dans le Centre, sous le nom de barette ; dans le Nord et l’Ouest, sous les dénominations de melle, soule, choule ou choulage, et sur des règles aussi variées que les noms. Si l’on ajoute que ces règles se transmettaient exclusivement par tradition orale, et que le jeu de ballon français, mal vu par les autorités locales, n’était toléré qu’à certains jours, on s’explique de reste qu’il n’ait jamais pris un caractère véritablement national. Que ce jeu soit néanmoins identique, au moins dans ses origines, avec le football, on ne saurait en douter quand on l’a vu pratiquer dans les départements de l’Aisne et de la Somme ; à Rollot, près de Montdidier, par exemple, le choulage est encore joué tous les ans dans l’après-midi du mardi gras. Les célibataires forment une équipe et les nouveaux mariés de l’année l’équipe adverse. Les deux buts, à 300 mètres environ l’un de l’autre, sur un vaste terrain communal exclusivement consacré aux jeux de plein air, sont constitués par des mâts portant à leur sommet un cerceau garni de papier, à peu près comme ceux où passent les écuyers de cirque, et dans lequel il s’agit de faire passer le ballon. Ce ballon est un redoutable projectile en cuir bourré de son et pesant 3 ou 4 kilogrammes, que les deux partis lancent du pied, poussent, emportent en courant, se disputent et s’arrachent avec un acharnement extraordinaire, jusqu’à la victoire. L’équipe triomphante fait danser le soir les nouvelles mariées.
Voici, au sujet de ce jeu populaire, les renseignements qui nous ont été fournis par un jeune instituteur, originaire de l’arrondissement de Montdidier, et qui a vu pratiquer la choule à Rollot et Bennaigues.
« La soule ou « choulet » est une grosse balle de cuir très lisse et très lourde, ornée de rubans multicolores.
Tout le pays attend avec impatience l’époque du mardi gras. La veille, on parle des prouesses accomplies l’année précédente. Le jour tant désiré arrive enfin. Le choulet, offert par la dernière mariée de la saison, est promené au son du tambour dans le village pour rappeler aux habitants qu’une lutte aura lieu l’après-midi.
Vers deux heures, le monde afflue sur la place publique ; les hommes ont eu bien soin de mettre leurs vieux pantalons et leurs blouses trouées.
À chaque extrémité de la place a été planté, par les soins du garde champêtre, un poteau surmonté d’un cercle de tonneau qui va servir de but.
Ce cercle a été garni de papier et ressemble ainsi à ceux que les clowns emploient dans les cirques et au travers desquels ils passent avec agilité.
C’est à travers ce papier que le choulet devra être lancé pour que la lutte soit terminée.
Tout d’abord, il faut dire que les lutteurs se divisent en deux camps, les hommes mariés d’un côté, les garçons de l’autre. Chaque camp a son cerceau de but et tous ses efforts tendront à y faire passer le choulet. Pour ouvrir le jeu, le projectile est lancé au milieu de la place par le maire de la commune. Aussitôt, tous se précipitent à l’envi sur la balle : un mari la saisit, un garçon la lui arrache des mains, un autre mari la saisit ; cette fois il est plus heureux : il lance le choulet avec force vers son poteau.
La balle passe ainsi de main en main ; elle reçoit bien des coups de pied, car on ne se hasarde guère à la ramasser.
Tantôt le bataillon serré des chouleurs est auprès du poteau des garçons ; le choulet lancé par une main adroite dans la direction du cerceau est sur le point de crever le papier ; mais un mari saute habilement, arrête le choulet en chemin, le saisit et court de toutes ses forces vers son poteau.
Tout le monde le suit et la lutte recommence, acharnée.
Cette masse grouillante d’hommes bondit dans la campagne, roule dans les fossés, saute dans les ruisseaux, se meurtrit aux épines des haies et sur les cailloux des roules.
La lutte dure depuis longtemps : chacun essuie à la hâte la sueur qui ruisselle sur son front et rentre dans la bagarre.
Mais on sent que l’assaut tire à sa fin ; les garçons, moins nombreux et harassés, lancent le choulet avec moins de force. Les maris s’en saisissent, se protègent les uns les autres, et le choulet, lancé par l’un d’eux, va crever le papier du cerceau.
Ce ne sont alors que cris de désappointement et de joie. Tous sont rompus, moulus ; la sueur ruisselle sur leurs corps. Ils vont étancher leur soif et passer en revue l’état de leurs vêtements ; puis chacun se retire, les vainqueurs triomphants et les vaincus se promettant une revanche.
Ce n’est point fini. Il faut naturellement que les vainqueurs aient leur récompense. Le soir, il y a grand bal public, on se divertit ; puis, pour terminer, les musiciens jouent une danse du pays : « le branle ». C’est là qu’arrive la récompense : les vainqueurs seuls ont le droit de prendre part au branle.
Si les maris ont gagné, ils font danser les dames, et les garçons regardent tristement. Si ce sont les garçons qui ont la victoire, les maris ne voient pas sans dépit leurs moitiés au bras des triomphateurs pendant toute la durée du branle.
Tel est le jeu de choule à Rollot. »
L’intérêt de cette communication n’échappera à personne. Nous avons ici le ballon au pied dans sa forme élémentaire et vraiment française. Tout y est : les buts, les distances, le règlement, la distribution des prix à l’état original. Disposition autrement élégante et sûre que la corde ou la barre transversale d’importation anglaise. On voit la grosse balle passant de main en main ou chassée à coups de pied parce qu’on ne se hasarde guère à la ramasser. C’est la physiologie même et l’anatomie du ballon au pied en ses origines picardes.
On ne saurait douter que ce ne soit là, dans la forme primitive et brutale, le jeu même qui a pris en Angleterre le nom de football. La commune de Rollot, éloignée des grandes routes et des lignes ferrées, l’a gardé dans sa pureté native comme pour fournir la preuve du fait historique.
Là, d’ailleurs, pas plus qu’en aucune autre région de la France, on ne trouve une règle écrite, quoique les archives de la commune soient anciennes et riches.
Voici la seule règle que nous ayons pu obtenir, en nous adressant à tous les instituteurs de France, au sujet du « ballon français » :
Les règles du jeu de ballon sont, dans leurs grandes lignes, identiques à celles du jeu de longue paume, et nous n’aurons à relever que des différences de détail, dérivant de la nature spéciale de l’engin employé. Nous rappellerons sommairement les principes du jeu ; nous signalerons ensuite les règles particulières applicables au ballon, règles fort simples, d’ailleurs, et que des joueurs s’exerçant fréquemment auront vite fait de s’assimiler.
De même que pour la paume, il est indispensable d’avoir un terrain d’environ 70 mètres de longueur et de 13 à 14 mètres de largeur, limité longitudinalement par une raie tracée dans le sol et divisé en deux parties égales par une lanière transversale fixée à plat et qui se nomme : la corde. Une autre lanière, parallèle à celle-ci et distante de 24 à 26 mètres, indique le « tiré » ; c’est de là que le camp désigné à cet effet par le sort engage la partie, en tirant ou servant le premier coup.
Chaque faute commise par un camp donne 15 à son adversaire. L’un des deux camps ayant 45, si l’autre commet une faute, le premier gagne le jeu. Toutefois, si les deux camps arrivent en même temps à 45, le marqueur annonce : « À deux ! » et le jeu n’est gagné que par le camp qui fait commettre deux fautes successives à son adversaire. À la première, le marqueur annonce : « Avantage ! » au camp non fautif : mais si celui-ci faisait à son tour une faute, les deux camps reviendraient « à deux ». Un jeu peut ainsi durer longtemps, si les forces des joueurs sont bien équilibrées. La partie est gagnée par le camp qui réunit le premier le nombre de jeux convenus, habituellement six.
Il y a faute, comme au jeu de paume :
Lorsque le ballon tombe hors des limites latérales du jeu ;
Lorsque le joueur qui sert le premier coup ne lui fait pas franchir la corde ;
Lorsque le ballon ne dépasse pas la chasse ;
Et enfin dans certains cas spéciaux au ballon que nous verrons plus loin.
Le ballon, venant du camp adverse, se renvoie ou plus techniquement se rechasse, soit de volée (avant qu’il ait touché terre), soit après son premier bond. S’il ne peut être repris après ce premier bond, le joueur le plus rapproché l’arrête, et le marqueur vient enfoncer un piquet ou chasse à la hauteur du point où il a été arrêté.
Lorsqu’il y a deux chasses (une seule suffit lorsqu’un des deux camps a un avantage), les joueurs traversent et jouent la ou les chasses dans les mêmes conditions qu’au jeu de paume.
La partie se joue régulièrement six contre six ou, à la rigueur, cinq contre cinq.
Le ballon se renvoie, soit avec le poing, soit avec le pied, soit même avec n’importe quelle partie du corps. Toutefois, il est interdit de le toucher successivement avec deux d’entre elles, et le joueur qui, par exemple, ayant reçu le ballon sur le bras, le renverrait avec la main ou le pied, ferait une faute, au même titre que si deux joueurs du même camp touchaient le ballon avant qu’il ait été renvoyé par l’autre camp.
On ne peut prendre le ballon avec les deux mains que pour l’arrêter, ni faire une chasse après le deuxième bond. Tout joueur qui présenterait les deux mains et qui, sans même toucher le ballon de ses deux mains, le renverrait avec une seule ou toute autre partie du corps, ferait perdre 15 à son camp.
Les joueurs peuvent se trouver à tout moment, sans qu’il y ait faute, dans le camp de leurs adversaires. Mais il y aurait faute, s’ils sortaient des limites du jeu ; ils n’y sont autorisés que dans le cas où le ballon, tombant dans les limites, mais faisant son bond au dehors, l’un des joueurs en sort pour le renvoyer.
Les bonds du ballon étant plus longs que ceux de la balle, les joueurs ne sont pas tout à fait placés comme ceux de longue paume. Spécialement, les cordiers se tiennent un peu plus éloignés de la corde, et les demi-volées sont plus mobiles, se rapprochant du foncier ou des cordiers, selon les besoins.
Les joueurs s’enveloppent généralement le poing et une partie du bras avec une lisière large de deux doigts, qui amortit le choc, parfois un peu rude, du ballon.
En l’absence de toute règle écrite, on ne saurait beaucoup s’étonner que la jeunesse française, quand elle a tourné son attention vers les jeux de plein air, se soit montrée disposée à profiter des perfectionnements apportés au jeu de ballon par nos voisins d’outre-Manche, en un demi-siècle de pratique soutenue. On sait comment ce mouvement a pris naissance avec les livres d’André Laurie sur La Vie de collège dans tous les pays. Le premier de ces ouvrages, publié en 1879, préconisait les jeux de plein air comme la source la plus évidente de la vigueur et de l’énergie si manifeste dans la race anglo-saxonne. Après avoir décrit dans tous leurs détails les jeux pratiqués par les écoliers anglais, André. Laurie demandait que des exercices analogues fussent établis en France dans tous les collèges et sur les terrains communaux des moindres villages.
« J’ai beaucoup voyagé dans votre pays, » faisait-il dire à l’un des héros de son récit, tout entier consacré à l’apologie des jeux d’exercice ; « c’est pour moi comme une seconde patrie. J’aime le peuple français pour ses qualités brillantes, pour son esprit, pour sa générosité, qui font de lui la mieux douée peut-être de toutes les races. Mais, je vous le dis avec chagrin, il ne se relèvera pas de ses désastres, et il ne reprendra pas la place qui lui appartient, s’il n’accomplit dans ses jeux une réforme complète.
Cette opinion peut paraître frivole, elle ne l’est pas. Je lisais dernièrement, dans le Times, que les réserves de votre armée avaient été appelées aux exercices annuels, et que les trois quarts des jeunes soldats avaient mal supporté les fatigues des marches forcées auxquelles on les avait soumis. Croyez-vous qu’il en aurait été de même, si tous avaient eu, dès l’enfance, l’habitude des exercices violents ? C’est à la jeunesse des écoles, c’est aux adolescents de votre âge qu’il appartient de donner ce salutaire exemple. Rappelez-vous tous que l’Allemagne a dû sa victoire, autant à sa vigueur physique qu’à son esprit méthodique ; et cette vigueur, elle en a puisé le germe, il y a cinquante ans, dans les associations athlétiques qui se formaient en toutes les écoles prussiennes, après la rude leçon d’Iéna. »
La doctrine, ainsi formulée en 1879 par André Laurie, et qu’il a depuis lors incessamment rééditée, expliquée, commentée en huit ou dix volumes, cette doctrine ne tarda pas à faire son chemin. Dès le mois de mai 1881, elle recevait une première application au lycée de Bastia, par la formation d’un cercle de marches et de jeux, sous la direction de MM. Garrigues, proviseur, et Delpech, censeur des études. En 1882, les lycées ou collèges de Grenoble, Oran, Bordeaux, Pau, Montpellier, Remiremont, d’autres encore, entraient dans la voie tracée par le lycée de Bastia. L’École Alsacienne de Paris prenait l’habitude de conduire ses élèves, une fois par semaine, soit au Bois de Boulogne, soit à Saint-Cloud. La première Société française de courses à pied se formait au quartier Latin, pour se placer bientôt sous la présidence honoraire de M. de Lesseps et la présidence effective de M. Napoléon Ney. Un cercle de jeux, composé des élèves du lycée Condorcet, se constituait sous la direction de M. Carvallo et pratiquait pendant quatre années consécutives les jeux de plein air sur la pelouse de Madrid, présentement occupée par la Ligue de l’Éducation physique. À la dissolution du cercle, en 1886, par suite du départ de son chef pour l’Espagne, les débris du groupe Carvallo devaient se reformer avec de nouveaux adhérents et comme capitaine M. Cadiot, plus tard chef moniteur de la Ligue.
Dès l’année 1884, un nouveau cercle de ballon s’était formé au Bois de Boulogne, sous la direction de M. Jean-Paul Cook, alors élève du lycée Condorcet, depuis élève en théologie, et qui a plus tard, lui aussi, commandé une équipe sur le terrain de la Ligue.
« En octobre 1884, écrit M. Cook, plusieurs de mes amis du lycée Condorcet et moi, ne pouvant nous joindre le dimanche aux exercices du cercle Carvallo, décidâmes de former un club, le Lutèce-Football-Club, et de nous rendre le jeudi à la pelouse de Madrid. L’administration du Bois voulut bien nous y autoriser. Notre cercle, peu nombreux au début, ne tarda pas à grandir et à prendre des proportions encourageantes ; nous devenions de plus en plus habiles, et nous ne tardâmes pas à nous mesurer aux joueurs du dimanche. C’est ainsi que nous eûmes, à plusieurs reprises, avec eux, des matchs qui n’avaient pas la publicité qu’on leur accorde aujourd’hui, mais qui intéressèrent vivement des spectateurs déjà nombreux.
Ces jours étaient des jours heureux et nous aimons à nous les rappeler. Tous ceux qui ont pris part à ces exercices peuvent dire que cet entraînement ne leur a point été inutile. Ayant eu, pour la plupart, à faire notre service militaire, nous avons tous éprouvé que l’exercice physique, tel que nous le prenions au Bois, était la meilleure préparation aux fatigues de la vie militaire. Tous mes anciens amis sont d’accord pour l’affirmer.
De temps en temps, nous organisions, dans le Bois de Boulogne, un rallie-papier ; mais, comme nous n’étions pas alors soutenus par une Ligue nationale, nous avions quelque difficulté à obtenir la permission, et, alors même que nous l’avions, nous étions fréquemment obligés de nous arrêter pour la montrer aux gardes du Bois, ce qui entravait singulièrement notre course. Nous n’en réunissions pas moins pour ces rallies une trentaine de jeunes gens. Malheureusement, je dus quitter Paris au commencement de mars 1886, et abandonner cette œuvre qui m’intéressait beaucoup. Le Lutèce-Football-Club finit par se dissoudre. »
En voici le règlement :
LUTÈCE-FOOTBALL-CLUB
RÈGLEMENT
ARTICLE PREMIER.– La Société prend le nom de Lutèce-Football-Club.
ART.2. – La cotisation annuelle est fixée à 5 francs.
ART.3. – La Société se réunira tous les jeudis, à deux heures, sur la pelouse de Madrid, en face du Tir aux pigeons.
ART.4. – Un match aura lieu le premier jeudi de chaque mois.
ART.5. – Le comité, élu par tous les membres actifs du cercle, se composera d’un président, de deux capitaines de camp et d’un secrétaire-trésorier.
ART.6. – Tout joueur devra rigoureusement obéir au capitaine de son camp.
ART.7. – Pourront faire partie du Lutèce-Football-Club les individus de toutes nationalités.
ART.8. – Tout candidat devra : 1° être âgé d’au moins quinze ans ; 2° être présenté par deux membres actifs du cercle.
ART.9. – Tout candidat, après avoir été présenté par deux membres, devra ensuite attendre la décision de tous les membres du cercle appelés à délibérer sur son admission.
ART.10. – Aussitôt qu’il aura été admis, il devra payer la cotisation et se procurer le costume requis (jersey bleu marin).
Paris, le 10 janvier 1885.
Entre temps, la doctrine d’André Laurie se répandait en Belgique et en Suisse. Dès 1883, l’organisation des jeux scolaires s’effectuait en Belgique sous la direction du lieutenant-colonel Docx et prenait rapidement un développement assez considérable pour motiver en 1888 l’envoi d’une commission française chargée par le ministre de l’instruction publique d’en étudier les effets.
En 1886, les instituteurs de la Seine s’occupaient de cette question et la mettaient à l’ordre du jour de leurs discussions.
Au cours de ces mêmes années paraissaient dans les journaux le Temps, l’Illustration, dans le supplément littéraire du Figaro, plus de deux cents articles signés Philippe Daryl et consacrés aux questions d’éducation physique.
En 1887 s’ouvrait, à l’Académie de médecine, la discussion sur le surmenage, provoquée par M. Spuller, ministre de l’instruction publique, et au cours de laquelle le docteur Peler disait en propres termes : « Le remède est simple. On le trouvera dans les jeux de plein air, tels qu’ils sont décrits par les ouvrages d’André Laurie. »