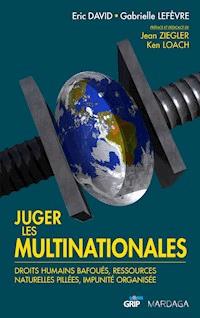
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mardaga
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
La dénonciation des pratiques des multinationales dans le cadre du débat sur le Traité transatlantique.
Coca-Cola, Monsanto, Shell, Nestlé, Bayer, Texaco… : certaines marques sont associées à des scandales retentissants. Hydropiraterie en Inde, pesticides aux effets dévastateurs, exploitation pétrolière transformant le delta du Niger en désert écologique, drame du Rana Plaza au Bangladesh, enfants empoisonnés par le plomb au Pérou…, la liste est longue et plus qu’inquiétante.
Dans cet ouvrage, les auteurs examinent quelques-uns des crimes les plus significatifs commis par des multinationales. Des crimes qui ont fait l’objet de poursuites judiciaires ou de « procès citoyens », que ce soit sur le plan national ou international.
Ils expliquent aussi comment ces sociétés ont conquis, au cours du XXe siècle, de vastes marchés. Une montée en puissance – et en impunité – grâce notamment au soutien des États-Unis.
Après avoir analysé l’inefficacité des mécanismes de régulation (Banque mondiale, OMC, OCDE) et s’être interrogés sur le projet de grand marché transatlantique, les auteurs rappellent que les multinationales n’échappent pas au droit. Le recours à la justice, c’est l’arme des victimes ! À quand un « tribunal pénal international » apte à juger les exactions de ces colosses industriels ?
En coédition avec le GriP (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité), cet ouvrage de référence plaide pour une Cour pénale internationale qui jugerait les crimes des multinationales.
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
Les mots sont des armes. Ce livre est très important : c’est un outil pour contrer les conséquences désastreuses de la toute-puissance des grandes entreprises. Les auteurs nous posent la question : ces immenses sociétés multinationales sont-elles compatibles avec un avenir démocratique ? Comment envisager un monde où nous pourrions protéger les ressources de la Terre et offrir à tous une vie digne et sûre, tant que le pouvoir réside aux mains de ces géants voraces ? Le temps n’est-il pas venu de les consigner, à l’instar des dinosaures, dans les livres d’Histoire ? - Ken Loach
Un bel objet qui met le focus sur la place des multinationales dans notre monde moderne. - Alexandre Wajnberg, entretien avec Gabrielle Lefèvre, Radio Campus
Un livre dense et utile – d’un côté, une journaliste faisant son métier, l’investigation ; de l’autre, un juriste faisant le sien et apportant son point de vue de spécialiste sur des actions possibles. Car la leçon majeure de ce livre, c’est qu’il ne faut pas désespérer. - Jean Rebuffat, Entre les lignes
À PROPOS DES AUTEURS
Éric David, professeur émérite de droit international de l’Université libre de Bruxelles (ULB), président du Centre de droit international de l’ULB, auteurs de nombreux articles juridiques et d’ouvrages de droit international dont certains sont devenus des classiques. Juriste de renommée internationale, il est considéré comme le père de la loi dite de compétence universelle en Belgique et plaide pour une Cour pénale internationale qui jugerait les crimes des multinationales.
Gabrielle Lefèvre, journaliste spécialisée dans les problèmes de développement, d’urbanisme et d’évolution sociétale. Ancien membre du Conseil supérieur de la justice. Chroniqueuse sur le site de débat citoyen www.entreleslignes.be.
Préface de Jean Ziegler, homme politique, altermondialiste et sociologue suisse. Il a été rapporteur spécial auprès de l’ONU sur la question du droit à l’alimentation dans le monde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÉFACE
PLAIDOYER POUR UNE JUSTICE UNIVERSELLE
Jean ZIEGLER1
Face à la mondialisation néolibérale, un engagement altermondialiste populaire se construit. Partout dans le monde, des citoyens, des peuples bougent, manifestent, marchent, s’indignent, dénoncent, revendiquent. C’est nouveau dans l’histoire des nations.
Et le mouvement s’amplifie, si l’on en juge par les innombrables rassemblements et manifestations contre le projet de traité de libre-échange Europe-États-Unis. Surnommé « cheval de Troie des multinationales » par les opposants, il constituerait un véritable « OTAN économique » selon Hillary Clinton elle-même.
Ce mouvement de résistance, pour étayer ses revendications, a besoin de pouvoir s’appuyer sur une argumentation juridique et une analyse des faits solides.
Tel est bien le propos de ce livre exemplaire d’érudition, de courage et de clarté.
Juger les multinationales entend nourrir la réflexion de ceux, nombreux et répartis sur tous les continents, qui souffrent des pratiques prédatrices de multinationales de tous genres. Des populations qui trop souvent ne trouvent pas de défenseurs, ni auprès de leur gouvernement, ni auprès de leur justice nationale et qui, dans le cadre d’une instance pénale internationale chargée de juger les exactions des multinationales, pourraient enfin être entendues.
Pour y parvenir, les auteurs
– nous rappellent les principaux scandales qui, ces dernières années, ont défrayé la chronique et dont les acteurs ne sont autres que Monsanto, Chevron/Texaco, Shell, Union Carbide, Nestlé, Samsung, Coca-Cola, Bayer, Syngenta pour ne citer que les plus connus ;
– remettent la montée en puissance des sociétés multinationales dans un contexte historique et institutionnel ;
– évoquent l’échec des outils de régulation existants et suggèrent des solutions innovantes, au service de l’émergence d’une éthique mondiale.
Cet ouvrage constituera une arme pour tous ceux, et ils sont très nombreux, qui militent dans le monde entier pour cette justice économique et sociale. Un intérêt démontré dans une étude passionnante : « Manifestations dans le monde 2006-2013 », réalisée par l’Initiative for Policy Dialogue et la Friedrich-Ebert-Stiftung New York2. Cette étude recense 843 manifestations menées dans 84 pays qui rassemblent 90 % de la population mondiale : « Printemps arabes », Indignados, Occupy, émeutes contre la faim, etc.
Ce que dénoncent les millions de manifestants, c’est avant tout l’absence de véritable démocratie (y compris en Occident) face aux problèmes dramatiques de notre planète, les États n’incarnant que rarement l’intérêt de la population, notamment dans les négociations avec les multinationales.
Pour dénoncer les crimes commis par ces grandes entreprises, les « citoyens du monde » disposent, grâce à de nombreuses associations spécialisées, de beaucoup d’informations et d’analyses spécifiques. Ils peuvent ainsi soutenir cette exigence nouvelle : une justice internationale permettant de contraindre ces puissances économiques et financières à mettre fin à leurs pratiques criminelles et à réparer les torts causés aux populations. Une justice qui avait déjà été réclamée par des Tribunaux des peuples en Amérique latine notamment mais qui devrait aujourd’hui être portée par un tribunal pénal international trouvant sa légitimité parmi les instances mises en place par les Nations unies.
Un mouvement international « Treaty Alliance »3 regroupant plus de 600 ONG et 400 personnalités du monde entier soutient le processus en cours au Conseil des Nations Unies pour les droits humains. L’enjeu : qu’une loi internationale lie désormais les États et les entreprises en établissant clairement leurs responsabilités économiques et sociales respectives et les sanctions applicables en cas d’infraction. Les acteurs de la société civile seraient reconnus dans ce cadre comme les défenseurs de l’intérêt collectif.
Car l’exigence de justice, qui fait ainsi marcher des millions d’humains, vise deux objectifs essentiels : le bien commun de l’humanité et la survie de notre écosystème.
Un nouveau sujet historique est en train de naître : la société civile planétaire. Son seul moteur est la conscience de l’identité qui habite chaque être humain.
Emmanuel Kant écrit : « L’inhumanité infligée à un autre détruit l’humanité en moi. »
Du sud au nord, de l’est à l’ouest, les vents se lèvent. La révolte est proche. Des fronts du refus portent l’espoir du peuple. De ces fronts, chacun de nous et tous ensemble, nous devons être les constructeurs.
1. Homme politique, altermondialiste et sociologue suisse, Jean Ziegler a été rapporteur spécial auprès des Nations unies sur la question du droit à l’alimentation dans le monde (de 2000 à 2008). Auteur de nombreux ouvrages dont Retournez les fusils ! – Choisir son camp (éd. du Seuil, 2014).
2. Isabel Ortiz, Sara Burke, Mohamed Berrada, Hernan Cortes Saenz, World Protests 2006-2013 Executive Summary, Initiative for Policy Dialogue, http://policydialogue.org.
3. www.treatymovement.com.
DÉDICACE
« Les mots sont des armes. Ce livre est très important ; c’est un outil pour contrer les conséquences désastreuses de la toute-puissance des grandes entreprises. Les auteurs nous posent la question : ces immenses sociétés multinationales sont-elles compatibles avec un avenir démocratique ? Comment envisager un monde où nous pourrions protéger les ressources de la Terre et offrir à tous une vie digne et sûre, tant que le pouvoir réside aux mains de ces géants voraces ? Le temps n’est-il pas venu de les consigner, à l’instar des dinosaures, dans les livres d’Histoire ? »
Ken LOACH (cinéaste)
À Pierre Galand, infatigable explorateur des progrès de l’humanité
INTRODUCTION
L’économie n’est pas qu’une accumulation de chiffres, de statistiques, de diagrammes : il s’agit d’activités humaines basées sur des projets politiques et sociaux. C’est la manière de gérer la survie et le développement des populations, de gérer les biens communs de l’humanité, à commencer par les ressources naturelles de la Terre. Bref, c’est une question de civilisation, de conception de notre présence au monde et de notre responsabilité d’humains.
Ces principes de civilisation basés sur le respect des droits humains et des droits de la nature sont bafoués depuis des décennies par une caste de très riches dirigeants et d’actionnaires de sociétés souvent transnationales (STN), déjouant les réglementations internationales et les lois nationales, imposant leur propre loi, celle du plus fort. Le rapport d’Oxfam 2015, « Insatiable richesse : toujours plus pour ceux qui ont déjà tout », le démontre : en 2016, le patrimoine cumulé détenu par le 1 % le plus riche du monde dépassera celui des autres 99 % de la population, à moins de freiner la tendance actuelle à l’augmentation des inégalités.
La part du patrimoine mondial détenue par cette minorité extrêmement fortunée est passée de 44 % en 2009 à 48 % en 2014, et dépassera les 50 % en 2016. En 2014, les membres de cette ploutocratie internationale possédaient en moyenne 2,7 millions de dollars par adulte. Pour lutter contre ces inégalités, il faut, toujours selon cette ONG, « commencer par des mesures énergiques contre l’évasion fiscale des multinationales » et « accélérer les avancées vers la conclusion d’un accord mondial sur le changement climatique ».
Une autre étude, celle d’une équipe de chercheurs de Zurich et publiée dans New Scientist4, démontre que l’économie mondiale est hyperconcentrée : sur 43 060 multinationales, un noyau de 1 318 entreprises, liées par des participations croisées, représente 20 % du chiffre d’affaire mondial. Par leurs interconnections, elles possèdent collectivement la majorité des plus grandes entreprises et sociétés de production du monde (l’économie réelle), soit 60 % du chiffre d’affaires mondial. Au sein de ce réseau, les scientifiques ont détecté une « superentité » de 147 sociétés encore plus interconnectées, contrôlant 40 % de la richesse totale du réseau. La plupart sont des institutions financières, parmi lesquelles figurent en premières places Barclays, JPMorgan Chase et Goldman Sachs.
Parallèlement à cette hyper concentration du capital, on assiste depuis les années 80 à une « hyper fragmentation » des structures de production par le recours croissant aux pratiques de sous-traitance par les multinationales. La question de leur responsabilité est donc devenue complexe. L’ancien directeur de la revue Transnational Corporation, John Dunning, écrivait en 1998 : « L’entreprise multinationale est maintenant en train d’assumer de façon croissante le rôle d’un chef d’orchestre par rapport à des activités de production et à des transactions, qui s’effectuent à l’intérieur d’une grappe ou d’un réseau, de relations transnationales, aussi bien internes qu’externes à l’entreprise […] dont le but est de promouvoir ses intérêts globaux. »5
Les activités de commerce et de production représentaient environ 80 % des revenus de ces entités. À partir des années 80, la financiarisation de leurs activités, à savoir le développement spectaculaire des activités financières, n’a cessé de croître pour représenter jusqu’à 80 % du chiffre d’affaires de certaines d’entre elles. La spéculation par des actionnaires, grands et petits, sur les capitaux tournant à toute vitesse à travers les bourses du monde entier, grâce à des algorithmes de plus en plus sophistiqués, échappe à l’économie réelle et à la maîtrise publique. Ces capitaux ne sont donc plus réinvestis dans des activités de production et les pouvoirs publics ne parviennent plus à récolter le produit des taxations qui leur permettent de réinvestir dans des politiques sociales et de développement. Selon Global Financial Integrity, l’évasion fiscale des firmes multinationales, en moyenne annuelle ces dix dernières années, représente une perte globale de 400 à 440 milliards de dollars pour les pays en développement. Mais dans cet ouvrage, nous n’approfondirons pas davantage ce sujet ni la problématique complexe de l’évasion fiscale6.
Multinationales ou transnationales ?
La question n’est pas uniquement linguistique. Les Nations Unies utilisent l’acronyme STN, sociétés transnationales, un terme qui a été préféré par les États du Sud lors de leur entrée à l’ONU. La plupart des dirigeants de ces sociétés sont en effet des ressortissants des pays où elles ont leur siège, à savoir dans les pays du Nord et principalement aux États-Unis. Cela souligne le caractère inégal de la mondialisation économique en termes de pouvoir de décision.
Cependant, le terme « multinationales » est très communément utilisé, à juste titre puisque la plupart de ces entreprises possèdent des bureaux, des sièges d’exploitation, des industries, des filiales dans plusieurs pays. Les nombreuses sources que nous avons consultées utilisent soit l’une soit l’autre dénomination. Ce que nous ferons aussi.
Ce livre : un dialogue
Les deux auteurs ont choisi deux approches complémentaires du sujet. Gabrielle Lefèvre expose les cas et les faits ainsi que des perspectives historiques, sans prétendre à une exhaustivité évidemment impossible. Elle renvoie aux sources d’informations afin que le lecteur puisse poursuivre sa recherche si nécessaire.
Eric David examine les mêmes questions sur un plan purement juridique. Partant des faits rapportés, il regarde si ceux-ci tombent sous le coup de règles de droit international applicables aux sociétés transnationales et aux États concernés par leurs activités. Vu le format de « poche » de l’ouvrage, l’analyse juridique reste fragmentaire. Chacun des faits relatés par Gabrielle Lefèvre pourrait donner lieu aux longs développements techniques, analytiques et factuels dont les juristes sont friands mais qui, vu les contraintes éditoriales, seront épargnés au lecteur. Il n’en demeure pas moins que, comme le disent les Anglais, « le diable est dans le détail » et quand on sait le rôle que peut jouer une virgule dans l’interprétation d’un texte7, on comprendra aisément que l’auteur est souvent resté dans la généralité tout en s’efforçant d’être précis.
Le chapitre I examine les fautes et crimes que l’on peut reprocher à quelques-unes de ces entreprises transnationales que nous avons sélectionnées parce que connues et représentatives de secteurs importants au point de vue économique, sanitaire, écologique, industriel, dans des zones géographiques différentes et parce qu’elles font déjà l’objet de poursuites judiciaires, que ce soit au niveau national ou international. Ou alors parce que certains agissements ont été contestés par des tribunaux d’opinion.
Le chapitre II explique comment, au cours du XXe siècle, les entreprises transnationales ont conquis de vastes marchés, étendant leurs tentacules dans le monde entier. Dans la foulée de la colonisation, on verra leur montée en puissance grâce au soutien des États, notamment des États-Unis. Sur la scène de ce théâtre économique et politique, apparaît un nouvel acteur : la société civile dans sa définition actuelle, comprenant les mouvements sociaux, syndicalistes et altermondialistes, les « indignés » qui s’opposent au néolibéralisme ravageur pour la planète et pour les droits humains. Ils défendent non seulement la justice sociale mais aussi les « biens communs mondiaux ».
Le chapitre III analyse la faiblesse des mécanismes de régulation et d’autorégulation mis en place par les Nations unies, et plus particulièrement par le Groupe de la Banque mondiale (GBM), l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). On verra à quoi aboutit le jeu du capitalisme mondialisé en Europe, à savoir le projet de grand marché transatlantique, triomphe de l’emprise des multinationales et danger pour la démocratie européenne. Enfin, nous examinerons les possibilités de justice internationale qui se dessinent aujourd’hui.
4. Andy Coghlan et Debora Mackenzie, « The Capitalist network that runs the world », New Scientist, décembre 2011.
5. Cité dans « Les sociétés transnationales », GRESEA Échos, septembre 2012.
6. Voir Joseph Spanjers et Hakon Frede Foss, Illicit Financial Flows and Development Indices : 2008-2012, Global Financial Integrity, 3 juin 2015.
7. Voyez par exemple, Plateau continental de la Mer Egée (Grèce c/Turquie), CIJ Rec. 1978, p. 22, § 53.
Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra, y Jehova repartió el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors, y otras entidades : la Compañía Frutera Inc. se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América.
Pablo Neruda, « La United Fruit Co. », extrait du Canto General (1950)
CHAPITRE I
LES FAUTES ET LES CRIMES COMMIS PAR LES MULTINATIONALES
De grandes sociétés transnationales ont acquis d’énormes richesses, parfois en utilisant des méthodes brutales et illégales. Les crimes commis par certains de ces groupes sont parfois équivalents à des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes contre la nature. Leur gravité se situe souvent à la hauteur des immenses profits qu’elles réalisent en exploitant les travailleurs, en pillant les ressources naturelles et les biens communs à l’humanité8.
Les institutions judiciaires nationales et internationales sont bien faibles face à de puissantes collusions entre intérêts économiques et politiques. La corruption reste toujours aussi élevée.
Voici quelques exemples de fautes et de crimes commis par des multinationales ou certaines filiales, leur qualification juridique ainsi que des affaires déjà jugées. On verra ainsi que ces entreprises et leurs dirigeants sont des sujets de droit privé qui n’échappent pas à la justice. Leur participation à ces faits est constitutive de faute civile et d’infraction pénale, entraînant la responsabilité civile et pénale de la multinationale et/ou de ses dirigeants ou agents, si l’on peut démontrer leur connaissance de ces agissements et leur intention d’y participer.
Certaines affaires, échappant à la justice, sont réglées par des instances d’arbitrage, d’autres par des « tribunaux d’opinion » citoyens.
I. QUAND ELLES SONT AUTEURS DIRECTS OU CO-AUTEURS
Des entreprises commettent elles-mêmes des violations diverses du droit international comme le pillage des ressources naturelles, la surpêche dans les eaux territoriales d’un État, des atteintes graves à l’environnement : marées noires, dégazage des soutes de pétroliers en haute mer, destruction de deltas (Niger), empoisonnement et disparition d’habitats naturels de populations indigènes (Amazonie), atteintes aux droits humains, etc.
Une initiative citoyenne a d’ailleurs été lancée concernant la notion d’écocide comme crime contre la paix, ainsi que l’avait évoqué en 1972 le Suédois Olof Palme. Il commentait alors les ravages de l’agent orange au Vietnam, lors d’une conférence des Nations unies sur l’environnement humain, à Stockholm. Cela n’a pas été retenu dans le Statut de la Cour pénale internationale (Rome, 1998) à côté des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, crime de génocide et celui d’agression pouvant être jugés par cette cour. Le mouvement End Ecocide n’en revendique pas moins la mise en place d’une justice internationale de l’environnement et de la santé9.
A. Exemples d’atteintes graves à l’environnement souvent accompagnées de violations de droits humains et de corruption
Dans cette catégorie, une entreprise incarne la multinationale la plus dangereuse en des domaines très divers, avec notamment la fabrication de l’agent orange utilisé lors de la guerre du Vietnam. Pour ses atteintes à la santé, à la sécurité alimentaire, à la diversité agricole, à la production de produits phytosanitaires et autres, Monsanto est devenue emblématique. Certaines procédures judiciaires démontrent que les justices nationales et locales sont bien faibles face à la puissance d’action d’une telle entreprise.
1. Monsanto
a) L’affaire du Roundup
Basé aux États-Unis, à Creve Coeur dans le Missouri, le groupe produit entre autres un puissant herbicide, le glyphosate commercialisé sous le nom de Roundup. Celui-ci a d’ailleurs été utilisé pour détruire les champs de coca en Colombie tout comme des portions importantes de la forêt amazonienne, cela avec l’appui de Washington. Le Roundup est associé à des cultures transgéniques qui lui résistent mais les paysans sont dès lors obligés de n’acheter que des semences brevetées par Monsanto. Cette méthode présentée comme plus rentable pour les paysans s’est avérée catastrophique sur le plan économique, sanitaire et phytosanitaire dans plusieurs pays.
En janvier 2007, la société Monsanto fut condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon pour publicité mensongère concernant le Roundup. Quelques années auparavant, la firme avait déjà fait l’objet d’une condamnation aux États-Unis pour le même motif10. Depuis, il ne leur est plus possible d’indiquer que le Roundup est un produit sans risques pour l’environnement. L’emploi du terme « biodégradable » sur l’étiquette des produits a été jugé contraire aux normes en vigueur sur les pesticides, la firme ne peut donc l’utiliser que si elle prouve que ce n’est pas le cas11. La condamnation a été confirmée en appel, le 29 octobre 2008, et Monsanto a été obligée de verser une amende de 15 000 euros12.
En avril 2015, le glyphosate a été classé comme « probablement cancérogène » par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) basée à Lyon. « L’information est énorme. En France, un champ de blé sur trois est traité au glyphosate. En Europe, pas moins de 400 entreprises en commercialisent, à travers 30 désherbants différents. Ailleurs dans le monde, une bonne partie des maïs et soja OGM ont été conçus pour être “Roundup ready”, c’est-à-dire résistants au glyphosate. Ce qui permet d’épandre du glyphosate sur un champ et y tuer toutes les plantes sauf les OGM. Ce qui permet à Monsanto de vendre à un agriculteur à la fois la plante et l’herbicide. Génial », écrit Rue8913.
Le site de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) annonçait la publication de son avis pour fin 2015.
b) les semences génétiquement modifiées
Selon l’association Inf’OGM14, le 4 avril 2012, un juge du tribunal de l’État du Rio Grande do Sul (Brésil) a interdit à Monsanto de prélever des redevances sur le soja OGM. Il a également exigé que l’entreprise restitue les frais de licence payés par les agriculteurs depuis 2003.
La Cour suprême du Brésil a décidé, à l’unanimité, que le jugement de cet État s’appliquait à l’ensemble du pays.
D’après Inf’OGM, le remboursement en question avoisinerait les 6,2 milliards d’euros pour plus de 5 millions d’agriculteurs brésiliens. En outre, en cas d’inexécution de ce jugement, le groupe américain encourt une pénalité de 400 000 euros par jour.
Le 12 juin 2012, la Cour suprême du Brésil a décidé, à l’unanimité, que le jugement de cet État s’appliquait à l’ensemble du pays.
c) Corruption en Indonésie
En janvier 2005, Monsanto a été poursuivie aux États-Unis par la Securities and Exchange Commission (SEC)15 pour corruption et a accepté de payer une amende de 1,5 million de dollars (1 million au ministère de la Justice et 500 000 à la SEC). L’entreprise était accusée d’avoir versé un « paiement illégal » de 50 000 dollars à un responsable indonésien du ministère de l’Environnement pour faciliter l’adoption par l’Indonésie du coton transgénique. La société avait faussement comptabilisé la somme versée à cette personne comme des « honoraires à un consultant ». La plainte mentionne aussi qu’entre 1997 et 2002, Monsanto a effectué pour 700 000 dollars de paiements illicites à environ 140 employés du gouvernement indonésien et à leurs familles. Le ministère de la Justice a par ailleurs nommé un expert qui, pendant trois ans, a analysé les comptes de la multinationale.
Les poursuites devaient être abandonnées si la société ne commettait pas d’infractions pendant cette période probatoire. Monsanto a introduit le coton transgénique en Indonésie en 2001, avant d’arrêter cette activité pour se consacrer à la vente d’herbicides et de semences traditionnelles. Les producteurs se plaignaient du manque de rentabilité de ces cultures.
d) Victoire des abeilles
En octobre 2014, après deux ans de procédures, des apiculteurs de la péninsule du Yucatán au Mexique ont remporté un procès contre le géant américain. Ils s’opposaient à la décision du ministère de l’Agriculture d’autoriser la plantation d’OGM. Le juge a révoqué cette autorisation et demandé que, conformément à la Constitution, des référendums à ce sujet soient tenus dans les communautés autochtones Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Peto et Tizimin avant tout changement en la matière16. La victoire est encore loin d’être définitive. Monsanto, soutenu par les autorités fédérales, a introduit divers recours contre le jugement. Ils ont été jusqu’à demander la destitution d’un juge qui les avait déboutés. L’affaire est suivie avec grand intérêt par les États voisins du Quintana Roo et du Chiapas, confrontés à la même question17.
e) Propriété intellectuelle : de la biopiraterie ?
Cependant, les condamnations paraissent bien légères pour Monsanto, qui accumule des milliards de dollars de profit avec ses produits herbicides et ses semences génétiquement modifiées : 2,74 milliards de dollars de bénéfice net en 2013-2014. Le livre de Marie-Monique Robin, Le monde selon Monsanto18, explique à quel point l’OMC permet aux multinationales de couvrir leurs manœuvres les plus criminelles, entre autres, par le biais de l’accord sur la propriété intellectuelle signé en 1994.
L’accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est la création d’une coalition d’entreprises actives dans le domaine des biotechnologies et de la pharmacie voulant étendre au reste du monde le système des brevets existant dans les pays industrialisés. Les États qui protègent leurs ressources végétales et animales sont privés de leurs droits sur ces ressources nationales dès lors que de grosses entreprises pharmaceutiques acquièrent des brevets exclusifs sur des procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux. Ces sociétés transnationales peuvent ensuite toucher des royalties sur leurs « créations » génétiquement modifiées. En attendant, elles sont donc accusées de piller les savoirs traditionnels des populations locales concernant les espèces naturelles. Cette pratique est qualifiée de « biopiraterie légalisée »19.
2. Doe Run/Renco contre le Pérou
Dans cet exemple, nous voyons à quel point l’introduction d’un mécanisme d’arbitrage des différends entre investisseurs et États20 rend très difficile la promulgation de nouvelles lois pour protéger davantage l’environnement.
Doe Run appartenant au Groupe Renco, un fond d’investissement, est une entreprise minière américaine produisant du plomb, du zinc, du cuivre. Le gouvernement péruvien avait exigé qu’une entreprise du groupe, Doe Run Peru, nettoie la pollution massive et très toxique que ses activités avaient occasionnée dans le pays. La filiale a été déclarée en faillite en 2010, laissant l’environnement pollué. Les citoyens du site La Oroya ont intenté une action en justice contre Renco au Missouri – où est localisé le siège de l’entreprise –, pour les dommages dont souffrent les enfants, intoxiqués par le plomb. Renco a contrattaqué en lançant un arbitrage international contre le Pérou devant un « tribunal investisseurs/États » arguant des violations de l’accord de libre-échange entre les deux pays (US-Peru Free Trade Agreement).
La société Renco réclame par ailleurs 800 millions de dollars de dédommagements à cet État andin pour la perte de sa filiale, ainsi que le remboursement des dommages éventuels qu’elle risque de devoir payer si le Pérou obtenait gain de cause dans la plainte déposée au nom des enfants intoxiqués21. Aujourd’hui, le site de La Oroya n’est toujours pas assaini. En 2014, le Blacksmith Institute l’a placé au quatrième rang des endroits les plus pollués au monde. 99 % des enfants présentent un haut degré d’empoisonnement au plomb22.
3. Pacific Rim contre l’État du Salvador
Même conséquence néfaste d’un accord de libre-échange : la société Pacific Rim Mining Corporation (basée à Vancouver au Canada), achetée par le puissant groupe canado-australien Oceana Gold en novembre 2013, poursuit le gouvernement du Salvador pour son refus d’octroyer à l’entreprise une licence d’extraction de l’or23.
Une rivière passant par le village de San Sebastian a été entièrement polluée par les produits utilisés pour extraire l’or, notamment de l’arsenic. Toute la vie aquatique a été détruite et l’eau polluée a causé des dégâts environnementaux jusqu’à son arrivée à la mer. Les populations villageoises ne peuvent plus consommer cette eau vu le haut taux d’empoisonnement à l’arsenic. Or, la multinationale veut ouvrir une nouvelle mine d’or mais le gouvernement s’y oppose. Il veut empêcher toute nouvelle pollution de ses réserves d’eau. L’entreprise poursuit donc ce gouvernement devant le CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements) pour entrave à son activité et réclame une somme de 301 millions de dollars, à un pays très endetté dont près de 30 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Plus de 300 ONG appuient le gouvernement salvadorien dans sa démarche contre cette multinationale qu’elles accusent de sabotage du processus démocratique au profit d’un arbitrage qui ne sert que ses intérêts. Trois d’entre elles, le Centre Europe – Tiers monde (CETIM), l’Institute for Policy Studies et le Center for International Environmental Law (CIEL) ont déposé, en juin 2014, une plainte conjointe au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.
La compagnie s’était d’abord appuyée sur l’Accord de libre-échange liant la République Dominicaine à l’Amérique centrale (CAFTA-DR) puisque la société Pacific Rim est canadienne mais opère aussi aux États-Unis, qui sont partie prenante à l’accord. L’arbitrage CIRDI a rejeté la plainte lançant l’accusation de « shopping de juridiction » contre la compagnie. Ensuite, cette dernière a réattaqué le Salvador en se fondant sur la loi d’investissement qui permet aux entreprises de recourir aux juridictions internationales. Le Salvador a changé sa loi afin que de telles plaintes soient portées devant les juridictions locales mais l’effet n’est pas rétroactif. L’affaire est toujours pendante devant le CIRDI (créé par la Convention de Washington du 18 mars 1965 qui lie aussi la France et la Belgique).
L’arbitrage CIRDI a rejeté la plainte lançant l’accusation de « shopping de juridiction » contre la compagnie.
Ce cas exemplaire interpelle tous les opposants au projet de partenariat transatlantique Europe – États-Unis24.
4. Glencore en Zambie et au Congo
En Zambie, dans la région de Mufulira, une filiale de Glencore, puissante compagnie anglo-suisse enregistrée à Jersey, Mopani Copper Mines a fortement pollué le sol, l’air et l’eau par des émissions non contrôlées de dioxyde de soufre, ce qui a causé de graves effets sur la santé des populations locales : maladies respiratoires sévères, contamination de la faune et de la flore dont dépendent ces populations pour leur alimentation. De plus, cette filiale s’est livrée à d’importantes évasions fiscales25.
Malgré ses confortables bénéfices, Glencore avait reçu des aides financières de la Banque européenne d’investissement (BEI). 50 millions de dollars devaient servir à moderniser la fonderie de cuivre de Mufulia en vue de réduire sensiblement les émissions de dioxyde de soufre. Selon la BEI, ce prêt a permis « l’élimination effective de la moitié des émissions de SO2 rejetées par la fonderie ». Si la moitié seulement des émissions a été supprimée, cela signifie que la pollution se poursuit. Malgré les faits avérés de fraude fiscale, jamais la BEI n’a pris des mesures contre cette entreprise. En effet, le 5 février 2015, l’institution financière publiait un communiqué dans lequel elle reconnaît n’avoir pas reçu d’informations suffisantes de la part de Glencore pour mener une enquête approfondie. La multinationale ayant remboursé son emprunt, le dossier a été refermé26.
Malgré les faits avérés de fraude fiscale, jamais la BEI n’a pris des mesures contre cette entreprise.
En République démocratique du Congo : par les activités d’extraction minière de sa filiale Kamoto Copper Company (KCC) à Kolwezi au Katanga, Glencore cause de gros dégâts à l’environnement en polluant l’air et l’eau. S’il est vrai que l’entreprise a construit des écoles, des centres de soins et soutenu d’importants projets d’élevage ou d’agriculture, il faut préciser que « des 15 millions de francs [suisses] comptabilisés en 2011 au titre de dépenses communautaires, près de 90 % ont été consacrés à des infrastructures qui profitent à la firme comme la construction de routes ou la réfection d’un aérodrome. Ensuite, Glencore ne tient pas compte de l’impact de ses décisions sur les populations locales. Des routes utilisées par les villageois traversant la concession ont, par exemple, été fermées au public sans aucune consultation. La population de plusieurs villages est désormais contrainte de faire un détour de 10 kilomètres afin de vendre sa production de fruits et légumes et ainsi gagner sa vie », signale la European Coalition for Corporate Justice.
Si, en avril 2012, la multinationale déclarait avoir réglé le problème de pollution des eaux provoqué par sa fabrique Luilu, « l’analyse d’échantillons prélevés dans le Canal Albert et la rivière Pingri montre que les concentrations de cuivre et de cobalt dans ces cours d’eau dépassent largement les limites fixées par la loi et recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La teneur en cuivre est ainsi jusqu’à six fois supérieure aux valeurs seuils et celle en cobalt même jusqu’à 53 fois. Les poissons ont disparu de la rivière Luilu et les berges ressemblent à de la “terre brûlée”. Les personnes qui habitent en aval de la mine ne peuvent utiliser l’eau de la rivière ni pour leurs besoins quotidiens, ni pour irriguer leurs champs », signale cette coalition européenne27.
Les associations de la société civile Pain pour le prochain, Action de carême et Rights and Accountability in Development (RAID) ont aussi effectué des recherches sur la mine de Mutanda Mining (Mumi) dans la Basse-Kando, dont la majorité des actions est détenue par Glencore. La zone est en réalité une réserve de chasse où la loi interdit expressément toute activité extractive. Et pourtant, Mumi a obtenu une concession…
5. Chevron/Texaco accusé de crime contre l’humanité en Équateur
En octobre 2014, une association de victimes de très graves dommages environnementaux causés par la firme Texaco (fusionnée avec Chevron en 2001) – « L’Union des affecté(e)s par Texaco » (UDAPT) –, a déposé une plainte pour crime contre l’humanité contre le PDG de Chevron Corporation, John Watson, auprès de la procureure de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye. En cause, explique l’UDAPT : « l’intérêt personnel qu’a Monsieur Watson à ne pas réparer les dommages environnementaux causés par Texaco en Équateur, étant donné qu’il fut le principal promoteur de la fusion entre Chevron et Texaco. Cette fusion qui a propulsé la carrière de Watson est à l’origine de la deuxième plus grande entreprise pétrolière des États-Unis, un revers serait désastreux pour lui et pour ses intérêts au sommet de la hiérarchie de la compagnie. »
L’accusation selon le communiqué des plaignants : « Le PDG-président est accusé d’avoir participé à la création d’un espace vital contaminé, au harcèlement des populations d’une région, et pire, à maintenir de manière indéfinie ces conditions qui violent les droits fondamentaux définis comme crime contre l’humanité, selon les termes définis par le Statut de Rome, ratifié par l’Équateur le 5 mai 2002 [mais non par les États-Unis, ndlr]. D’autre part, il est reproché à Watson de “continuer à fuir [ses] responsabilités, et de contribuer, à chaque opportunité qui se présente, à empêcher que la contamination de l’Oriente soit réparée”. »28
En mars 2015, la procureure de la CPI, créée pour juger les auteurs physiques (donc, non les multinationales comme telles) des crimes de droit international les plus graves (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crime d’agression), a répondu aux avocats équatoriens qu’elle ne voyait pas matière à l’ouverture d’une enquête sur le principal dirigeant de Chevron. Les avocats lui ont néanmoins envoyé des éléments supplémentaires, comme elle leur en laissait la possibilité29.
L’affaire est en effet gigantesque ! De 1964 à 1999, Texaco a provoqué, voire autorisé, une déforestation illégale conduisant à la fragmentation écologique d’un vaste territoire de l’Amazonie équatorienne. La firme a délibérément déversé des millions de tonnes de déchets toxiques – liés aux forages et à l’exploitation pétrolière – en pleine jungle ou dans les fleuves ou marais, sur plusieurs centaines de sites, dont le parc national Yasuni (point chaud de biodiversité) et une réserve ethnique habitée par un peuple autochtone, les Huaorani. Résultat : quelque 30 000 Équatoriens poursuivent la multinationale pour avoir contaminé leur sol et leurs cours d’eau. Cette pollution a des conséquences catastrophiques pour la santé : les taux enregistrés de cancers, leucémies, problèmes digestifs et respiratoires sont sensiblement supérieurs à ceux du reste du pays. Nombre de personnes ont dû abandonner leurs terres.
La firme a délibérément déversé des millions de tonnes de déchets toxiques […] en pleine jungle ou dans les fleuves ou marais…
Voici un rappel du marathon judiciaire complexe aboutissant à cette plainte devant la CPI.
La première démarche remonte à 1993, quand des citoyens équatoriens s’adressent à la Cour fédérale de New York. En 2002, la Cour d’appel de New York renvoie l’affaire devant les tribunaux équatoriens. Le procès de Chevron/Texaco est un cas sans précédent : c’est la première fois qu’une transnationale pétrolière doit comparaître devant la justice d’un pays du tiers-monde à la suite d’une dénonciation faite par des particuliers. En 2003 donc, plainte est déposée à la Cour supérieure de Nueva Loja, à l’époque site principal de la firme en Équateur.
Pendant l’année 2005, Chevron utilise divers artifices pour saboter l’inspection des sites contaminés. L’année suivante, le gouvernement de Quito accuse la multinationale de fraude dans son programme de réparation des dommages. Il faudra attendre 2011 pour qu’un juge équatorien condamne le groupe pétrolier à verser plus de 18 milliards de dollars pour dégâts environnementaux. Mais en janvier 2012, en appel, Chevron est condamnée à payer 9,5 milliards. L’entreprise doit présenter publiquement des excuses aux victimes, sans quoi l’amende sera doublée et portée à 18 milliards30. Chevron se dit victime d’une conspiration et refuse de payer.
L’entreprise n’ayant plus aucun actif en Équateur, les avocats des victimes ont dû recourir à la Convention interaméricaine d’exécution des jugements pour faire appliquer la décision de justice. Mais comme les États-Unis ne sont pas parties à cette convention, les plaignants ont dû agir dans des pays où Chevron avait des biens. D’abord en Argentine, en vain : la firme américaine a promis un milliard de dollars d’investissements dans les gisements de gaz de schiste de Vaca Muerta en échange de la levée de cet embargo. Le 4 juin 2013, la Cour suprême argentine levait le gel des avoirs de Chevron. Un mois plus tard, son PDG et la présidente Kirchner signaient en grande pompe un accord d’investissement, explique Pablo Fajardo, principal avocat des victimes31.
Les juristes défendant les intérêts des Équatoriens ont ensuite travaillé sur une procédure au Canada. Dans le même temps, Chevron a initié aux États-Unis un procès32 contre certains avocats des victimes, les accusant de conspiration et de tentative d’extorsion.
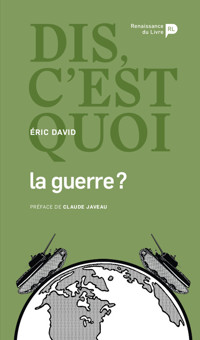













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














