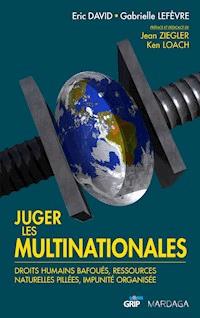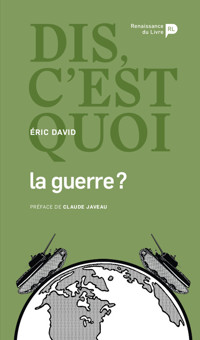
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La guerre est un affrontement armé de forces collectives représentant un État ou un groupe armé assez organisé pour s’apparenter à un acteur de droit. L’ouvrage analyse ses origines et ses causes qui vont souvent de pair avec des causes économiques et idéologiques conjuguées à la personnalité très forte de dirigeants politiques. Pourquoi existe-t-il un droit de la guerre alors que le droit international interdit l’emploi de la force armée ? À partir de quand peut-on parler de « légitime défense » ? Quelles sont les règles régissant la conduite des hostilités et les moyens mis en place pour s’assurer qu’elles soient respectées ? Toutes ces questions, et plus encore, sont abordées.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Éric David enseigne le droit international public depuis 1973 à l’Université libre de Bruxelles, où il est professeur émérite depuis 2009. Il applique concrètement son expertise en droit international par les consultations qu’il fournit à des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et son activité de conseil de différents États devant la Cour internationale de Justice.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dis,
c’est
quoi
la guerre ?
Éric David
Dis, c’est quoi la guerre ?
Renaissance du Livre
Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Renaissance du Livre
@editionsrl
directrice de collection : nadia geerts
maquette de la couverture : aplanos
illustrations : © denis dubois
isbn : 978-2-507-05642-1
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.
Quand j’étais môme, dans les années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, ma mère avait coutume de dire, quand l’une ou l’autre revendication – surtout en matière culinaire – de la part de mes frères ou de la mienne lui semblait outrecuidante, « il faudrait une bonne guerre ». Nous venions d’en vivre une, et on ne peut pas dire qu’elle avait été bonne. Elle voulait insister sur le contraste entre ce que nous pouvions désormais trouver sur la table familiale et ce qui ne s’y trouverait pas si la guerre revenait. « Une bonne guerre » était évoqué par antiphrase. Elle avait vécu, petit enfant, la Première Guerre mondiale et en avait gardé un souvenir très peu agréable ; « bonne » signifiait « mauvaise », « néfaste » et, pour tout dire, « impensable » : une menace qui n’avait pas plus de sens qu’invoquer saint Nicolas pour nous punir quand nous n’avions pas été sages.
J’ai peu de souvenirs de la guerre au début de laquelle j’étais né, dans un faubourg de Liège. Je n’ai pas oublié pourtant les attaques que la ville a dû subir de la part des V1, les « bombes volantes » comme on disait alors, Liège devait en encaisser plus de quatre mille. On passait les nuits dans des abris improvisés, en général des caves profondes mises à notre disposition par des propriétaires qui se croyaient ainsi généreux. Mais l’atmosphère de ces caves est restée dans ma mémoire, ce qui n’a pas peu contribué à mon aversion à toute guerre et à tout récit héroïque à propos des guerriers courageux ou intrépides. Mon père, américanophile acharné (sa connaissance de l’anglais lui avait valu de jouer à l’interprète auprès de l’armée américaine, à laquelle Liège devait sa libération) m’emmenait souvent voir au cinéma des films de guerre. Je reconnais que j’y ai parfois trouvé du plaisir. Mais aucun de ces films ne faisait ostensiblement l’apologie de la guerre. Il s’agissait surtout de destins individuels relevant l’abnégation et la grandeur d’âme. Mais peut-être n’ai-je reconnu que ces deux aspects des intrigues militaires qui en général faisaient l’éloge des braves Américains, opposés aux vilains Boches ou aux perfides Japs (« faces de citron » pouvait-on lire dans la BD dont le héros s’appelait Buck Danny). Mais j’ai vite appris, par diverses lectures et d’autres films moins claironnants, qu’il n’y avait pas de « bonnes guerres », seulement des moins inacceptables que d’autres. Si votre pays est envahi par un autre pour des raisons stratégiques ou de constitution de butin, par exemple au nom de l’« espace vital », le devoir de ses citoyens est de participer à sa défense. Mais la guerre nécessaire n’en est pas « bonne » pour autant.
À l’égard de toute guerre, il y en a de moins coupables que d’autres, peu importe le « ressenti » de ceux qui la livrent d’un côté comme de l’autre. Je suis à peu près convaincu que les membres du peloton allemand qui, un matin de septembre 1941, ont fusillé mon grand-oncle René à la citadelle de Liège n’étaient pas des soudards sanguinaires et n’éprouvaient aucune haine à l’endroit de ce résistant de la première heure. Il n’empêche qu’ils ont commis, sur ordre il est vrai, un véritable crime. L’ordre donné n’excuse pas le meurtre : tout au plus peut-on considérer que les soldats de la Wehrmacht qui l’ont accompli ne sont pas les seuls coupables.
Quoi qu’il en soit, dans toute guerre, il y a toujours ou presque des bons et des mauvais. Même dans les guerres coloniales où il arrive souvent que des atrocités sont commises de part et d’autre, on ne peut les renvoyer dos à dos : les oppresseurs ne peuvent être mis sur le même pied que les opprimés, pas davantage que dans la corrida on ne devrait faire s’équivaloir, au sens moral, le torero et le taureau.
Guerre inévitable, lorsque, comme l’a si bien dit Clausewitz, elle est la continuation de la politique par d’autres moyens. Mais guerre juste ? Les deux notions ne se recoupent pas nécessairement. Depuis (saint) Augustin, en passant notamment par (saint) Thomas d’Aquin et Grotius, l’idée de « guerre juste » a connu de fortes modifications. L’internationalisation des conflits et l’existence de traités d’assistance ont apporté à cette notion des dimensions nouvelles. Ainsi, en 1914, la Grande-Bretagne est-elle intervenue dans la guerre mondiale à la suite de la violation par l’Empire allemand de la neutralité belge, garantie par les grandes nations européennes. Ce n’était sans doute qu’un prétexte, mais le fait que cette neutralité avait été effectivement violée coûta aux Britanniques plus de 700 000 morts à l’issue de plus de quatre ans de guerre ! Alors que la Grande-Bretagne elle-même n’avait pas été envahie. En dépit des efforts d’internationalisation des institutions devant intervenir en cas de menace de conflits armés (SDN, puis ONU), chaque État-nation a pu affirmer que la guerre qu’il menait était juste, même si dans les faits il s’agissait d’une invasion. Les invasions des pays destinés à devenir des colonies sont de cet ordre, les envahisseurs se drapant dans les pavillons de la civilisation apportée aux « sauvages ». Même si certains (bons) apôtres de la colonisation ont pu être sincères, vu l’esprit du temps, la civilisation a toujours eu bon dos !
Mais il est vrai que de différents bords, juristes, diplomates, moralistes ou même militaires se sont efforcés de fournir à la guerre un cadre juridique contraignant, quelle que soit la nature des guerres mises en cause. On est un peu surpris de découvrir qu’il existe un « droit de la guerre », alors qu’il s’agit d’une activité humaine brutale et criminelle dans ses effets qui n’a que faire d’être codifiée. Des matières telles que le sort des prisonniers, la discrimination entre militaires sur le terrain et civils installés fût-ce de manière passagère sur ce terrain, le renoncement à certaines espèces d’armes (par exemple, les gaz), etc., firent ainsi l’objet de conventions plus ou moins détaillées et destinées à « humaniser » la guerre. Beaucoup d’entre elles ne furent jamais effectivement respectées, ce qui donna lieu à maintes controverses, en particulier lors de la conclusion de traités dits « de paix », dont Versailles est une illustration contestable (et contestée notamment par le régime nazi).
En spécialiste de droit international averti, dans le livre que j’ai l’honneur de préfacer, Éric David se penche sur les dimensions juridiques de la guerre, avec pas mal d’exemples inspirés par des conflits parfois assez lointains dans le temps, parfois d’une actualité criante. D’un juriste certes, mais jamais aride ou compliquée, la prose d’Éric, en quelques pages bien inspirées, s’efforce de proposer un cadre de pensée à la guerre, et non seulement d’un point de vue juridique, quand il professe que « la guerre est l’expression la plus abjecte, la plus obscène de la condition humaine ». Je souscris sans réserve à cette affirmation. Car si « la guerre existe, elle n’est pas une fatalité », écrit un peu plus loin notre auteur vu qu’elle dépend de la volonté des hommes (et des femmes, quoi qu’on ait pu en dire). Mais il faudrait aussi leur enlever le goût de la guerre : dans un film de guerre dont l’action se situe au moment de la conquête de l’Italie par les troupes alliées en 1943, un général américain qui vient d’être limogé demande à un correspondant de guerre (incarné par Robert Mitchum) pourquoi les hommes se font la guerre. « Parce qu’ils aiment cela, Général », répond de manière flegmatique le journaliste.
Il faut croire qu’il n’a pas tort. Les hommes aiment s’étriper, depuis la nuit des temps. Ah, que la guerre est jolie ! est le titre d’une pièce de théâtre portée ensuite, si j’ai bonne mémoire, au cinéma. Rien de plus fallacieux que cette assertion. Quelle connerie la guerre, sauf peut-être pour ceux qui, dans la sécurité des états-majors, n’y voient qu’une espèce de Kriegspiel menée pour de vrai, par de lointains troufions loin de leurs cartes et de leurs batailles de préséance (même s’ils ont été troufions eux-mêmes, ce qui n’est pas toujours le cas, ils l’ont oublié) !
Non, il n’y a pas de bonne guerre, ou de bonnes guerres. Dire, quand on se venge de l’un ou l’autre affront, que c’est « de bonne guerre », c’est se servir d’un mot malheureux pour justifier un accident d’interaction qui n’a rien de guerrier. Méfions-nous des mots, car invoquer une bonne guerre pourrait être de mauvais augure. On pourrait croire que ceux qui recourent à cette expression y mettent quelque regret.
Il n’y a pas lieu de regretter la guerre. Il faut regretter qu’elle ait lieu, et que d’aucuns, peut-être, projettent d’en mener une nouvelle. Pour l’empêcher, un passage par ce livre, riche en enseignements, est souhaitable, voire indispensable.
Claude Javeau
Table des abréviations
AGNU Assemblée générale des Nations unies
AMISOM African Union Mission to Somalia
art. article
CAI conflit(s) armé(s) international/aux
CANI conflit(s) armé(s) non international/aux
CG convention(s) de Genève
CICR Comité international de la Croix-Rouge
CIJ Cour internationale de justice
DIH droit international humanitaire
É.-U. États-Unis
FARC Forces armées révolutionnaires de Colombie
NU Nations unies
OMS Organisation mondiale de la santé
ONU Organisation des Nations unies
OTAN Organisation du traité de l’Atlantique Nord
RDC République démocratique du Congo
RES résolution
R.-U. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
SdN Société des Nations
TMI tribunal/aux militaire(s) international/aux
UE Union européenne
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Ma série télé favorite, le journal du soir, se termine sur les images, plutôt sanglantes, d’un attentat à Nairobi attribué aux Shebab. C’est le moment que choisit Quentin, le cadet de nos deux fils, pour se rappeler qu’il a une dissertation à terminer pour avant-hier – comme d’habitude… – sur le thème « Guerre et terrorisme ». Il se tourne vers moi :
Lors des attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles du World Trade Center de New York, George W. Bush a dit que les É.-U. avaient été attaqués et qu’ils étaient en guerre contre le terrorisme. De même, lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris (à côté du Stade de France, à Saint-Denis et dans la salle de spectacle du Bataclan), François Hollande a dit que la France était en guerre contre le terrorisme. Alors, dis, c’est quoi la guerre ? Les attentats terroristes de New York et de Paris sont-ils une guerre comme la Première ou la Seconde Guerre mondiale ?
C’est pour ta dissertation que tu me poses cette question ? Tu aurais pu y penser plus tôt, non ? Bon, allons-y, mais je te préviens, nous risquons d’y passer la soirée.