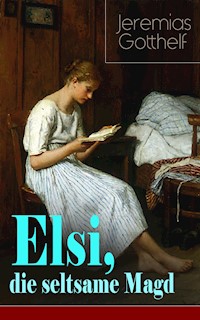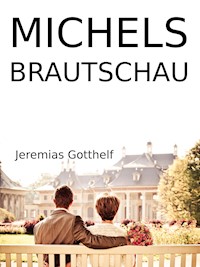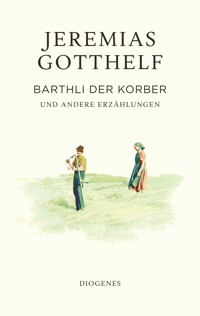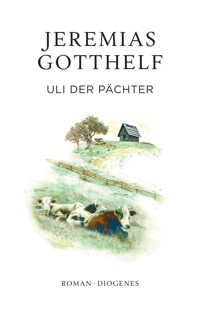0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jeremias Gotthelf
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Nous sommes au milieu du XIXe siècle dans l’Emmenthal (vallée de l’Emme). Kathi vit seule, avec son petit-fils Petit-Jean, dans un très modeste chalet près de la rivière.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Kathi la grand mère (1ère partie)
Jérémias Gotthelf
Jeremias Gotthelf est le pseudonyme (tiré de son premier roman Le Miroir du paysan ou la vie de Jérémias Gotthelf) de l'écrivain bernois Albert Bitzius (né à Morat, dans le canton de Fribourg le 4 octobre 1797 et décédé le 22 octobre 1854).
Chapitre1 Un orage couche à terre un beau champ de lin et fait sortir de terre de bonnes gens.
Si quelqu’un eût pu assister à l’enfantement des montagnes, quand ces gigantesques enfants de la terre surgirent de son sein, et, frais éclos de ses entrailles brûlantes, se raidirent au contact de l’atmosphère glacée qui l’entourait ; si quelqu’un eût été là, quand arrivèrent des brises déjà tièdes et que s’épanouirent ces enfants aux chauds rayons du soleil, quand leurs vêtements de glace se fondirent en eau, que les torrents percèrent la croûte des montagnes, s’ouvrirent des issues, creusèrent des bas-fonds, créèrent des vallées, firent de la Suisse une immense cataracte, il fût demeuré muet devant ce spectacle imposant, il eût été tellement saisi, que son âme entière fût restée dans une perpétuelle adoration.
Celui qui, au fond d’une vallée des Alpes entourée de parois de rochers que dominent des cimes neigeuses dressées droit contre le ciel et sans autre issue qu’une gorge étroite, a vu les vents chauds du midi venir heurter ces blancs sommets, les noirs nuages se plaquer sur leurs flancs, la main de Dieu serrer ces nuages pour en faire jaillir les éclairs, celui qui a entendu leurs grondements sinistres ébranler la terre, leurs pleurs rouler le long des montagnes en torrents inondant avec fracas les vallées, celui qui, abrité dans une fente de rocher, a vu à la lueur des éclairs les pentes des monts se transformer en cataractes et la vallée en une chaudière écumante pendant que le tonnerre du ciel répondait au tonnerre des eaux déchaînées – cet homme-là a certainement senti son âme s’humilier devant la grandeur de cette scène. Son émotion s’est changée en adoration ; il a eu comme une vision de la terre enfantant les montagnes, des mondes sortant du néant.
L’homme qui se serait trouvé le 22 août tout au fond d’une vallée du Canton d’Uri, au chalet dit de l’Étroit, avec une paroi de rochers abrupte devant soi et de chaque côté des montagnes gigantesques, aurait eu quelque idée de ce que nous venons de décrire. Il aurait senti passer sur lui un frisson pareil aux affres de la mort. Sa prière eût été un tremblement d’angoisse ; il serait tombé à genoux, et son âme se fût inclinée devant le Tout-Puissant dans un inexprimable sentiment de petitesse.
Le voyageur qui, du sommet arrondi d’une colline couverte d’une luxuriante verdure, contemple à ses pieds dans le fond de la vallée de jolies habitations, et sur les flancs des montagnes des arbres magnifiques, toute une contrée riche et gracieuse, a peine à se représenter les luttes et les déchirements qui ont présidé à la naissance de ces vallées et de ces coteaux, et, s’il y songe par un effort de pensée, il est forcé de s’incliner devant la Toute-Puissance de Dieu, qui se révèle non seulement dans la création des mondes et dans le tumulte des éléments, mais avec encore plus d’éclat dans l’action douce et paisible qui transforme le désert sauvage en un charmant jardin.
C’est ainsi que le voyageur arrivé au sommet d’une des gracieuses collines de l’Emmenthal, après avoir laissé ses regards errer un moment dans le vague, aperçoit dans une étroite vallée, où l’Emme a creusé son lit bordé de chaque côté d’une rangée de coteaux fertiles, où s’égrènent d’opulents villages, une maisonnette en bois, couverte de chaume. Elle est vraiment bien jolie dans la verdure qui l’entoure, et plus d’un passant, lassé du tourbillon du monde, s’est dit avec un soupir qu’il voudrait pouvoir se réfugier dans cette calme retraite. S’il s’est approché pour la voir mieux, il n’est certes point revenu de cette première impression.
La maisonnette est vieille : la plupart des petits carreaux des petites fenêtres ne laissent guère passer la lumière, mais tout est propre aux alentours ; à chaque angle de la maison un petit banc ; devant, un jardinet ; la clôture de celui-ci est en mauvais état, mais l’intérieur a tout à fait bonne façon. Point de mauvaises herbes, mais des œillets, des roses et quelques autres gentilles fleurettes. Par-delà le jardinet, on aperçoit les majestueuses Alpes bernoises, qui dressent fièrement vers le ciel leurs vénérables têtes chenues, pendant que leurs pieds s’appuient larges et puissants sur la terre.
Du petit banc devant la maisonnette, on a la vue sur une belle prairie, où coule un ruisseau paisible peuplé de truites que l’on voit s’élancer hors de l’eau limpide pour happer des mouches. Bien des gens trouveraient encore plus charmante la vue que l’on a depuis un autre petit banc derrière la chaumière. On aperçoit de là, plus au fond de la vallée, une bande de terre qui ressemble à un véritable grenier, tant elle est couverte de plantations de lin, de haricots et de pommes de terre ; en regardant bien, on y découvre également des raves, des carottes et des choux. La campagne confine à un bois, d’où sort tout un gazouillis d’oiseaux, qui y ont fait leur séjour favori ; on y entend même le chant du rossignol, si rare en Suisse. Derrière le bois retentit un murmure profond et uniforme de contrebasse accompagnant ce joyeux concert. C’est l’Emme fougueuse et indomptée, la rivière qui a creusé la vallée et qui de temps à autre rappelle aux hommes qu’elle en est la mère, mais une mère redoutable et prompte à la colère.
Celui qui, dans l’après midi du 12 juin 1845, aurait remarqué cette maisonnette, aurait pu voir aussi derrière elle, dans un champ de pommes de terre, ses habitants. Ils étaient au nombre de quatre : une vieille femme, un gamin de 4 à 5 ans, et deux poules, une blanche et une noire.
La vieille mère était au milieu des pommes de terre et enlevait à la pioche les mauvaises herbes ; elle était vêtue pauvrement, mais proprement ; sur son visage ridé rien de sale dans les rides. La figure du gamin était lisse et rose et blanche de nature, mais on ne le remarquait presque pas, car elle n’était pas aussi propre que celle de la grand’mère. Ce n’était pourtant pas la faute de cette dernière ; mais, l’eût-elle lavée tous les quarts d’heure, elle eût chaque fois trouvé beaucoup à nettoyer. C’était un joli garçon aux cheveux frisés, d’un blond pâle, mais qui avait beaucoup d’empire sur sa grand’mère et se figurait par conséquent qu’il pouvait toucher de ses mains à tout ce qu’il voulait, y compris naturellement sa frimousse. Il n’était point richement vêtu, un peu mieux pourtant que notre mère Ève n’eût habillé sa marmaille ; mais on n’aurait jamais, à le voir, deviné l’essor qu’a pris de nos temps le métier de tailleur.
Il était occupé à tailler dans des bardeaux la figure d’un poulailler et voulait à chaque instant savoir de sa grand’mère s’il serait assez grand pour abriter des poulets. En attendant, la poule noire et la poule blanche picoraient tranquillement dans le voisinage, auprès de la vieille femme surtout, parce que c’était là, dans la terre fraîchement remuée, qu’elles trouvaient le plus de nourriture. De temps en temps cependant l’une ou l’autre s’approchait du gamin et, la tête penchée, clignotait de son côté. La vieille mère aussi y jetait souvent un regard de complaisance sans laisser toutefois son croc se reposer. Elle savait tout à la fois remuer ses bras et se servir de ses yeux, ce qui n’est pas le cas de la plupart des servantes. Il semblait même que chaque fois que son regard se portait de l’enfant sur ses mains, celles-ci en eussent plus d’entrain. La grand’mère non seulement trouvait sa plus grande joie dans son petit-fils, mais il était sa vie, ses amours. C’est pourquoi elle lui était absolument dévouée. Non seulement sa vie à elle se confondait avec la sienne, mais elle l’aurait dix fois le jour joyeusement donnée pour lui. On le voyait bien du reste à ses yeux, chaque fois que son regard se reportait sur le petit garçon.
Il faisait cette après-midi-là une chaleur étouffante ; çà et là dans le ciel apparaissaient de noirs nuages, pareils à des bataillons prêts, au moindre signal, à se jeter dans la mêlée. La chaleur n’empêchait cependant pas la vieille femme de continuer sa besogne ; rarement elle s’appuyait sur sa bêche pour reprendre haleine. Elle savait combien vite le soir tombe, combien vite le temps s’enfuit, combien vite arrive la nuit dans laquelle on ne peut plus travailler.
Pour beaucoup de gens les journées ressemblent aux pièces de monnaie que l’on donne à regret, quand on arrive aux dernières. Les meilleures, ils les prodiguent, ils les laissent s’écouler comme le sable glisse entre les doigts, aussi longtemps qu’ils se figurent en avoir beaucoup en réserve, mais, que leur vie soit sur son déclin, qu’ils n’aient plus que quelques pauvres jours devant eux, voilà que tout d’un coup ils se mettent à l’œuvre et comptent ces jours avec sagesse. Seulement ils ne savent plus alors comment s’y prendre.
Ce n’est pas ainsi que cette brave femme avait fait. Elle avait toujours travaillé consciencieusement et toujours plus assidûment à mesure qu’elle vieillissait, et, ce jour-là, elle mettait à sa besogne un zèle tout particulier. Elle s’était donné une tâche qu’elle voulait achever, ne sachant pas si elle aurait le temps le lendemain, ni combien l’orage tarderait encore. Elle se réjouissait au fond de son cœur en pensant que les gens diraient : « C’est tout de même Kathi qui est la plus assidue ; elle est prête à son ouvrage quand les autres ne font que commencer le leur. Si tout le monde était comme elle, il y aurait moins de nécessiteux et les pénitenciers ne seraient pas si garnis. »
Elle avait enfin sarclé son dernier sillon.
– Dieu soit loué, voilà qui serait fait ! se dit Kathi, de son nom complet Kathi Hänzig. Elle essuya proprement son croc, et dit : « Allons ! mon petit ! rentrons ! mais, auparavant, allons voir si le lin va fleurir. »
Le champ de lin n’était séparé des pommes de terre que par deux rangées de haricots, et, comme on peut bien se le figurer, sans être bien grand, il représentait le trésor de la vieille femme. Car il lui fournissait en majeure partie de quoi payer son loyer. Il eût été difficile d’ailleurs de trouver un champ de lin mieux soigné ; il avait l’avantage d’être fertile, sablonneux, arrosé par les débordements de l’Emme, et, probablement, mélangé d’un peu de marne. Kathi était renommée pour son lin. Rien au monde ne lui faisait plus de plaisir que lorsque quelqu’un lui disait : « Vous avez le plus beau petit garçon et le plus beau lin qui se puissent voir à la ronde. »
Ce jour-là, Kathi eut du plaisir à regarder sa plantation et se dit : « S’il plaît à Dieu, j’aurai une bonne année et je n’aurai pas besoin d’être en souci pour ma nourriture et pour mon loyer. »
Au fait, le petit champ avait belle apparence. Le lin avait bien deux pieds de haut ; il n’était pas encore en fleurs, mais il était dru, fin et bien droit dans son réseau. Il était garni, en effet, de petits bâtons espacés d’un peu plus d’un pied, parfaitement alignés, absolument de même hauteur ; de l’un à l’autre couraient de gros fils entrecroisés qui formaient comme un damier. Le lin avait cru au milieu de ces fils, qui lui avaient donné un point d’appui et de la vigueur, en sorte que le vent ne pouvait ni le plier, ni le verser, ce qui, comme on sait, lui est nuisible et fait qu’il rend peu et manque de consistance.
Sur le court chemin qu’elle avait à faire pour rentrer chez elle, Kathi calculait dans sa pensée le rendement de son champ, le comparait avec ce dont elle avait besoin et dressait son bilan. Une brave femme comme elle a son livre de ménage dans la tête et calcule, chemin faisant, aussi bien qu’un marchand ; elle se trompe à peine plus que lui ; seulement les sommes ont une autre importance.
La maisonnette, comme nous l’avons dit, était située un peu au-dessus du terrain des plantations, et jouissait par conséquent d’une vue plus étendue. Toujours plongée dans ses calculs, Kathi déposa son sarcloir, passa devant la chaumière pour aller chercher du bois pour cuire son souper, et remarqua seulement alors l’aspect menaçant du ciel. Du côté du nord, le Jura était couvert de noirs nuages ; au midi, sur les Alpes, d’autres nuages se dressaient comme des tours marquées de traînées blanches, vraies montagnes s’élevant vers le ciel au-dessus des autres cimes.
– Oh ! mon Dieu ! soupira la vieille. Comme le temps est menaçant ! Pourvu que le bon Dieu nous préserve de la grêle et de l’ouragan ! Nous l’aurions bien mérité sans doute, mais s’il nous punissait selon nos péchés, qui pourrait subsister ?
Là-dessus le gamin arriva en courant : « Grand’mère, criait-il, viens donc voir comme les poissons sautent hors de l’eau ! Ça doit être bon pour la pêche. Fais-moi bien vite un hameçon ! »
– Qu’est-ce que tu veux faire avec ces poissons ? répliqua la grand’mère ; tu ne saurais en tirer parti !
– Les vendre, grand’mère, les vendre ! La Mareili de chez l’aubergiste m’a dit qu’ils valaient beaucoup d’argent, beaucoup, beaucoup de batz.
– Oui ! les gros ! mais de ceux-là il n’y en a pas dans le ruisseau. Il n’y en a que des tout petits, et ceux-là ne valent rien.
– On les cuit et on les mange soi-même. La Mareili m’a dit qu’ils étaient rudement bons ; ils en ont souvent de pareils, quand le père n’est pas à la maison.
– Ah, bien vrai ? Mais tu ne les aimerais pas. Et puis les poissons ont des arêtes qui vous étranglent. Voudrais-tu être étouffé ?
– Oh ! non ! grand’mère ! Pas ça ! Mais Mareili en a souvent mangé, et elle n’est pas morte pour ça ; ce qu’elle mange je puis bien aussi le manger, et je le trouverai aussi bon qu’elle.
– Mais tu vois, mon garçon, je n’ai pas le temps maintenant. Il faut que je fasse des pommes de terre rôties ; pense donc, des pommes de terre rôties, comme tu les aimes tant !
– Je ne les aime plus, grand’mère, j’en suis dégoûté. C’est un hameçon que je veux, un hameçon !
Et le voilà pleurant.
– Grand’mère ne m’aime pas ! Non, elle ne m’aime pas !
Le gamin savait bien que c’était là le trait sensible au cœur de la grand’mère, et qui ne manquait jamais son but.
– Ah, mon petit ! Tais-toi donc ; tais-toi ! disait la brave femme tout épouvantée. Tais-toi ! et ne dis pas de pareilles choses ! Ne pas aimer les pommes de terre rôties ! Bon Dieu ! Que veux-tu donc manger ? À quoi penses-tu ? Si le bon Dieu voulait maintenant que nos pommes de terre fussent grêlées, ou que l’Emme débordât, que mangerais-tu ? De quoi faudrait-il nous nourrir ? C’est bien alors que tu en voudrais ! Tu ne sais pas encore ce que c’est que des pommes de terre. Prie seulement le bon Dieu qu’il ne te faille jamais l’apprendre comme moi en l’an seize. Tes joues rouges s’en iraient, s’il te fallait vivre de poisson et n’avoir plus de pommes de terre.
Tout en chapitrant ainsi le petit, elle lui fabriquait un hameçon, c’est-à-dire qu’elle attachait à un fil une épingle recourbée. Le gamin suivait avec grande joie cette opération, et nous doutons fort qu’il ait rien entendu de ce petit sermon.
– Tiens, voilà un hameçon ! Mais ne va pas me tomber dans le ruisseau. Sinon gare à toi !
Avant que la brave femme eût achevé, l’hameçon et sa ligne étaient déjà dans le ruisseau.
Alors seulement elle put allumer son feu, bien nettoyer son croc et donner la pâtée du soir à ses poules, qui regagnèrent ensuite avec empressement leur perchoir accoutumé dans un coin de la cuisine.
– Ah ! mon Dieu ! disait Kathi, qui de temps en temps allait à la porte surveiller le gamin, quels éclairs ! on dirait qu’on vide des corbeilles de feu.
Que le bon Dieu ait pitié des pauvres gens sur qui passe l’orage !
– Vois, grand’mère, ces chaînes de feu qui se promènent ! Si elles étaient d’or, et si tu en avais une et moi une, alors, grand’mère, nous serions assez riches, nous achèterions un coq, et nous aurions encore plus de poules, et des moutons, des chevaux, des vaches. Et moi je serais un riche paysan. N’est-ce pas, grand’mère ?
– Eh, mon petit gars, ce que tu peux dire ! Qu’est-ce qui te vient à l’esprit ? Allons, rentre ! Écoute comme il tonne dans le lointain ! Si cela vient par ici, Dieu ait pitié de nous !
La grand’mère eut bien à faire jusqu’à ce qu’elle eut pu faire rentrer le petit qui était tout à ses poissons. Tant que le tonnerre est éloigné, les enfants et même les grandes personnes sont singulièrement crânes, et les héros sont aussi serrés dans la campagne que les tiges de lin dans le champ de Kathi. Mais plus tard, quand la foudre et les éclairs éclatent au-dessus des têtes, quand le torrent baigne les pieds, quand le danger est proche, alors les rangs des héros s’éclaircissent et celui d’entre eux qui faisait le plus le rodomont, tant que l’orage était de l’autre côté de la montagne, s’éclipse quand l’éclair déchire l’air au-dessus de sa tête. Et, par contre, voici que dans le danger ceux-là deviennent des héros qui mettaient en garde contre lui et avaient l’air de trembler quand il était encore éloigné et ne semblait être qu’un nuage dans les brumes d’un rêve.
La grand’mère laissa l’enfant à ses poissons jusqu’à ce qu’un éclair éblouissant passât près d’eux, suivi d’un assez fort coup de tonnerre, avant-coureur de l’orage. Alors, adieu les poissons et les chaînes d’or ! L’enfant se précipita vers la vieille mère et la supplia de bien fermer la porte pour empêcher le tonnerre et les éclairs d’entrer. Mais ce qui ne vient pas par la porte pénètre souvent par la fenêtre, et, au moment où ils entraient dans la maison, une lueur rouge les aveugla…
– Grand’mère, s’écria le petit Jean, il brûle ! Et il cacha sa tête dans son tablier. La grand’mère eut bien de la peine à l’amener à la table où elle avait placé leur frugal repas : du café et des pommes de terre rôties dans un peu, bien peu de beurre.
Le petit était à la fois un crâne gamin et un enfant craintif. Il n’avait aucune frayeur de ce qu’il pouvait comprendre, mais il tremblait avant tout devant ce qui du monde invisible faisait irruption dans son monde à lui, devant tout esprit qui pouvait apparaître. Et comme les esprits se montrent la nuit, il avait peur de la nuit. Lorsqu’il était assis dans la chambrette aux côtés de sa grand’mère et qu’elle lui racontait des histoires d’esprits, ou lorsqu’il entendait le tonnerre du bon Dieu rouler dans le lointain et voyait les éclairs lancer le feu sur la terre, il tremblait. Mais dans cette crainte il n’y avait rien de pénible ; c’était quelque chose de doux plutôt et de bienfaisant ; l’assurance que là, dans cette petite chambre, il était à l’abri, bien gardé, et qu’aucune puissance maligne ne lui pouvait rien.
– Prie, Jeannot, dit la grand’mère.
Et tous deux joignirent les mains.
– Ô mon Dieu ! nourris tous les enfants pauvres qui sont sur la terre, priait le petit Jean.
Les éclairs devenaient toujours plus fréquents ; en revanche, il faisait presque nuit, bien que le soleil fût à peine couché. D’épais nuages s’étaient abaissés vers la terre, se traînant noirs et menaçants sur les collines, pareils à une armée qui se lève et s’étend lentement sur la plaine pour livrer une bataille sanglante. Les avant-coureurs de l’orage s’approchaient en grondant ; des coups de vent isolés gémissaient dans les arbres en inclinant leurs faîtes jusqu’à terre, le tonnerre roulait sourd et puissant, toujours plus près, et la maisonnette était toute ébranlée.
– Oh ! mon Dieu ! soupirait la vieille, voilà qu’il fait nuit ! Écoute quel vacarme ! Et ces nuages qui se traînent sur le sol ! Il y a longtemps que je n’ai vu le ciel aussi noir. Qu’est ce que le Seigneur veut faire de nous ? Prie, Jeannot, dis la prière en temps d’orage ! Notre Seigneur entend bien comme il tonne et comme il vente.
Petit Jean joignit de nouveau ses petites mains et pria : « Garde nous, ô mon Dieu, de tout mal, de l’orage, de l’inondation et de la mort ; envoie nous des anges pour nous protéger pendant cette nuit, et quand il nous faudra mourir, donne nous une part d’héritage dans ton ciel. Amen !
– Sais-tu encore « Notre Père ? » demanda Kathi.
Petit Jean commença. Tout à coup quelque chose heurta aux parois de la maisonnette et frappa d’un coup sec et étrange le bois coupé menu entassé contre elles.
Kathi devint blême, se leva en sursaut et s’écria :
– Oh ! mon Dieu ! la grêle !
Tout s’arrêta un instant au dehors.
– Prie, Jeannot, prie ! Il y aurait trop de mal s’il fallait encore avoir la grêle. Que faudrait-il manger ? Que faudrait-il faire ?
À peine la brave femme avait-elle prononcé ces mots, que les coups recommencèrent au dehors, toujours plus précipités, jusqu’à ce qu’enfin les grêlons crépitèrent violemment contre les parois et les fenêtres. Les éclairs se succédaient sans interruption ; les coups de tonnerre s’entremêlaient et faisaient trembler la terre.
Terrible et imposant se déchaînait un orage tel qu’on en voit rarement même dans la montagne ; un de ces orages qui épouvantent les mortels, et pendant lesquels les lèvres les plus impudentes ne peuvent se défendre d’invoquer le secours et la compassion du Tout-Puissant. Les éléments semblaient avoir rompu leurs entraves et se ruer l’un sur l’autre avec une sauvage fureur. Dans ce mélange d’eau et de feu, sous les coups de la tempête, la terre était la proie de l’inondation et de toutes les violences, comme si, réduite en pièces, ses débris devaient aller s’engloutir dans l’océan où roulent les vagues sous la main de Dieu. Les trois éléments déchaînés contre le quatrième semblaient, dans leur aveugle courroux, rivaliser de rage pour l’anéantir, insensibles aux misères des créatures sourdes à leur effroi. La pluie et la grêle ruisselaient en masses serrées avec un cliquetis sinistre ; les éclairs illuminaient de leurs traits de flamme les maisons et les forêts ; les fondements de la terre s’ébranlaient sous la violence du tonnerre ; les eaux des abîmes s’en échappaient ; les parois des montagnes roulaient vers les vallées ; les torrents heurtaient le flanc des rochers, franchissaient les digues et se répandaient dans la campagne.
C’était une de ces révoltes de la nature, dans lesquelles rois et mendiants se rendent compte également de leur impuissance et où toute âme qui pense sent, dans une profonde humilité, combien l’homme est néant : une fleur des champs qui se flétrit quand un vent passe sur elle. Les yeux cherchent alors involontairement en haut la main qui a fondé les mondes, qui commande aux éléments et met un frein à la fureur de l’orage.
La grand’mère et son petit-fils étaient là, abasourdis, au milieu de ce tumulte des éléments ; ils avaient joint leurs mains sur la table et d’abondantes larmes roulaient sur les joues de la bonne femme. Elle voyait ses plantations abîmées, anéanties, avec tout le fruit de ses peines ; elle ne trouverait ni joie ni nourriture dans ce qu’elle avait cultivé à la sueur de son front ! C’était comme si une épaisse et sombre nuée oppressait son âme. Ce n’était pas ce qu’éprouve un capitaine de vaisseau, lorsque, en plein océan, le feu éclate dans son navire battu des vagues, sans une voile libératrice à l’horizon, et que, la tête baissée, dans une muette prière, il se résigne à sombrer. Non. Ce qu’éprouvait Kathi, c’était la lassitude du voyageur épuisé, qui, après une longue et pénible journée de marche, se réjouit de passer une bonne soirée dans une auberge hospitalière, et qui, arrivé au sommet de la montagne, au lieu d’une auberge, ne voit devant lui qu’une plaine sans fin, couverte d’une épaisse couche de neige, balayée par des vents glacés ; et il faut qu’il s’y aventure sans un but devant lui, sans prévoir le terme de ses efforts ! Un accablement inexprimable s’empare de lui ; toutes ses pensées lui échappent ; il ne lui reste plus qu’une ressource : dormir ! Ah ! dormir ! Se reposer, n’avoir plus à lutter contre la neige pour trouver son chemin…
Voilà ce qui arrivait à Kathi après 70 ans de lutte et de devoir accompli. Elle était là, anéantie devant la montagne abrupte de la détresse, sans force, brisée, et, pour tourner cette montagne, pour la conduire au repos tant désiré, pas d’autre chemin que la mort !
La grand’mère fut soudainement arrachée à cet abattement par un cri de l’enfant :
– Grand’mère ! De l’eau ! de l’eau ! nous allons être noyés !
Kathi se réveilla de ses sombres pensées ; l’eau clapotait autour de ses pieds, entrant, par les fenêtres mal jointes et les carreaux brisés par la grêle, avec un vacarme tel qu’elle n’en avait jamais entendu. Éperdue, elle ouvrit précipitamment la porte qui conduisait à la cuisine : l’eau y avait pénétré aussi ; elle ouvrit la porte qui ouvrait de la cuisine sur la campagne ; le tonnerre et les rafales de pluie la renversèrent ; à peine put-elle refermer la porte. Elle regagna en trébuchant la petite chambre ; l’eau y était montée à la hauteur du seuil de la cuisine. Elle prit Petit-Jean dans ses bras, s’assit sur le lit, le serrant contre son sein, oubliant ses plantations et ne se souciant plus que de sauver non pas sa vie mais celle du pauvre enfant. Le tonnerre grondait si fort, le bruit de l’orage était si terrible, l’eau montait si haut autour de la maisonnette, qu’elle croyait entendre le roulement de l’Emme, sortie de ses digues, prête à l’entraîner elle et la chaumière. Impossible de fuir par un temps pareil ; il ne lui restait de salut que dans la miséricorde de Dieu.
Kathi demeura longtemps ainsi, partagée entre la crainte et l’espérance, car l’orage durait plus longtemps qu’à l’ordinaire. Quand on le croyait passé, il revenait avec un redoublement de fureur, comme s’il eût oublié de détruire et de dévaster encore quelque chose. On eût dit que la main qui met un frein aux éléments n’avait plus la force de les contenir. Petit Jean s’était endormi ; Kathi tremblait et priait ; elle se reprit enfin à espérer, à mesure que les éclairs se firent plus rares, les coups de tonnerre plus faibles, que la grêle cessa, que la pluie ne fouetta plus si violemment les vitres et que l’eau ne monta plus. Ce qui la rassura singulièrement, c’est que c’était une preuve que l’eau provenait de la pluie, et non pas de la rivière, qui ne déborde que lorsque l’orage est passé. Cependant, plus le tonnerre diminuait, mieux elle entendait le grondement de l’eau, et longtemps encore une menace de mort lui sembla suspendue sur sa tête comme un glaive à deux tranchants.
Enfin il lui parut que le danger était écarté, elle posa doucement l’enfant sur le lit, ouvrit le guichet de la fenêtre et chercha à se rendre compte de ce qui se passait au dehors. Les nuages formaient une masse obscure et compacte, qui s’épaississait sur le ciel, et la terre avait un aspect étrange. Tout y était devenu gris de vert que c’était, si bien que Kathi crut d’abord à un amoncellement de grêlons ; mais on entendait un tel bruit et la surface du sol se mouvait de telle façon, qu’elle en revint à se demander si ce n’était pas de l’eau qui couvrait la terre de cette couche grisâtre et qui produisait ce mugissement étrange.
Elle pataugea dans l’eau jusqu’à la porte de la cuisine ; cette fois aucune rafale ne la repoussa ; elle put franchir le seuil ; mais d’abord elle ne remarqua rien. La grêle remplissait le chenal du toit ; tout autour de la maison bruissaient et mugissaient comme des vagues, mais cela ne ressemblait pas à l’Emme, ce n’était pas son grondement. Enfin le rideau de nuages se déchira pendant quelques instants. Ce que la lune éclaira, c’était bien de l’eau ; aussi loin que s’étendait la vue de Kathi, roulaient des flots tumultueux avec grand fracas, mais ce n’était toujours pas le grondement de l’Emme. C’étaient des eaux inconnues, que Kathi n’avait jamais vues. Aussi l’angoisse la reprit-elle. Ce qu’elles roulaient et poussaient, elle n’en savait rien. Elle referma la porte et revint auprès de l’enfant pour prier et veiller sur lui.
Tout était plus calme au dehors ; l’enfant respirait doucement, Kathi s’assoupit auprès de lui. Elle ne voulait que fermer un peu les yeux ; lorsqu’elle les rouvrit, le jour brillait dans la chambrette, mais si blafard qu’il ressemblait au visage d’un trépassé ou d’un revenant. Pendant longtemps la brave femme n’osa pas lever la tête pour regarder le désastre qui venait de la frapper ; elle avait de nouveau le cœur si lourd, qu’il lui semblait qu’elle voudrait mourir. Mais son regard se porta sur le petit garçon qui sommeillait si gentiment, si doucement à côté d’elle :
– Oh ! pauvre enfant ! que vas-tu devenir ? soupira-t-elle avec une prière.
Cela lui rendit un peu de courage. Elle se mit sur son séant, regarda dehors et vit le ciel et la terre tout gris, aussi loin que sa vue pouvait s’étendre.
Elle ne regarda pas de plus près, alluma du feu, prépara le repas du matin : du café et des pommes de terre rôties. La flamme pétilla, une des poules gloussa : cela réveilla l’enfant, qui demanda après sa grand’mère, voulut se lever, regarda par la fenêtre ce qui se passait, et n’y comprit rien. Petit-Jean n’avait plus peur des esprits et ne savait plus rien de l’orage. Quand la grand’mère lui raconta, en geignant et gémissant, que le lin était abîmé, et les pommes de terre, et tout ce en quoi elle avait mis son espoir, et qu’ils étaient maintenant de pauvres, pauvres gens, qui n’avaient plus rien à manger et qui ne savaient où aller…
– Mange donc ! grand’mère, lui dit le petit garçon. Tu seras joliment mieux, quand tu auras pris ton café.
– Et à quoi cela sert-il, que je sois mieux, mon pauvre petiot, si nous n’avons plus rien à manger ? C’est pourtant une chose horrible que de mourir de faim, pense donc, mon chéri.
– Grand’mère ! Ce ne sera pas si terrible, il n’y a pas de si grandes batailles qu’il n’en échappe quelques uns, dis-tu toujours. Il y aura encore des pommes de terre. Et puis les cerises rougissent sur les cerisiers, les arbres sont pleins de pommes ; il y a toujours de bonnes gens, comme tu dis, et le bon Dieu vit encore. D’ailleurs je pense à mes poules ; elles font des œufs presque chaque jour, nous aurions presque assez rien qu’à cela, et qui sait, si, en les nourrissant bien, elles ne pondront pas deux fois par jour ?
En parlant ainsi il caressait les deux volatiles qui étaient à ses côtés, presque comme le bon et le mauvais ange, avec cette différence toutefois, que tous deux avaient les mêmes bonnes intentions et attendaient tous deux quelques miettes de la main de leur petit ami.
Nous éprouvons un drôle de sentiment, lorsqu’une bouche étrangère nous renvoie les propres paroles dont nous nous servons habituellement pour consoler les autres. Nous avons parfois envie d’y voir une raillerie et de nous fâcher. Mais quand cet écho nous revient par la bouche d’un enfant, surtout quand c’est notre petit-fils, il ne manque jamais son effet. C’est comme un éclair de joie dans la nuit du cœur le plus attristé, lorsque la bouche d’un cher petit distille le miel des consolations et applique sur nos blessures le baume de nos propres paroles. Y a-t-il rien de plus sage pour de grands-parents que de faire du cœur de leurs petits enfants un trésor où, lorsque viendront les jours auxquels ils ne prendront plus de plaisir, ils pourront puiser consolation, joie, espérance, foi, amour, en un mot tout ce dont ils auront besoin.
Ainsi en allait-il pour Kathi. Ce fut comme un rayon de soleil dans son cœur.
– Cependant, dit-elle, si le lin est grêlé, si les pommes de terre sont sous l’eau, tout cela est perdu, et ni les braves gens, ni le bon Dieu n’y peuvent remédier.