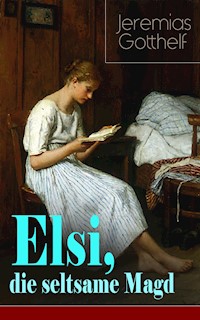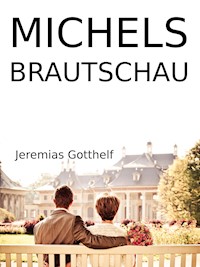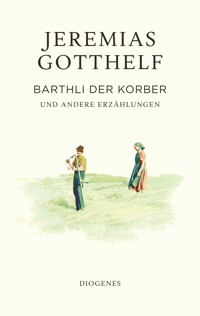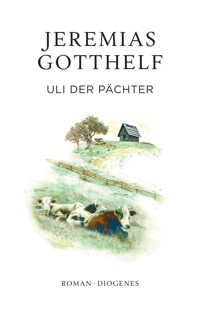0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jeremias Gotthelf
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Nous sommes au milieu du XIXe siècle dans l’Emmenthal (vallée de l’Emme). Kathi vit seule, avec son petit-fils Petit-Jean, dans un très modeste chalet près de la rivière.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Kathy la grand mère (2e partie)
Jérémias Gotthelf
Jeremias Gotthelf est le pseudonyme (tiré de son premier roman Le Miroir du paysan ou la vie de Jérémias Gotthelf) de l'écrivain bernois Albert Bitzius (né à Morat, dans le canton de Fribourg le 4 octobre 1797 et décédé le 22 octobre 1854).
Chapitre1 Kathi cherche à se tirer honorablement d’affaire sans importuner personne, mais en priant et en travaillant.
Là-dessus, Kathi s’occupa de la question qui lui tenait le plus à cœur. Elle vendit des pommes de terre, jusqu’à ce qu’elle eut réuni sept écus et demi. Cela lui fut bien dur : « On ne sait jamais, disait-elle, ce qui arrive, mais l’essentiel est que je puisse rester où je suis. Peu importe qu’on aille se coucher une couple de fois l’estomac plus au moins creux. »
Lorsqu’enfin elle fut arrivée à réunir la somme, elle avait oublié ce que les pommes de terre lui avaient coûté de privations. Toute joyeuse elle alla trouver le paysan et paya.
Le paysan ne se fit pas prier pour recevoir ses sous, tout en souriant avec complaisance. Il savait bien, dit-il, qu’elle pouvait payer, la vieille, si elle voulait. Il s’agissait seulement de faire comprendre à ces gens à qui ils avaient affaire. Il s’entendait à mettre ordre aux blagues, et il n’était pas facile de mettre Grozenbauer dedans.
Il se savait le plus grand gré de ses façons polies, sans se douter le moins du monde des blessures qu’elles faisaient aux cœurs. Du reste il ne savait pas ce que c’était qu’un cœur, n’ayant de sens que pour l’argent. Sa femme le désapprouvait fort, mais elle se contint, et se borna à dire en passant à Kathi : « Ça ne pressait pas autant. Quoi qu’il arrive, n’oublie pas que je suis encore là. »
Kathi s’en retourna chez elle tout heureuse. Dieu soit béni ! disait-elle, je puis rester là. C’est l’essentiel. Le reste s’arrangera.
Pour des milliers de ménages la saison qui suivit fut pleine d’inquiétudes. Ceux dont nous parlons avaient tous encore, au commencement de l’hiver, de quoi manger ; mais combien de temps cela durerait-il ? Et après ? C’était un lourd fardeau sur le cœur. Car ceux-là étaient de braves pères et mères de famille, qui s’étaient donné pour tâche de s’en tirer avec honneur, sans tourmenter personne.
Il est beau de voir au fort de la bataille un héros se frayer un passage au travers des lignes ennemies pour conquérir des lauriers ; il est beau de voir un navire fendre les ondes et tenir tête à la tourmente ; mais n’est-ce pas un spectacle plus beau de voir un brave père, une brave mère de famille aux prises avec les nécessités de la vie et les angoisses de la pauvreté, livrer pendant des années un combat recommencé chaque matin, et qui ne cesse souvent qu’à la dernière aurore qui se lève pour eux sur la terre. Ce n’est que dans cette constance à lutter que réside la vraie humilité, celle qui sait recevoir, qui n’est pas importune, qui embellit l’aumône, et qui, malgré celle-ci, ne cesse d’être honorable ici-bas, et même jusque dans le ciel. De même que pour le héros qui a perdu des membres à la bataille ou qui est resté impotent, les récompenses de sa patrie l’honorent, de même pour le fidèle combattant dans la lutte de la vie, de qui les forces se sont usées, et qui succombe sous ses blessures, les dons de la charité sont des marques d’honneur ; il les a méritées au champ d’honneur ; il peut les recevoir avec honneur. Et il y en a encore des millions qui pensent ainsi, qui livrent vaillamment une rude bataille, les uns vainqueurs, les autres vaincus.
Kathi était de ce nombre ; sans doute elle était débarrassée de sa dette ; mais elle n’avait plus le sou, et l’hiver était à la porte. Elle ne pouvait plus rien récolter, et l’on sait ce que peut gagner une vieille femme.
Sa principale ressource était sa quenouille. Mais depuis l’introduction des machines à filer le coton, qui ont fait baisser le prix de la toile, les fileuses de lin et de chanvre ont vu leur gain diminuer. Leur nombre a diminué aussi, et leur habileté, n’étant plus encouragée, s’est perdue. Après bien des essais infructueux on est enfin parvenu à filer également le lin à la machine ; le fil anglais s’est répandu partout en Suisse et les prix du filage à la main sont tombés presqu’à rien. Dans le commerce on n’emploie presque que du fil fait à la machine ; ce n’est que pour l’usage domestique qu’on se sert encore de fil fait à la main. Or, ici comme ailleurs, s’est vérifié le vieux principe, que celui qui s’est donné la peine de devenir un ouvrier hors ligne gagne encore aussi longtemps qu’il y a encore à gagner dans sa patrie, tandis que les mauvais ouvriers, et plus tard aussi tous les médiocres sont sans pain. Lorsque finalement il n’y a plus de travail du tout, l’ouvrier brave et consciencieux trouve de bonnes gens pour lui aider ; il est peut-être encore dans les années de vigueur où avec de l’adresse et de la bonne volonté il peut entreprendre autre chose. Il n’y a pas de vertu qui ne trouve sa récompense une fois ou l’autre.
Kathi était une de ces braves fileuses, qui rendent toujours le poids exact, qui avec une livre de bon lin peuvent vous filer quinze mille, vingt mille et plus, le mille compté à vingt-deux aunes, si l’on veut, et, malgré sa finesse, un fil si solide, que jamais le tisserand n’y trouve à reprendre, ce qui est beaucoup dire. Elle manquait rarement d’ouvrage, mais son gain restait minime. Il y avait eu un temps où elle avait filé plus de deux mille, et chaque mille lui avait alors rapporté huit à dix kreutzers. Maintenant, avec ses membres roidis, elle pouvait encore filer dans une journée quelques mille pour lesquels elle recevait six kreutzers au lieu de dix. Au lieu de cinq batz, elle gagnait donc six kreutzers quand cela allait bien, soit trois kreutzers chaque jour pour chaque mille, ou, si elle pouvait faire un mille et demi, huit à neuf kreutzers. Mais ce n’était plus le temps où l’architecte qui a construit la cathédrale de Berne jetait derrière la porte le dîner que sa femme lui avait servi parce qu’un homme qui gagnait un batz par jour ne pouvait se contenter à midi de haricots au lard.
Cependant Kathi ne murmurait pas ; elle était au contraire reconnaissante envers Dieu quand elle avait de l’ouvrage, et elle en avait effectivement parce qu’elle était habile. Il y a toujours encore beaucoup de gens qui ne veulent entendre parler ni de coton, ni de fil à la machine, et qui considèrent une belle toile de lin comme un luxe de ménage. Madame la ministre donnait volontiers à filer à Kathi, et bien des dames du village lui disaient au passage : « Si tu n’as rien à faire un jour, viens, il y a longtemps que j’ai là quelque chose pour toi. » Et Kathi était reconnaissante pour le batz qu’on lui payait, bien qu’elle sût que la plupart des marchands payaient à peine autant.
De temps à autre elle avait des occasions de gagner davantage, ainsi lorsqu’on faisait boucherie ou lorsqu’on avait besoin de plus de bras qu’il n’y en avait dans la maison. Mais ces cas étaient rares. Néanmoins elle s’en tirait honorablement sans rien demander à personne. Nous ne voulons pas refaire les calculs de Kathi et dire pour combien de kreutzers elle employait pour ceci ou cela. Il y avait là deux choses qui ne se laissaient pas porter en compte. La première est la bénédiction de Dieu.
Qu’est-ce que cela ? demandera-t-on. La bénédiction de Dieu est la bénédiction de Dieu. On ne peut rien en dire de plus. C’est comme quand on dit : la lumière est la lumière, l’esprit est l’esprit et Dieu est Dieu. Elle est ici, elle est là, d’une façon évidente, tout comme ailleurs le contraire, ici la cruche de la veuve, là un tonneau sans fond. Impossible de dire à quoi cela tient. C’est ainsi, sans qu’on puisse l’expliquer, pas plus que l’on n’explique comment il se fait que des gens ont toujours des vêtements propres et bonne façon, tandis que d’autres sont toujours sales. Ces contrastes se produisent entre frères et sœurs ; les parents ne l’ignorent pas, mais ils ignorent pourquoi et ils n’y peuvent rien changer. Il en est de même de la bénédiction de Dieu ; on ne peut pas plus en rendre compte par des mots qu’on ne peut emprisonner dans ses mains la lumière du soleil ; mais là où elle existe, de peu de chose elle fait une abondance, et enrichit le corps et l’âme. Cette bénédiction est la première chose qui rend impossible le contrôle des comptes de ménage de Kathi.
La seconde accompagne le plus souvent la première ; ce sont les braves gens avec la générosité de leurs dons. Lorsque Kathi apportait du fil dans une maison, elle en remportait du moins, à côté de son salaire, du pain, parfois des pommes, parfois autre chose encore, ce que la bonne dame avait sous la main. Car il faisait si bon donner quelque chose à Kathi ; elle était si reconnaissante, remerciait tellement du fond du cœur. On ne voulait pas laisser passer l’occasion. D’ailleurs il en est sans doute en d’autres endroits comme chez nous, où beaucoup de femmes mettent leur orgueil à êtres bonnes. On ne veut pas croire qu’il y ait tant de gens animés du désir de passer pour bons, d’êtres aimables ; et c’est surtout dans ce qu’on appelle les basses classes qu’on rencontre ce besoin de charité, cet instinct de la bienfaisance. On rit souvent de saint Crépin, qui volait du cuir pour en faire des souliers aux pauvres. Eh bien ! c’est là une de ces histoires qui se renouvellent tous les jours, et s’en moquer prouve simplement qu’on a encore des yeux qui ne veulent point voir et des oreilles qui ne veulent point entendre. De ces Crépin là il y en a encore tous les jours. Seulement on ne les canonise plus, on leur donne simplement une volée de coups de bâtons et on les chasse. Que de femmes ont été ainsi saintement rossées, parce qu’elles voulaient faire les généreuses au détriment des intérêts de leur mari ! Dans notre Suisse où tous les maris ont l’air d’être seigneurs et maîtres, combien de femmes sont les vrais souverains dans le ménage. Et nous voudrions bien voir le mari qui oserait mettre la main, sur un souverain de cette espèce.
C’est ce qui fait qu’on rencontre vraiment une grande quantité de femmes généreuses ; la seule différence entre elles est que les unes le sont avec intelligence, et les autres sans intelligence. Ces dernières commettent beaucoup de fautes ; elles rendent les pauvres mauvais et sans vergogne, et plus d’une a ruiné son mari et réduit à la misère ses enfants et ses petits-enfants. La bonté veut être raisonnée et réfléchie, sans quoi elle dégénère en abus ; il n’y a pas de vertu qui ne se transforme en vice quand elle n’est pas accompagnée de bon sens. Les femmes généreuses qui possèdent cette qualité ne sont pas seulement des perles dans leur sexe, car les perles sont fragiles ; ce sont des diamants humains ; le bien qu’elles font est ce qu’il y a de plus beau dans ce monde, et même dans le ciel où tout cela est noté.
Kathi s’en tira, grâce à la bénédiction de Dieu et aux bonnes femmes. Toutefois elle n’arriva pas à avoir quelque avance. Le bas de noces resta intact ; il n’y entra pas la moindre pièce d’argent. Aux deux secours dont nous avons parlé Dieu en ajouta un troisième, non pas pour Kathi seule, ni pour ceux-là seulement qui voulaient, comme elle, n’être à charge à personne, mais pour ceux aussi qui se souciaient peu de l’honneur et de la discrétion et qui ne songeaient qu’à leur bien être, n’importe par quel moyen. Il fit luire son soleil sur les bons et les méchants, sur les justes et les injustes. Sans doute il eut pitié de tant de milliers de pauvres enfants, qui auraient souffert de la cherté des vivres, s’il avait fait bien froid, et si le père n’avait pas eu assez d’argent pour se procurer du bois, des vêtements chauds et de bonnes chaussures. S’il avait fait très froid, on aurait eu, comme on sait, beaucoup plus faim, et l’on aurait souffert bien davantage. La compassion de Dieu se porta surtout sur les braves petits qui auraient dû porter la peine des péchés de pères qui vilipendaient leur argent et le dépensaient pour de l’eau-de-vie, sans se soucier de savoir s’il y avait du pain à la maison, des pommes de terre dans la cave, du bois à la cuisine, des vêtements chauds pour leurs enfants.
Pour les riches, pour les citadins en particulier, un hiver clément est une jouissance ; pour les belles dames, un gai soleil à cette saison est une volupté. Que sont-ils donc pour de vieilles bonnes femmes, pour de pauvres enfants mal chaussés ? Plus d’une après-midi Kathi put filer au soleil, dehors, sur son petit banc ; elle en était comme rajeunie ; elle disait qu’elle n’avait jamais vu un hiver pareil. N’était-ce pas la preuve que le bon Dieu vivait encore et qu’il s’occupait des pauvres gens ? D’autres fois, par une chaude après-dînée, elle allait avec son petit garçon dans la forêt, au bord de l’Emme, et ramassait des fagots, bien qu’elle n’en eût, pour le moment, pas encore besoin. Mais elle calculait que lorsqu’on fait provision à temps, on est pourvu quand vient le besoin. Elle parcourait ainsi bois et taillis ; le petit Jeannot lui tenait fidèle compagnie, et elle prenait plus de plaisir à le voir si actif, si gentil qu’au bois qu’elle trouvait, bien qu’elle attrapât souvent encore un beau tronc amené par l’inondation et qui n’était devenu visible qu’une fois son feuillage tombé.
Mais ce beau temps ne convenait à personne mieux qu’aux deux poules, la noire et la blanche. Ces volatiles sont, comme on sait, de très curieuses et capricieuses personnes, absolument comme celles qu’on doit rencontrer dans les sérails. Plus un harem est luxueux, plus, d’après ce que l’on dit, les personnes qui l’habitent ont des fantaisies et des caprices : tantôt elles sont un peu timbrées ; tantôt elles veulent couver, tantôt elles ont la pépie ; tantôt elles sont hydropiques, tantôt malades d’hypertrophie du foie ; tantôt elles ont la tête lourde, tantôt les nerfs en déroute, ce qui doit être tout à fait mauvais. Il en est absolument de même chez les poules. On a des exemples de poules qui pondent fort mal et ne songent qu’à se faire belles. Elles dédaignent l’avoine, jouent des tours au coq, se couchent au soleil, muent trois fois par an, mettent à leur plumage tout ce qu’elles avalent, cela sans la moindre vergogne et veulent toujours paraître plus belles que la nature ne les a faites. Les poules des pauvres gens ne sont point ainsi ; elles ne savent, hélas ! pas même ce que c’est que de l’avoine ; elles vivent heureuses des miettes de la table de leur maître ; elles sont ravies quand le bon Dieu permet au soleil de luire, et de leur tenir la terre ouverte pour qu’elles puissent y chercher leur pâture ; elles ne songent pas à leur plumage, mais elles pondent magnifiquement. Et pour des poules qu’importent les plumes ? Les œufs ne sont-ils pas l’essentiel ? Des plumes de poules ! Fi donc !
Les poules de Kathi étaient de braves poules, qui partageaient sans se plaindre sa pauvreté. Elles profitaient du soleil, se contentaient de peu, pondaient courageusement et ne laissaient pas tomber rien que des plumes. Elles ne faisaient pas des œufs tous les jours, mais tous les deux jours, tant qu’elles pouvaient aller au soleil. Or sept œufs par semaine, à un kreutzer l’œuf, ou même à deux batz ou huit kreutzers pour deux, ce n’est pas une bagatelle pour un pauvre ménage. Quand, le samedi, Kathi allait au village avec cinq œufs, elle pouvait, avec leur produit, acheter un petit pain chez le boulanger, ou avoir presque une demi-livre de beurre. Et il lui en restait encore deux pour faire, le dimanche, une omelette, un vrai régal, dont ils jouissaient en partie pour l’omelette, en partie pour le plaisir qu’ils avaient à voir leurs braves poules pondre même en hiver, et le bon Dieu leur envoyer son soleil pour les encourager.
Sans doute, il y eut aussi des jours sombres où les flocons de neige tourbillonnaient dans l’air, mais ces jours-là passèrent gaiement pour eux et ne leur parurent pas longs, ce qui est l’essentiel. Mais Kathi allongeait la journée tant qu’elle pouvait. Il était rarement plus de cinq heures quand elle se levait, faisait de la lumière et s’asseyait à son rouet, jusqu’à ce que le jour vînt ou que le petit remuât. Alors elle mettait son rouet de côté, allait à la cuisine, faisait du feu, chauffait de l’eau et du lait, et préparait le café. Entre temps, elle habillait l’enfant, rôtissait quelques morceaux de pommes de terre dans un peu de beurre et d’eau, et, quand tout était prêt, ils déjeûnaient. Puis venait le tour des poules, qui, en hiver, avaient leur abri sous le poêle chaud ; elles se secouaient, appelaient l’attention sur elles, et attendaient curieusement leur part du repas. Quand tout ce petit monde avait mangé, que la vaisselle était essuyée, le lit fait, la chambrette aérée et balayée, Kathi reprenait sa place au rouet ; auprès d’elle le petit garçon jouait avec des bouts de bois ou de petites pierres, écossait des haricots, s’essayait à épeler ; ou bien la grand’mère lui racontait du diable ou de Croque-mitaine, de Dieu et des anges, bref, tout ce qu’elle savait. Naturellement le savoir de Kathi n’allait pas en augmentant, mais cela ne nuisait en rien à ses récits, car Jeannot n’avait pas encore le goût si perverti qu’il voulût entendre chaque jour quelque chose de nouveau ; les vieilles histoires lui suffisaient amplement. Il avait ses contes de prédilection que la grand’mère ne pouvait assez lui répéter, et chaque fois qu’il les entendait, ils lui paraissaient plus beaux et plus attachants. On se trompe fort, si l’on se figure que les gens du peuple cherchent à avoir toujours quelque chose de nouveau, de plus merveilleux, de plus curieux, de plus arrangé.
C’est le contraire, et cela se voit déjà chez l’enfant qui n’a pas été gâté. Le peuple aime ce qui est uniforme, connu, permanent, et cela dans toutes les sphères de son existence, dans ses mœurs, dans sa nourriture, dans ses livres, ses chants, ses maisons, ses relations, partout en un mot. Cette particularité est dans la nature même de tous les peuples à l’origine. Or ce que Dieu a mis dans la nature est bon, et vouloir l’en chasser est un crime. Émondez un arbre tous les ans, ou transplantez-le tous les deux ans, et voyez ensuite quelle vigueur il a, quels fruits il porte, combien d’années il végète ! Pour qu’un arbre devienne beau, robuste, et donne des fruits, il faut qu’il soit solidement enraciné, et qu’on ne le taille pas constamment à nouveau. Il ne s’agit pas de procéder avec ses rameaux et ses branches, comme un perruquier avec les cheveux d’une dame de Paris. C’est pourquoi il arrive que des gens qui ne lisent que leurs tout vieux livres domestiques, sont infiniment plus avisés et plus réellement cultivés que ceux auxquels il faut chaque jour des gazettes nouvelles. Si l’on se pénétrait de cette vérité, on ne tracasserait pas tant le peuple, comme des gamins un jeune chien.
Souvent, quand la grand’mère était au plus beau de son récit, voilà qu’une poule se mettait à caqueter joyeusement pour proclamer la nouvelle qu’un œuf avait été heureusement pondu. Si, l’instant d’après, un second caquetage annonçait un second œuf, alors la joie était grande dans la maisonnette. Car deux œufs d’un jour de deux poules, en hiver, c’est chose rare. Lorsqu’enfin il sonnait midi au clocher de l’église, ce qui ordinairement arrivait à onze heures, pour que les ménagères eussent le temps de préparer à manger pour les enfants jusqu’à midi, alors Kathi mettait de nouveau son rouet de côté et allait à la cuisine, puis au ruisseau où elle lavait ses pommes de terre, les malades, tant qu’elle en eut ; elle les cuisait ensuite dans l’eau, ajoutait une petite soupe, et, comme dessert, mais le plus souvent pour Jeannot seul, un petit morceau de pain. C’était leur dîner, dont ils se réjouissaient chaque fois, louant Dieu qui le leur donnait, le remerciant du plaisir qu’ils y trouvaient ; car la faim l’assaisonnait et l’envie ne l’empoisonnait pas. Ils savouraient en toute paix et simplicité le bienfait que Dieu a accordé aux hommes en leur donnant une langue qui est le siège du goût. Ce repas si maigre, si monotone, leur semblait meilleur qu’au banquier ou au riche fabricant ses mets artistement compliqués et chaque jour différents, pour lesquels il faut encore le plus souvent qu’il se mette artificiellement en appétit.
Lorsqu’on avait mangé, on lavait la vaisselle, et l’après-midi se passait comme la matinée, à filer et à jouer, à raconter et à questionner. Il n’y manquait que le caquetage des poules. Le soir venait avant qu’on s’en aperçût ; les poules allaient chercher leur gîte sous le poêle, Kathi était obligée de quitter sa quenouille, et de s’occuper du ménage ; elle allait chercher de l’eau et du bois. Jeannot l’y aidait bravement et la grand-mère disait souvent : « Oh ! comme tu es déjà un grand garçon et comme tu me secondes bien ! »
Une fois toutes les courses terminées pour chercher, par exemple, du lait, du pain ou du café, Kathi préparait le souper, composé de café et de pommes de terre, et, pour la troisième fois, ils se réjouissaient des dons de Dieu, tandis qu’un riche fainéant a bien de la peine à manger comme il faut une fois par jour, quitte à batailler ensuite au moins douze heures contre des embarras d’estomac.
On préparait, après cela, ce qu’il fallait pour le lendemain ; on triait les pommes de terre gâtées, on les séchait, finalement on mettait Jeannot dans son lit ; il faisait sa prière, et, quand tout était en ordre, vers sept heures environ, Kathi se remettait à son rouet et filait jusqu’à dix heures et souvent bien au-delà, quand elle voulait essayer de faire de nouveau deux mille, parce qu’elle avait grand besoin de trois batz.
C’étaient pour elle des heures tranquilles, mais courtes ; tout son passé lui revenait alors à la mémoire ; aujourd’hui telle chose, le lendemain telle autre ; tantôt la naissance d’un enfant, tantôt un baptême, souvent le jour de ses noces, souvent aussi un jour de deuil. Parfois son œil cherchait à pénétrer le mystère de l’avenir, elle se représentait Jeannot devenu homme ; elle pensait à Jean ou à ce qui lui serait encore dispensé de bon ou de mauvais dans les jours qui suivraient.
Quand l’huile tirait à sa fin, que la mèche de la lampe crépitait, elle mettait de nouveau son rouet de côté, versait de l’huile dans la lampe, afin de ne pas la trouver vide le matin, rangeait le foyer, se mettait au lit, recommandait son âme à Dieu et attendait le sommeil. Les jours passaient ainsi tous pareils et elle était heureuse de cette uniformité ; elle n’éprouvait ni ennui ni lassitude de la vie ; chaque matin elle se levait fortifiée dans son corps et dans son âme pour reprendre sa besogne quotidienne.
Il y eut bien, pendant l’hiver, quelques soirées où cette uniformité fut rompue. C’étaient de vrais événements dans sa vie. Anne-Babi et quelques autres jeunes filles venaient avec leur rouet pour filer auprès de Kathi. Ces jeunesses aiment la société des vieilles grand’mères ; elles prennent plaisir à les entendre parler de fantômes, ou raconter leur passé, leur jour de noces, leurs couches, ou les autres événements de leur vie. Cela leur fait le même effet que si leur avenir se déroulait devant elles ; elles se réjouissent, ou s’épouvantent suivant qu’il leur apparaît sous un aspect ou sous un autre. C’est pour elles comme si elles consultaient une diseuse de bonne aventure, et elles y vont souvent pour essayer de soulever un coin du voile. Le cœur leur bat violemment, quand elles pensent à l’avenir ; il se romprait même, pensent-elles, si elles ne pouvaient le tranquilliser par les promesses et les espérances que leur donnent ces regards indiscrets jetés dans les mystérieuses profondeurs de l’avenir.
Kathi racontait, et il en arrivait aux jeunes filles comme à Jeannot ; chacune d’elle avait son histoire préférée, qu’elle voulait entendre, et pour laquelle, bon gré, mal gré, il fallait que Kathi s’exécutât. De leur côté, les jeunes filles ne venaient pas sans rien ; l’une apportait du pain, une autre des noix ou des pommes de terre ; parfois même l’une arrivait avec une petite bouteille de liqueur. Elles s’en retournaient tard à la maison, toutes tremblantes, se glissaient dans leurs lits, et se réjouissaient des rêves qui allaient venir, les plus doux qu’elles eussent jamais faits.
Chapitre2 Comment Kathi passe les fêtes de Noël et jouit du Nouvel-An.
Noël arriva ; un grand jour dans la vie du peuple comme dans celle de l’humanité. C’est le jour des enfants. C’est par un enfant que le monde pécheur a été réconcilié avec Dieu et sanctifié. Voilà pourquoi les adultes font des cadeaux aux enfants ; ce sont des offrandes de reconnaissance, les signes visibles d’une promesse sacrée de rendre aux enfants ce qu’un enfant a fait pour l’humanité.
Les enfants, eux, se réjouissent du fond de l’âme ; ils ont le sentiment qu’ils sont chose sacrée pour leurs parents. Là où il n’y a point d’enfants, là manque souvent le sentiment filial qui élève l’âme, tandis que la matière s’empare des hommes sous mille formes, et les tire vers les choses d’en bas. Les enfants sont à la fois les médiateurs entre Dieu et les hommes, et le lien qui unit et réconcilie ces derniers. Sans eux le monde serait un désert, et ceux qui le traversent descendraient au niveau des bêtes, pour mourir ensuite de consomption. Là où les enfants ne sont pas considérés comme un don de Dieu, où ils sont au contraire un fardeau et destinés à devenir plus tard les serviteurs de l’égoïsme, on peut dire que le ciel est voilé pour cette nation, et que les racines de sa vie sont pourries.
Noël est pour tout le monde ce qu’était pour les mages d’Orient l’étoile qui leur annonça la naissance du Sauveur, les arracha à leur repos, leur fit rassembler leurs trésors et prendre le bâton de voyage pour aller saluer le Roi de gloire.
Kathi se réjouissait toujours de Noël, mais nous pourrions presque dire qu’elle s’en réjouissait avec crainte et tremblement. C’était au sens spirituel son jour de pronostics. Les paysans ont, dans l’année, beaucoup de ces jours-là, qui, suivant ce qu’ils sont, leur présagent le temps qu’il fera, ou ce que vaudront leurs différentes récoltes. Ainsi les premiers douze jours après le plus court indiquent le temps qu’il fera pendant les douze mois de l’année suivante. Si le soleil se montre à la Chandeleur (vieux ou nouveau style) tous les fruits mûriront jusque dans les coins les plus retirés de la montagne. S’il neige à la Sainte-Agathe, il tombera de la neige encore quarante fois. Si à la Saint-Grégoire (le 12 mars) c’est le vent du nord qui souffle, on n’aura qu’une mauvaise récolte de foin ; s’il fait mauvais temps à la Saint-Urbain, la vendange ne sera pas bonne ; les Vaudois traînent alors dans le lac une image représentant Saint-Urbain, pour lui faire boire sa négligence.
Ces jours significatifs sont égrenés tout le long de l’année, mais les femmes pieuses en ont un qui a un sens plus spirituel, c’est Noël. Quand il a sonné minuit, ou si elles se réveillent plus tard dans la nuit, elles ouvrent la Bible et le livre des Psaumes, mettent dans chacun un signet, et quand le jour vient, elles lisent le chapitre et le Psaume ainsi marqués. Suivant qu’ils renferment des promesses ou des menaces, elles voient venir l’an nouveau avec joie ou avec crainte et s’attendent à des choses gaies ou à des choses tristes.