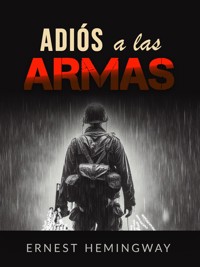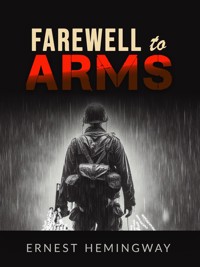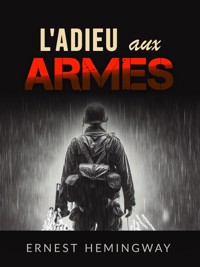
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Stargatebook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
C'est l'histoire d'amour et de guerre qu'Hemingway avait toujours eu l'intention d'écrire, inspirée par ses expériences sur le front italien en 1918, et en particulier la blessure subie à Fossalta et sa passion pour l'infirmière Agnes von Kurowsky. Les thèmes de la guerre, de l'amour et de la mort, qui sous-tendent à bien des égards toute l'œuvre d'Hemingway, trouvent dans ce roman un espace et une articulation particuliers. C'est l'histoire elle-même qui stimule les émotions et les sentiments liés aux enchantements, mais aussi à l'extrême précarité de l'existence, à la révolte contre la violence et le sang injustement versé. La désertion du jeune officier américain pendant la retraite de Caporetto se révèle, avec les retrouvailles entre le protagoniste et la femme dont il est amoureux, comme une condamnation décisive de tout ce qu'il y a d'inhumain dans la guerre. Mais même l'amour, dans cette histoire marquée par une défaite tragique du bonheur, reste une aspiration que l'homme poursuit désespérément, prisonnier de forces mystérieuses contre lesquelles il semble inutile de lutter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ernest Hemingway
L'ADIEU AUX ARMES
Traduction et édition 2025 par Stargatebook
Tous droits réservés
SOMMAIRE
LIVRE PREMIER
DEUXIÈME LIVRE
TROISIÈME LIVRE
LIVRE QUATRIÈME
LIVRE CINQUIÈME
LIVRE PREMIER
1.
Vers la fin de l'été, nous avons vécu dans un village d'où l'on pouvait voir les montagnes de l'autre côté de la rivière et de la plaine. Dans le lit de la rivière, les galets et les graviers étaient secs et blancs au soleil, et l'eau coulait claire et bleue dans les canaux. Ils passèrent en troupes devant la maison et continuèrent sur la route, leur poussière recouvrant les feuilles des arbres. Même les troncs étaient couverts de poussière, et les feuilles tombaient tôt cette année-là ; nous avons vu des troupes marcher le long de la route, soulevant des nuages de poussière et de feuilles tombantes agitées par le vent au passage des soldats, puis la route nue et blanche là où il n'y avait pas de feuilles.
La plaine était encore riche en cultures, avec de nombreux vergers, et au fond s'élevaient les montagnes brunes et stériles. Là-haut, il y avait des combats. La nuit, nous pouvions apercevoir les éclairs des canons. Ils ressemblaient à des éclairs de chaleur dans l'obscurité, mais les nuits étaient fraîches : on ne sentait pas l'orage approcher.
Parfois, la nuit, on entendait des marches sous la fenêtre, et le passage de canons traînés par des tracteurs. Il y avait toujours de la circulation la nuit, des mules sur les routes avec des caisses de munitions en équilibre de chaque côté du bâton, et des camions gris transportant des soldats et d'autres camions chargés de matériel, couverts d'auvents, se faufilant plus lentement dans la circulation. Et de gros canons passaient de jour, tractés par des tracteurs, les longues cannes entrelacées de branches vertes comme des sarments de vigne recouvraient les tracteurs. Vers le nord, une forêt de châtaigniers est apparue au fond d'une vallée, puis sur une autre montagne, de ce côté-ci de la rivière. Ils se sont longtemps battus pour elle aussi, mais en vain ; à l'automne, quand les pluies ont commencé, les feuilles sont tombées des châtaigniers et les branches sont restées nues, les troncs des châtaigniers étant noirs sous la pluie. Les vignes étaient dépouillées et tout le pays était stérile, humide et mort en automne. Des bancs de brouillard se dressaient sur la rivière et des nuages sur les montagnes, et les camions éclaboussaient les routes de boue. Sous les manteaux, des gantelets gris en cuir, remplis de chargeurs avec leurs longues et fines cartouches de 6,5 millimètres, ont poussé sur le devant ; ils ont gonflé et les hommes ont marché comme s'ils étaient enceintes de six mois. De petites voitures grises passaient à toute allure, un officier étant généralement assis à côté du conducteur et d'autres derrière. Elles éclaboussaient encore plus que les camions, et si l'un des officiers à l'arrière était minuscule, assis entre deux généraux, si petit qu'on ne pouvait même pas voir son visage mais seulement la pointe de sa casquette, et si la voiture passait encore plus vite, c'était probablement le roi. Il vivait à Udine et, presque tous les jours, il voulait savoir comment allaient les choses, qui étaient en réalité très mauvaises.
Au début de l'hiver, il n'a jamais cessé de pleuvoir. Le choléra est arrivé. Mais on réussit à le dompter, et ce ne sont finalement pas plus de sept mille hommes qui en moururent, dans toute l'armée.
2.
L'année suivante, les victoires furent nombreuses. La montagne au-delà de la vallée et les pentes avec la forêt de châtaigniers furent prises, et nous gagnâmes également la plaine sur le plateau au sud. En août, après avoir traversé la rivière, nous nous sommes installés à Gorizia, dans une maison avec une fontaine et un jardin plein de grands arbres ombragés, entouré d'un mur, et des rangées de glycines violettes sur le côté de la maison. Or, à un peu moins d'un kilomètre de là, des combats se déroulaient dans les montagnes. Gorizia était une belle ville, et la maison où nous vivions était très belle. Derrière elle coulait la rivière. Gorizia était presque intacte après la conquête, mais les montagnes devant elle ne pouvaient pas être prises, et j'étais heureux que les Autrichiens, pensant peut-être qu'ils allaient revenir, n'aient pas bombardé la ville pour la détruire, mais seulement le peu que la guerre exigeait. La population était restée et il y avait des hôpitaux, des cafés, de l'artillerie dans les rues et deux casernes, l'une pour les soldats, l'autre pour les officiers ; Vers la fin de l'été, les nuits fraîches et les combats dans les montagnes de l'autre côté de la ville, le fer du pont du chemin de fer marqué par les obus et le tunnel en ruine près de la rivière où les combats avaient eu lieu, les arbres autour de la place et la longue avenue bordée d'arbres qui y menait, les filles dans les rues et les promenades du roi dans son automobile (maintenant, parfois, on pouvait voir son visage et son visage), tout cela était très beau, parfois, on pouvait voir son visage et son petit corps, son long cou avec un chaume gris ressemblant à une dentelle de chèvre), tout cela et le spectacle soudain de maisons montrant leurs intestins après un tir d'artillerie, avec des décombres et des débris dans les jardins et les rues, et la bonne situation sur le Karst, appartenaient à un automne très différent de celui où l'on vivait dans le village. La guerre avait également changé.
Il avait disparu, sur la montagne d'en face, la forêt de chênes.
Nous l'avions trouvée verte en été en entrant dans la ville, mais il n'en restait que des souches, des troncs cassés et un sol bouleversé. Un jour, à la fin de l'automne, en passant devant la forêt, j'ai vu un gros nuage s'avancer sur la montagne. Il avançait rapidement et le soleil est devenu sombre, puis tout est devenu gris, le ciel est resté fermé par ce nuage ; il avançait toujours en descendant sur la montagne, et soudain nous étions dedans et c'était de la neige. Elle est tombée latéralement sous l'effet du vent, et le sol en était recouvert , seuls les troncs cassés dépassaient ; la neige s'est accumulée sur les canons, les traces dans la neige menaient maintenant aux toilettes derrière les tranchées.
Plus tard, en ville, j'ai vu la neige tomber devant les fenêtres du mess des officiers, où je me trouvais avec un ami autour d'une bouteille d'Asti. En regardant la neige tomber lentement et lourdement, j'ai su que tout était fini pour cette année-là. Les montagnes le long de la rivière n'avaient pas été prises, aucune montagne de l'autre côté de la rivière n'avait été prise, tout ce qu'il restait à faire pour l'année suivante. Mon camarade aperçut l'aumônier qui nous accompagnait au mess et qui passait sur la route en marchant prudemment dans la neige fondue. Il a tapé sur la vitre pour l'appeler, et l'aumônier a levé les yeux et a souri. Mon camarade lui fit signe de monter, mais il secoua la tête et continua son chemin.
Ce soir-là, à la cafétéria, après les spaghettis, nous avons mangé rapidement et tranquillement, en les tournant sur la fourchette jusqu'à ce qu'ils s'amassent mollement et que nous puissions ainsi les plonger dans la bouche ou même les laisser pendre doucement en les aspirant, Pendant ce temps, le capitaine nous versait du vin à partir de la grande gourde suspendue dans son porte-gourde métallique (avec son index, il abaissait son cou et le vin d'un rouge clair, sombre et agréable coulait dans le verre tenu par la même main) - après les spaghettis, donc, le capitaine commença à se moquer de l'aumônier.
L'aumônier était jeune et rougissait facilement. Il portait un uniforme semblable au nôtre, avec une croix de velours rouge sur la poche de poitrine gris-vert. Par délicatesse à mon égard, le capitaine s'exprime en italien nègre ; il veut que je ne perde pas un mot, ce qui est tout à mon avantage.
D'autres officiers s'amusaient.
dit le major. - Il a une passion pour François-Joseph, c'est de là qu'il tire son pognon. Mais heureusement, je suis athée. -
J'ai souri à l'aumônier et il m'a souri en retour à travers la bougie.
Il devrait aller à Rome. Et puis Naples, la Sicile...
3.
Quand je suis retourné au front, j'ai retrouvé Gorizia, il y avait beaucoup plus de canons dans la campagne, et le printemps était arrivé. Les champs étaient verts et les premiers bourgeons poussaient sur les vignes, les arbres le long de la route avaient mis un doigt de feuilles, et un petit vent venait de la mer. Je vis la ville s'approcher avec sa colline et son vieux château au-dessus, les autres collines qui la couronnaient, et les montagnes derrière, brunes avec un peu de vert sur les pentes. Il y avait aussi plus de canons dans la ville, et quelques nouveaux hôpitaux, et j'ai rencontré quelques Anglais, et d'autres maisons avaient aussi été touchées par l'artillerie. Il faisait chaud comme au printemps ; le long de l'avenue bordée d'arbres, les murs étaient chauffés par le soleil. J'ai constaté que nous vivions toujours dans la même maison et que tout était comme avant, identique au moment où j'étais parti. La porte était ouverte et un soldat était assis sur un banc au soleil, et à l'entrée latérale, une ambulance était à l'arrêt. En entrant, j'ai retrouvé l'odeur du sol en marbre et l'odeur de l'hôpital, tout était comme je l'avais laissé, sauf que c'était le printemps. J'ai cherché la porte de la grande salle, j'ai vu le major assis à la table et la fenêtre ouverte, le soleil entrant dans la pièce. Le major ne m'avait pas remarqué, et je ne savais pas si je devais me présenter tout de suite ou monter me laver, puis j'ai décidé de monter.
La chambre que je partageais avec le lieutenant Rinaldi donnait sur la cour. La fenêtre était ouverte et ma couchette semblait faite, mais il n'y avait que les couvertures, et des affaires à moi étaient accrochées au mur, le masque à gaz dans sa boîte en fer-blanc oblongue, le casque. Sur le coffre se trouvaient mes bottes d'hiver lustrées. La carabine de tireur d'élite, avec son canon bleuté et sa crosse en noyer foncé, bien ajustée à la joue, pendait en longueur au-dessus des deux lits de camp. Je me suis souvenu que j'avais mis la lunette dans le coffre. Rinaldi dormait sur sa couchette, et m'entendant me réveiller, il se redressa. - Bonjour - me dit-il. - Comment ça s'est passé ? -
Il a tapé dans ses mains, a passé son bras autour de mon cou et m'a embrassée.
John, Messine, Taormine... -
Après la guerre, vous comprenez ? -
J'ai enlevé ma veste et ma chemise, je me suis lavé avec l'eau froide du lavabo et, en me frottant avec la serviette, j'ai regardé autour de la pièce et par la fenêtre, Rinaldi allongé là, les yeux fermés. C'était un bel homme, à peu près de mon âge, originaire d'Amalfi, et il aimait être chirurgien. Il y avait beaucoup d'amitié entre nous deux. Lorsque je l'ai regardé, il a ouvert les yeux.
Je me suis essuyé les mains et j'ai sorti mon portefeuille de la poche de ma veste, Rinaldi a plié le billet et, restant allongé, l'a glissé dans la poche de son pantalon. Il sourit.
Ce soir-là, à la cafétéria, j'étais assis à côté de l'aumônier et il était un peu vexé parce que je n'étais pas allé dans les Abruzzes. Il avait annoncé ma visite aux parents et ils avaient fait les préparatifs. J'étais désolé aussi, je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas allé dans les Abruzzes, j'en avais vraiment envie, mais j'ai essayé d'expliquer que de fil en aiguille, et finalement, il s'est laissé convaincre, il a compris que je voulais y aller ; l'affaire était réglée ou presque. J'avais bu beaucoup de vin, puis du café, puis de la sorcière et j'essayais d'expliquer, pris par le vin, comment on ne peut pas faire ce que l'on veut : comment on n'y arrive jamais. J'ai continué à parler à l'aumônier pendant que les autres se disputaient. J'avais vraiment envie de voir les Abruzzes, et je n'étais pas allé là où les routes sont gelées et dures comme du fer, où le froid est clair et sec, où la neige est sèche comme de la poussière, où les traces de lièvres sillonnent la neige, où les paysans enlevant leurs chapeaux vous appellent seigneurie, et où la chasse est excellente. Je n'avais traversé aucun de ces pays, mais seulement la fumée des cafés et les nuits où la pièce tourne autour de vous et où vous devez regarder le mur pour qu'elle s'arrête, les nuits perdues dans l'ivresse, au lit, quand vous sentez qu'il n'y a rien d'autre que ce que vous voyez et l'étrange excitation du réveil, sans savoir avec qui vous êtes, et le monde reste irréel, dans l'obscurité, et vous êtes tellement excité que vous devez vous rendre sombre à nouveau, perdu encore dans la nuit : On est seulement convaincu que c'est tout, tout, vraiment tout, et que cela n'a pas tellement d'importance. Mais soudain, on s'en soucie encore beaucoup, on dort et on peut se réveiller le matin avec la même pensée, à l'intérieur de ce qui a été et s'est évanoui et qui revient si net, si aigre ou si clair - et parfois, on pense à nouveau à quel point l'addition était chère. Parfois, on est encore joyeux, plongé dans le contentement et bien au chaud, jusqu'au petit déjeuner et au déjeuner, d'autres fois, on est exclu, éloigné de toute gaieté et satisfait de pouvoir sortir, dehors, dans les rues - mais c'est un autre jour qui commence et puis une autre nuit.
J'essayais de parler à l'aumônier de la nuit et de la différence entre la nuit et le jour, et du fait que la nuit est meilleure sauf lorsque le jour est particulièrement frais et clair, mais je n'arrivais pas à m'exprimer. Je ne peux donc pas le faire maintenant, mais ceux qui l'ont vécu le savent. L'aumônier n'avait pas essayé, mais il avait compris que j'avais vraiment voulu voir les Abruzzes ; et je n'y étais pas allé malgré tout, et nous étions tous les deux amis comme avant : avec beaucoup de goûts en commun, mais pas tout à fait les mêmes entre nous. Il avait toujours su, lui, ce que je ne savais pas, et même après l'avoir appris, je restais prêt à l'oublier ; et je ne le savais toujours pas à ce moment-là, je devais l'apprendre plus tard. Entre-temps, tout le monde est resté à table. Le dîner était terminé mais la discussion continuait. J'avais cessé de parler à l'aumônier. Le capitaine a parlé fort :
4.
Le lendemain matin, j'ai été réveillé par le tambourinage du jardin voisin, j'ai vu le soleil à la fenêtre et je me suis levé. J'ai regardé dans le jardin, les allées étaient humides et l'herbe mouillée par la rosée. La batterie a tiré deux fois et à chaque fois le coup a frappé la vitre en faisant onduler mon pyjama sur ma poitrine. Je ne voyais pas les canons, mais les balles passaient certainement juste au-dessus de nous. C'était ennuyeux que les canons soient si proches ; heureusement, il ne s'agissait pas d'artillerie de forteresse. Je me suis habillé, j'ai descendu les escaliers, j'ai bu une gorgée de café dans la cuisine et je suis allé au garage. Dix voitures étaient alignées sous le long auvent. Il s'agissait d'ambulances à toit en caisson et à capot biseauté, peintes en gris et ressemblant à des fourgonnettes.
Dans la cour, des mécaniciens s'affairent autour d'une autre voiture. Les trois disparus se trouvaient dans les montagnes, dans les hôpitaux de campagne. - Est-ce qu'il leur arrive de retirer cette batterie ? - demandai-je à l'un des mécaniciens. - Non, monsieur le lieutenant, elle est abritée par la colline. -Comment se passe le travail ? Et tout le reste ? - demandai-je.
Il a quitté le travail pendant un moment et a souri. - A-t-il été en congé ? -
Il se nettoie les mains dans la combinaison, grimace. - Ça s'est bien passé ? - Même parmi les autres, j'ai vu quelques grimaces.
Je les ai laissés travailler. L'ambulance ressemblait à une carcasse, tellement elle était dépouillée avec son moteur ouvert et ses pièces éparpillées sur le banc. Elles étaient bien rangées, certaines fraîchement lavées et d'autres poussiéreuses. J'ai regardé attentivement les pneus, pour voir s'il n'y avait pas de coupures ou si les routes caillouteuses ne les avaient pas abîmés. Tout avait l'air en ordre. Il était clair qu'on n'avait pas besoin de moi. J'avais cru que le fonctionnement de chaque voiture et tout ce qui pouvait être réalisé pour elles, le bon déroulement des voyages avec les blessés et les malades en les amenant des montagnes aux centres de matriculation et en les triant ensuite entre les hôpitaux indiqués sur leurs feuilles, il m'avait semblé que tout cela dépendait, en grande partie, de moi, mais il était clair qu'il importait peu que je sois présent.
J'étais revenu tout poussiéreux et sale et j'étais monté me laver. Rinaldi était assis sur la couchette et lisait la grammaire anglaise de Hugo. Il s'était changé, avait mis ses bottes noires et ses cheveux brillaient. - Oh bravo - dit-il. - Maintenant, c'est parti pour Miss Barkley. - Non - lui ai-je répondu.
Je me suis lavé, brossé les cheveux et nous sommes partis.
Il a rempli les verres et nous avons trinqué avec son petit doigt. Le schnaps était très fort.
Nous avons bu. Rinaldi a rangé la bouteille et il ne restait plus qu'à partir. Il faisait encore chaud en marchant dans la ville, mais le soleil était sur le point de se coucher et cela faisait du bien. L'hôpital anglais était installé dans un grand manoir que certains Allemands avaient construit juste avant la guerre. Miss Barkley était dans le jardin avec une autre infirmière, nous avons aperçu les vêtements blancs dans les arbres. Nous nous sommes approchés, Rinaldi a salué, j'ai salué aussi, avec moins d'effusion.
Rinaldi discutait avec l'autre infirmière. Elles rient.
-
Nous nous sommes assis sur un banc. Je l'ai regardée.
Je l'aurais épousé, comme j'aurais fait n'importe quoi d'autre. Je me rends compte maintenant de ce qui s'est passé ; mais il voulait partir à la guerre, et je n'ai pas assez compris à l'époque. - Je n'ai pas répondu.
Rinaldi est toujours en train de discuter avec l'autre infirmière.
Ici, nous sommes près du front, n'est-ce pas ? -Très près. -
Nous nous sommes approchés des autres.
J'ai traduit pour Mlle Ferguson.
Au bout d'un moment, nous nous sommes dit bonsoir et nous sommes partis. Sur le chemin du retour, Rinaldi me dit : - Miss Barkley te préfère à moi, c'est clair. Mais l'écossaise est très jolie - .
5.
Le lendemain, dans l'après-midi, je suis allé chercher Miss Barkley. Elle n'était pas dans le jardin et je suis entré dans le manoir par la porte arrière où l'on avait arrêté les ambulances. Le directeur m'a dit que Miss Barkley était de service. - Il y a la guerre, savez-vous ? -
J'ai répondu que je le savais.
Par cette route étroite, j'étais descendu jusqu'à la rivière, j'avais laissé la voiture au petit hôpital sous la colline et, en traversant le ponton qui restait protégé par la montagne, j'avais suivi les tranchées à l'intérieur de la ville dévastée au pied de la colline. Tout le monde est resté dans les abris. De longues rangées de fusées éclairantes étaient prêtes à avertir l'artillerie, d'autres à signaler les défauts des fils téléphoniques, et il y avait du calme, de la chaleur et une grande saleté. En regardant les tranchées autrichiennes à travers les filets, on ne voyait personne. Dans un abri, j'ai bu quelques verres avec un capitaine que je connaissais, puis je suis retourné sur le pont. Ils terminaient une nouvelle route très large qui, après avoir traversé la montagne, descendait en zigzag jusqu'à la rivière. Ils attendaient cette route pour commencer l'offensive. Avec des virages en épingle à cheveux secs, elle descendait à travers la forêt. Nous utiliserions la nouvelle route pour le matériel entrant, tandis que les camions et les charrettes vides, les ambulances avec les blessés, tout le trafic de retour emprunterait l'ancienne route.
Le premier petit hôpital se trouvait du côté autrichien, et les blessés étaient transportés sur des civières le long du ponton. J'ai vu que les Autrichiens pouvaient bombarder sans problème même la nouvelle route sur le dernier kilomètre : dans la plaine, elle était complètement exposée. Là aussi, un massacre pouvait avoir lieu. Mais j'ai trouvé un endroit où les voitures pouvaient se mettre à l'abri juste après cette zone, jusqu'à ce que les blessés arrivent par là depuis le pont.
J'aurais volontiers emprunté la nouvelle route, mais elle n'était pas terminée. Elle était large et semblait bien faite, avec une pente bien étudiée, et les courbes avaient fière allure parmi les clairières de la forêt à flanc de montagne. Les ambulances auraient bien descendu, avec leurs freins à mâchoires, et de toute façon elles n'auraient pas été chargées en descente. Je revins par l'ancienne route. Deux carabiniers m'ont arrêté, un coup de feu avait retenti sur la route, et pendant que nous attendions, trois autres sont arrivés. 77 balles. Elles sifflaient et soufflaient, puis une explosion sèche et brillante, un incendie et une fumée grise qui couvrait la route. Les carabiniers nous ont fait signe de repartir.
J'ai évité les trous où les balles étaient tombées, et j'ai senti l'explosion et l'odeur de la terre brûlée, de la pierre battue. J'arrivai à Gorizia et passai devant la maison avant d'aller chercher Miss Barkley ; mais elle était de service. Je me dépêchai de prendre mon dîner et retournai immédiatement à l'hôpital anglais. Le manoir était grand et majestueux, et il y avait de beaux arbres dans le parc. Miss Barkley était assise sur un banc avec Miss Ferguson.
Elles semblaient très heureuses de me voir ; au bout d'un moment, Mlle Ferguson a dit qu'elle regrettait de ne pas pouvoir rester.
infirmière. Un V.A.D., en revanche, c'est quelque chose qui se fait rapidement. - Je comprends", ai-je dit.
Nous nous sommes regardés, dans l'obscurité. Je l'ai trouvée très belle et je lui ai pris la main. Elle l'a lâchée, je l'ai serrée dans la mienne et j'ai passé mon bras autour de sa taille.
Il m'a regardé dans le noir. J'étais irritée mais confiante, je voyais tout ce qui allait se passer ensuite : comme les coups d'un jeu d'échecs.
Pouvons-nous nous occuper d'autre chose ? -
Elle a ri. C'était la première fois que je l'entendais rire. Je l'ai regardée.
Je me suis dit : "Au diable tout ça". Je lui ai caressé les cheveux et j'ai posé ma main sur son épaule. Elle pleurait encore.
Au bout d'un moment, je l'ai accompagnée à la villa et nous nous sommes séparées. J'ai trouvé Rinaldi allongé sur la couchette. Il m'a regardé longuement. - Alors tu progresses, avec Miss Barkley ? -
Avec mon oreiller, j'ai donné un coup sur la bougie et je me suis glissé dans le lit dans l'obscurité, Rinaldi s'est penché pour ramasser la bougie, l'a rallumée et s'est remis à lire.
6.
Je suis resté deux jours dans les hôpitaux de campagne. Je suis rentré trop tard dans la soirée pour aller chez Miss Barkley, et j'ai remis cela au lendemain soir. Dans le jardin, elle n'était pas là et j'ai dû attendre dans le bureau. Plusieurs bustes de marbre se dressaient sur leurs piliers de bois peint le long des murs de la pièce. Même le hall d'entrée était orné de bustes ; ils étaient faits du même marbre et se ressemblaient tous. J'avais toujours trouvé les objets sculptés un peu idiots - les bronzes, par contre, peuvent avoir un sens. Mais les bustes en marbre ont un goût de cimetière. Le cimetière de Pise est cependant magnifique. Allez à Gênes si vous voulez voir des marbres laids. C'est un Allemand très riche qui a construit la villa, et les bustes ont dû lui coûter je ne sais combien. Je me suis demandé qui les avait fabriqués et combien il avait pu gagner. J'essayais de deviner s'il s'agissait de bustes de famille ou autre, mais ils étaient tous uniformément classiques et il était impossible de le savoir.
J'avais pris place sans enlever ma casquette. Même à Gorizia, nous aurions dû porter le casque, mais c'était peu pratique et trop théâtral dans une ville où vivaient encore des civils. Je l'ai porté quand je suis allé au front, équipé de mon masque à gaz de fabrication britannique : ils arrivaient et ce n'étaient pas des masques de parade. Même le pistolet automatique qu'on nous faisait porter, à nous les médecins et les officiers de santé. Je sentais le mien appuyé contre le dossier de la chaise. Il y avait des arrestations à faire pour ne pas l'avoir gardé à la vue de tous. Mais Rinaldi ne portait que l'étui rempli de papier hygiénique. Le mien était un pistolet en règle, et je l'avais senti.
C'était un Astra 7,65 à canon court, dont le tir sautait tellement que je ne risquais jamais d'atteindre la cible, mais je m'étais entraîné à bien viser et à maîtriser sa montée en flèche. J'avais finalement réussi à l'atteindre à un mètre, puis à vingt pas, et j'avais alors ressenti tout le ridicule de porter cette arme ; mais j'avais fini par ne plus y prêter attention et à la laisser rebondir sur ma hanche sans impression particulière, si ce n'est un vague sentiment de honte lorsque je rencontrais des Anglo-Saxons.
Je m'assis ; pendant ce temps, sur ma chaise et de l'autre côté d'une petite table, un planteur m'observait d'un air désapprobateur tandis que je regardais les plantations de marbre, les colonnes avec les bustes, et que j'attendais Miss Barkley. Les fresques n'étaient pas mauvaises. Toutes les fresques s'améliorent lorsqu'elles commencent à se rider. J'ai vu Catherine Barkley venir vers moi et je me suis levé. Elle avait l'air moins grande maintenant qu'elle marchait, mais elle restait belle.
Lorsque nous sommes sorties, le planteur nous a suivies des yeux. J'ai marché derrière elle et dès que j'ai été dehors, elle m'a demandé : - Où étais-tu ? -
Nous avions quitté l'allée et nous marchions sous les arbres. J'ai pris ses mains et je me suis arrêté pour l'embrasser.
Nous avons emprunté une allée isolée et un arbre nous a empêchés d'aller plus loin.
Je savais que je n'aimais pas Catherine Barkley et je n'avais aucune idée que je l'aimais ; c'était le jeu de tous les temps, une sorte de bridge où, au lieu de cartes, on joue des mots ; et comme au bridge, on joue pour de l'argent ou pour un autre enjeu ; nous n'avions pas encore déterminé l'enjeu. Nous n'avions pas encore déterminé l'enjeu. Cela me convenait.
Il baissa le regard vers l'herbe.
Mais le jeu ne va pas plus loin. -
J'ai appuyé sur sa main. - Chère Catherine. -
Nous nous sommes embrassés, mais il s'est brusquement détaché.
7.
Le lendemain, en redescendant du premier hôpital, j'ai arrêté la voiture au "triage" où les blessés et les malades étaient répartis selon la destination indiquée sur les dossiers. J'avais conduit et j'étais resté au volant pendant que le mécanicien réfléchissait aux dossiers. Il faisait chaud et le ciel s'étendait dans une lumière bleue sur la route blanche et poussiéreuse. Je suis resté perché sur le siège haut de la Fiat, sans penser à rien. Un régiment est passé et j'ai regardé. Les soldats ruisselaient de sueur, certains portaient des casques mais la plupart les gardaient accrochés à leur sac à dos, les casques étaient trop larges, en général, et ils descendaient jusqu'aux oreilles ; tous les officiers portaient des casques, les leurs avaient une forme plus pratique. La moitié de la Brigade Basilicata passait, je l'ai reconnue à ses insignes rouges et blancs. Avec beaucoup de retard arrivèrent ceux qui n'avaient pas pu suivre le peloton ; ils étaient trempés, poussiéreux et fatigués. Certains avaient l'air en piteux état. Le dernier est arrivé en boitant, s'est arrêté et s'est assis sur le bord de la route. Je suis descendu et je suis allé vers lui.
Après m'avoir regardé, il s'est à nouveau levé :
Le mécanicien est sorti avec les dossiers des personnes présentes dans l'ambulance.