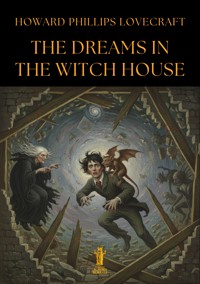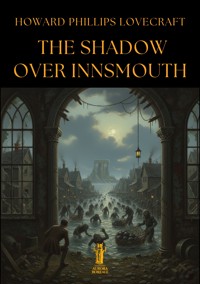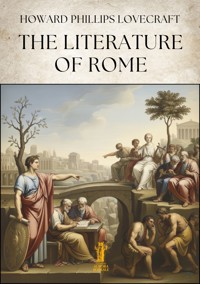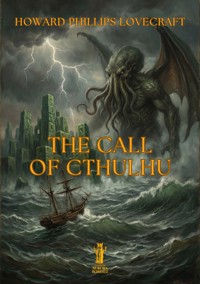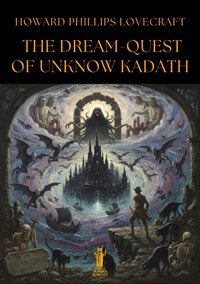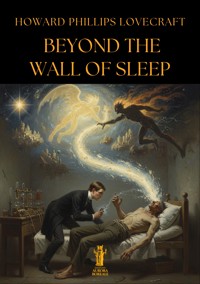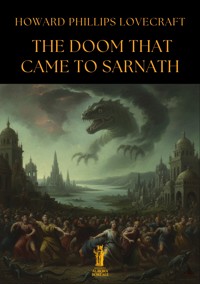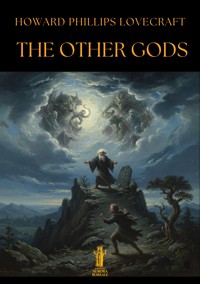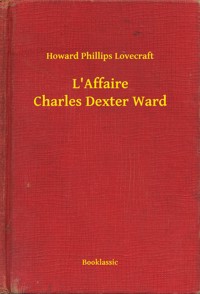
0,88 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: WS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Providence, États-Unis, 1918. Charles Dexter Ward est un jeune homme passionné d'archéologie, d'histoire, et de généalogie. C'est par le biais de cette derniere que Ward se découvre un ancetre nommé Joseph Curwen, qui avait fui la ville de Salem lors de la grande chasse aux sorciers au cours du XVIIIe siecle, et qui vint s'établir a Providence, ou il décéda en 1771. Cette découverte sera le début d'un drame au cours duquel le jeune homme perdra l'esprit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
L'Affaire Charles Dexter Ward
Howard Phillips Lovecraft
« Les Sels essentiels des Animaux se peuvent préparer et conserver de telle façon qu’un Homme ingénieux puisse posséder toute une Arche de Noé dans son Cabinet, et faire surgir, à son gré, la belle Forme d’un Animal à partir de ses cendres ; et par telle méthode, appliquée aux Sels essentiels de l’humaine Poussière, un Philosophe peut, sans nulle Nécromancie criminelle, susciter la Forme d’un de ses Ancêtres défunts à partir de la Poussière en quoi son Corps a été incinéré. »
Borellus.
Chapitre1 Résultat et prologue
Un personnage fort étrange, nommé Charles Dexter Ward, a disparu récemment d’une maison de santé, près de Providence, Rhode Island. Il avait été interné à contrecœur par un père accablé de chagrin, qui avait vu son aberration passer de la simple excentricité à une noire folie présentant à la fois la possibilité de tendances meurtrières et une curieuse modification du contenu de son esprit. Les médecins s’avouent complètement déconcertés par son cas, car il présentait des bizarreries physiques autant que psychologiques.
En premier lieu, le malade paraissait beaucoup plus vieux qu’il ne l’était. À vrai dire, les troubles mentaux vieillissent très vite ceux qui en sont victimes, mais le visage de ce jeune homme de vingt-six ans avait pris une expression subtile que seuls possèdent les gens très âgés. En second lieu, ses fonctions organiques montraient un curieux désordre. Il n’y avait aucune symétrie entre sa respiration et les battements de son cœur ; sa voix était devenue un murmure à peine perceptible ; il lui fallait un temps incroyablement long pour digérer ; ses réactions nervales aux stimulants habituels n’avaient aucun rapport avec toutes celles, pathologiques ou normales, que la médecine pouvait connaître. La peau était sèche et froide ; sa structure cellulaire semblait exagérément grossière et lâche. Une grosse tache de naissance, en forme d’olive, avait disparu de sa hanche gauche, tandis qu’apparaissait sur sa poitrine un signe noir très étrange qui n’existait pas auparavant. Tous les médecins s’accordent à dire que le métabolisme du sujet avait été retardé d’une façon extraordinaire.
Sur le plan psychologique également, Charles Ward était unique. Sa folie n’avait rien de commun avec aucune espèce de démence consignée dans les traités les plus récents et les plus complets ; elle semblait être une force mentale qui aurait fait de lui un génie ou un chef si elle n’eût été bizarrement déformée. Le Dr Willett, médecin de la famille Ward, affirme que les facultés mentales du malade, si on les mesurait par ses réactions à tous les sujets autres que celui de sa démence, s’étaient bel et bien accrues depuis le début de sa maladie. Le jeune Ward avait toujours été un savant et un archéologue ; mais même ses travaux les plus brillants ne révélaient pas la prodigieuse intelligence qu’il manifesta au cours de son examen par les aliénistes. En fait, son esprit semblait si lucide et si puissant qu’on eut beaucoup de peine à obtenir l’autorisation légale de l’interner ; il fallut, pour emporter la décision, les témoignages de plusieurs personnes et la constatation de lacunes anormales dans les connaissances du patient, en dehors de son intelligence proprement dite. Jusqu’au moment de sa disparition, il se montra lecteur omnivore et aussi brillant causeur que le lui permettait sa faible voix. Des observateurs expérimentés, ne pouvant prévoir sa fuite, prédirent qu’il ne manquerait pas d’être bientôt rendu à la liberté.
Seul le Dr Willett, qui avait mis au monde Charles Ward et n’avait pas cessé depuis lors de surveiller son évolution physique et mentale, semblait redouter cette perspective. Il avait fait une terrible découverte qu’il n’osait révéler à ses confrères. En vérité, le rôle qu’il a joué dans cette affaire ne laisse pas d’être assez obscur. Il a été le dernier à parler au malade, trois heures avant sa fuite et plusieurs témoins se rappellent le mélange d’horreur et de soulagement qu’exprimait son visage à l’issue de cet entretien. L’évasion elle-même reste un des mystères inexpliqués de la maison de santé du Dr Waite : une fenêtre ouverte à soixante pieds du sol n’offre pas une solution. Willett n’a aucun éclaircissement à donner, bien qu’il semble, chose étrange, avoir l’esprit beaucoup plus libre depuis la disparition de Ward. En vérité, on a l’impression qu’il aimerait en dire davantage s’il était sûr qu’un grand nombre de gens attacheraient foi à ses paroles. Il avait trouvé le malade dans sa chambre, mais, peu de temps après son départ, les infirmiers avaient frappé en vain à la porte.
Quand ils l’eurent ouverte, ils virent, en tout et pour tout, la fenêtre ouverte par laquelle une froide brise d’avril faisait voler dans la pièce un nuage de poussière d’un gris bleuâtre qui faillit les étouffer. Les chiens avaient aboyé quelque temps auparavant, alors que Willett se trouvait encore dans la pièce ; par la suite, les animaux n’avaient manifesté aucune agitation. On avertit aussitôt le père de Ward par téléphone, mais il montra plus de tristesse que de surprise. Lorsque le Dr Waite se présenta en personne à son domicile, le Dr Willett se trouvait déjà sur les lieux, et les deux hommes affirmèrent n’avoir jamais eu connaissance d’un projet d’évasion. Seuls, quelques amis intimes de Willett et de Mr Ward ont pu fournir certains indices, et ils paraissent beaucoup trop fantastiques pour qu’on puisse y croire. Un seul fait reste certain jusqu’aujourd’hui, on n’a jamais trouvé la moindre trace du fou échappé.
Dès son enfance, Charles Dexter Ward manifesta une véritable passion pour l’archéologie. Ce goût lui était venu, sans aucun doute, de la ville vénérable où il résidait et des reliques du passé qui abondaient dans la vieille demeure de ses parents, à Prospect Street, au faîte de la colline. À mesure qu’il avançait en âge, il se consacra de plus en plus aux choses d’autrefois l’histoire, la généalogie, l’étude de l’architecture et du mobilier coloniaux, finirent par constituer son unique sphère d’intérêt. Il est important de se rappeler ses goûts pour tâcher de comprendre sa folie, car, s’ils n’en constituent pas le noyau, ils jouent un rôle de premier plan dans son aspect superficiel. Les lacunes relevées par les aliénistes portaient toutes sur des sujets modernes. Elles étaient invariablement compensées par des connaissances extraordinaires concernant le passé, connaissances soigneusement cachées par le patient, mais mises à jour par des questions adroites on aurait pu croire que Ward se trouvait transféré dans une autre époque au moyen d’une étrange auto-hypnose. Chose bizarre, il semblait ne plus s’intéresser au temps d’autrefois qui lui était peut-être devenu trop familier. De toute évidence, il s’attachait à acquérir la connaissance des faits les plus banals du monde moderne, auxquels son esprit était resté entièrement et volontairement fermé. Il fit de son mieux pour dissimuler cette ignorance ; mais tous ceux qui l’observaient constatèrent que son programme de lecture et de conversation était déterminé par le désir frénétique d’acquérir le bagage pratique et culturel qu’il aurait dû posséder en raison de l’année de sa naissance (1902) et de l’éducation qu’il avait reçue. Les aliénistes se demandent aujourd’hui comment, étant donné ses lacunes dans ce domaine, le fou évadé parvient à affronter les complications de notre monde actuel ; l’opinion prépondérante est qu’il se cache dans une humble retraite jusqu’à ce qu’il ait accumulé tous les renseignements voulus.
Les médecins ne sont pas d’accord en ce qui concerne le début de la démence de Ward. L’éminent Dr Lyman, de Boston, le situe en 1919-1920, au cours de sa dernière année à Moses Brown School, pendant laquelle il cessa brusquement de s’intéresser au passé pour se tourner vers les sciences occultes, et refusa de passer l’examen d’admission à l’Université sous prétexte qu’il avait à faire des études individuelles beaucoup plus importantes. À cette époque, il entreprit des recherches minutieuses dans les archives municipales et les anciens cimetières pour retrouver une tombe creusée en 1771 : la tombe d’un de ses ancêtres, Joseph Curwen, dont il affirmait avoir découvert certains papiers derrière les boiseries d’une très vieille maison d’Olney Court, au faîte de Stampers Hill, où Curwen avait jadis habité.
Il est donc indéniable qu’un grand changement se produisit dans le comportement de Ward au cours de l’hiver de 1919-1920 ; mais le Dr Willett prétend que sa folie n’a pas commencé à cette époque. Le praticien base cette opinion sur sa connaissance intime du patient et sur certaines découvertes effroyables qu’il fit quelques années plus tard. Ces découvertes l’ont durement marqué : sa voix se brise quand il en parle, sa main tremble quand il essaie de les coucher par écrit. Willett reconnaît que le changement de 1919-1920 semble indiquer le début d’une décadence progressive qui atteignit son point culminant avec l’horrible crise de 1928, mais il estime, d’après ses observations personnelles, qu’il convient d’établir une distinction plus subtile. Sans doute, le jeune homme avait toujours été d’humeur instable ; néanmoins, sa première métamorphose ne représentait pas un accès de folie véritable : elle était due simplement à ce que Ward avait fait une découverte susceptible d’impressionner profondément l’esprit humain.
La démence véritable vint quelques années plus tard quand Ward eut trouvé le portrait et les papiers de Joseph Curwen ; quand il eut effectué un voyage en pays lointain et psalmodié des invocations effroyables dans d’étranges circonstances ; quand il eut reçu certaines réponses à ces invocations et rédigé une lettre désespérée ; quand plusieurs tombes eurent été violées ; quand la mémoire du patient commença à oublier toutes les images du monde moderne, tandis que sa voix s’affaiblissait et que son aspect physique se modifiait. C’est seulement au cours de cette période, déclare Willett, que le personnage de Ward prit un caractère cauchemardesque.
On ne saurait mettre en doute que le patient ait fait, comme il l’affirme, une découverte cruciale. En premier lieu, deux ouvriers étaient auprès de lui quand il trouva les papiers de Joseph Curwen. En second lieu, le jeune homme montra au médecin ces mêmes documents qui semblaient parfaitement authentiques. Les cavités où Ward prétendait les avoir découverts sont une réalité visible. Il y a eu en outre les coïncidences mystérieuses des lettres d’Orne et de Hutchinson, le problème de l’écriture de Curwen, et ce que révélèrent les détectives au sujet du Dr Allen ; sans oublier le terrible message en lettres médiévales minuscules, trouvé dans la poche de Willett quand il reprit conscience après sa terrifiante aventure.
Enfin, et surtout, il y a les deux épouvantables résultats obtenus par le docteur, grâce à certaines formules, résultats qui prouvent bien l’authenticité des papiers et leurs monstrueuses implications.
Il faut considérer l’existence de Ward avant sa folie comme une chose appartenant à un passé lointain. À l’automne de 1918, très désireux de subir l’entraînement militaire qui faisait fureur à cette époque, il avait commencé sa première année à l’École Moses Brown, située tout près de sa maison. Le vieux bâtiment, construit en 1819, et le vaste parc qui l’entoure, avaient toujours eu beaucoup de charme à ses yeux. Il passait tout son temps à travailler chez lui, à faire de longues promenades, à suivre des cours et à rechercher des documents généalogiques et archéologiques dans les différentes bibliothèques de la ville. On peut encore se le rappeler tel qu’il était en ce temps-là grand, mince, blond, un peu voûté, assez négligemment vêtu, donnant une impression générale de gaucherie et de timidité.
Au cours de ses promenades, il s’attachait toujours à faire surgir des innombrables reliques de la vieille cité une image vivante et cohérente des siècles passés. Sa demeure, vaste bâtisse de l’époque des rois George, se dressait au sommet de la colline abrupte à l’est de la rivière : les fenêtres de derrière lui permettaient de voir la masse des clochers, des dômes et des toits de la ville basse, et les collines violettes de la campagne lointaine. C’est là qu’il était né. Partant du porche classique de la façade en brique à double baie, sa nourrice l’avait emmené dans sa voiture jusqu’à la petite ferme blanche, vieille de deux siècles, que la ville avait depuis longtemps enserrée dans son étreinte, puis jusqu’aux majestueux bâtiments de l’Université, le long de la rue magnifique où les grandes maisons de brique et les petites maisons de bois au porche orné de colonnes doriques rêvent au milieu de leurs cours spacieuses et de leurs vastes jardins.
Sa voiture avait également roulé dans Congdon Street, un peu plus bas sur le flanc de la colline, où toutes les maisons du côté est se trouvaient sur de hautes terrasses : elles étaient en général beaucoup plus vieilles que celles du sommet, car la ville avait grandi de bas en haut. La nourrice avait coutume de s’asseoir sur un des bancs de Prospect Terrace pour bavarder avec les agents de police ; et l’un des premiers souvenirs de l’enfant était un océan confus de clochers, de dômes, de toits, de collines lointaines, qu’il aperçut depuis cette grande plate-forme, par un après-midi d’hiver, baigné d’une lumière violette et se détachant sur un couchant apocalyptique de rouges, d’ors, de mauves et de verts.
Lorsque Charles eut grandi, il s’aventura de plus en plus bas sur les flancs de cette colline presque à pic, atteignant chaque fois des parties de la ville plus anciennes et plus curieuses. Il descendait prudemment la pente quasi verticale de Jencken Street pour gagner le coin de Benefit Street : là, il trouvait devant lui une vieille maison de bois à la porte ornée de pilastres ioniens, et, à côté de lui, la grande maison du juge Durfee, qui conservait encore quelques vestiges de sa splendeur défunte. Cet endroit se transformait peu à peu en taudis, mais les ormes gigantesques lui prêtaient la beauté de leur ombre, et l’enfant se plaisait à errer, en direction du sud, le long des demeures de l’époque pré-révolutionnaire, pourvues de grandes cheminées centrales et de portails classiques.
Vers l’Ouest, la colline s’abaissait en pente raide jusqu’au vieux quartier de Town Street qui avait été bâti au bord de la rivière en 1636. Là se trouvaient d’innombrables ruelles aux maisons entassées les unes sur les autres ; et, malgré l’attrait qu’elles exerçaient sur le jeune Ward, il hésita longtemps avant de s’y hasarder, par crainte d’y découvrir des terreurs inconnues. Il préférait continuer à parcourir Benefit Street, en passant devant l’auberge branlante de La Boule d’Or où Washington avait logé. À Meeting Street, il regardait autour de lui : vers l’Est, il voyait l’escalier de pierre auquel la route devait recourir pour gravir la pente ; vers l’Ouest, il apercevait la vieille école aux murs de brique qui fait face à l’antique auberge de La Tête de Shakespeare où l’on imprimait, avant la révolution, La Gazette de Providence. Venait ensuite la première église baptiste de 1775, avec son merveilleux clocher construit par Gibbs. À cet endroit et en direction du Sud, le district devenait plus respectable ; mais les vieilles ruelles dégringolaient toujours la pente vers l’Ouest : spectrales, hérissées de toits pointus, elles plongeaient dans le chaos de décomposition iridescente du vieux port avec ses appontements de bois pourris, ses magasins de fournitures maritimes aux fenêtres encrassées, sa population polyglotte aux vices sordides.
À mesure qu’il devenait plus grand et plus hardi, le jeune Ward s’aventurait dans ce maelström de maisons branlantes, de fenêtres brisées, de balustrades tordues, de visages basanés et d’odeurs indescriptibles. Entre South Main Street et South Water Street, il parcourait les bassins où venaient encore mouiller quelques vapeurs ; puis, repartant vers le Nord, il gagnait la large place du Grand-Pont où la Maison des Marchands, bâtie en 1773, se dresse toujours solidement sur ses arches vénérables. Là, il s’arrêtait pour contempler la prodigieuse beauté de la vieille ville aux multiples clochers, étalée sur la colline, couronnée par le dôme neuf du temple de la Christian Science, comme Londres est couronné par le dôme de Saint-Paul. Il aimait surtout arriver à ce lieu en fin d’après-midi, quand le soleil déclinant dore de ses rayons la Maison des Marchands et les toits amoncelés sur la colline, prêtant un charme magique aux quais où les navires des Indes jetaient l’ancre jadis. Après s’être absorbé dans sa contemplation jusqu’au vertige, il regagnait sa demeure au crépuscule, en remontant les rues étroites où des lueurs commençaient à briller aux fenêtres.
Il lui arrivait aussi de chercher des contrastes marqués. Il consacrait parfois la moitié d’une promenade aux districts coloniaux au nord-ouest de sa maison, à l’endroit où la colline s’abaisse jusqu’à Stampers Hill avec son ghetto et son quartier nègre, groupés autour de la place d’où partait autrefois la diligence de Boston ; et l’autre moitié au charmant quartier du Sud qui renferme George Street, Benevolent Street, Power Street, Williams Street, où demeurent inchangées de belles demeures aux jardins verdoyants entourés de murs. Ces promenades, jointes à des études diligentes, expliquent la science archéologique qui finit par chasser le monde moderne de l’esprit de Charles Ward ; elles nous montrent aussi la nature du sol sur lequel tomba, au cours de ce fatal hiver 1919-1920, la graine qui devait donner un si terrible fruit.
Le Dr Willett est certain que, jusqu’à cette date, il n’y avait aucun élément morbide dans les études et les recherches du jeune homme. Les cimetières présentaient à ses yeux un intérêt purement historique, et il était entièrement dépourvu de tout instinct violent. Puis, par degrés, on vit s’opérer en lui une étrange métamorphose, après qu’il eut découvert parmi ses ancêtres maternels un certain Joseph Curwen, venu de Salem, qui avait fait preuve d’une longévité surprenante et était le héros d’étranges histoires.
Le trisaïeul de Ward, Welcome Potter, avait épousé en 1785 une certaine « Ann Tillinghast, fille de Mme Eliza, elle-même fille du capitaine James Tillinghast » : le nom du père ne figurait pas dans les papiers de la famille. À la fin de l’année 1918, en examinant un volume manuscrit des archives municipales, le jeune généalogiste découvrit une inscription mentionnant un changement légal de nom, par lequel, en l’an 1772, Mme Eliza Curwen, épouse de Joseph Curwen, avait repris, ainsi que sa fille Anne, âgée de sept ans, le nom de son père, le capitaine Tillinghast : étant donné que « le nom de son Mari était devenu un Opprobre public, en raison de ce qu’on avait appris après sa mort, et qui confirmait une ancienne Rumeur, à laquelle une loyale Épouse avait refusé d’ajouter foi jusqu’à ce qu’elle fût si formellement prouvée qu’on ne pût conserver aucun Doute ». Cette inscription fut découverte à la suite de la séparation accidentelle de deux feuillets soigneusement collés ensemble.
Charles Ward comprit tout de suite qu’il venait de se trouver un aïeul jusqu’alors inconnu. Ceci le troubla d’autant plus qu’il avait déjà entendu de vagues rumeurs concernant ce personnage dont il semblait qu’on eût voulu effacer officiellement le souvenir.
Jusqu’alors, Ward s’était contenté de bâtir des hypothèses plus ou moins fantaisistes au sujet du vieux Joseph Curwen ; mais, dès qu’il eut découvert le lien de parenté qui les unissait, il entreprit de rechercher systématiquement tout ce qu’il pourrait trouver. Il réussit au-delà de ses plus grands espoirs : des lettres, des mémoires et des journaux intimes, enfouis dans les greniers de Providence et d’autres villes, recélaient des passages révélateurs que leurs auteurs avaient jugé inutile de détruire. Mais les documents les plus importants, ceux qui, selon le Dr Willett, causèrent la perte de Ward, furent trouvés par le jeune homme, en août 1919, derrière les boiseries d’une maison délabrée d’Olney Court.
Chapitre2 Antécédent et abomination
Joseph Curwen, s’il faut en croire les légendes, les rumeurs et les papiers découverts par Ward, était un homme énigmatique qui inspirait une horreur obscure. Il avait fui Salem pour se réfugier à Providence (ce havre de tous les êtres libres, originaux et dissidents) au début de la grande persécution des sorcières : il craignait d’être accusé de pratiquer la magie, en raison de son existence solitaire et de ses expériences chimiques ou alchimiques. Devenu libre citoyen de Providence, il acheta un terrain à bâtir au bas d’Olney Street. Sa maison fut construite sur Stampers Hill, à l’ouest de Town Street, à l’endroit qui devint par la suite Olney Court ; en 1761, il remplaça ce logis par un autre, beaucoup plus grand, encore debout à l’heure actuelle.
Ce qui parut d’abord le plus bizarre, c’est que Joseph Curwen ne sembla pas vieillir le moins du monde à partir du jour de son arrivée. Il se fit armateur, acheta des appontements près de la baie de Mile-End, et aida à reconstruire le Grand-Pont en 1713 ; mais il garda toujours le même aspect d’un homme de trente à trente-cinq ans. À mesure que les années passaient, cette qualité singulière attira l’attention générale. Curwen se contenta d’expliquer qu’il était issu d’une lignée d’ancêtres particulièrement robustes, et que la simplicité de son existence lui permettait d’économiser ses forces. Les habitants de Providence, ne comprenant pas très bien comment on pouvait concilier la notion de simplicité avec les inexplicables allées et venues du marchand et les lumières qui brillaient à ses fenêtres à toute heure de la nuit, cherchèrent d’autres causes à son étrange jeunesse et à sa longévité. La plupart d’entre eux estimèrent que cet état singulier provenait de ses perpétuelles manipulations de produits chimiques. On parlait beaucoup des curieuses substances qu’il faisait venir de Londres et des Indes sur ses bateaux, où qu’il allait chercher à Newport, Boston et New York. Lorsque le vieux Dr Jabez Bowen arriva de Rehoboth et ouvrit sa boutique d’apothicaire, de l’autre côté du Grand-Pont, à l’enseigne de la Licorne et du Mortier, Curwen lui acheta sans arrêt drogues, acides et métaux. S’imaginant qu’il possédait une merveilleuse science médicale, plusieurs malades allèrent lui demander secours ; il les encouragea dans leur croyance, sans se compromettre le moins du monde, en leur donnant des potions de couleur bizarre, mais on observa que ses remèdes, administrés aux autres, restaient presque toujours sans effet. Finalement, lorsque, après cinquante ans de séjour, Curwen ne sembla pas avoir vieilli de plus de cinq ans, les gens commencèrent à murmurer et à satisfaire le désir d’isolement qu’il avait toujours manifesté.
Diverses lettres et journaux intimes de cette époque révèlent plusieurs autres raisons pour lesquelles on en vint à craindre et à éviter Joseph Curwen comme la peste. Ainsi, il avait une passion bien connue pour les cimetières où on le voyait errer à toute heure, encore que personne ne l’eût jamais vu se livrer à un acte sacrilège. Sur la route de Pawtuxet, il possédait une ferme où il passait l’été et à laquelle il se rendait fréquemment à cheval, de jour ou de nuit. Deux domestiques prenaient soin de ce domaine. C’était un couple d’Indiens Narragansett : le mari avait un visage couturé d’étranges cicatrices ; la femme, d’aspect répugnant, devait avoir du sang noir dans les veines. L’appentis attenant à la ferme abritait le laboratoire de Curwen. Les porteurs qui livraient des flacons, des sacs ou des caisses par la petite porte de derrière, parlaient entre eux de creusets, alambics et fourneaux qu’ils avaient vus dans la pièce aux murs garnis de rayonnages, et disaient à voix basse que le taciturne alchimiste ne tarderait pas à trouver la pierre philosophale. Les voisins les plus proches, les Fenner, qui habitaient à un quart de mille de distance, déclaraient qu’ils entendaient, pendant la nuit, des cris et des hurlements prolongés provenant de la ferme de Curwen. En outre, ils s’étonnaient du grand nombre d’animaux qui paissaient dans les prés : en effet, il n’y avait pas besoin de tant de bêtes pour fournir de la viande, du lait et de la laine à un vieillard solitaire et à ses deux serviteurs. Chose non moins bizarre, le cheptel n’était jamais le même, car, chaque semaine, on achetait de nouveaux troupeaux aux fermiers de Kingstown. Enfin, un grand bâtiment de pierre, dont les fenêtres étaient réduites à d’étroites fentes, avait une très mauvaise réputation.