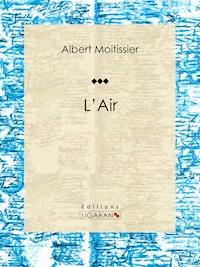
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "La matérialité de l'air a été admise par les plus anciens philosophes, sans qu'ils aient pu appuyer leur manière de voir sur aucune preuve directe. Plongés au sein de l'atmosphère, nous recevons de nos sens des notions fort incertaines, sans doute, sur la nature intime de la masse gazeuse qui nous enveloppe..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335043082
©Ligaran 2015
Il existe, dans toutes les sciences, certaines notions fondamentales qui s’imposent d’elles-mêmes à tout esprit réfléchi, et dont l’origine se perd dans la nuit des temps ; de ce nombre est la notion de l’air : on en trouve la trace chez les peuples les plus anciens dont l’histoire nous ait conservé le souvenir. L’homme, toujours préoccupé des conditions nécessaires à sa vie, ne devait pas tarder à reconnaître l’action puissante exercée par le milieu qui l’environne, et ses premiers efforts vers l’étude de l’univers le conduisent à affirmer l’existence d’un agent, invisible et impalpable sans doute, mais dont les effets ne pouvaient rester longtemps méconnus. Réduits à admirer la mystérieuse activité de l’air sans pouvoir en pénétrer la nature, les premiers hommes ne tardèrent pas à lui attribuer une essence divine ; les mythologies de tous les peuples adorent en lui un esprit créateur, maître de l’univers, donnant la vie à la nature et animant le monde par son souffle bienfaisant.
Cette longue période d’ignorance, entretenue par des idées superstitieuses, est, d’ailleurs, justifiée par les difficultés mêmes qui se rattachent à l’étude des propriétés de l’air. Nous nous faisons une idée des objets qui nous environnent par leur forme, leur couleur, leur étendue ; tout le monde sait ce qu’est un corps liquide ou un corps solide ; nous pouvons les voir, les toucher ; ils se présentent tous avec un caractère commun, ils sont pesants. Mais, dès que ces propriétés échappent à nos sens, il devient plus difficile de concevoir la matière. Il existe cependant une nombreuse classe de corps qui n’ont ni forme ni couleur ; leur subtilité est telle, qu’on a pu croire, pendant des milliers d’années, qu’ils n’avaient pas de poids ; ces corps, dont l’air nous offre un des types les plus parfaits, sont désignés sous le nom de gaz. Il y a plus ; une même substance peut affecter successivement ces différents états ; l’eau nous en présente un exemple bien connu : liquide dans les circonstances ordinaires, elle prend la forme solide quand elle est congelée, et se convertit en vapeur quand on la chauffe. Cette vapeur, invisible et transparente comme l’air, n’est autre chose que de l’eau à l’état gazeux, et personne n’ignore avec quelle facilité elle se transforme de nouveau en eau liquide ou en glace.
Que l’on se représente maintenant les premiers observateurs, abandonnés à eux-mêmes en face de la nature, dans une ignorance absolue de ces principes fondamentaux, dépourvus des procédés d’expérimentation les plus élémentaires : on comprendra sans peine pourquoi la constitution de l’air est restée si longtemps impénétrable. Il faut arriver au milieu du dix-septième siècle pour voir se déchirer un lambeau du voile qui obscurcissait cette importante question. À partir de cette époque, commence pour la science une ère nouvelle : mais combien n’a-t-il pas fallu de persévérants efforts pour mettre la dernière main à cette première ébauche ! Depuis Galilée jusqu’à Lavoisier, combien de génies ont épuisé leurs forces à élucider les points les plus importants de ce difficile problème ! et, après tant, de brillantes découvertes, que de choses restent encore à trouver !
On sait aujourd’hui que l’air est une substance gazeuse, uniformément répandue sur toute la surface du globe, formant autour de lui une enveloppe appelée atmosphère, dont l’épaisseur est encore mal connue. Lavoisier nous a appris que cet air est essentiellement formé de deux gaz, l’oxygène et l’azote, dont l’un entretient la vie, tandis que le second modère la dangereuse activité du premier. À ces deux éléments se joint la vapeur d’eau, versée à profusion dans l’atmosphère par l’évaporation des mers. Perdus au fond de cet océan gazeux, nous sommes témoins des changements qui s’y opèrent sans cesse, et nous en ressentons continuellement l’influence. Cette seule considération suffirait certainement à exciter vivement notre curiosité ; mais nous trouvons dans l’étude de l’air bien d’autres sujets dignes de captiver notre attention : la formation de la pluie et des orages, la naissance des vents et des tempêtes, la distribution de la chaleur et de la lumière a la surface de la terre, l’apparition de ces brillants météores répandant sur la nature une féerique illumination, toutes ces merveilles sont l’œuvre de l’atmosphère, animée par les rayons du soleil.
Opinion des anciens. – Observations de Galilée. – La machine pneumatique. – Découverte de Torricelli. – Expérience de Pascal. – Baromètre de Fortin. – Baromètre anéroïde. – Pressions exercées par l’air. – Poids total de l’atmosphère.
La matérialité de l’air a été admise par les plus anciens philosophes, sans qu’ils aient pu appuyer leur manière de voir sur aucune preuve directe. Plongés au sein de l’atmosphère, nous recevons de nos sens des notions fort incertaines, sans doute, sur la nature intime de la masse gazeuse qui nous enveloppe, mais sa présence se révèle à nous par des effets trop variés et trop nombreux pour qu’on ait pu songer à lui refuser les attributs les plus essentiels de la matière. Si l’on trouve dans les auteurs anciens l’air souvent désigné sous le nom d’esprit, on doit voir seulement dans cette expression figurée une manière d’exprimer la subtilité de ce fluide en même temps que le rôle immense qu’il joue dans toutes les manifestations de la vie.
Comme la plupart des corps transparents, l’air est invisible ; il se laisse traverser par la lumière avec une telle facilité, qu’interpose en couche même très épaisse entre nos yeux et les objets extérieurs, il semble ne produire en nous aucune sensation capable de trahir sa présence. Il serait cependant inexact d’attribuer à l’air une invisibilité absolue. Vu en niasse considérable, il nous apparaît avec cette belle nuance d’azur qui constitue la couleur bleue du ciel. Lorsque nous contemplons un paysage vivement éclairé, à la brillante illumination des premiers plans succède une coloration plus douce, passant insensiblement par toutes sortes de gradations, et couvrant d’un voile opalin les plans les plus éloignés. Les montagnes de l’horizon nous semblent le plus souvent colorées en bleu ; d’autres fois, elles se parent d’une nuance rose ou orangée ; tous ces mélanges merveilleux de tons si doux et si variés ont pour origine l’action de l’air sur la lumière du soleil, et l’atmosphère nous révèle constamment sa présence par des effets sublimes que l’œil ne se lasse jamais d’admirer.
La matérialité de l’air se manifeste par d’autres actions dont le caractère grandiose devait nécessairement frapper l’attention des premiers observateurs. Comment expliquer cette agitation incessante dont l’atmosphère est le théâtre, sans attribuer à l’air une essence matérielle, sans saisir l’analogie qui le rattache à tous les corps de la nature, seuls capables de recevoir et de transmettre un mouvement ? Le navire, poussé sur les Ilots de la mer par le souffle du vent, reçoit de l’air l’impulsion qui l’anime ; c’est l’air en mouvement qui soulève en vagues gigantesques les eaux de l’Océan, et déchaîne sur notre globe les plus furieuses tempêtes. Toute la bruyante agitation de la nature, au sein d’un milieu invisible, serait inconcevable, si les forces qui la produisent n’avaient pour point d’application un élément matériel.
Les anciens n’avaient cependant que des notions très vagues et fort incomplètes sur la nature de l’air. On a lieu de s’étonner, en présence des effets si puissants exercés par l’atmosphère, de la longue ignorance des philosophes de l’antiquité ; des expériences mal conçues semblaient même leur indiquer l’absence des propriétés les plus essentielles. Ils admettaient généralement que l’air était sans poids, et arrivaient ainsi à la conception singulière d’une substance à la fois matérielle et impondérable. Cette croyance avait surtout pour base une expérience d’Aristote, en apparence irréfutable ; ayant pris une outre d’abord vide, puis gonflée d’air, il fut surpris de lui trouver exactement le même poids. La conclusion de ce fait fut que l’air dont elle était remplie était impondérable. Il faut arriver aux siècles modernes pour voir se dissiper ces grossières erreurs, et trouver des notions exactes sur cette importante question.
On attribue généralement à Galilée les premières expériences destinées à démontrer la pesanteur de l’air. On trouve cependant, dans des observations antérieures de dix ans à celles du savant italien, la preuve certaine que ce fait était déjà nettement établi. Jean Rey, médecin français, né à Bugue sur la Dordogne vers la fin du seizième siècle, publiait en 1630 un remarquable opuscule, dans lequel il réfute l’opinion et les expériences des anciens, et établit lui-même la pesanteur de l’air de la manière suivante :
Balançant l’air dans l’air mesme, et ne lui trouvant point de pesanteur, ils ont cru qu’il n’en avait point. Mais qu’ils balancent l’eau (qu’ils croient pesante) dans l’eau mesme, ils ne lui en trouveront non plus ; estant très véritable que nul élément pèse dans soi-mesme. Tout ce qui pèse dans l’air, tout ce qui pèse dans l’eau, doibt soubs esgal volume contenir plus de poids (pour plus de matière) que l’air ou l’eau dans lequel le balancement se pratique.
Remplissez d’air à grand force un ballon avec un soufflet, vous trouverez plus de poids à ce ballon plein qu’à lui-mesme étant vide.
Ces quelques lignes établissent d’une manière indiscutable la priorité de la découverte du médecin français ; ce n’est, en effet, qu’en 1640 que Galilée fut conduit à soupçonner la pesanteur de l’air. Il était alors presque octogénaire, quand des fontainiers de Florence vinrent le consulter sur un fait curieux qu’ils venaient d’observer. Chargés de construire une pompe dans le palais du grand-duc, ils virent avec surprise que l’eau refusait de s’élever au-delà d’une hauteur de 32 pieds, malgré le bon état de leur appareil. Galilée pensa que la pression de l’air devait intervenir dans l’ascension du liquide ; mais cette explication exigeait nécessairement que l’air fût pesant. Pour vérifier le fait, il expulsa l’air d’une bouteille, en faisant bouillir dans son intérieur une petite quantité d’eau ; la bouteille, hermétiquement fermée, fut pesée vide, et il vit son poids augmenter dès qu’en la débouchant il permettait à l’air de la remplir. Cette expérience est, on le voit, la contre-partie de celle de Jean Rey. Celui-ci accumulait dans un vase une quantité d’air supérieure à celle qu’il renfermait normalement ; Galilée faisait le vide dans une bouteille, et constatait une augmentation de poids dès qu’il la remplissait d’air.
On comprend, d’après ce qui précède, pourquoi tant d’observateurs ont échoué dans leurs tentatives pour apprécier directement la pesanteur de l’air : la difficulté de l’expérience consistait à extraire ce gaz des récipients.
Aussi, la question ne fut-elle définitivement résolue que lorsque, en 1654, Otto de Guericke, bourgmestre de Magdebourg, eût doté la science d’un ingénieux appareil qui devint une source féconde de progrès : nous voulons parler de la machine pneumatique.
Cet instrument consiste essentiellement en un corps de pompe muni d’un piston et de deux soupapes. Sa disposition est analogue à celle des pompes employées à élever l’eau. La partie inférieure du cylindre est reliée, par un canal étroit, à une plaque horizontale de métal ou de verre soigneusement dressée, c’est la platine de la machine, destinée à recevoir la cloche ou tout autre récipient dont on veut extraire l’air. Supposons d’abord le piston au bas de sa course et élevons-le jusqu’à la partie supérieure : le vide se fera nécessairement au-dessous de lui, mais en même temps l’air de la cloche pressant par son élasticité sur la soupape qui ferme le tube de communication, la soulèvera et se précipitera dans le corps de pompe. Vient-on maintenant à abaisser le piston, l’air emprisonné au-dessous de lui se comprime et ferme la soupape inférieure, tandis qu’il soulève celle dont le piston est muni, et s’échappe dans l’atmosphère par cet orifice. Recommençons plusieurs fois la même manœuvre, à chaque coup de piston une partie de l’air sera expulsée, et peu à peu le vide se fera dans le récipient.
La machine d’Otto de Guericke ne tarda pas à subir dans sa construction d’importants et nombreux perfectionnements. La figure 2 montre la disposition le plus généralement adoptée. On y voit deux corps de pompe en cristal, munis chacun d’un piston, dont l’un s’élève pendant que l’autre s’abaisse ; on réalise ainsi le double avantage d’une extraction plus rapide de l’air en même temps que la manœuvre de l’appareil est rendue beaucoup moins pénible. Il sortirait de notre sujet de décrire ici les modifications successivement apportées à la machine pneumatique ; il nous suffira d’avoir indiqué le principe de cet instrument qui a été le point de départ des plus importantes découvertes dans la question qui nous occupe.
Le physicien de Magdebourg venait à peine de terminer son invention, qu’il l’appliqua à l’étude de la pesanteur de l’air ; reprenant dans des conditions rationnelles la vieille expérience d’Aristote, il arriva sans peine à la démonstration d’un fait qui avait dérouté la sagacité des plus infatigables chercheurs de l’antiquité. L’outre du philosophe grec fut remplacée par un globe de cristal qui, déplaçant toujours le même volume d’air extérieur, rendait appréciables toutes les variations de poids de son contenu. Il prit un simple ballon de verre dont le goulot était muni d’un robinet, et après l’avoir suspendu au fléau d’une balance, il lui fit exactement équilibre par des poids placés dans l’autre plateau. Il y fit ensuite le vide et, le reportant sur la balance, il constata une notable diminution de poids. En ouvrant alors le robinet, il laissa l’air rentrer peu à peu dans l’appareil et vit se rétablir ainsi l’équilibre primitivement rompu.
Cette expérience devait encore servir à l’évaluation du poids absolu de l’air : en opérant sur un ballon de 10 litres de capacité, et en y faisant un vide aussi complet que possible, on reconnaît que la perte de poids est de 12 à 15 grammes environ et, en apportant à ce chiffre toutes les corrections nécessaires, on la trouve exactement égale à 12gr, 93. Un litre d’air pèse donc 1gr, 293 ; cette quantité est loin d’être négligeable, car elle représente seulement la sept cent soixante-dixième partie du poids d’un égal volume d’eau.
La pesanteur de l’air une fois bien constatée, on doit naturellement s’attendre à retrouver dans ce gaz toutes les propriétés mécaniques que possèdent les corps pesants, et à lui voir exercer des actions semblables à celles qui manifestent ces derniers ; c’est, en effet, ce que justifient les observations les plus élémentaires. Imaginons, par exemple, un bloc de plomb placé sur une table, il en pressera la surface avec d’autant plus de force que son poids sera plus considérable ; ce poids devient-il suffisant pour vaincre la résistance de la table, celle-ci fléchira d’abord et finira par se rompre sous l’action de cette pression exagérée. De même, les couches d’air, dont l’ensemble constitue l’atmosphère, exercent par leur poids une pression analogue sur la surface de tous les objets terrestres ; on conçoit même qu’il suffirait de connaître cette pression pour évaluer le poids total de l’atmosphère.
Une expérience des plus simples met en évidence cette pression produite par l’atmosphère ; c’est encore la machine pneumatique qui va nous permettre de la réaliser. Fixons sur la platine un cylindre de verre fermé supérieurement par un morceau de vessie solidement attaché, puis faisons graduellement le vide dans l’appareil. Dès le premier coup de piston, nous voyons la membrane s’affaisser et devenir concave, comme si un poids pesait à sa surface : bientôt la concavité augmente, et la vessie ne tarde pas à se rompre avec bruit, indiquant ainsi l’action d’une pression extérieure considérable. On s’étonnera peut-être que le même effet ne se manifeste pas avant qu’on n’ait fait le vide sous la cloche, mais il suffit de remarquer que l’air intérieur réagit par sa propre pression contre celle de l’atmosphère, en formant au-dessous de la membrane une sorte d’étançon invisible, neutralisant exactement l’action extérieure.
On explique sans peine, en se fondant sur ces principes, pourquoi l’eau s’élève dans le tube d’une pompe aspirante : le corps de pompe, véritable machine pneumatique, fait le vide à la partie supérieure du tuyau d’aspiration ; l’atmosphère, agissant alors par son poids sur la surface du liquide, en presse les divers points et le force à s’élever dans le tube ; mais on conçoit aussi que cette ascension devra avoir une limite, puisque le poids de la colonne d’air est lui-même limité. Ainsi s’explique l’observation des fontainiers de Florence, qui ne purent élever l’eau par aspiration à une hauteur supérieure à 52 pieds ; Galilée comprit aussitôt qu’une colonne d’eau de cette hauteur devait équilibrer la pression atmosphérique ; et quelques années après, Torricelli son élève, développant les idées du maître, dotait la science d’un de ses instruments les plus précieux.
Si la pression exercée par le poids de l’air est la cause réelle qui soutient un liquide dans un tube vide, on doit prévoir que la nature du liquide exercera une grande influence sur la hauteur à laquelle il pourra être soulevé : plus il sera pesant, moins sera grande cette hauteur. Tel est le raisonnement qui conduisit Torricelli à la construction du baromètre. Le mercure, à cause de sa grande densité, se prêtait merveilleusement à la vérification de ses idées. Ce corps pesant en effet, à volume égal, 13 fois 1/2 plus que l’eau, il devait en résulter qu’à la colonne d’eau de 52 pieds on pourrait substituer, sans rien changer aux résultats de l’expérience, une hauteur de mercure 15 fois 1/2 plus petite, le poids des deux colonnes restant le même.
L’expérience célèbre de Torricelli confirma pleinement cette vue théorique. Il prit un tube de verre de 1 mètre de longueur environ, fermé à une de ses extrémités. Ce tube fut rempli de mercure, et après avoir bouché avec le doigt son extrémité ouverte il le retourna verticalement pour en faire plonger l’orifice dans un vase rempli du même liquide. Le mercure descendit aussitôt dans le tube d’une certaine quantité, et resta suspendu à une hauteur constante de 76 centimètres environ au-dessus du niveau du mercure dans la cuvette.
Telle est l’origine du baromètre, instrument d’une si merveilleuse simplicité qu’on s’étonne de ne pas en voir remonter la découverte à une époque plus reculée, quand les faits sur lesquels elle repose étaient connus depuis des siècles. Dès les temps les plus anciens, on avait observé l’ascension de l’eau dans les tubes purgés d’air ; mais loin de chercher à se rendre compte de phénomènes aussi simples, on préférait les expliquer par des actions mystérieuses. « La nature, disait-on, a un amour secret pour le plein ; dès qu’il y a quelque part défaut de matière, elle s’empresse d’y en porter ; en un mot, la nature abhorre le vuide. » Les esprits les plus sérieux se contentaient de pareilles explications ! Galilée lui-même ne reculait pas devant cette interprétation naïve, et ce n’est qu’en présence d’une observation inattendue « qu’il se révolta contre cette manière de philosopher ; et bien loin de penser, comme aurait pu le faire quelque autre, que l’horreur du vide avait ses limites au-delà desquelles elle se tournait en indifférence, il commença à croire que ces sortes de phénomènes avaient une cause physique bien différente de ce qu’on avait imaginé jusqu’alors pour les expliquer. » Quoi de plus difficile à déraciner que ces préjugés vulgaires qui prennent peu à peu force de loi, luttant sans cesse contre les manifestations de la vérité, pour dérouter et ralentir les progrès de la science ! Combien il serait plus sage d’avouer franchement notre ignorance sur les faits que nous ne comprenons pas, que de la déguiser sous des explications vides de sens, toujours inutiles et le plus souvent dangereuses.
Comme toutes les idées nouvelles, la découverte de Torricelli ne parvint pas sans peine à prendre le rang qu’elle était destinée à occuper ; peut-être même serait-elle restée longtemps dans l’oubli, si elle n’eût été fécondée et développée par le génie de Pascal. On a souvent considéré ce philosophe comme l’inventeur du baromètre ; il suffit cependant de lire ses écrits pour rester convaincu qu’il n’a jamais eu l’intention de s’attribuer la plus faible part dans cette découverte ; il repousse même avec énergie l’honneur que l’on semblait vouloir faire rejaillir sur lui ; il insiste à plusieurs reprises sur l’importance des travaux du savant italien, revendiquant seulement les expériences nouvelles qu’elle lui a suggérées. Mais si la France ne peut prétendre à l’honneur de l’invention du baromètre, c’est à elle que revient la gloire d’avoir fait triompher la vérité, et de l’avoir répandue par l’organe d’un de ses plus grands génies.
Le grand mérite de Pascal a été de comprendre l’immense portée de la nouvelle invention et d’en faire ressortir toutes les conséquences. Désireux surtout d’appuyer par des preuves décisives le principe de Torricelli, il conçut des expériences nouvelles d’une exécution difficile et délicate, mais qu’il sut mener à bonne fin, malgré les soins minutieux qu’elles exigeaient. Il répéta d’abord l’expérience fondamentale du disciple de Galilée, en varia les conditions, et ne recula pas devant la construction d’un baromètre à eau. L’opération fut exécutée à Rouen en 1646. Le tube avait 46 pieds de long ; il fut scellé à une de ses extrémités et rempli d’eau, puis dressé verticalement à l’aide de cordes et de poulies, pendant que son extrémité ouverte était plongée dans un vase plein d’eau. La colonne liquide s’abaissa aussitôt dans le tube pour se maintenir à une hauteur constante de 52 pieds, tandis que la partie supérieure de l’appareil était complètement vide d’air ; ainsi se trouvait confirmée par une expérience colossale l’idée-mère de Torricelli.
Deux ans plus tard, l’ingéniosité de Pascal concevait une expérience plus décisive encore, dont il confia l’exécution à son beau-frère, Florin Périer. « J’ai imaginé, lui écrivait-il, une expérience qui pourra lever tous les doutes si elle est exécutée avec justesse. Que l’on fasse l’expérience du vide plusieurs fois, en un même jour, avec le même vif-argent, en bas et au sommet de la montagne du Puy, qui est auprès de notre ville de Clermont. Si, comme je le pense, la hauteur du vif-argent est moindre en haut qu’en bas, il s’ensuivra que la pesanteur ou pression de l’air est la cause de cette suspension, puisque, bien certainement, il y a plus d’air qui pèse sur le pied de la montagne que sur son sommet, tandis qu’on ne saurait dire que la nature abhorre le vide en un lieu plus qu’en un autre. »
L’expérience, habilement conduite par les soins de Périer, donna les résultats prévus ; répétée par Pascal lui-même, à Paris, au sommet et à la base de la tour Saint-Jaques-la-Boucherie, elle fut suivie du même succès, de sorte que le baromètre fournissait non seulement un moyen de démontrer facilement la pression exercée par l’air, mais il devenait encore un instrument capable de mesurer l’intensité de cette pression, et d’en suivre toutes les variations à la surface du globe.
Les travaux de Pascal ont été le point de départ d’une des applications les plus importantes du baromètre : la mesure de la hauteur des montagnes. L’air pris à la surface du sol pèse 10 515 fois moins que le mercure ; en lui attribuant une densité uniforme à toutes les hauteurs, on pourrait par un calcul très simple déduire la hauteur d’une station d’après une simple observation barométrique. Dans cette hypothèse, à chaque millimétré dont s’abaisserait la colonne mercurielle correspondrait une couche d’air 10 515 fois plus épaisse, c’est-à-dire une hauteur de 10 mètres environ. Mais les choses sont loin de se passer avec cette simplicité. À mesure que l’on s’élève dans l’atmosphère, chaque couche d’air est affranchie du poids des couches laissées au-dessous d’elle. Cette diminution de pression permet à l’air de se dilater, de sorte qu’un même poids occupe un plus grand espace ; d’autres influences, telles que le degré d’humidité, la température, viennent encore compliquer le problème. Aussi, de nombreuses corrections sont-elles nécessaires pour éliminer l’influence de ces divers éléments. Il est possible cependant d’obtenir par ce procédé des résultats d’une grande rigueur, à la condition toutefois de s’entourer des précautions les plus minutieuses.
La perfection du baromètre doit avoir, on le conçoit, une importance capitale sur l’exactitude de ses indications ; nous ne voulons pas entrer ici dans tous les détails que comporte sa construction, ni dans l’énumération de tous les perfectionnements dont il a été l’objet depuis son origine ; nous indiquerons seulement la forme la plus usitée dans les recherches scientifiques. La figure 7 représente le baromètre de Fortin, tel qu’on le construit habituellement ; il joint à une précision suffisante l’avantage d’une grande légèreté et celui d’être facilement transportable. La cuvette, d’un petit diamètre, contient un poids peu considérable de mercure ; de plus, le fond de cette cuvette est formé d’une peau flexible que peut soulever ou abaisser une vis de pression ; il est facile d’amener ainsi le mercure à une hauteur fixe, indiquée par un repère ; enfin, en soulevant complètement le fond mobile de la cuvette, on force le liquide à s’élever jusqu’au sommet du tube, et l’instrument peut alors être transporté sans risquer d’être brisé par les chocs du mercure. Ajoutons que le tout est protégé par une enveloppe de cuivre, portant une graduation en millimètres, et munie d’une fente permettant de viser le sommet de la colonne.
Le baromètre à mercure n’est pas le seul dont on fasse usage. On se sert beaucoup, depuis quelques années, d’appareils fondés sur un principe complètement différent, très commodes et très portatifs, mais dont l’exactitude laisse malheureusement beaucoup à désirer : ce sont les baromètres anéroïdes. Un tube mince de laiton, à section elliptique, est complètement purgé d’air et hermétiquement clos à ses deux extrémités. Ce tube, contourné en cercle, est fixé par son milieu et libre à ses deux bouts. Quand la pression atmosphérique augmente, l’aplatissement du tube s’accroît et ses deux extrémités se rapprochent, un effet inverse se produit sous l’influence d’une diminution de pression. Ces mouvements alternatifs sont amplifiés par un mécanisme d’horlogerie, et transmis à une longue aiguille qui se meut sur un cadran divisé. Le jeu de cet appareil est fondé, comme on le voit, sur l’élasticité des métaux réduits en lame mince, mais cette élasticité ne conserve pas toujours la même valeur ; elle diminue ordinairement avec le temps, de sorte que les baromètres anéroïdes ne sont pas toujours comparables à eux-mêmes ; de là, la nécessité de réglages fréquents et de comparaisons souvent répétées avec un baromètre à mercure étalon : en résumé, ces instruments suffisent, à la rigueur, pour des observations ordinaires ; mais, ils ne comportent pas le degré de précision nécessaire à des recherches délicates.
La découverte du baromètre venait de résoudre divers problèmes d’une haute importance. Mais là ne se bornent pas les services rendus par cet admirable instrument. Il ne fournit pas seulement un moyen facile de démontrer la pesanteur de l’air, il permet encore de déduire d’une simple observation le poids total de l’atmosphère qui recouvre la surface du globe. Un calcul des plus élémentaires répond à la question, et ce calcul a été effectué par Pascal lui-même. La pression exercée par l’air sur les objets terrestres est équivalente, on vient de le voir, à celle qu’exercerait une enveloppe d’eau de 10m, 30 d’épaisseur, ou une couche de mercure de 76 centimètres uniformément répartie à la surface du sol ; l’intensité de cette pression devient, par conséquent, facile à évaluer en kilogrammes.
Personne n’ignore que le poids de 1 litre d’eau est égal à 1 kilogramme, et que le litre correspond au volume d’un cube de 10 centimètres de côté. Chaque carré de 10 centimètres pris à la surface du sol supportera donc une pression représentée par le poids d’une colonne d’eau de 10m, 3, ou de 103 décimètres de hauteur, c’est-à-dire de 103 kilogrammes. Ce poids représente, en nombre rond, 1 kilo par centimètre carré, ou 10000 kilos par mètre carré. Or, il est facile d’évaluer avec assez d’exactitude la surface du globe, quand on connaît son diamètre. On trouve ainsi que le poids total de l’atmosphère correspond à 5 quintillions de kilogrammes.
Ce chiffre est trop colossal pour parler nettement à notre esprit ; on s’en fera peut-être une idée plus exacte par une comparaison : ainsi, l’atmosphère accumulée en une seule masse pèserait autant qu’une sphère de cuivre de 100 kilomètres de diamètre, ou que 5 millions de cubes d’eau de 1 kilomètre de côté. C’est à peu près la millionième partie du poids total de la terre.
Tous les corps plongés dans l’atmosphère supportent donc d’énormes pressions, et cependant aucun phénomène sensible ne semble en manifester l’influence ; une mince feuille de papier n’en ressent pas plus les effets qu’une épaisse planche de bois. Il suffit de remarquer, pour expliquer cette apparente contradiction, que la pression s’exerce dans tous les sens avec la même intensité ; les objets sont également comprimés sur toutes leurs faces, d’où résulte un état d’équilibre qui empêche les corps d’être écrasés par ce poids considérable.
Mais vient-on à soustraire à l’action de l’air une partie de leur surface, les effets de la pression se font immédiatement sentir, comme on l’a vu précédemment dans l’expérience du crève-vessie.
Le corps des animaux, et celui de l’homme en particulier, n’est pas soustrait à de pareilles influences ; on peut évaluer à 1 mètre carré 1/2 la surface du corps d’un homme de taille moyenne, et à cette surface correspond une pression de 15000 kilos ; nous n’avons cependant pas conscience du poids énorme qui pèse sur nous, et si le corps n’éprouve aucune gêne dans ses mouvements, c’est que les pressions s’équilibrent exactement autour de lui. L’air le presse à la fois de haut en bas et de bas en haut avec la même intensité ; il pénètre dans toutes nos cavités, dans tous nos tissus, et réagit encore de l’intérieur à l’extérieur avec la même énergie.
La machine pneumatique se prête à une foule d’expériences curieuses, propres à démontrer l’existence et la puissance de la pression atmosphérique. Nous citerons seulement la suivante, due à Otto de Guericke, et désignée sous le nom d’expérience des hémisphères de Magdebourg. Deux hémisphères en cuivre s’emboîtent réciproquement, et forment par leur réunion une sphère creuse hermétiquement close. Les deux moitiés se séparent sans peine l’une de l’autre tant que l’appareil contient de l’air ; mais vient-on à faire le vide intérieurement, la séparation devient très difficile, presque impossible même, si le diamètre de l’appareil est suffisamment grand. Dans une des expériences du savant Hollandais, les hémisphères avaient un diamètre de 65 centimètres. L’effort de quatre vigoureux chevaux, attelés sur chacune des moitiés, ne parvint pas à les séparer ; la pression atmosphérique correspondait, en effet, à 3 500 kilogrammes environ.
Différents états de la matière. – Expansibilité et compressibilité des gaz. – Loi de Mariotte. – Liquéfaction de l’acide carbonique. – Action de la chaleur sur l’air. – Relations entre ses changements de volume et ses variations de pression, – Montgolfières. – La chaleur et le travail mécanique. – Travail effectué pendant la dilatation de l’air. – Chaleur nécessaire pour effectuer ce travail. – Équivalent mécanique de la chaleur. – Le zéro absolu.
La plupart des faits énoncés dans les pages précédentes n’ont pas seulement pour cause l’action de la pesanteur sur l’air atmosphérique ; ils dépendent encore d’une importante propriété de l’air, commune à tous les corps gazeux et sur laquelle nous devons nous arrêter un instant.
Tous les objets qui frappent nos regards nous apparais sent avec des formes déterminées ; c’est le plus souvent par ces formes extérieures que nous les distinguons les uns des autres ; nous pouvons même grouper à notre gré des matériaux solides quelconques et donner à cet assemblage toutes les figures imaginables. Mais tous les corps ne se prêtent pas à des dispositions aussi variées. Un liquide, par exemple, se moule exactement dans le vase qui le contient ; il n’a, par lui-même, d’autre forme que celle de sa surface toujours plane et horizontale. Si les vagues de la mer semblent échapper à cette loi, si un jet d’eau conserve une forme spéciale et permanente, si une cascade prend l’aspect d’une nappe limpide presque immobile, il ne faut pas perdre de vue que tous ces phénomènes sont dus à une cause spéciale, se renouvelant sans cesse pour produire un mouvement continu. Le souffle du vent, la pression exercée par un niveau supérieur, la chute de l’eau d’un point élevé, sont nécessaires pour entretenir la forme des vagues, celle du jet d’eau ou de la cascade ; c’est toujours une nouvelle masse liquide qui se montre à nos yeux, la seule continuité de son mouvement lui donne une forme permanente ; que ces causes viennent à disparaître, l’eau reprend aussitôt son allure normale, elle n’a plus d’autre forme que celle de sa surface.
Les choses se passent tout autrement encore dans une masse gazeuse. L’air n’a plus, en effet, ni forme, ni volume, ni surface libre ; non seulement il se moule exactement dans le vase qui le renferme, mais, que la capacité du récipient vienne à augmenter ou à diminuer, l’air qu’il contient suit les mêmes variations ; tantôt dilaté, tantôt comprimé, il sera toujours uniformément répartie dans toutes les portions du vase ; on exprime ces faits en disant que les gaz sont expansibles et compressibles.
L’expansibilité des gaz peut être mise en évidence par une expérience très saisissante. Plaçons sous la cloche de la machine pneumatique une vessie à moitié remplie d’air, et fermée par un robinet : dès les premiers coups de piston on la voit se gonfler spontanément ; peu à peu ses parois se distendent et finissent quelquefois par se rompre ; mais laisse-t-on rentrer l’air dans le récipient, la vessie s’affaisse aussitôt pour reprendre son état primitif. Il est à peine nécessaire de donner l’explication de ce phénomène : au début de l’expérience, la vessie, également pressée dans les deux sens par le gaz qu’elle renferme et par celui qui pèse sur elle, doit conserver sa forme primitive ; mais le vide se fait-il autour d’elle, la diminution de la pression extérieure permet au gaz d’augmenter de volume et de repousser les parois de son enveloppe.
Une expérience inverse démontre la compressibilité de l’air. Dans un tube de verre à parois résistante fermé à l’une de ses extrémités, se meut un piston de cuir qui en ferme exactement l’ouverture ; il suffit de presser sur la tige du piston pour réduire le volume de l’air contenu dans l’appareil ; mais dès qu’on l’abandonne à elle-même, le piston reprend aussitôt sa position primitive, repoussé par l’air comprimé.
Ces deux propriétés des gaz achèvent d’expliquer le mécanisme peut-être encore un peu obscur dans l’esprit du lecteur des expériences indiquées dans le chapitre précédent ; elles montrent pourquoi dans la machine pneumatique l’air se précipite, à chaque coup de piston, du récipient dans le corps de pompe ; pourquoi on peut extraire d’une minière à peu près complète l’air renfermé dans un ballon de verre ; ces faits seraient inexplicables sans la faculté que possèdent les gaz de se répandre instantanément dans un espace vide ouvert devant eux. On conçoit alors que chaque coup de piston enlève une portion du fluide gazeux en rapport avec le volume du corps de pompe, mais on comprend aussi qu’il sera impossible d’arriver à un vide absolu, puisqu’on n’extrait jamais qu’une partie de ce qu’il reste.
L’expansibilité et la compressibilité de l’air constituent deux de ses propriétés les plus caractéristiques, et par conséquent les plus intéressantes ; aussi n’est-il pas surprenant de les voir étudiées avec soin dès l’origine même de la découverte de Torricelli ; c’est à l’abbé Mariotte que sont dues les premières recherches sur ce sujet. En comparant les relations qui existent entre les divers volumes d’une même masse d’air et les pressions auxquelles elle est soumise, il est arrivé à formuler une loi d’une extrême simplicité qui a été le point de départ de toutes les questions relatives à l’étude des gaz.
Mariette prit un long tube de verre, recourbé, comme le montre la figure, en deux branches de longueur très inégale ; la plus courte était fermée, la plus longue ouverte. Un peu de mercure introduit dans la courbure emprisonnait dans la courte branche un certain volume d’air ; enfin, le tube était gradué en pouces et en lignes.
Il versa alors du mercure dans le tube de manière à comprimer l’air renfermé dans l’appareil, et quand son volume fut réduit de moitié, il constata que la hauteur de la colonne mercurielle, mesurée à partir du niveau dans la branche fermée, était exactement égale à la hauteur barométrique. Il résulte de cette observation que l’air réduit à la moitié de son volume, supporte une pression égale à celle que lui transmet le mercure, augmentée de la pression atmosphérique. Son volume est donc devenu deux fois plus petit quand la pression est devenue deux fois plus grande.
L’expérience fut refaite dans un tube plus long, permettant de réduire le gaz au 1/3, au 1/4, au 1/5 de son volume primitif ; dans chacun de ces cas il fallut exercer la compression par des hauteurs de mercure égales à 2, 3, 4 fois la colonne barométrique. En ajoutant à ces divers nombres la pression de l’atmosphère s’exerçant toujours sur la branche ouverte, on voit que le volume devient 1/3, 1/4, 1/5, quand le gaz est soumis à des pressions 3, 4, 5 fois plus grandes. On énonce cette loi remarquable en disant que les volumes occupés par une même masse d’air sont en raison inverse des pressions qu’elle supporte. On désigne sous le nom de force élastique l’effort par lequel le gaz réagit contre la pression qui agit sur lui ; cette force élastique a évidemment pour mesure la hauteur de la colonne mercurielle qui produit la compression.
Cette loi a été vérifiée pour des pressions très considérables, aussi bien que pour des pressions de beaucoup inférieures à celles de l’atmosphère, les mêmes relations existent toujours, ou du moins elles éprouvent de si faibles variations, que le principe énoncé par Mariotte peut être considéré comme ayant une rigueur presque absolue dans les limites où il est ordinairement appliqué.
Le changement de volume n’est pas la seule conséquence de l’accroissement ou de la diminution de pression exercée sur un gaz. Nous avons déjà vu de quelle manière on pouvait déterminer le poids absolu de l’air, et nous avons évalué à 1gr, 29 le poids d’un litre de ce gaz ; mais il est bien évident que ce chiffre doit être soumis à des variations très notables, selon qu’on le détermine dans telle ou telle condition. L’air est-il raréfié, un vase d’un litre en renfermera une moindre quantité ; est-il au contraire comprimé, le même volume en contiendra une plus grande masse ; il y aura diminution de poids dans le premier cas, augmentation dans le second ; le gaz a donc subi des variations de densité.
La loi de Mariotte permet de saisir les relations qui rattachent la densité de l’air à ses changements de volume ou de pression. On voit en effet que dans l’appareil employé pour la démonstration de cette loi, c’est toujours la même quantité de gaz qui occupe des volumes différents ; son poids doit par conséquent rester le même, mais sa densité sera devenue double quand le volume aura été réduit de moitié ; de même si l’espace occupé par l’air avait été doublé, la densité serait deux fois plus petite. En appliquant à ces relations le langage des mathématiciens, on dira que la densité de l’air est proportionnelle aux pressions qu’il supporte.
En résumé, quand l’air est comprimé, son volume diminue et sa densité augmente ; quand, au contraire, il est raréfié, son volume devient plus grand, tandis que sa densité s’affaiblit. On voit, d’après cela, qu’il est nécessaire, toutes les fois que l’on parle du volume ou du poids d’un gaz, de faire intervenir la pression sous laquelle on le considère. On est convenu de rapporter toujours ces données à ce qu’elles seraient si la pression du gaz était égale à 760 millimètres de mercure, ce qui représente la hauteur moyenne du baromètre au niveau de la mer. Il est toujours facile d’effectuer cette correction en s’appuyant sur la loi de Mariotte.
Il semble résulter des faits précédents que la compressibilité de l’air ne doit pas avoir de limites, et que des pressions de plus en plus intenses doivent nécessairement se traduire par une réduction de volume. Cependant, en raisonnant par analogie, on était conduit à admettre que cette contraction devait avoir un terme, et que, dans certaines conditions, l’air fortement comprimé se transformerait probablement en un corps liquide. De semblables transformations s’observent facilement, en effet, sur la plupart des corps gazeux : nous citerons comme exemple la manière dont se comporte l’acide carbonique.
Quand on verse un acide sur quelques fragments d’une pierre calcaire ou sur un morceau de craie, on voit se produire une vive effervescence, due au dégagement d’un gaz facile à recueillir dans des appareils convenables. Ce gaz est incolore comme l’air, mais il en diffère par toutes ses propriétés ; nous aurons d’ailleurs occasion de l’étudier de près, car il entre d’une manière constante dans la constitution de l’atmosphère ; pour le moment, nous examinerons seulement les modifications qu’il éprouve sous l’influence d’une forte compression.
En le soumettant comme l’air à l’expérience de Mariotte, on remarque d’abord que son volume diminue plus rapidement que l’indique la loi, et si la pression atteint 36 atmosphères, le gaz disparaît pour se transformer en un liquide très mobile revenant à la forme gazeuse dès qu’on cesse de le comprimer. L’opération n’est pas sans danger, à cause de l’énorme pression nécessaire pour la mener à bonne fin ; il est indispensable de faire usage de vases d’une extrême solidité, afin d’éviter des explosions redoutables pour l’opérateur ; voici comment cette mémorable expérience a été faite par Thilorier en 1854.
Dans un vase métallique offrant une grande résistance, on introduit du bicarbonate de soude, puis un tube de cuivre renfermant de l’acide sulfurique. L’appareil est disposé de façon à pouvoir basculer autour d’un axe horizontal, et l’on peut, par des mouvements convenables, mélanger peu à peu l’acide sulfurique avec le carbonate. Il en résulte un abondant dégagement de gaz dans un espace hermétiquement clos où la pression ne tarde pas à s’élever à 50 ou 60 atmosphères. L’acide carbonique ainsi comprimé par lui-même se liquéfie bientôt ; il suffit, pour le séparer du mélange, de mettre le générateur en communication avec un second cylindre refroidi. Le liquide distille aussitôt et vient se condenser dans le récipient ; celui-ci, séparé du reste de l’appareil, ne contient que l’acide carbonique liquide dans un grand état de pureté.
Nous ne pouvons insister ici sur toutes les propriétés intéressantes de ce gaz liquéfié, nous citerons seulement celles qui se rattachent au sujet qui nous occupe. Si l’on ouvre le robinet du récipient contenant le liquide, celui-ci s’échappe dans l’air, comme on devait s’y attendre, poussé par l’énorme pression intérieure ; mais, au lieu de se répandre sous forme d’un jet liquide ou gazeux il se transforme en un nuage de flocons blancs comme de la neige qui, recueillis dans un récepteur spécial imaginé par Thilorier, se façonnent en une sorte de boule de la grosseur d’un œuf : cette neige constitue l’acide carbonique solidifié. Par quelle influence s’est produit ce nouveau changement d’état ? il est facile de s’en rendre compte.
Le jet liquide brusquement soustrait, en pénétrant dans l’atmosphère, à la forte pression qu’il supportait dans l’appareil, tend à reprendre la forme gazeuse, ou, pour employer une expression plus familière, tend à s’évaporer avec une grande rapidité. Or toute évaporation est nécessairement suivie d’un abaissement de température, d’autant plus intense qu’elle est plus rapide. On conçoit donc qu’une portion du liquide doive se refroidir énormément, et ce refroidissement est assez considérable pour en déterminer la congélation. On trouve en effet que la température de cette sorte de neige peut, dans certaines conditions, atteindre 90° et même 100° au-dessous de zéro ; c’est le froid le plus intense obtenu jusqu’à ce jour.
Voilà donc un corps qui, dans les conditions ordinaires, se présente toujours à nous sous la forme d’un gaz, mais qui, soumis à une pression élevée, se transforme en un liquide ; enfin ce liquide suffisamment refroidi se congèle comme de l’eau pour prendre l’état solide. Ces propriétés n’appartiennent pas seulement à l’acide carbonique ; elles s’appliquent, au contraire, à tous les autres corps gazeux.
Faraday, en soumettant les différents gaz à l’action simultanée d’une forte compression et d’un refroidissement considérable, a obtenu la liquéfaction et même la solidification de la plupart d’entre eux. Un grand nombre se liquéfient avec la plus grande facilité, tels sont l’acide sulfureux, le chlore, l’ammoniaque. Cinq seulement ont résisté pendant longtemps à tous nos moyens d’action, et parmi eux se trouvent l’oxygène et l’azote, dont le mélange constitue l’air atmosphérique. Les trois autres sont l’hydrogène, l’oxyde de carbone et le bioxyde d’azote. On les désignait sous le nom de gaz permanents, pour les distinguer des premiers qu’on appelait gaz liquéfiables.
Cette distinction n’a plus aujourd’hui sa raison d’être. Μ. Cailletet, en France, M. Pictet, à Genève, viennent en effet de démontrer tout récemment par d’ingénieuses expériences, que tous les gaz suivent la loi commune et qu’ils sont tous susceptibles de prendre l’état liquide ou solide quand ils sont suffisamment comprimés et refroidis.
L’air est donc liquéfiable au même titre que l’acide carbonique. Cette importante découverte était d’ailleurs prévue par la théorie ; nous ne tarderons pas à voir, en effet, que le maintien de l’état gazeux, à une température très basse, est incompatible avec les données les plus certaines de la science.
Nous venons d’examiner de quelle manière la force expansive des gaz entre en jeu quand la pression qu’ils supportent augmente ou diminue ; maison peut provoquer des changements de volume dans une masse d’air par des procédés complètement différents : il suffit de chauffer ou de refroidir un corps gazeux pour lui imprimer des modifications importantes sur lesquelles nous devons nous arrêter un instant.
Toutes les fois que l’on échauffe un corps, son volume augmente ; il diminue au contraire quand on le refroidit : c’est là une loi générale, commune à toutes les substances solides, liquides ou gazeuses ; l’on désigne ces variations de volume, produites par la chaleur, sous le nom général de dilatation. Le thermomètre ordinaire nous offre un exemple vulgaire de la dilatation des corps liquides ; tout le monde a pu observer l’augmentation de volume de l’alcool ou du mercure dans cet instrument, dès que la température s’élève, et sa contraction quand elle s’abaisse. Une barre de fer s’allonge et se raccourcit sous les mêmes influences ; mais ces variations de volume, toujours très faibles, ont besoin, pour être mises en évidence, d’appareils spéciaux destinés à en amplifier les effets. Dans les gaz, au contraire, le moindre changement de température entraîne des modifications considérables que nous allons examiner.
Prenons un ballon de verre dont le col est muni d’un tube étroit, deux fois recourbé, comme l’indique la figure. Le ballon renferme de l’air, séparé de l’atmosphère par une petite quantité de mercure contenu dans la courbure du tube. Si nous l’échauffons à l’aide d’une lampe à alcool, nous voyons aussitôt un double effet se manifester : le niveau du mercure s’abaisse du côté du ballon, ce qui indique une augmentation de volume ; en même temps il s’élève dans la branche ouverte à plusieurs centimètres au-dessus de son niveau primitif ; l’air a donc aussi augmenté de force élastique, et cet accroissement de pression est mesuré par la hauteur du mercure soulevé. Supprimons la lampe à alcool et plongeons l’appareil dans un vase plein de fragments de glace, un effet inverse se produit aussitôt : l’air se contracte et en même temps la dénivellation du mercure se produit en sens inverse, indiquant une diminution de pression intérieure.
Ces deux actions simultanées de la chaleur ne sont pas nécessairement liées l’une à l’autre, et l’on conçoit sans peine qu’elles puissent exister isolément ; il suffirait en effet de supprimer dans notre expérience le mercure placé dans le tube, pour permettre au gaz de se dilater librement sans augmentation de pression ; d’un autre côté, si l’air échauffé était contenu dans un vase hermétiquement clos, son volume serait invariable comme celui du vase ; sa force élastique seule se trouverait accrue. Les manifestations de la chaleur présentent donc des différences essentielles selon les circonstances au milieu desquelles cet agent exerce son action ; à chacune de ces conditions correspondent des phénomènes spéciaux.
La dilatation de l’air par la chaleur est très considérable, quand on la compare à celle des corps solides ou liquides. Le zinc, par exemple, un des corps les plus dilatables, éprouve un accroissement de volume presque insignifiant quand on l’échauffe ; une règle de ce métal d’un mètre de longueur s’allonge à peine de 3 millimètres quand on élève sa température de 100°. Les liquides se dilatent beaucoup plus que les solides : c’est ainsi qu’un litre d’eau s’accroît, dans les mêmes conditions, de 46 centimètres cubes environ, c’est-à-dire des 46 millièmes de son volume primitif.
L’air est encore infiniment plus dilatable que l’eau : quand on le chauffe de zéro à 100, son volume augmente d’un tiers environ, ou plus exactement de 366 millièmes. Pour une élévation de température d’un degré seulement, cet accroissement sera naturellement cent fois plus petit, c’est-à-dire de 366 cent millièmes ou 1/273. Ainsi, pour chaque degré de température, l’air se dilate de 1/273 de son volume ; il est facile, d’après cela, de calculer l’augmentation correspondant à une température déterminée, et l’on voit sans peine qu’à 273° le volume sera devenu double.
À ces variations considérables doivent nécessairement correspondre des changements inverses de densité ; l’air échauffé devient en effet plus léger, et cette légèreté augmente à mesure que la température s’élève ; on peut même conclure des données précédentes qu’à 273° un litre d’air pèserait moitié moins qu’à la température de zéro. Un phénomène opposé se manifestera si la température s’abaisse : l’air deviendra plus lourd en se refroidissant. Il résulte de cette excessive mobilité du poids de l’air que l’homogénéité de l’atmosphère doit être constamment troublée par des mouvements occasionnés par ces changements continuels de densité.
Un grand nombre de faits nous ont tous familiarisés avec ces agitations produites par la chaleur : des masses d’air énormes s’écoulent par les tuyaux de nos cheminées dès qu’un peu de feu les échauffe ; l’air froid, au contraire, afflue de tous côtés vers le foyer pour combler le vide qui tend à se produire. Dans bien des circonstances, ces mouvements deviennent visibles par des modifications imprimées à la propagation de la lumière. Tout le monde a observé cette trépidation ondulatoire dont l’atmosphère est animée au-dessus d’une plaine fortement échauffée par le soleil, les objets lointains ne nous envoient plus que des images diffuses et incertaines, déformées par des vacillations continuelles. Une simple bougie, interposée pendant le jour entre nos yeux et les objets éclairés, donne lieu aux mêmes apparences.
Ces propriétés ont servi de point de départ à l’une des plus étonnantes découvertes des temps modernes, l’invention des aérostats. La navigation aérienne a acquis dans ces dernières années une si grande importance que nous devons dire ici quelques mots de son origine.
Le désir de s’élever dans l’atmosphère semble avoir de tout temps tourmenté les hommes. Aussi voit-on la science engagée dès ses premiers débuts dans des projets chimériques, regardés comme irréalisables par tous les esprits réfléchis. Vers le milieu du dix-septième siècle, l’imagination des savants devançait déjà la solution du problème ; on pressentait vaguement la possibilité d’une solution ; mais les procédés d’exécution semblaient au-dessus des ressources expérimentales de l’époque, lorsque les frères Montgolfier arrivèrent, par une brillante découverte, à réaliser ce rêve de l’imagination. Quelques essais sur remploi du gaz hydrogène avaient suffi pour les convaincre de la possibilité d’arriver à quelques résultats utiles : ils imaginèrent alors de remplir d’air chaud une vaste enveloppe, pensant que la plus faible densité du gaz suffirait pour la soulever dans l’atmosphère ; l’expérience fut couronnée du plus éclatant succès.
Après quelques tentatives sur des appareils de petite dimension, ils construisirent un globe de toile, doublé intérieurement de papier, mesurant 15 mètres de diamètre ; un grand feu fut allumé au-dessous d’un large orifice ménagé à la partie inférieure, et le ballon, distendu peu à peu par l’air dilaté, s’éleva dans l’atmosphère avec une force capable d’entraîner 5 à 6 quintaux. La nouvelle de ce brillant résultat se répandit rapidement en France et ne tarda pas à occuper tous les esprits ; l’expérience de Montgolfier, plusieurs fois répétée au milieu de l’enthousiasme d’une foule immense de spectateurs, fit songer aussitôt à utiliser ce nouveau moyen de locomotion. Le 20 novembre 1783, deux hommes intrépides osèrent pour la première fois confier leur vie à cette frêle enveloppe. Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes partirent du château de la Muette, et franchirent en moins d’une demi-heure une distance de 8 kilomètres, après s’être élevés à une hauteur de 1000 mètres.
Le succès dont fut suivi cette première épreuve ne tarda pas à déterminer, dans tous les points de la France, de nouvelles ascensions. Malheureusement, la témérité s’unissait trop souvent au courage, et l’on eut bientôt la douleur d’enregistrer une horrible catastrophe. Encouragé par sa première expédition, Pilâtre de Rozier conçut l’audacieux projet de traverser la Manche dans ce fragile véhicule. Un compagnon, aussi hardi que lui, Romain, voulut partager sa gloire et ses dangers. Mais les deux intrépides voyageurs devaient payer de leur vie leur téméraire entreprise. Partis de Boulogne, ils s’étaient déjà élevés à une assez grande hauteur, lorsqu’on vit l’appareil s’abattre sur le sol avec une effrayante rapidité ; les deux voyageurs furent trouvés broyés dans leur nacelle, à la place même qu’ils occupaient au moment du départ.
Ce qui étonna le plus dans la découverte de Montgolfier, ce fut son extrême simplicité. « Cela devait être, s’écria l’illustre Lalande, en en rendant compte devant l’Académie, comment n’y a-t-on pas songé ! » Le principe une fois appliqué, les perfectionnements ne tardèrent pas à surgir. La fragile enveloppe de papier est remplacée par un tissu de soie rendu imperméable, et à la montgolfière on substitua aussitôt le ballon gonflé par le gaz hydrogène. Ce gaz possède, sous le même volume et à pression égale, un poids 14 fois moindre que celui de l’air, il devait donc remplacer avec avantage l’air simplement dilaté par la chaleur. Le physicien Charles fut le premier à l’appliquer utilement au gonflement des ballons. Ses expériences eurent un plein succès, et ainsi se trouva résolu un problème du plus haut intérêt, mais dont les conséquences n’auront une véritable utilité pratique que le jour où l’on saura diriger à volonté ces navires aériens. Quelques tentatives encourageantes permettent tout au plus de ne pas désespérer encore, mais combien de difficultés restent à vaincre avant que ce problème ait reçu une solution définitive !





























