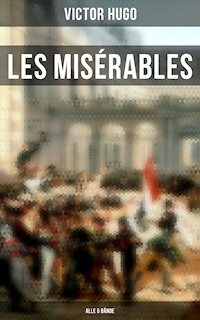Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
L'Art d'être grand-père est un recueil de 27 poèmes que Victor Hugo a publié en 1877. À la suite de la mort de son épouse Adèle Foucher en 1868, puis d'un de ses fils, Charles Hugo, en 1871, Victor Hugo prend en charge l'éducation de ses deux petits-enfants Georges et Jeanne Hugo. Après avoir goûté le bonheur d'être grand-père en exil à Vianden en 1871, il accueille les enfants et leur mère à Guernesey l'été 1872, et s'installe avec eux à Paris en 18741. C'est au cours de cette période qu'il écrit plusieurs poèmes illustrant les comportements et l'innocence reliée à ses petits-enfants. En 1881, une chanson est publiée, reprenant le titre du recueil de poèmes. Parole de Villemer et musique d'Edmond Lonati. Comme le note très justement l'édition Gallimard de ce recueil, " L'Art d'être grand-père est un livre majeur par son ampleur, sa diversité, son architecture et l'entrelacement de ses thèmes, mais souvent ignoré du fait d'un titre réducteur qui suggère une succession de «recettes» pour séduire et amadouer les petits-enfants". Ce recueil réunit les poèmes suivants : À des âmes envolées. À Georges. Ah ! vous voulez la lune. À Jeanne (I). C'est une émotion étrange. Chant sur le berceau. Choses du soir. Encore Dieu, mais avec des restrictions. Et Jeanne à Mariette a dit. Fenêtres ouvertes. Georges et Jeanne. Grand âge et bas âge mêlés. Jeanne endormie (II). Jeanne fait son entrée. Jeanne songeait. Je prendrai par la main les deux petits enfants. Laetitia rerum. La face de la bête est terrible. La sieste. L'autre. L'exilé satisfait. Oh ! comme ils sont goulus. Parfois, je me sens pris d'horreur. Printemps. Tous les bas âges sont épars. Toutes sortes d'enfants. Un manque.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
À Guernesey
I. L’exilé satisfait
II.
III. Jeanne fait son entrée
IV. Victor, sed victus
V. L'autre
VI. Georges et Jeanne
VII.
VIII. Laetitia rerum
IX.
X. Printemps
XI. Fenêtres ouvertes
XII. Un manque
Jeanne endormie (1)
La sieste
La lune
I
II. Choses du soir
III.
IV.
Le Poème du Jardin des Plantes
I
II
III. Ce que dit le public
IV. À Georges
V. Encore Dieu, mais avec des restrictions
VI. À Jeanne
VII.
VIII.
IX.
X.
Jeanne endormie (2)
Grand âge et bas âge mêlés
I
II. Chant sur le berceau
III. La cicatrice
IV. Une tape
V.
VI. Jeanne était au pain sec
VII. Chanson pour faire danser en rond les petits enfants
VIII. Le pot cassé
IX.
X.
L’Immaculée Conception
Les griffonnages de l’écolier
Les fredaines du grand-père enfant
Enfants, oiseaux et fleurs
I.
II.
III. Dans le jardin
IV. Le Trouble-fête
V. Ora, Ama
VI. La mise en liberté
Jeanne lapidée
Jeanne endormie (3)
L’Épopée
du lion
I. Le Paladin
II. L'Ermite
III. La chasse et la nuit
IV. L'Aurore
À des âmes envolées
Laus puero
I. Les enfants gâtés
II. Le Syllabus
III. Enveloppe d’une pièce de monnaie dans une quête faite par Jeanne
IV. A propos de la loi dite Liberté de l’enseignement
V. Les enfants pauvres
VI. Aux champs
VII. Encore L'Immaculée Conception
VIII. Mariée et mère
IX.
Deux chansons
I. Chanson de Grand-père
II. Chanson d’ancêtre
Jeanne endormie (4)
Que les petits liront quand ils seront grands
I. Patrie
II. Persévérance
III. Progrès
IV. Fraternité
V. L’âme à la poursuite du vrai
1.
2.
3.
I – À Guernesey
I. L’exilé satisfait
Solitude ! silence ! oh ! le désert me tente.
L'âme s'apaise là, sévèrement contente ;
Là d'on ne sait quelle ombre on se sent l'éclaireur.
Je vais dans les forêts chercher la vague horreur ;
La sauvage épaisseur des branches me procure
Une sorte de joie et d'épouvante obscure ;
Et j'y trouve un oubli presque égal au tombeau.
Mais je ne m'éteins pas ; on peut rester flambeau
Dans l'ombre, et, sous le ciel, sous la crypte sacrée,
Seul, frissonner au vent profond de l'empyrée.
Rien n'est diminué dans l'homme pour avoir
Jeté la sonde au fond ténébreux du devoir.
Qui voit de haut, voit bien ; qui voit de loin, voit juste.
La conscience sait qu'une croissance auguste
Est possible pour elle, et va sur les hauts lieux
Rayonner et grandir, loin du monde oublieux.
Donc je vais au désert, mais sans quitter le monde.
Parce qu'un songeur vient, dans la forêt profonde
Ou sur l'escarpement des falaises, s'asseoir
Tranquille et méditant l'immensité du soir,
Il ne s'isole point de la terre où nous sommes.
Ne sentez-vous donc pas qu'ayant vu beaucoup d'hommes
On a besoin de fuir sous les arbres épais,
Et que toutes les soifs de vérité, de paix,
D'équité, de raison et de lumière, augmentent
Au fond d'une âme, après tant de choses qui mentent ?
Mes frères ont toujours tout mon coeur, et, lointain
Mais présent, je regarde et juge le destin ;
Je tiens, pour compléter l'âme humaine ébauchée,
L'urne de la pitié sur les peuples penchée,
Je la vide sans cesse et je l'emplis toujours.
Mais je prends pour abri l'ombre des grands bois sourds.
Oh ! j'ai vu de si près les foules misérables,
Les cris, les chocs, l'affront aux têtes vénérables,
Tant de lâches grandis par les troubles civils,
Des juges qu'on eût dû juger, des prêtres vils
Servant et souillant Dieu, prêchant pour, prouvant contre,
J'ai tant vu la laideur que notre beauté montre,
Dans notre bien le mal, dans notre vrai le faux,
Et le néant passant sous nos arcs triomphaux,
J'ai tant vu ce qui mord, ce qui fuit, ce qui ploie
Que, vieux, faible et vaincu, j'ai désormais pour joie
De rêver immobile en quelque sombre lieu ;
Là, saignant, je médite ; et, lors même qu'un dieu
M'offrirait pour rentrer dans les villes la gloire,
La jeunesse, l'amour, la force, la victoire,
Je trouve bon d'avoir un trou dans les forêts,
Car je ne sais pas trop si je consentirais.
II.
Qu'est-ce que cette terre ? Une tempête d'âmes.
Dans cette ombre, où, nochers errants, nous n'abordâmes
Jamais qu'à des écueils, les prenant pour des ports ;
Dans l'orage des cris, des désirs, des transports,
Des amours, des douleurs, des veux, tas de nuées ;
Dans les fuyants baisers de ces prostituées
Que nous nommons fortune, ambition, succès ;
Devant Job qui, souffrant, dit : Qu'est-ce que je sais ?
Et Pascal qui, tremblant, dit : Qu'est-ce que je pense ?
Dans cette monstrueuse et féroce dépense
De papes, de césars, de rois, que fait Satan ;
En présence du sort tournant son cabestan
Par qui toujours — de là l'effroi des philosophes —
Sortent des mêmes flots les mêmes catastrophes ;
Dans ce néant qui mord, dans ce chaos qui ment,
Ce que l'homme finit par voir distinctement,
C'est, par-dessus nos deuils, nos chutes, nos descentes,
La souveraineté des choses innocentes.
Étant donnés le coeur humain, l'esprit humain,
Notre hier ténébreux, notre obscur lendemain,
Toutes les guerres, tous les chocs, toutes les haines,
Notre progrès coupé d'un traînement de chaînes,
Partout quelque remords, même chez les meilleurs,
Et par les vents soufflant du fond des cieux en pleurs
La foule des vivants sans fin bouleversée,
Certes, il est salutaire et bon pour la pensée,
Sous l'entrecroisement de tant de noirs rameaux,
De contempler parfois, à travers tous nos maux
Qui sont entre le ciel et nous comme des voiles,
Une profonde paix toute faite d'étoiles ;
C'est à cela que Dieu songeait quand il a mis
Les poètes auprès des berceaux endormis.
III. Jeanne fait son entrée
Jeanne parle ; elle dit des choses qu'elle ignore ;
Elle envoie à la mer qui gronde, au bois sonore,
A la nuée, aux fleurs, aux nids, au firmament,
A l'immense nature un doux gazouillement,
Tout un discours, profond peut-être, qu'elle achève
Par un sourire où flotte une âme, où tremble un rêve,
Murmure indistinct, vague, obscur, confus, brouillé,
Dieu, le bon vieux grand-père, écoute émerveillé.
IV. Victor, sed victus
Je suis, dans notre temps de chocs et de fureurs,
Belluaire, et j'ai fait la guerre aux empereurs ;
J'ai combattu la foule immonde des Sodomes,
Des millions de flots et des millions d'hommes
Ont rugi contre moi sans me faire céder ;
Tout le gouffre est venu m'attaquer et gronder,
Et j'ai livré bataille aux vagues écumantes,
Et sous l'énorme assaut de l'ombre et des tourmentes
Je n'ai pas plus courbé la tête qu'un écueil ;
Je ne suis pas de ceux qu'effraie un ciel en deuil,
Et qui, n'osant sonder les styx et les avernes,
Tremblent devant la bouche obscure des cavernes ;
Quand les tyrans lançaient sur nous, du haut des airs,
Leur noir tonnerre ayant des crimes pour éclairs,
J'ai jeté mon vers sombre à ces passants sinistres ;
J'ai traîné tous les rois avec tous leurs ministres,
Tous les faux dieux avec tous les principes faux,
Tous les trônes liés à tous les échafauds,
L'erreur, le glaive infâme et le sceptre sublime,
J'ai traîné tout cela pêle-mêle à l'abîme ;
J'ai devant les césars, les princes, les géants
De la force debout sur l'amas des néants,
Devant tous ceux que l'homme adore, exècre, encense,
Devant les Jupiters de la toute-puissance,
Été quarante ans fier, indompté, triomphant ;
Et me voilà vaincu par un petit enfant.
V. L'autre
Viens, mon George. Ah ! les fils de nos fils nous enchantent,
Ce sont de jeunes voix matinales qui chantent.
Ils sont dans nos logis lugubres le retour
Des roses, du printemps, de la vie et du jour !
Leur rire nous attire une larme aux paupières
Et de notre vieux seuil fait tressaillir les pierres ;
De la tombe entr'ouverte et des ans lourds et froids
Leur regard radieux dissipe les effrois ;
Ils ramènent notre âme aux premières années ;
Ils font rouvrir en nous toutes nos fleurs fanées ;
Nous nous retrouvons doux, naïfs, heureux de rien ;
Le coeur serein s'emplit d'un vague aérien ;
En les voyant on croit se voir soi-même éclore ;
Oui, devenir aïeul, c'est rentrer dans l'aurore.
Le vieillard gai se mêle aux marmots triomphants.
Nous nous rapetissons dans les petits enfants.
Et, calmés, nous voyons s'envoler dans les branches
Notre âme sombre avec toutes ces âmes blanches.
VI. Georges et Jeanne
Moi qu'un petit enfant rend tout à fait stupide,
J'en ai deux ; George et Jeanne ; et je prends l'un pour guide
Et l'autre pour lumière, et j'accours à leur voix,
Vu que George a deux ans et que Jeanne a dix mois.
Leurs essais d'exister sont divinement gauches ;
On croit, dans leur parole où tremblent des ébauches,
Voir un reste de ciel qui se dissipe et fuit ;
Et moi qui suis le soir, et moi qui suis la nuit,
Moi dont le destin pâle et froid se décolore,
J'ai l'attendrissement de dire : Ils sont l'aurore.
Leur dialogue obscur m'ouvre des horizons ;
Ils s'entendent entre eux, se donnent leurs raisons.
Jugez comme cela disperse mes pensées.
En moi, désirs, projets, les choses insensées,
Les choses sages, tout, à leur tendre lueur,
Tombe, et je ne suis plus qu'un bonhomme rêveur.
Je ne sens plus la trouble et secrète secousse
Du mal qui nous attire et du sort qui nous pousse.
Les enfants chancelants sont nos meilleurs appuis.
Je les regarde, et puis je les écoute, et puis
Je suis bon, et mon coeur s'apaise en leur présence ;
J'accepte les conseils sacrés de l'innocence,
Je fus toute ma vie ainsi ; je n'ai jamais
Rien connu, dans les deuils comme sur les sommets,
De plus doux que l'oubli qui nous envahit l'âme
Devant les êtres purs d'où monte une humble flamme ;
Je contemple, en nos temps souvent noirs et ternis,
Ce point du jour qui sort des berceaux et des nids.
Le soir je vais les voir dormir. Sur leurs fronts calmes.
Je distingue ébloui l'ombre que font les palmes
Et comme une clarté d'étoile à son lever,
Et je me dis : À quoi peuvent-ils donc rêver ?
Georges songe aux gâteaux, aux beaux jouets étranges,
Au chien, au coq, au chat ; et Jeanne pense aux anges.
Puis, au réveil, leurs yeux s'ouvrent, pleins de rayons.
Ils arrivent, hélas ! à l'heure où nous fuyons.
Ils jasent. Parlent-ils ? Oui, comme la fleur parle
A la source des bois ; comme leur père Charles,
Enfant, parlait jadis à leur tante Dédé ;
Comme je vous parlais, de soleil inondé,
Ô mes frères, au temps où mon père, jeune homme,
Nous regardait jouer dans la caserne, à Rome,
A cheval sur sa grande épée, et tout petits.
Jeanne qui dans les yeux a le myosotis,
Et qui, pour saisir l'ombre entrouvrant ses doigts frêles,
N'a presque pas de bras ayant encore des ailes,
Jeanne harangue, avec des chants où flotte un mot,
Georges beau comme un dieu qui serait un marmot.
Ce n'est pas la parole, ô ciel bleu, c'est le verbe ;
C'est la langue infinie, innocente et superbe
Que soupirent les vents, les forêts et les flots ;
Les pilotes Jason, Palinure et Typhlos
Entendaient la sirène avec cette voix douce
Murmurer l'hymne obscur que l'eau profonde émousse ;
C'est la musique éparse au fond du mois de mai
Qui fait que l'un dit : J'aime, et l'autre, hélas : J'aimai ;
C'est le langage vague et lumineux des êtres
Nouveau-nés, que la vie attire à ses fenêtres,
Et qui, devant avril, éperdus, hésitants,
Bourdonnent à la vitre immense du printemps.
Ces mots mystérieux que Jeanne dit à George,
C'est l'idylle du cygne avec le rouge-gorge,
Ce sont les questions que les abeilles font,
Et que le lys naïf pose au moineau profond ;
C'est ce dessous divin de la vaste harmonie,
Le chuchotement, l'ombre ineffable et bénie
Jasant, balbutiant des bruits de vision,
Et peut-être donnant une explication ;
Car les petits enfants étaient hier encore
Dans le ciel, et savaient ce que la terre ignore.
Ô Jeanne ! Georges ! voix dont j'ai le coeur saisi !
Si les astres chantaient, ils bégaieraient ainsi.
Leur front tourné vers nous nous éclaire et nous dore.
Oh ! d'où venez-vous donc, inconnus qu'on adore ?
Jeanne a l'air étonné ; Georges a les yeux hardis.
Ils trébuchent, encore ivres du paradis.
VII.
Parfois, je me sens pris d'horreur pour cette terre ;
Mon vers semble la bouche ouverte d'un cratère ;
J'ai le farouche émoi
Que donne l'ouragan monstrueux au grand arbre ;
Mon coeur prend feu ; je sens tout ce que j'ai de marbre
Devenir lave en moi ;
Quoi ! rien de vrai ! le scribe a pour appui le reître ;
Toutes les robes, juge et vierge, femme et prêtre,
Mentent ou mentiront ;
Le dogme boit du sang, l'autel bénit le crime ;
Toutes les vérités, groupe triste et sublime,
Ont la rougeur au front ;
La sinistre lueur des rois est sur nos têtes ;
Le temple est plein d'enfer ; la clarté de nos fêtes
Obscurcit le ciel bleu ;
L'âme a le penchement d'un navire qui sombre ;
Et les religions, à tâtons, ont dans l'ombre
Pris le démon pour Dieu !
Oh ! qui me donnera des paroles terribles ?
Oh ! je déchirerai ces chartes et ces bibles,
Ces codes, ces corans !
Je pousserai le cri profond des catastrophes ;
Et je vous saisirai, sophistes, dans mes strophes,
Dans mes ongles, tyrans.
Ainsi, frémissant, pâle, indigné, je bouillonne ;
On ne sait quel essaim d'aigles noirs tourbillonne
Dans mon ciel embrasé ;
Deuil ! guerre ! une euménide en mon âme est éclose !
Quoi ! le mal est partout ! Je regarde une rose
Et je suis apaisé.
VIII. Laetitia rerum
Tout est pris d'un frisson subit.
L'hiver s'enfuit et se dérobe.
L'année ôte son vieil habit ;
La terre met sa belle robe.
Tout est nouveau, tout est debout ;
L'adolescence est dans les plaines ;
La beauté du diable, partout,
Rayonne et se mire aux fontaines.
L'arbre est coquet ; parmi les fleurs
C'est à qui sera la plus belle ;
Toutes étalent leurs couleurs,
Et les plus laides ont du zèle.
Le bouquet jaillit du rocher ;
L'air baise les feuilles légères ;
Juin rit de voir s'endimancher
Le petit peuple des fougères.
C'est une fête en vérité,
Fête où vient le chardon, ce rustre ;
Dans le grand palais de l'été
Les astres allument le lustre.
On fait les foins. Bientôt les blés.
Le faucheur dort sous la cépée ;
Et tous les souffles sont mêlés
D'une senteur d'herbe coupée.
Qui chante là ? Le rossignol.
Les chrysalides sont parties.
Le ver de terre a pris son vol
Et jeté le froc aux orties ;
L'aragne sur l'eau fait des ronds ;
Ô ciel bleu ! l'ombre est sous la treille ;
Le jonc tremble, et les moucherons
Viennent vous parler à l'oreille ;
On voit rôder l'abeille à jeun,
La guêpe court, le frelon guette ;
A tous ces buveurs de parfum
Le printemps ouvre sa guinguette.
Le bourdon, aux excès enclin
Entre en chiffonnant sa chemise ;
Un oeillet est un verre plein
Un lys est une nappe mise.
La mouche boit le vermillon
Et l'or dans les fleurs demi-closes,
Et l'ivrogne est le papillon,
Et les cabarets sont les roses.
De joie et d'extase on s'emplit,
L'ivresse, c'est la délivrance ;
Sur aucune fleur on ne lit :
Société de tempérance.
Le faste providentiel
Partout brille, éclate et s'épanche
Et l'unique livre, le ciel,
Est par l'aube doré sur tranche.
Enfants, dans vos yeux éclatants
Je crois voir l'empyrée éclore ;
Vous riez comme le printemps
Et vous pleurez comme l'aurore.
IX.
Je prendrai par la main les deux petits enfants ;
J'aime les bois où sont les chevreuils et les faons,
Où les cerfs tachetés suivent les biches blanches
Et se dressent dans l'ombre effrayés par les branches ;
Car les fauves sont pleins d'une telle vapeur
Que le frais tremblement des feuilles leur fait peur.
Les arbres ont cela de profond qu'ils vous montrent
Que l'éden seul est vrai, que les coeurs s'y rencontrent,
Et que, hors les amours et les nids, tout est vain ;
Théocrite souvent dans le hallier divin
Crut entendre marcher doucement la ménade.
C'est là que je ferai ma lente promenade
Avec les deux marmots. J'entendrai tour à tour
Ce que Georges conseille à Jeanne, doux amour,
Et ce que Jeanne enseigne à George. En patriarche
Que mènent les enfants, je réglerai ma marche
Sur le temps que prendront leurs jeux et leurs repas,
Et sur la petitesse aimable de leurs pas.
Ils cueilleront des fleurs, ils mangeront des mûres.
Ô vaste apaisement des forêts ! ô murmures !
Avril vient calmer tout, venant tout embaumer.
Je n'ai point d'autre affaire ici-bas que d'aimer.
X. Printemps
Tout rayonne, tout luit, tout aime, tout est doux ;
Les oiseaux semblent d'air et de lumière fous ;
L'âme dans l'infini croit voir un grand sourire.
À quoi bon exiler, rois ? à quoi bon proscrire ?
Proscrivez-vous l'été ? m'exilez-vous des fleurs ?
Pouvez-vous empêcher les souffles, les chaleurs,
Les clartés, d'être là, sans joug, sans fin, sans nombre,
Et de me faire fête, à moi banni, dans l'ombre ?
Pouvez-vous m'amoindrir les grands flots haletants,
L'océan, la joyeuse écume, le printemps
Jetant les parfums comme un prodigue en démence,