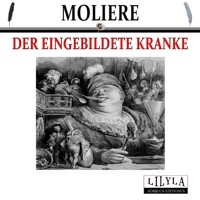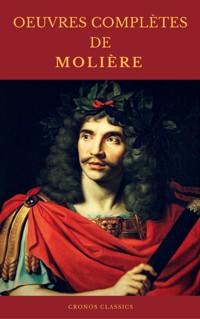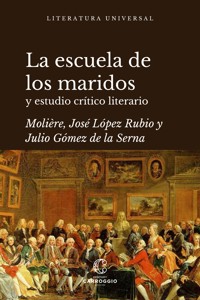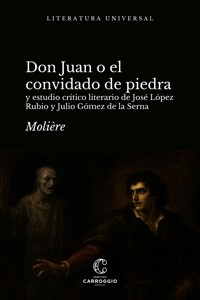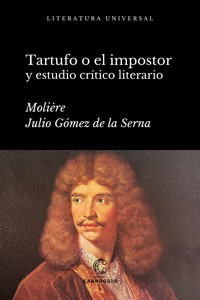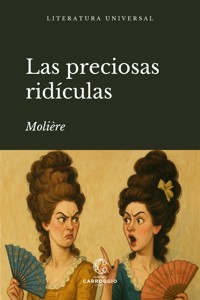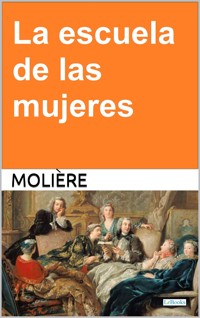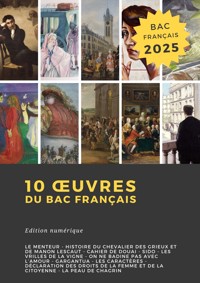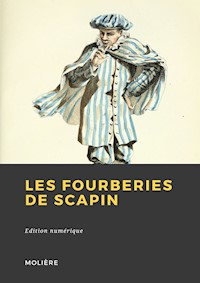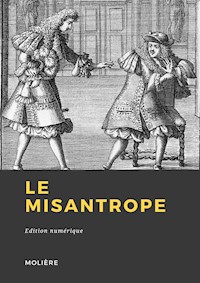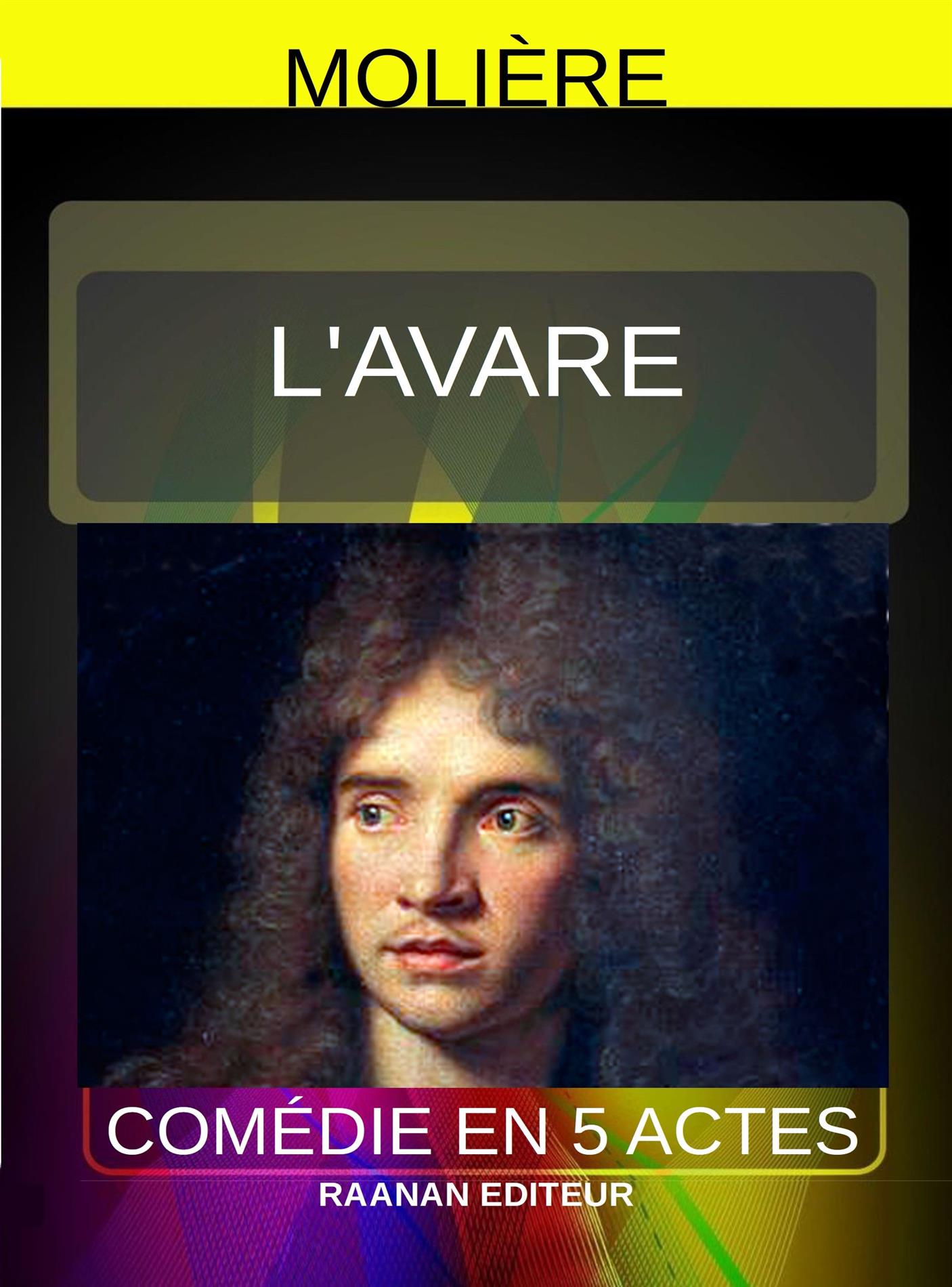
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L’Avare est une comédie de Molière en cinq actes et en prose, représentée pour la première fois sur la scène du Palais-Royal le 9 septembre 1668. Il s’agit d’une comédie de caractère dont le personnage principal, Harpagon, est caractérisé par son avarice caricaturale. Harpagon tente de marier sa fille de force, tout en protégeant obstinément une cassette pleine d’or.
Présentation
| Acte I - L'intrigue se passe à Paris. Harpagon est bourgeois , riche et avare. Il a deux enfants : Élise qui est amoureuse de Valère, un fils de noble napolitain au service de son père en qualité d'intendant, et Cléante qui souhaite épouser Mariane, une jeune femme vivant chez sa mère sans fortune. Il ne supporte pas que l'avarice de son père contrarie ses projets amoureux. Harpagon est terrifié par une crainte obsédante : il a dissimulé dans le jardin, une cassette qui renferme dix mille écus d'or, il a peur qu’on la découvre et qu'on la lui vole. Suspicieux, il se méfie de tout le monde, même de ses enfants, il va jusqu'à renvoyer La Flèche, le valet de Cléante. Finalement, il leur dévoile ses intentions : il va épouser Mariane, Élise est promise (sans apport de dot) à Anselme, un vieillard, et Cléante est destiné à une veuve. La jeune fille refuse énergiquement, son père demande à Valère de la convaincre. Valère est rusé et prend Harpagon par la ruse dans un filet invisible..|
|Source Wikipédia|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
NOTICE
PERSONNAGES
ACTE PREMIER
ACTE SECOND
ACTE TROISIÈME
ACTE QUATRIÈME
ACTE CINQUIÈME
Notes
MOLIÈRE
L'AVARE
COMÉDIE EN CINQ ACTES.
1669
Texte établi par Charles Louandre Charpentier | 1910
Raanan ÉditeurLivre numérique 457 | édition 2
NOTICE
Cette pièce fut jouée pour la première fois le 9 septembre 1668. Voici le jugement qu’en a porté Voltaire :
« Le même préjugé qui avait fait tomber le Festin de Pierre, parcequ’il était en prose, nuisit au succès de l’Avare. Cependant le public qui, à la longue, se rend toujours au bon, finit par donner à cet ouvrage les applaudissements qu’il mérite. On comprit alors qu’il peut y avoir de fort bonnes comédies en prose, et qu’il y a peut-être plus de difficulté à réussir dans le style ordinaire, où l’esprit seul soutient l’auteur, que dans la versification, qui, par la rime, la cadence et la mesure, prête des ornements à des idées simples, que la prose n’embellirait pas. Il y a dans l’Avare quelques idées prises dans Plaute et embellies par Molière. Plaute avait imaginé le premier de faire en même temps voler la cassette de l’Avare et de séduire sa fille ; c’est de lui qu’est toute l’invention de la scène du jeune homme qui vient avouer le rapt, et que l’Avare prend pour le voleur. Mais on ose dire que Plaute n’a point assez profité de cette situation ; il ne l’a inventée que pour la manquer. Que l’on en juge par ce seul trait : l’amant de la fille ne paraît que dans cette scène ; il vient sans être annoncé ni préparé, et la fille elle-même n’y paraît point du tout. Tout le reste de la pièce est de Molière, caractères, critiques, plaisanteries ; il n’a imité que quelques lignes, comme cet endroit où l’Avare, parlant, peut-être mal à propos, aux spectateurs, dit : « Mon voleur n’est-il point parmi vous ? Ils me regardent tous, et se mettent à rire ! » (Quid est quod ridetis ? novi omnes, scio fures hic esse complures.) Et cet autre endroit encore où, ayant examiné les mains du valet qu’il soupçonne, il demande à voir la troisième : Ostende tertiam. Ces comparaisons de Plaute avec Molière sont toutes à l’avantage du dernier. » Cette opinion de Voltaire, qui se trompe rarement en matière de goût, est aussi celle de la plupart des critiques. Mais on a nié, avec quelque apparence de raison, que la froideur avec laquelle furent accueillies les premières représentations de l’Avare, ait tenu à ce que cette comédie était écrite en prose. Quant à la supériorité de notre auteur sur le comique latin, elle a été reconnue par tout le monde, et l’on est tombé d’accord sur ce point que tout en rendant le personnage d’Harpagon plus dramatique et plus moral, Molière a aussi rendu l’intrigue plus attachante et plus vive. Il a même peint sous des couleurs si vraies le vice qu’il voulait flétrir, qu’un avare disait de bonne foi qu’il y avait beaucoup à profiter de cet ouvrage, et qu’on pouvait en tirer d’excellents principes d’économie.
M. Aimé Martin raconte que Boileau, qui assistait à toutes les représentations, « opposait sa justice inflexible aux cris de la cabale ; on le voyait, dans les loges et sur les bancs du théâtre, applaudir ce nouveau chef-d’œuvre : et Racine, qui fut injuste une fois, lui ayant dit un jour, comme pour lui adresser un reproche : « Je vous ai vu à la pièce de Molière, et vous riiez tout seul sur le théâtre. — Je vous estime trop, lui répondit Boileau, pour croire que vous n’y ayez pas ri, du moins intérieurement. »
Geoffroy, qui se montre souvent aussi sévère que Boileau, surtout en ce qui touche les questions morales, place l’Avare au nombre des chefs-d’œuvre de Molière. « Avec quelle vigueur, dit-il, avec quelle fidélité de pinceau Molière ne trace-t-il pas son avare s’isolant de sa famille, voyant des ennemis dans ses enfants qu’il redoute, et dont il n’est pas moins redouté ; concentrant toutes ses affections dans son coffre, tandis que son fils se ruine d’avance par des dettes usuraires, tandis que sa fille a une intrigue dans la maison avec son amant déguisé ! L’avare ne sait rien de ce qui se passe au sein de sa famille, rien de ce que font ses enfants ; il ne sait au juste que le compte de ses écus ; c’est la seule chose qui le touche et qui l’intéresse, c’est le seul objet de ses veilles, l’argent lui tient lieu d’enfants de parents et d’amis, voilà la morale qui résulte de l’admirable comédie de Molière ; et s’il y a quelque tableau capable de faire haïr et mépriser l’avarice, c’est celui-là… Ce vice était assez commun sous Louis XIV. Les nobles avaient seuls alors le privilège de se ruiner, soit en servant l’État, soit en étalant un luxe au-dessus de leur fortune. La consolation des roturiers était de s’enrichir en volant l’État et les nobles, et pour cacher leur larcins, ils avaient soin d’enfouir leurs richesses. »
Contrairement à l’opinion de Voltaire, de Boileau et de Geoffroy, Rousseau a taxé l’Avare d’immoralité : « C’est un grand vice assurément d’être avare et de prêter à usure ; mais n’en est-ce pas un plus grand encore à un fils de voler son père, de lui manquer de respect, de lui faire les plus insultants reproches ; et quand ce père irrité lui donne sa malédiction, de répondre d’un air goguenard, qu’il n’a que faire de ses dons ? Si la plaisanterie est excellente, en est-elle moins punissable ? Et la pièce où l’on fait aimer le fils insolent qui l’a faite, en est-elle moins une école de mauvaises mœurs ? » — M. Saint-Marc Girardin, dans son Cours de littérature dramatique, au chapitre intitulé : Des Pères dans la comédie, et surtout dans les comédies de Molière, a discuté l’opinion de Rousseau :
« Au dix-huitième siècle, J. J. Rousseau attaquait donc la comédie et lui reprochait d’enseigner aux enfants l’oubli du respect qu’ils doivent à leurs parents, comme Aristophane autrefois, dans les Nuées, accusait la philosophie de pervertir l’esprit des jeunes gens et d’ébranler dans leur cœur la majesté du pouvoir paternel. Et c’est ainsi que la comédie et la philosophie, les doux arts les plus hardis du monde, l’un par la raillerie et l’autre par le doute, ont tour à tour, dans leurs querelles, reconnu et proclamé, l’une contre l’autre, la sainteté de ce pouvoir paternel qui est le vrai fondement des sociétés.
» Avant Rousseau, Bossuet et Nicole avaient parlé du théâtre de la même manière ; et, avant Bossuet et Nicole, tous les Pères de l’Église l’avaient condamné. Essaierai-je de réclamer contre cet anathème ? Essaierai-je de soutenir, comme les philosophes du dix-huitième siècle, que le théâtre est une école de morale ? Non. Reconnaissons le mal où il est ; mais seulement mesurons-le, afin de ne pas le faire plus grand qu’il n’est. Ne préconisons pas le théâtre, mais ne le condamnons que pour les fautes qui lui appartiennent. Ne lui demandons pas la pureté de la morale chrétienne : quiconque veut trouver cette morale, doit aller la chercher à l’église. Ne lui demandons pas non plus la morale sévère et guindée du Portique : tant d’austérité l’épouvante. N’attendons pas même de lui cette haine vertueuse que donne aux gens de bien la vue du mal il est plutôt du parti de Philinte, qui
… prend tout doucement les hommes comme ils sont,
que du parti d’Alceste. Ne croyons pas cependant que le théâtre soit, de tous les genres de littérature, le plus dépourvu de morale. Image de la vie humaine, le théâtre est moral comme l’expérience, et, ajoutons-le, hélas ! pour ne rien déguiser de son inefficacité, moral comme l’expérience d’autrui, qui touche et qui corrige peu.
» J’examinerai plus tard quels sont, quant à la morale, les dangers du théâtre. Je veux seulement aujourd’hui rechercher s’il est vrai que Molière ait voulu, comme l’en accuse J. J. Rousseau, ébranler l’autorité paternelle. Remarquons d’abord que les pères, les maris, les vieillards que Molière raille gaiement ne sont pas ridicules par leur caractère de père, de mari et de vieillard ; mais par les vices et les passions qui déshonorent en eux ce caractère même. Dans l’École des Maris, Sganarelle est ridicule, non parce qu’il est vieux, mais parce qu’étant vieux il est amoureux, et surtout un amoureux sévère et dur, ce qui est contraire au caractère de l’amour ; et il est si vrai que Sganarelle n’est point ridicule à cause de son âge mais à cause de ses défauts, qu’à côté de lui est Ariste, son frère, vieux aussi et amoureux, mais aimable et indulgent, qui est le héros de la pièce, et que la jeune Léonore épouse de fort bon cœur. Ce n’est donc point la vieillesse que Molière ridiculise, ce sont les défauts qui la discréditent. J’en dirai autant d’Arnolfe dans l’École des Femmes : il n’est pas ridicule parce qu’il est vieux, mais parce qu’il est grondeur et jaloux. George Dandin non plus n’est pas ridicule parce qu’il est marié, mais parce qu’il a fait un mariage de vanité : il paye la faute de son orgueil. Harpagon enfin nous amuse, non comme père, mais comme avare ; et, si son fils lui manque de respect, c’est que, dans ce moment, l’avare, l’usurier et le vieillard amoureux, les trois vices ou les trois ridicules d’Harpagon, cachent et dérobent le père.
La comédie, en faisant punir les vices les uns par les autres, représente la justice du monde telle qu’elle est, justice qui s’exerce et qui s’accomplit à l’aide des passions humaines qui se combattent et se renversent tour à tour. C’est cette justice qu’expriment aussi les proverbes, qui ne sont que la comédie résumée en maximes, quand ils disent : À père avare fils prodigue. Lorsque les passions sont grandes et fortes, cette justice est terrible, et elle enfante l’émotion de la tragédie ; quand les passions sont plus petites et plus mesquines, cette justice est plaisante et gaie : elle enfante alors le ridicule de la comédie.
» Une étude attentive des rôles du père et du fils, d’Harpagon et de Cléante, dans l’Avare, justifiera ces réflexions.
» Si je voulais, dans un sermon, dépeindre l’avarice et la rendre odieuse ; si je disais que cette passion fait tout oublier, l’honneur, l’amitié, la famille ; que l’avare préfère son or à ses enfants ; que ceux-ci, réduits par l’avarice de leur père aux plus grandes nécessités, s’habituent bientôt à ne plus le respecter, et que cette révolte des enfants est le châtiment de l’avarice du père ; si je disais tout cela dans un sermon, qui s’en étonnerait ? qui s’aviserait de prétendre qu’en parlant ainsi j’encourage les enfants à oublier le respect qu’ils doivent à leurs parents ? Molière, dans la scène de l’Avare qu’accuse Jean-Jacques Rousseau, n’a pas fait autre chose que mettre en action le sermon que j’imagine. Quand le père oublie l’honneur, le fils oublie le respect qu’il doit à son père. Ne nous y trompons pas, en effet : c’est un beau titre que celui de père de famille, c’est presque un sacerdoce ; mais c’est un titre qui oblige, et, s’il donne des droits, il impose aussi des devoirs. Je sais bien qu’un fils ne doit jamais accuser son père, même s’il est coupable mais c’est là le précepte, ce n’est point, hélas ! la pratique, sinon des fils vertueux. Or, Molière, dans l’Avare, n’a pas entendu le moins du monde nous donner Cléante pour un fils vertueux que nous devons approuver aux dépend de son père ; il a voulu seulement opposer l’avarice à la prodigalité, parce que ce sont les deux vices qui, contrastant le plus l’un avec l’autre, peuvent, par cela même, se choquer et se punir le plus efficacement. »
Cette ingénieuse et piquante appréciation est sans aucun doute, avec la comédie même de Molière une réfutation sans réplique des paradoxes de Rousseau.
PERSONNAGES
Harpagon, père de Cléante et d’Élise, et amoureux de Mariane.
Cléante, fils d’Harpagon, amant de Mariane.Élise, fille d’Harpagon, amante de Valère.Valère, fils d’Anselme et amant d’Élise.Mariane, amante de Cléante et aimée d’Harpagon .Anselme, père de Valère et de Mariane.Frosine, femme d’intrigue.Maître Simon, courtier.Maître Jacques, cuisinier et cocher d’Harpagon.La Flèche, valet de Cléante.Dame Claude, servante d’Harpagon.
Brindavoine, La Merluche, laquais d’Harpagon.
Un commissaire et son clerc.
ACTE PREMIER
Scène I
VALÈRE, ÉLISE.
VALÈRE
Hé quoi ! charmante Élise, vous devenez mélancolique, après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi ? Je vous vois soupirer, hélas ! au milieu de ma joie ! Est-ce du regret, dites-moi, de m’avoir fait heureux ? et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre ?
ÉLISE
Non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m’y sens entraîner par une trop douce puissance, et je n’ai pas même la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais, à vous dire vrai, le succès me donne de l’inquiétude ; et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais.
VALÈRE
Eh ! que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi ?
ÉLISE
Hélas ! cent choses à la fois : l’emportement d’un père, les reproches d’une famille, les censures du monde ; mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur, et cette froideur criminelle dont ceux de votre sexe payent le plus souvent les témoignages trop ardents d’un innocent amour.
VALÈRE
Ah ! ne me faites pas ce tort, de juger de moi par les autres ! Soupçonnez-moi de tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela ; et mon amour pour vous durera autant que ma vie.
ÉLISE
Ah ! Valère, chacun tient les mêmes discours ! Tous les hommes sont semblables par les paroles ; et ce n’est que les actions qui les découvrent différents.
VALÈRE
Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes, attendez donc, au moins, à juger de mon cœur par elles, et ne me cherchez point des crimes dans les injustes craintes d’une fâcheuse prévoyance. Ne m’assassinez point, je vous prie, par les sensibles coups d’un soupçon outrageux ; et donnez-moi le temps de vous convaincre, par mille et mille preuves, de l’honnêteté de mes feux.
ÉLISE
Hélas ! qu’avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l’on aime ! Oui, Valère, je tiens votre cœur incapable de m’abuser. Je crois que vous m’aimez d’un véritable amour, et que vous me serez fidèle : je n’en veux point du tout douter, et je retranche mon chagrin aux appréhensions du blâme qu’on pourra me donner.
VALÈRE
Mais pourquoi cette inquiétude ?
ÉLISE
Je n’aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois ; et je trouve en votre personne de quoi avoir raison aux choses que je fais pour vous. Mon cœur, pour sa défense, a tout votre mérite, appuyé du secours d’une reconnaissance où le ciel m’engage envers vous. Je me représente à toute heure ce péril étonnant qui commença de nous offrir aux regards l’un de l’autre ; cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie, pour dérober la mienne à la fureur des ondes ; ces soins pleins de tendresse que vous me fîtes éclater après m’avoir tirée de l’eau, et les hommages assidus de cet ardent amour que ni le temps ni les difficultés n’ont rebuté, et qui, vous faisant négliger et parents et patrie, arrête vos pas en ces lieux, y tient en ma faveur votre fortune déguisée, et vous a réduit, pour me voir, à vous revêtir de l’emploi de domestique de mon père. Tout cela fait chez moi, sans doute, un merveilleux effet ; et c’en est assez, à mes yeux, pour me justifier l’engagement où j’ai pu consentir ; mais ce n’est pas assez peut-être pour le justifier aux autres, et je ne suis pas sûre qu’on entre dans mes sentiments.
VALÈRE
De tout ce que vous avez dit, ce n’est que par mon seul amour que je prétends auprès de vous mériter quelque chose ; et quant aux scrupules que vous avez, votre père lui-même ne prend que trop de soin de vous justifier à tout le monde, et l’excès de son avarice, et la manière austère dont il vit avec ses enfants, pourraient autoriser des choses plus étranges. Pardonnez-moi, charmante Élise, si j’en parle ainsi devant vous. Vous savez que, sur ce chapitre, on n’en peut pas dire de bien. Mais enfin, si je puis, comme je l’espère, retrouver mes parents, nous n’aurons pas beaucoup de peine à nous les rendre favorables. J’en attends des nouvelles avec impatience, et j’en irai chercher moi-même, si elles tardent à venir.
ÉLISE
Ah ! Valère, ne bougez d’ici, je vous prie, et songez seulement à vous bien mettre dans l’esprit de mon père.
VALÈRE
Vous voyez comme je m’y prends, et les adroites complaisances qu’il m’a fallu mettre en usage pour m’introduire à son service ; sous quel masque de sympathie et de rapports de sentiments je me déguise pour lui plaire, et quel personnage je joue tous les jours avec lui, afin d’acquérir sa tendresse. J’y fais des progrès admirables ; et j’éprouve que, pour gagner les hommes, il n’est point de meilleure voie que de se parer à leurs yeux de leurs inclinations, que de donner dans leurs maximes, encenser leurs défauts, et applaudir à ce qu’ils font. On n’a que faire d’avoir peur de trop charger la complaisance ; et la manière dont on les joue a beau être visible, les plus fins toujours sont de grandes dupes du côté de la flatterie, et il n’y a rien de si impertinent et de si ridicule qu’on ne fasse avaler, lorsqu’on l’assaisonne en louanges. La sincérité souffre un peu au métier que je fais ; mais, quand on a besoin des hommes, il faut bien s’ajuster à eux, et puisqu’on ne saurait les gagner que par là, ce n’est pas la faute de ceux qui flattent, mais de ceux qui veulent être flattés.
ÉLISE
Mais que ne tâchez-vous aussi de gagner l’appui de mon frère, en cas que la servante s’avisât de révéler notre secret ?
VALÈRE
On ne peut pas ménager l’un et l’autre ; et l’esprit du père et celui du fils sont des choses si opposées, qu’il est difficile d’accommoder ces deux confidences ensemble. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre frère, et servez-vous de l’amitié qui est entre vous deux pour le jeter dans nos intérêts. Il vient. Je me retire. Prenez ce temps pour lui parler, et ne lui découvrez de notre affaire que ce que vous jugerez à propos.
ÉLISE
Je ne sais si j’aurai la force de lui faire cette confidence.
Scène II
CLÉANTE, ÉLISE.
CLÉANTE
Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur ; et je brûlais de vous parler, pour m’ouvrir à vous d’un secret.
ÉLISE
Me voilà prête à vous ouïr, mon frère. Qu’avez-vous à me dire ?
CLÉANTE
Bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J’aime.
ÉLISE
Vous aimez ?
CLÉANTE
Oui, j’aime. Mais, avant que d’aller plus loin, je sais que je dépends d’un père, et que le nom de fils me soumet à ses volontés ; que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour ; que le ciel les a faits les maîtres de nos vœux, et qu’il nous est enjoint de n’en disposer que par leur conduite ; que, n’étant prévenus d’aucune folle ardeur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous et de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre ; qu’il en faut plutôt croire les lumières de leur prudence que l’aveuglement de notre passion ; et que l’emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire ; car enfin mon amour ne veut rien écouter, et je vous prie de ne me point faire de remontrances.
ÉLISE
Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez ?
CLÉANTE
Non ; mais j’y suis résolu, et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raisons pour m’en dissuader.
ÉLISE
Suis-je, mon frère, une si étrange personne ?
CLÉANTE
Non, ma sœur ; mais vous n’aimez pas ; vous ignorez la douce violence qu’un tendre amour fait sur nos cœurs, et j’appréhende votre sagesse.
ÉLISE
Hélas ! mon frère, ne parlons point de ma sagesse : il n’est personne qui n’en manque, du moins une fois en sa vie ; et, si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous.
CLÉANTE
Ah ! plût au ciel que votre âme, comme la mienne… !
ÉLISE
Finissons auparavant votre affaire, et me dites qui est celle que vous aimez.
CLÉANTE
Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers, et qui semble être faite pour donner de l’amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n’a rien formé de plus aimable ; et je me sentis transporté dès le moment que je la vis. Elle se nomme Mariane et vit sous la conduite d’une bonne femme de mère qui est presque toujours malade, et pour qui cette aimable fille a des sentiments d’amitié qui ne sont pas imaginables. Elle la sert, la plaint et la console avec une tendresse qui vous toucherait l’âme. Elle se prend d’un air le plus charmant du monde aux choses qu’elle fait ; et l’on voit briller mille grâces en toutes ses actions, une douceur pleine d’attraits, une bonté toute engageante, une honnêteté adorable, une… Ah ! ma sœur, je voudrais que vous l’eussiez vue. 1
ÉLISE
J’en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites ; et, pour comprendre ce qu’elle est, il me suffit que vous l’aimez.
CLÉANTE
J’ai découvert sous main qu’elles ne sont pas fort accommodées 2 , et que leur discrète conduite a de la peine à étendre à tous leurs besoins le bien qu’elles peuvent avoir. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être que de relever la fortune d’une personne que l’on aime ; que de donner adroitement quelques petits secours aux modestes nécessités d’une vertueuse famille ; et concevez quel déplaisir ce m’est de voir que, par l’avarice d’un père, je sois dans l’impuissance de goûter cette joie, et de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour.
ÉLISE
Oui, je conçois assez, mon frère, quel doit être votre chagrin.
CLÉANTE
Ah ! ma sœur, il est plus grand qu’on ne peut croire. Car, enfin, peut-on rien voir de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu’on exerce sur nous, que cette sécheresse étrange où l’on nous fait languir ? Hé ! que nous servira d’avoir du bien, s’il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans le bel âge d’en jouir, et si, pour m’entretenir même, il faut que maintenant je m’engage de tous côtés ; si je suis réduit avec vous à chercher tous les jours le secours des marchands, pour avoir moyen de porter des habits raisonnables ? Enfin, j’ai voulu vous parler pour m’aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis ; et, si je l’y trouve contraire, j’ai résolu d’aller en d’autres lieux, avec cette aimable personne, jouir de la fortune que le ciel voudra nous offrir. Je fais chercher partout pour ce dessein de l’argent à emprunter ; et, si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu’il faille que notre père s’oppose à nos désirs, nous le quitterons là tous deux, et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable.
ÉLISE
Il est bien vrai que tous les jours il nous donne de plus en plus sujet de regretter la mort de notre mère, et que…
CLÉANTE
J’entends sa voix ; éloignons-nous un peu pour achever notre confidence ; et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur.
Scène III
HARPAGON, LA FLÈCHE.
HARPAGON 3
Hors d’ici tout à l’heure, et qu’on ne réplique pas. Allons, que l’on détale de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence !
LA FLÈCHE, à part.
Je n’ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard, et je pense, sauf correction, qu’il a le diable au corps.
HARPAGON
Tu murmures entre tes dents ?
LA FLÈCHE
Pourquoi me chassez-vous ?
HARPAGON
C’est bien à toi, pendard, à me demander des raisons ! Sors vite, que je ne t’assomme 4 .
LA FLÈCHE
Qu’est-ce que je vous ai fait ?
HARPAGON
Tu m’as fait que je veux que tu sortes.
LA FLÈCHE
Mon maître, votre fils, m’a donné ordre de l’attendre.
HARPAGON
Va-t’en l’attendre dans la rue, et ne sois point dans ma maison planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévorent ce que je possède, et furètent de tous côtés pour voir s’il n’y a rien à voler 5 .
LA FLÈCHE
Comment diantre voulez-vous qu’on fasse pour vous voler ? Êtes-vous un homme volable, quand vous renfermez toutes choses, et faites sentinelle jour et nuit ?
HARPAGON
Je veux renfermer ce que bon me semble, et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchards, qui prennent garde à ce qu’on fait ? (Bas, à part.) Je tremble qu’il n’ait soupçonné quelque chose de mon argent. (Haut.) Ne serois-tu point homme à 6 aller faire courir le bruit que j’ai chez moi de l’argent caché ?
LA FLÈCHE
Vous avez de l’argent caché ?
HARPAGON
Non, coquin, je ne dis pas cela. (Bas.) J’enrage ! (Haut.) Je demande si, malicieusement, tu n’irois point faire courir le bruit que j’en ai.
LA FLÈCHE
Hé ! que nous importe que vous en ayez, ou que vous n’en ayez pas, si c’est pour nous la même chose ?
HARPAGON, levant la main pour donner un soufflet à la Flèche.
Tu fais le raisonneur ! Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d’ici, encore une fois.
LA FLÈCHE
Eh bien ! je sors.
HARPAGON
Attends : ne m’emportes-tu rien ?
LA FLÈCHE
Que vous emporterois-je ?
HARPAGON
Tiens, viens çà, que je voie. Montre-moi tes mains 7 .
LA FLÈCHE
Les voilà.
HARPAGON
Les autres 8 .
LA FLÈCHE
Les autres ?
HARPAGON
Oui.
LA FLÈCHE
Les voilà.
HARPAGON, montrant les hauts-de-chausses de la Flèche.
N’as-tu rien mis ici dedans 9 ?
LA FLÈCHE
Voyez vous-même.
HARPAGON, tâtant le bas des hauts-de-chausses de la Flèche.
Ces grands hauts-de-chausses sont propres à devenir les recéleurs des choses qu’on dérobe ; et je voudrais qu’on en eût fait pendre quelqu’un.
LA FLÈCHE , à part.
Ah ! qu’un homme comme cela mériterait bien ce qu’il craint ! Et que j’aurais de joie à le voler !
HARPAGON
Euh ?
LA FLÈCHE
Quoi ?
HARPAGON
Qu’est-ce que tu parles de voler ?
LA FLÈCHE
Je vous dis que vous fouillez bien partout, pour voir si je vous ai volé.
HARPAGON
C’est ce que je veux faire.
Harpagon fouille dans les poches de La Flèche.
LA FLÈCHE, à part.
La peste soit de l’avarice et des avaricieux !
HARPAGON
Comment ? que dis-tu ?
LA FLÈCHE
Ce que je dis ?