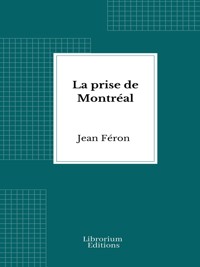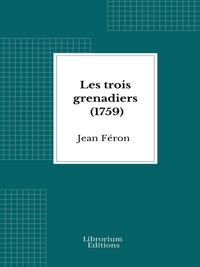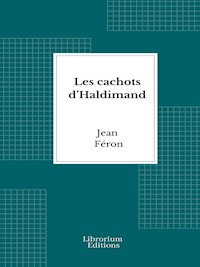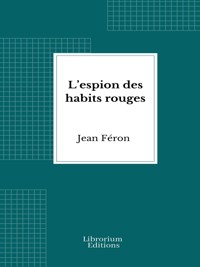
1,29 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le 23 novembre 1837, au matin, le village de Saint-Denis de Richelieu était soudainement mis en émoi par la nouvelle que des Patriotes avaient arrêté sur le chemin de Saint-Ours un émissaire ennemi, et plus justement un espion. Cet espion venait de Montréal et avait été envoyé par John Colborne avec ordre de surveiller les Patriotes de Saint-Charles, de s’assurer de leur nombre et de leurs moyens de défense, de prendre les noms des principaux meneurs et de faire rapport au colonel Gore en garnison à Sorel.
Voilà ce qu’on se disait de bouche à bouche. Mais un Patriote affirmait que l’espion précédait les troupes de Sorel commandées par Gore en personne et Crompton, son aide-de-camp, et que ces forces armées se dirigeaient vers le camp retranché de Saint-Charles à six milles de Saint-Denis. Il fallait donc admettre que cet espion avait déjà fait des relevés minutieux, qu’il avait surpris quelques secrets des Patriotes et que, maintenant, il conduisait les troupes du gouvernement avec la certitude que celles-ci surprendraient les insurgés inopinément, les tailleraient en pièces et raseraient leurs travaux militaires et, peut-être aussi, leurs villages.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
L’ESPION DES HABITS ROUGES
Roman canadien inédit
par
JEAN FÉRON
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385741983
PRÉAMBULE
I L’ESPION
II LA TOURMENTE
III LES BLESSURES DU CŒUR
IV UN GOUFFRE QUI SE CREUSE
V APPRÊTS DE BATAILLE
VI OÙ L’AMOUR SEMBLE PLUS FORT QUE LE DEVOIR
VII PREMIÈRES ESCARMOUCHES
VIII PREMIÈRE CHARGE
IX LE SANG BOUT
X EN PLEINE BATAILLE
XI LA PATRIOTE
XII LA PANIQUE ROUGE
XIII L’AMOUR EN DÉLIRE
XIV VICTOIRE ! VICTOIRE !…
PRÉAMBULE
Saint-Denis !…
Quel souvenir impérissable ont laissé sur ton sol ardent ceux-là qui, après les crépitements de la mousqueterie et les éclats du canon, lançaient dans ton ciel leurs cris de victoire ! Quelle généreuse semence de patriotisme ont répandue avec leur sang ces hommes qui se battaient courageusement pour les libertés canadiennes !
Saint-Denis !…
Après bientôt un siècle tu mires encore dans les ondes claires du Richelieu ton histoire ! Ton clocher, tes maisons, tes bosquets, tes champs, tes collines sont là encore les fiers témoins de tes prodiges ! Ils ont peut-être changé de physionomie, mais ils gardent la même âme sereine et fière ! Et qui n’aurait de fierté à laisser voir les magnifiques blessures reçues pour la défense de la cause sacrée ? Qui ne s’enorgueillirait d’avoir vécu et de vivre encore dans l’ombre douce de héros quasi légendaires ? Sparte, Athènes, Rome, Carthage, dans l’Antiquité, vivaient au souffle impétueux de leurs héros ! Plus rapprochés de nous, Québec et Ville-Marie auréolaient notre Histoire par les exploits de leurs vaillants défenseurs ! Mais l’épopée ne pouvait être complète sans toi, ô Saint-Denis ! Elle n’était pas complète sans Saint-Charles, sans Saint-Eustache, sans Odelltown ! Non… pour compléter cette épopée splendide ilfallait non seulement des guerriers le sang pur répandu à large flots, il fallait encore le sang des martyrs… Oui, l’échafaud devait ceindre d’une auréole plus brillante encore ceux qui étaient les vrais enfants de la race !
Saint-Denis !…
Un nom, à lui seul, t’illustre à jamais ; un nom étranger, un nom anglais, mais un ami et un défenseur de la race outragée… Wolfred Nelson ! Ah ! tu frémis, ô Saint-Denis ! quand on profère ce nom ? Quel nom !… Rien que ce nom c’est déjà une Histoire ! Wolfred Nelson… superbe héros ! L’Antiquité l’eût placé au rang des dieux ! L’été, quand tombe le crépuscule, quand les eaux du Richelieu semblent murmurer une complainte ancienne, quand les feuillages en frissonnant semblent raconter une légende des temps héroïques, quand la brise souffle doucement comme une musique de luth aux accents d’une mélancolie inexprimable, on croit entendre son nom cent fois chuchoté par mille voix invisibles… Wolfred Nelson ! Car son image est là, vivante toujours, de même que son nom est partout ! Quand les vents descendent des coteaux, ils apportent à notre ouïe le nom de Nelson ; quand on se penche sur la nappe miroitante du Richelieu, on voit la figure énergique de Nelson ! Si, par un soir d’hiver et sous la lune pleine, un villageois franchit le village, l’ombre de cet homme grandit et se profile hautement sur la neige… et l’on croit apercevoir la silhouette de Nelson ! Ah ! comme il l’avait parcouru ce petit village paisible et heureux ! De son pied rude il en avait foulé chaque pouce de terrain. Dix, vingt fois par jour il avait, de sa démarche saccadée, traversé ou longé ce chemin du roi allant à ses affaires, courant à ses malades. Tantôt il passait pédestrement de son pas militaire, tel un chef d’armée visitant son quartier général ; tantôt à cheval, droit et imposant dans les étriers, comme un général passant en revue ses troupes avant le coup de clairon qui annoncera les premières charges ; tantôt en voiture, conduisant lui-même une jument noire pleine de feu, comme un tranquille bourgeois qui va visiter ses amis. Comme il était salué… tous les chapeaux s’enlevaient sur son passage ! Les femmes et les jeunes filles s’inclinaient, quelquefois gauchement, mais avec tant de respect. Les enfants agrandissaient des yeux admiratifs à la vue de cet homme à l’allure si martiale. Lui, quoique sa physionomie eût une apparence de froideur, rendait aimablement le salut en souriant, disait un bon mot aux enfants. Ô Nelson ! aujourd’hui comme naguère Saint-Denis te salue ! Que dis-je ? toute la race te salue, valeureux Nelson ! Et si ces paysans que tu estimais étaient d’une belle race, tu étais, toi, de race non moins belle et d’une race dont tu voulus sauver l’honneur ! Tu portais un grand nom… un nom qui avait illustré l’Histoire de ta nation, et c’est pourquoi tu voulus conserver à ce nom toute sa gloire !
Saint-Denis… Saint-Charles… Saint-Eustache… magnifique trilogie !
Papineau… Nelson… Chénier… autre trilogie non moins magnifique ! Avec de tels noms comment une histoire peut-elle s’effacer ? Comment une race peut-elle ne pas survivre ?
Ainsi pensait l’âme canadienne en ces temps éloignés, ainsi elle pense encore chaque fois qu’elle se mire dans les pages sublimes de son Histoire ! Ainsi elle pensera en 1937 !…
IL’ESPION
Le 23 novembre 1837, au matin, le village de Saint-Denis de Richelieu était soudainement mis en émoi par la nouvelle que des Patriotes avaient arrêté sur le chemin de Saint-Ours un émissaire ennemi, et plus justement un espion. Cet espion venait de Montréal et avait été envoyé par John Colborne avec ordre de surveiller les Patriotes de Saint-Charles, de s’assurer de leur nombre et de leurs moyens de défense, de prendre les noms des principaux meneurs et de faire rapport au colonel Gore en garnison à Sorel.
Voilà ce qu’on se disait de bouche à bouche. Mais un Patriote affirmait que l’espion précédait les troupes de Sorel commandées par Gore en personne et Crompton, son aide-de-camp, et que ces forces armées se dirigeaient vers le camp retranché de Saint-Charles à six milles de Saint-Denis. Il fallait donc admettre que cet espion avait déjà fait des relevés minutieux, qu’il avait surpris quelques secrets des Patriotes et que, maintenant, il conduisait les troupes du gouvernement avec la certitude que celles-ci surprendraient les insurgés inopinément, les tailleraient en pièces et raseraient leurs travaux militaires et, peut-être aussi, leurs villages.
Il est vrai que les Patriotes n’avaient rien de précis sur les desseins de l’ennemi, mais on savait pour certain que le colonel Wetherall, qui commandait la garnison de Chambly, devait marcher contre Saint-Charles, et alors on ne s’étonnait pas que Gore vint tenter de se joindre à lui, afin que, avec des forces doubles, l’ennemi pût plus aisément dompter l’insurrection.
Quoi qu’il en soit, sur les routes qui se déroulaient entre Sorel et Saint-Denis et entre Chambly et Saint-Charles, les chefs des insurgés avaient aposté ça et là des factionnaires chargés de surveiller ces routes et de signaler la venue de troupes ennemies. C’est ainsi que l’espion était tombé entre les mains de deux Patriotes qui surveillaient la route entre Saint-Ours et Saint-Denis. Interrogé, l’inconnu avait refusé de répondre ; et les deux Patriotes, pour obéir probablement à des instructions précises, avaient conduit leur prisonnier au village de Saint-Denis pour le remettre entre les mains du docteur Wolfred Nelson, qui avait été reconnu comme le chef suprême des insurgés de la vallée du Richelieu. Mais là, au village, il s’était trouvé quelqu’un à qui le prisonnier n’était pas tout à fait inconnu, et l’on sut bientôt que le soi-disant espion était un nommé André Latour, de nationalité canadienne-française, et lieutenant d’une compagnie de volontaires en garnison à Montréal. Que cet homme fût espion ou nom, une chose certaine, comme le pensaient les Patriotes, c’était un ennemi.
On conduisit donc le prisonnier chez Nelson. Mais celui-ci était parti pour Saint-Charles avec Papineau ; les deux chefs étaient allés faire une revue du camp et donner des instructions nouvelles aux officiers qui y commandaient.
En attendant le retour de Nelson, le prisonnier fut conduit à l’auberge de dame veuve Rémillard, à l’extrémité ouest du village et sur le chemin du roi qui du village formait la rue principale.
Il était environ six heures du matin. Le temps était nuageux et froid. À l’arrivée du prisonnier et de ses deux gardiens les habitants du village étaient pour la plupart plongés dans un bon sommeil. Tout y était calme et silencieux. Mais ce ne fut pas long que l’arrestation de l’espion était connue, et bientôt on put voir les volets s’ouvrir, les fenêtres s’éclairer, les cheminées fumer, et dix minutes ne s’étaient pas écoulées qu’une bonne partie de la petite population entourait avec curiosité le prisonnier et ses gardiens. C’est alors qu’un jeune officier de Nelson, qui habitait Montréal, reconnut cet André Latour. Et peu à peu la nouvelle pénétrait dans tous les foyers, si bien que, lorsqu’on atteignit l’auberge, presque toute la population faisait cortège.
L’auberge fut envahie.
La tenancière venait de se lever. Une lampe et les hautes flammes de la cheminée éclairaient la salle commune.
Le prisonnier, dont les deux mains étaient liées derrière le dos, fut assis près du foyer, et ses deux gardiens en recommandèrent la surveillance à la tenancière, disant qu’ils devaient aller reprendre leur poste sur la route.
— C’est bien, répondit la brave femme. D’ailleurs, je trouverai bien quelques patriotes pour le surveiller.
Les deux hommes burent chacun un grand verre d’eau-de-vie et s’en allèrent.
Jusqu’à ce moment les villageois étaient demeurés sur la réserve à l’égard du prisonnier, et personne n’avait paru mal intentionné à son égard, attendu qu’on désirait savoir ce que dirait le docteur Nelson ! L’auberge comptait environ une quarantaine de personnes, des hommes d’âge mûr et des jeunes gens pour la plupart ; mais il y avait aussi sept ou huit femmes qui, curieuses, avaient vivement jeté un châle sur leur tête et étaient venues voir ce qui se passait. Les hommes s’étaient assis aux tables qui garnissaient la salle et avaient allumé leurs pipes, tout en commentant à voix plutôt basse l’incident. Les femmes, réunies en groupe au milieu de la pièce et non loin du prisonnier, faisaient aussi leurs commentaires mais à voix plus haute et avec plus d’animation que les hommes. Ceux-ci de temps à autre se faisaient servir des liqueurs par la tenancière qui répondait avec empressement.
C’était une accorte commère, pas laide, grasse et gaie. Âgée d’environ quarante-cinq ans elle possédait un visage encore sans rides, au teint clair et coloré qu’animaient des yeux noirs d’un vif éclat. Sur ses cheveux très noirs encore elle portait un bonnet de toile écrue et autour de son cou un fichu de soie mauve. Quant au reste, elle était vêtue comme les autres femmes du pays, corsage d’indienne ou de coton et jupe d’étoffe grise.
Dame Rémillard était très estimée dans le village et de tous les gens qui la connaissaient. C’était une femme hospitalière et généreuse, bonne chrétienne et excellente patriote. Avenante, sa clientèle augmentait constamment au lieu de diminuer, et l’on disait qu’elle faisait des affaires d’or. Aussi, nombre de veufs et vieux garçons avaient-ils essayé de lui faire la cour dans l’espoir d’obtenir sa main, mais Dame Rémillard avait fait savoir qu’elle ne songerait pas à se remarier tant qu’elle aurait sa fille avec elle. Cette décision avait paru définitive, et les pauvres soupirants qui, probablement, soupiraient après le magot plutôt qu’après la femme elle-même, avaient donc retraité, mais sans perdre tout à fait l’espoir de se voir un jour ou l’autre d’heureux élus.
Ce matin du 23 novembre 1837, Dame Rémillard avait l’air plus vive que d’habitude, plus avenante, et un large sourire ne quittait pas ses lèvres qui s’ouvraient sur de forts belles dents.
Elle parcourait la salle avec un cabaret sur lequel étaient posés un flacon et des verres. Elle servait elle-même les consommateurs. Quand le flacon était vide, elle allait derrière un petit comptoir placé dans un angle de la pièce et en prenait un autre.
Mais Dame Rémillard ne servait pas toujours ainsi : lorsqu’elle avait sa fille ou une servante elle demeurait à son comptoir pour y recevoir la monnaie. Elle abandonnait à sa fille ou à sa servante la tâche d’aller à la ronde dans la salle.
À mesure que se vidaient les verres, ce matin-là, les têtes s’échauffaient et les voix s’élevaient. Tous les hommes fumaient à grosses bouffées, de sorte qu’une boucane bleue planait comme un brouillard entre le plancher et le plafond bas, et dans ce brouillard on ne distinguait que confusément les silhouettes humaines.
À un moment, la tenancière offrit du vin aux quelques femmes présentes. Elle les fit approcher du comptoir, disant :
— Il n’y a pas que les hommes qui ont le droit de boire, les femmes aussi !
Cette invitation fut acceptée sans déplaisir.
Dame Rémillard versa du vin rouge dont elle vida elle-même allègrement une bonne tasse.
Les villageoises firent claquer leur langue et ne manquèrent pas de nombreux éloges sur la qualité du vin. Naturellement on entama la conversation avec la tavernière sur le compte du prisonnier vers qui ces braves femmes glissaient plus d’un regard furtif et défiant.
Une d’elles avait dit :
— Vous devez connaître cet espion, Mame Rémillard ?
La tenancière ne répondit pas, mais ses lèvres esquissèrent un sourire énigmatique.
Les femmes s’entre-regardèrent, ébauchant elles aussi un sourire qui pouvait clairement signifier : « Elle le connaît, mais elle ne dira rien ! »
Puis de nouveau chacune de ces femmes lançait un coup d’œil inquisiteur vers l’espion.
Celui-ci se trouvait assis de profil au coin de la cheminée. Cette cheminée occupait une partie du mur à gauche en entrant dans la salle. L’escalier conduisant à l’étage supérieur en frôlait le manteau. Dans l’angle du fond ouvrait la porte de la cuisine et entre cette porte et la cheminée s’élevait une haute pile de bûches de bois d’érable et de bouleau. Dans l’angle opposé se dressait le comptoir. Tel qu’il était placé le prisonnier se trouvait donc à faire face aux occupants de la salle.
Nous avons déjà dit qu’il avait les mains liées derrière le dos. Il était vêtu d’un ample manteau gris, comme en portaient les Patriotes, et coiffé d’un chapeau de feutre noir à larges bords. Son front disparaissait tout entier sous ce chapeau, et l’on ne pouvait bien voir que ses yeux, son nez et sa bouche. Avec sa tête un peu penchée, vers la poitrine, son menton s’enfonçait dans le collet de son manteau. De gros souliers le chaussaient lourdement, et ses jambes étaient emprisonnées dans des molletières de cuir noir.
Si l’on ne pouvait pas voir son visage en entier, on en découvrait suffisamment pour se convaincre que le prisonnier était un jeune homme âgé de pas plus de vingt-cinq ans.
De bonne taille, il pouvait avoir quelque élégance sous des vêtements moins grossiers. Son visage, aux traits assez réguliers, était pâle et fatigué, mais les regards brillants de ses yeux bruns accusaient l’audace et l’énergie. D’ailleurs, il levait rarement ses yeux qu’il tenait attachés sur les flammes du foyer. Ses lèvres minces esquissaient un sourire dédaigneux qui semblait y être stéréotypé.
Qui était ce jeune homme ?…
Quelqu’un avait dit qu’il se nommait André Latour et faisait partie d’un corps de volontaires au titre de lieutenant. En effet, André Latour était le fils d’un riche négociant de Montréal qui, comme beaucoup de Canadiens-français de cette époque, avait laissé pencher ses sympathies du côté des Loyalistes anglais qui, par tous les moyens, essayaient d’enlever aux Canadiens leurs droits, leurs coutumes et leur langue. On demandait que le Bas-Canada fût administré par un régime exclusivement anglais, qu’on n’y parlât qu’une langue et qu’on fît disparaître jusqu’au dernier vestige des lois civiles françaises. On voulait, en outre, que les Canadiens fussent exclus des emplois publics. Bref, on travaillait à l’extinction totale de la nationalité française de Québec.
André Latour, après ses études faites, avait préféré le métier des armes au négoce en lequel son père avait songé à l’initier. À ce propos, disons que, à cette époque si troublée, un bon nombre de Canadiens français et dont plusieurs étaient des officiers remarquables, étaient enrôlés sous les drapeaux britanniques ; mais nous devons leur rendre cette justice que la plupart, sinon tous, n’avaient pas pris du service pour combattre leurs compatriotes. Bien que les esprits fussent très exaltés, malgré que bien des rumeurs batailleuses circulassent par tout le pays, tant dans le Bas-Canada que dans le Haut-Canada où, à certains moments, on croyait voir éclater un volcan, personne n’osait croire avec assurance à une insurrection, pour la bonne raison que le peuple n’était nullement préparé ni armé pour jeter le défi aux troupes du gouvernement canadien. Au vrai, l’insurrection existait, elle était dans les esprits, mais les insurgés ne voulaient pas prendre la responsabilité de l’offensive. Mais cette offensive, les Patriotes la prirent d’une certaine façon, et il arriva que des compatriotes durent porter des armes meurtrières contre des compatriotes. Les événements devaient transformer en ennemis des hommes de même origine et de même sang.
C’est ainsi que, ce matin de novembre, André Latour se voyait traité comme un ennemi.
Un quart d’heure s’était écoulé depuis que s’en étaient allés les deux gardiens du prisonnier, lorsque la porte de l’auberge s’ouvrit pour laisser entrer une douzaine de Patriotes dont un seul cependant était armé d’un fusil.
— Ah ! ah ! les compagnons ! s’écria l’un des arrivants, il paraîtrait qu’on nous a amené un espion ?
— On sait ben ! répondit un des villageois attablés en pointant Latour avec sa pipe. Regardez-y donc le nez, là !
Le prisonnier venait de lever la tête pour jeter un rapide coup d’œil sur les nouveaux venus.
Le Patriote qui venait de parler et qui portait un fusil en bandoulière, s’approcha de la cheminée, se pencha et regarda sous le nez de Latour.
Puis il se releva, se redressa, fit entendre un sifflement et regardant toute la salle qui venait de faire silence :
— Dames et Sieurs de la compagnie, nasilla-t-il avec une expression de surprise comique, je veux que le Bon Guieu me pardonne tous mes péchés… mais c’est pas un espion… c’est une espionne !…
— Une espionne !
Tout le monde bondit d’étonnement.
— Es-tu fou, Farfouille Laçasse ? cria Dame Rémillard de son comptoir.
— Fou… non ! répliqua gravement celui qu’on venait de nommer Farfouille Laçasse. Mais j’ai peut-être mal vu et mal regardé !
— Regardes-y encore sous le nez, Farfouille ! cria un jeune homme, un Patriote aussi, mais tout petit, et qui pour mieux voir sauta sur une table à pieds joints. Car toute la salle se pressait en rond près du prisonnier.
Farfouille Laçasse, puisque tel était son nom, se rapprocha de nouveau et avec précaution du prisonnier, tout comme il aurait fait d’un animal dangereux, et tout en relevant le bord du chapeau qui couvrait la tête de l’espion, il disait :
— J’y vas doucement, comme faisait mon grand-père qui levait les couvertes pour me sacrer une claque parce que je dormais mieux le matin que le soir…
D’un geste brusque il enleva tout à fait le chapeau du prisonnier, puis exécuta un bond en arrière, exclamant :
— Ah ! batèche… j’avais ben mal vu… c’est un espion !
On se mit à rire à la ronde.
Mais une voix nasillarde clama :
— Un espion !… Un espion !… Ah ben ! à bas l’espion… à bas l’espion !
— Tais-toi donc, Landry ! commanda Dame Rémillard en perdant son sourire et en fronçant ses sourcils noirs !
Tout le monde se retourna, et tous les regards virent debout sur une table le petit bonhomme qui avait l’instant d’avant crié à Farfouille Laçasse de regarder le nez du prisonnier. Oui, c’était un petit homme, maigre, la figure longue et très brunie par le hâle, la pipe aux dents et fumant à grosses bouffées, un bonnet de laine rouge vif planté sur l’oreille gauche, et les deux mains dans les poches de sa capote grise. Ses jambes fines et fortement cagneuses étaient serrées dans les jambières de bottes sauvages, et dans cette pose il avait une mine si drolatique qu’on se mit à rire de nouveau.
— Faut pas rire ! s’écria la tenancière en jetant un regard courroucé au petit homme ; ça va l’encourager !
— Moi, Mame Rémillard, j’ris pas, répliqua Landry avec un grand sérieux… c’est eux autres qui rient ! Moi, j’dis seulement : à bas l’espion !
— C’est vrai, Mame Rémillard, renchérit Farfouille Laçasse, c’est un espion, et vous savez qu’un espion c’est dangereux ! Ça se fourre le nez partout, ça vous guette si ben que vous êtes pas capable de lever le couvercle de la casserole sans qu’on voie ce qu’il y a dedans ! Vous pouvez pas fermer les yeux une seconde, parce que si vous fermez les yeux ça peut vous donner un coup dans l’estomac, ou ben dans l’ventre. Non, faut pas se fier à un espion ! Si vous parlez, ça vous écoute ; si vous vous grattez, ça vous entend ; si vous reluquez quelque part, ça reluque aussi ; et même si vous pensez à quelque chose, ça devine ce que vous pensez ! Eh ben ! ma grande foi du bon Guieu ! cet espion-là est pas dans nos parages rien que pour se promener, il a dû sentir quelque chose, et je serais pas étonné qu’il ait joué quelque tour aux Patriotes ! Donc, moi, Mame Rémillard, que ça vous fâche ou que ça vous fâche pas, j’dis comme Landry : À bas l’espion !
Landry poussa un cri de joie, un cri si aigu qu’il faillit briser les tympans des villageois, et il se mit à sauter une gigue sur la table.
Les villageois et les villageoises, dont l’esprit, était quelque peu échauffé par l’eau-de-vie et le vin, se mirent à rire encore, puis à murmurer, à chuchoter… Et tout à coup plusieurs voix crièrent :
— À bas l’espion !
— Moi, je propose qu’on lui mette une corde au cou ! clama Landry.
— Eh bien ! vous autres, demanda Farfouille Lacasse qui, debout, droit comme un pin, haut de taille, se tenait devant le prisonnier, les deux mains appuyées sur le canon de son fusil et face aux villageois… Eh bien ! vous autres, dit-il, qu’est-ce que vous en dites ? Est-ce qu’on va le pendre, ou si on ne le pendra pas ?