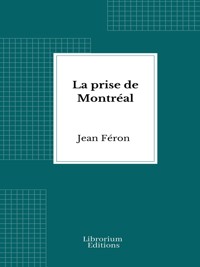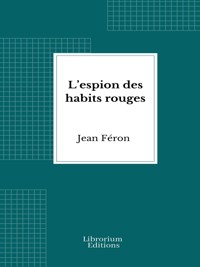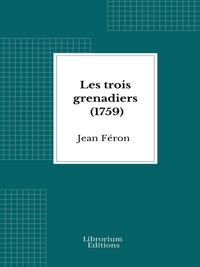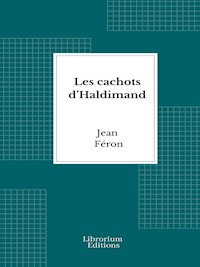
1,29 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Depuis deux jours la petite ville de Trois-Rivières était inondée par une pluie fine et froide que poussait un grand vent du nord-est. C’était un de ces temps à propos desquels l’habitant canadien aimait dire : — Voilà un bon « Nordet » pour couver la maison !
On était peu après la mi-septembre de 1780, et à une époque où les esprits étaient encore tout bouleversés par le tourbillon des idées révolutionnaires qu’avaient propagées les Américains durant et après leur invasion du Canada, et par les belles et séduisantes promesses faites aux Canadiens pour leur faire adopter la politique des sujets de la Nouvelle-Angleterre. Aussi, faut-il dire que les Canadiens avaient été fort tentés par ces promesses ; un moment ils avaient penché pour les lois nouvelles des États américains, alors qu’ils subissaient les lois tyranniques imposées par l’Angleterre et appliquées d’une façon barbare par ses représentants. Et les rigueurs du nouveau représentant du roi d’Angleterre, le général Haldimand, n’étaient pas un remède et pas même un palliatif aux ferments de scission et de révolte qui grondaient au sein de nos populations françaises du Canada. On eût dit qu’un volcan naissait et qu’il allait à tout instant cracher ses laves incendiaires. Et les Américains ne cessaient de lancer leurs promesses et leurs exhortations.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
LES CACHOTS D’HALDIMAND
Grand roman canadien historique
par
Jean Féron
Illustrations d’Albert Fournier
1926
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383838180
PROLOGUE
À cette époque, c’est-à-dire vers l’an 1780, la petite ville de Trois-Rivières commençait de rivaliser dans le commerce avec ses deux sœurs jumelles, Québec et Montréal. Sa population, d’à peine deux mille âmes et très industrieuse, comptait plusieurs hommes de grande valeur intellectuelle, morale et financière.
Située entre ses deux sœurs à distance à peu près égale de l’une et de l’autre, la petite ville qui, en fait n’était qu’un bourg, formait comme une sorte de trait d’union et un relais en même temps pour le commerce établi entre les deux villes extrêmes. Elle était là comme une auberge de grande route avec sa porte ouverte aux voyageurs. Elle devenait le point de repère du trafic qui se faisait de l’est à l’ouest et du nord au sud. L’industrie y naissait avec une croissance surprenante sous la poussée de ses commerçants habiles, de ses hommes d’affaires intelligents et autres personnalités qui jouissaient dans tout le pays d’un haut respect et d’une grande confiance.
Au nombre de ces personnalités était plus particulièrement remarqué le sieur Pierre du Calvet, gentilhomme huguenot et ancien magistrat, dont la fortune, la remarquable intelligence, l’énergie, le patriotisme et l’amour infini qu’il avait acquis pour sa patrie adoptive, le Canada, en faisaient un des personnages de l’époque. Ayant beaucoup de relations avec les huguenots établis en Louisiane, sa réputation s’était étendue à tous les états anglo-américains, si bien que des agents américains vinrent à plusieurs reprises le consulter sur l’opportunité, pour les colonies de l’Atlantique, de prendre leur indépendance politique et économique. Du Calvet fut chargé de toutes les rédactions des parchemins renfermant les revendications et les sommations des habitants des colonies anglaises auprès de la métropole britannique. Étant très versé dans les choses du droit international il avait une vision plus nette des nécessités d’un peuple colonial, qui commençait à sentir l’âpreté d’un lien qui l’unissait à un parent lointain et égoïste, et ce lien ne possédait plus assez d’élasticité pour durer longtemps. Du Calvet, avec sa science du droit, alla jusqu’au fond des choses les plus infimes, et l’on peut dire qu’il fût, mais sans que rien n’en transpirât, la cheville ouvrière du mouvement révolutionnaire des colonies de l’Atlantique.
Ici, il ne faut pas penser que le sieur Du Calvet avait été inspiré par un intérêt pécuniaire… non ! Sa fortune personnelle était assez considérable pour qu’il n’eût plus rien à désirer sous le rapport des acquisitions de biens matériels.
Mais quel était donc le but du gentilhomme français ?
Celui-ci uniquement : affaiblir en la divisant la puissance britannique sur le continent américain, afin que la race canadienne et française pût acquérir plus de force pour combattre avec succès les empiétements des Anglais sur ce qui était considéré comme des droits essentiels politiques, civils et religieux, reconnus aux colons français demeurés sur le sol canadien après les capitulations de 1759. Du Calvet s’était fait le champion de la cause. Dès qu’il avait saisi les premières convulsions du ver révolutionnaire dans l’esprit des colons américains, il avait essayé des stimulants que, d’ailleurs, les américains eux-mêmes étaient venus lui demander. Il n’avait pas manqué l’opportunité et de ce jour sa formule avait été : Diviser les Anglais !
— Comment ! s’était écrié un jour un de ses amis avec une immense stupeur, vous allez favoriser une révolution qui, pour nous, peut devenir une catastrophe ?
Du Calvet sourit.
— Non, mon ami. C’est justement la catastrophe que je veux éviter ; une fois que les Américains seront des maîtres chez eux, il n’y aura plus d’Anglais en cette immense Amérique que ceux qui occupent notre sol canadien. À ces Anglais alors nous pourrons dire : — À nous deux !
Mais ajoutons que Du Calvet, comme personne du reste, ne pouvait prévoir ou deviner le partage géographique qui allait se produire plus tard sur le sol canadien. Il ne pouvait prévoir que notre population française allait être coupée en deux tronçons, lorsque par le traité de Versailles de 1783 l’Angleterre se déciderait à céder aux Américains, en reconnaissant leur indépendance politique, toute une lisière de pays courant du nord-est au sud-ouest, c’est-à-dire du lac Champlain au Détroit, pays colonisé et habité par des populations de langue française. Du fait, ces populations passaient sous le régime américain et devenaient partie d’une nation qui, plus tard, aurait à peu près perdu la marque de ses premières origines. Ces colons français, qui devenaient ainsi par la force des choses des citoyens américains, ne seraient plus pour notre population canadienne ce nombre et cette force dont elle aurait tant besoin dans l’affreuse lutte de race qui allait commencer.
N’importe ! Du Calvet eût-il prévu ce partage qu’il eût marché quand même vers le même but, pensant qu’il valait mieux perdre un peu de ce côté que de se voir plus tard par l’immense majorité anglo-saxonne englobé, noyé, effacé.
Il n’avait pas prévu davantage l’émigration, des terres américaines en terre canadienne, des trente mille loyalistes anglais qui voulurent demeurer fidèles à leur mère-patrie ; car pendant que la race française perdait vingt mille âmes, la colonie anglaise du Canada en gagnait trente mille !
N’importe encore ! Du Calvet n’aurait pas dévié du chemin tracé.
Du Calvet avait donc donné tout son appui aux Américains, non seulement son appui moral et juridique, mais encore un appui financier considérable par la fourniture de vivres et de munitions de guerre, alors que les Anglais bloquaient tous les ports de l’Atlantique. C’est ce qui avait porté ses ennemis à croire et à clamer que Du Calvet avait également fourni des vivres et des munitions de guerre aux Américains, lors de leur invasion au Canada en 1775 et leur occupation de Montréal et de Trois-Rivières. Ces ennemis avaient profité de cette opportunité pour crier que Du Calvet et quelques-uns de ses amis et partisans travaillaient à pousser les Américains à faire la conquête du Canada. Du Calvet était loin de souhaiter cette conquête. Alors que les agents de Washington faisaient tous les efforts pour détacher les Canadiens du régime anglais, Du Calvet travaillait en sens contraire. À diverses reprises les agents américains et jusqu’à des envoyés spéciaux de La Fayette approchèrent Du Calvet pour l’attacher aux idées révolutionnaires. Il demeurait inébranlable et répondait :
— Messieurs, je vous prie de croire que vous perdez votre temps. Daignez répondre à monsieur de La Fayette que je suis ici en terre française et que j’y veux rester tant qu’elle demeurera française. Car le jour où ce pays deviendrait un pays anglo-saxon, je reprendrais le chemin de ma France.
— Mais, monsieur, vous êtes déjà en pays saxon !
— Non, répondait rudement Du Calvet qui n’aimait pas être contrarié, ce pays où je vis est français, cette atmosphère que je respire est française : partout autour de nous, nous sentons frissonner l’âme française, et ce pays restera français tant qu’un français aura assez d’énergie et de vaillance pour le défendre !
Du Calvet n’était donc pas partisan de la conquête du Canada par les Américains, car alors il ne fût plus resté de vestiges de cette terre française. Il sondait l’avenir et il espérait qu’un jour la race reprendrait le terrain perdu depuis le traité de Paris ; il espérait qu’un jour cette terre française, dominée pour le moment par le sceptre d’Albion, redeviendrait ce qu’elle avait été jusqu’à 1760.
Voilà à peu près ce qu’était ce personnage qui va occuper une large place dans les événements qui composent ce récit.
Du Calvet, naturellement, s’était fait des ennemis, et des ennemis puissants et implacables, dont l’un entre autres et le plus terrible : Sir Frederick Haldimand, lieutenant-gouverneur de la nouvelle colonie britannique.
PREMIÈRE PARTIE
IL’HOMME ET LE PÈRE
Depuis deux jours la petite ville de Trois-Rivières était inondée par une pluie fine et froide que poussait un grand vent du nord-est. C’était un de ces temps à propos desquels l’habitant canadien aimait dire : — Voilà un bon « Nordet » pour couver la maison !
On était peu après la mi-septembre de 1780, et à une époque où les esprits étaient encore tout bouleversés par le tourbillon des idées révolutionnaires qu’avaient propagées les Américains durant et après leur invasion du Canada, et par les belles et séduisantes promesses faites aux Canadiens pour leur faire adopter la politique des sujets de la Nouvelle-Angleterre. Aussi, faut-il dire que les Canadiens avaient été fort tentés par ces promesses ; un moment ils avaient penché pour les lois nouvelles des États américains, alors qu’ils subissaient les lois tyranniques imposées par l’Angleterre et appliquées d’une façon barbare par ses représentants. Et les rigueurs du nouveau représentant du roi d’Angleterre, le général Haldimand, n’étaient pas un remède et pas même un palliatif aux ferments de scission et de révolte qui grondaient au sein de nos populations françaises du Canada. On eût dit qu’un volcan naissait et qu’il allait à tout instant cracher ses laves incendiaires. Et les Américains ne cessaient de lancer leurs promesses et leurs exhortations.
Mais il se trouvait des hommes — tel Du Calvet — trop attachés à leur race et à leur sol pour se laisser leurrer par les promesses. Quitter sa terre et son foyer, c’était partir pour l’exil, aller à l’aventure dans un pays immense que des constitutions durables ne garantissaient pas encore contre les événements politiques, souvent funestes, dont souffrent plus particulièrement les étrangers. Du Calvet prêchait hautement qu’il est beaucoup préférable de vivre modestement chez soi, que de vivre, même fastueusement, chez le voisin qui ne sème pas ainsi ses prodigalités sans y dissimuler une chaîne quelconque. Du reste, Du Calvet depuis longtemps avait deviné la mentalité des colons de la Nouvelle-Angleterre qui s’étaient tant et tant plaints de l’égoïsme de leur ancienne métropole ; ils partageaient le même égoïsme, sous une forme et des couleurs différentes, et, peut-être, un égoïsme plus serré que celui qu’ils reprochaient à l’Angleterre.
Le but des Américains entrait, quoique avec une nuance, en parallèle avec celui de Du Calvet : ceux-là voulaient affaiblir la population du Canada en entraînant chez eux les Canadiens, afin de pouvoir plus facilement conquérir à leurs lois et à leur régime tout le reste de l’Amérique Septentrionale, et, par ce fait, bâtir sur ce vaste continent un formidable empire anglo-saxon. Le but de Du Calvet était d’affaiblir la force anglaise en Amérique, la réduire à sa plus simple expression dans cette partie de l’Amérique du Nord, puis la combattre fermement et reconquérir peu à peu, pour ensuite la conserver pour toujours, cette colonie à la race française.
Du Calvet ne pouvait donc tomber dans les vues américaines sans s’exposer à un illogisme brutal. Il est vrai de dire que les Américains offraient à la race française de se développer, dans leurs États, selon ses origines et ses traditions ; mais la race demeurerait toujours et quand même une race étrangère à l’autre, une race dans un pays, sur une terre, sous un ciel qu’elle ne pourrait un jour réclamer comme siens. Du Calvet pensait avec raison que d’accepter cette combinaison c’était s’exposer à un problème bien plus difficile de solution, pour ne pas dire impossible, que le problème de la reconquête du Canada par les fils de la race.
Voilà quelques-unes des idées qui tourmentaient les esprits, et l’on peut concevoir l’inquiétude et l’agitation qui régnaient non seulement sous les toits modestes et pauvres, mais aussi sous les toits bourgeois.
Le calendrier marquait lundi, 25 septembre.
C’était une maison massive et sévère de style qu’habitait Pierre Du Calvet. Élevée sur une éminence et entourée d’un grand parc planté d’ormes et de peupliers elle dominait, au sud, le fleuve Saint-Laurent, à l’est, la rivière Saint-Maurice, et à l’ouest, les toits et les pignons de la petite ville. Parmi les grosses constructions qui donnaient une certaine importance à la ville, se dressait la masse grise et imposante du Couvent des Ursulines au-dessus de laquelle s’élevait le clocher de la chapelle. Du côté du fleuve on découvrait de grands bâtiments : c’étaient des entrepôts et des magasins. À l’ouest et au nord se dressaient encore d’anciennes palissades qui avaient été élevées pour servir de fort et de rempart contre les incursions des sauvages. À l’est, du côté de la rivière Saint-Maurice, se trouvaient les chantiers et les magasins de bois : l’industrie des bois, qui avait pris naissance en la petite ville, allait au cours du siècle suivant s’étendre à tout le Canada et devenir l’un des puissants facteurs de sa prospérité.
Pénétrons dans la maison du sieur Du Calvet. Il venait d’entrer dans sa bibliothèque en compagnie de son fils unique âgé de vingt ans.
C’était après le repas du midi.
La pièce était très spacieuse, mais sombre et sévèrement meublée. C’était le sanctuaire du travailleur et du penseur. Une grande cheminée, qu’on entretenait par ces jours de pluies et de vents, répandait une chaleur tiède.
Sur deux pans de mur étaient disposés des rayons remplis de livres. Nulle décoration ne se voyait, hormis quatre tableaux à la peinture un peu sombre. C’étaient les portraits du fils de Du Calvet, alors qu’il était âgé de cinq ans, celui de Mme Du Calvet, mais à une époque où elle était encore jeune, puis le portrait du roi Henri iv et celui de l’amiral de Coligny. Ces portraits ne portaient le nom d’aucun peintre, mais par le manque de coloris, par l’indécision de la forme, par l’uniformité des contours, l’on pouvait penser que ces portraits n’étaient pas nés sous le pinceau d’un peintre illustre. Mais comme il était dit que Du Calvet s’était déjà essayé dans l’art de peindre et de représenter des figures, on aurait pu attribuer au maître de céans la paternité de ces œuvres.
Du Calvet était âgé de 56 ans. Il avait l’air plus vieux qu’il n’était en réalité par rapport au physique qui s’était un peu usé aux rudes travaux de la plume. Mais intellectuellement et moralement l’homme était dans toute la force de la maturité. Il était de taille ordinaire, un peu voûté lorsqu’il méditait. Mais dans les accès de colère il se redressait vivement, et l’on pouvait croire que dans ce corps vieilli avant l’âge vivait encore une sève jeune et vigoureuse.
Sa figure était généralement sévère et digne. Rarement le rire tombait de ses lèvres ; mais ces mêmes lèvres n’avaient pas perdu l’habitude de sourire de temps à autre. Elles étaient minces et sèches et les paroles qu’elles émettaient avaient des vibrations métalliques. Ceux qui connaissaient ce gentilhomme français savaient que sous sa gravité apparente éclatait souvent la plus franche jovialité. Dans la vie Du Calvet s’était fixé deux points de mire : sa famille, son pays. Pour son fils et sa femme il avait une tendresse que peu d’hommes peuvent se vanter d’avoir. Toute son existence il l’avait voulu consacrer à l’honneur et au bonheur de sa famille et de sa race. Il n’avait jamais dévié. Ses yeux gris et bleus, petits et très mobiles, exprimaient le plus souvent une énergie rude et indomptable, et par le fait même ils décelaient de suite une nature souvent brusque et parfois violente, surtout dans les moments de contrariété ou lorsque de trop grands soucis martelaient son esprit. Son verbe était généralement suave et profond dans les moments d’abandon familial ; mais il devenait de suite retentissant et sonore comme un clairon lorsqu’il commandait, et tranchant et quelque peu narquois dans les âpres discussions des affaires publiques. Il était donc plutôt d’un tempérament fougueux. On connaissait son intransigeance sur les droits acquis par sa race, et cette intransigeance le portait fort souvent à des violences de langage et à de terribles virulences qu’à maintes reprises on lui avait reprochées. Mais homme de probité et d’honneur, il était respecté et hautement admiré par ses compatriotes. Il aurait pu être un chef capable de porter aux plus hauts sommets les destinées de la race française du Canada.
En pénétrant dans sa bibliothèque il alla tendre ses mains blanches et soignées aux flammes claires du foyer tandis que son fils allait prendre place à une grande table chargée de papiers et de livres.
Du Calvet tourna son dos au foyer, jeta un long regard aux portraits de sa femme et de son fils, puis sur le jeune homme qui venait de pencher son front haut et mat sur un livre de droit, le père laissa peser un regard de paternelle douceur.
Au bout d’un moment il se dirigea vers la table, prit place dans un fauteuil devant une écritoire et des feuilles de papier blanc sur lesquelles on remarquait une écriture brusque et inégale, difficile à lire, et pleine de ratures. Du Calvet était en train de préparer un mémoire sur les actes de l’administration du lieutenant-gouverneur Haldimand, qu’il voulait adresser au roi d’Angleterre, C’était peut-être d’une audace qui pouvait lui être funeste ; mais Du Calvet était un de ces hommes qui ne reculent devant rien lorsqu’il s’agit de défendre un patrimoine, un bien, une liberté, des droits qu’ils savent leur avoir été reconnus. Or Du Calvet prenait la défense de la population française du Canada.
Le jeune homme, bel enfant blond, délicat, avec un grand front mat sur lequel la pensée vigoureuse et active posait déjà son empreinte, et des yeux bleus, un peu sombres, au fond desquels se reflétait toute l’énergie farouche du père, étudiait des livres de droit. Après avoir complété à Montréal ses études préliminaires, il allait partir bientôt pour la France et l’Angleterre où il finirait de s’instruire dans les lois.
Du Calvet n’avait pas encore repris son travail interrompu par le repas du midi, que Mme Du Calvet entra à son tour dans la bibliothèque.
C’était une femme d’allure très distinguée, sévère aussi, et également vieillie avant l’âge. De faible constitution, sa santé ne lui avait jamais permis de jouir comme tant d’autres femmes de son monde de la bonne existence que lui avait faite son époux. Maigre et pâle, elle conservait sans cesse un air souffreteux. Son sourire était toujours comme contraint. Sa voix était douce et agréable, ses yeux sans cesse pleins de reflets d’amour pour son enfant et son mari, et son geste était empreint d’une noble simplicité. Sa robe était de velours noir avec des garnitures de soie blanche, et ce noir lui donnait un aspect encore plus sévère.
Du Calvet allait reprendre sa plume lorsque sa femme entra. Il se ravisa aussitôt, se renvoya sur le dossier de son fauteuil, sourit tandis que Mme Du Calvet prenait place dans une chaise-longue non loin de la cheminée, et dit d’une voix plutôt basse :
— Ma chère amie, comme je vous en ai dit un mot à table, je termine ce mémoire, et naturellement, je me demande avec quel esprit il sera reçu par le roi d’Angleterre. Rappelez-vous que j’y expose les grandes lignes d’une constitution civile et toute particulière pour la gouverne de notre pays.
— Cette constitution que vous rêvez, mon ami, est-elle bien contraire aux lois anglaises ? demanda Mme Du Calvet.
— Contraire ?… Non pas, puisqu’elle est calquée sur ces lois mêmes. Mais elle comporte des nuances qui pourraient être mal saisies, en ce sens que cette constitution pourra s’appliquer aux deux éléments étrangers qui composent notre population, et que d’elle pourront dériver des lois susceptibles de s’adapter au caractère de chacun de ces deux éléments.
— Mais ce seront des lois qui ne pourront s’accorder si elles diffèrent dans leur application ; et comment ensuite les appliquer avec justice et discernement à un groupe d’habitants qui vivent sous une même administration ?
— Oh ! j’ai prévu le cas, ma chère amie. Cette constitution ne pourrait être possible et applicable qu’au seul cas où l’on diviserait le pays en deux administrations, ou si vous aimez mieux en deux provinces, dont l’une à majorité anglaise, l’autre à majorité française, et chaque province pourrait, sans s’écarter des principes de la constitution, élaborer et décréter des lois civiles propres au caractère ethnique de chaque groupe. Par là nous ferions disparaître les frictions, les colères et le chaos administratif au sein duquel nous nous débattons sans nous entendre et sans nous comprendre.
— Je découvre votre but, mon ami, sourit Mme Du Calvet.
— N’est-ce pas ?… Vous voyez donc comment il serait possible par une telle constitution de gouverner notre race française par des lois sympathiques à sa mentalité. Nous reviendrions insensiblement aux lois françaises, notre race reprendrait sa vie et sa croissance en poursuivant le cours de ses coutumes, de sa langue, de ses institutions. Cette fois, notre législation nouvelle serait décrétée, non par des étrangers inaptes à connaître notre caractère et nos besoins, mais par des hommes de notre langue et de notre mentalité.
— C’est merveilleux, sourit Mme Du Calvet qui professait pour son mari la plus belle admiration.
— C’est logique, sensé et juste, et vous comprendrez que c’est le plus sûr moyen de préserver la race du contact des étrangers et de lui conserver ses grandes traditions.
— Vous avez parfaitement raison, mon ami.
— Et j’ajoute, poursuivit Du Calvet en s’animant, que ce serait l’unique remède de faire disparaître de notre population française les éléments de discorde qui naissent, et de lui ôter de l’esprit cette idée absurde d’embrasser la cause américaine et d’accepter de vivre sous des lois et un régime pas plus en compatibilité avec son caractère que ne le sont les lois et le régime anglais. Croyez bien que les Canadiens s’imaginent aller à la conquête d’un autre pays, d’une autre terre où ils pensent trouver le bien-être et la sécurité qu’en ce moment ils doutent d’avoir en leur terre canadienne. Mais c’est une grave illusion. Lorsqu’on se donne un maître, on s’attache une chaîne ; il arrive ensuite qu’on ne puisse se dérober aux caprices ou aux fantaisies du maître, et l’on arrive aussi à constater que la chaîne qu’on avait cru fragile ne se brise pas.
Les Américains ont suffisamment démontré, pour que nous voyions clair, aux peuples de la terre qu’ils entendent devenir et demeurer des maîtres chez eux, ce dont nous ne saurions les blâmer ; mais alors que deviendront nos Canadiens ? Observez qu’ils ne seront qu’une poignée, qu’on ménagera beaucoup, si vous voulez, pendant un certain espace de temps, et pour qui on semblera avoir beaucoup de sympathie et d’amitié. Mais viendra le jour où se fera sentir la nécessité de l’unité politique, unité indispensable pour assurer la solidité constitutionnelle de nos voisins, pour fortifier leur industrie, pour étendre leur commerce, pour rendre leur pays puissant et inattaquable. Or, si je vois bien au fond des choses, la construction de l’unité politique ne pourra que faire germer parmi les groupes ethniques des mécontentements, des dissensions, des désaveux, des révoltes. Pourront alors éclater les guerres fratricides, guerre de race, guerre de religion, que pourra suivre ensuite tout un cortège de calamités. L’établissement dans un pays hétérogène de l’unité politique est toujours un problème difficile et fort souvent impossible de solution. Que d’exemples n’avons-nous pas dans les vieux âges ! En plus, pourra aussi surgir chez nos voisins la doctrine de l’unité religieuse. Voilà encore un grave problème que devrait envisager la population canadienne si profondément catholique. Est-ce que nous n’en savons pas quelque chose, nous ? N’avons-nous pas assez souffert, nous protestants, dans notre France où, après la Réforme, l’on voulut rétablir l’unité religieuse ? N’avons-nous pas, pour éviter la persécution, fui notre patrie ? Et remarquez que nous étions chez nous, dans notre pays, dans notre France, et que nous y étions de beaucoup plus forts que ne le seront jamais dans les États voisins nos compatriotes français du Canada.
Voilà donc le terrible danger qu’il importe de prévoir et de prévenir, si nous voulons conserver à la race ce beau pays qui ne cesse de me rappeler la chère France !
Du Calvet s’arrêta pour regarder son fils, qui l’écoutait très attentivement, et lui demander :
— Dis-moi, Louis, si tu ne penses pas de même !
— Mon père, répondit le jeune homme, vous ne pouvez mieux dire. Le grand danger qui menace la race française en ce pays de l’Amérique, alors qu’elle se trouve entourée d’éléments étrangers d’un nombre très supérieur, c’est l’assimilation. Pour nous, au Canada, il n’y aura aucun danger sérieux du moment que nous demeurerons groupés, et ce danger aura disparu presque entièrement le jour où la race française aura reçu une constitution basée sur les principes que vous émettez dans votre projet. Mais pour le groupe canadien actuellement établi en Nouvelle-Angleterre, et pour ceux des nôtres qui seraient tentés de nous abandonner pour fuir une domination étrangère qui leur pèse trop, le danger, tout inapparent qu’il peut être, n’existe pas moins. Si nous basons notre jugement sur les promesses faites et réitérées des envoyés américains, nous pouvons constater que la brioche qu’on nous offre est toute couverte de sucre. Nécessairement viendra le jour où le sucre aura fondu dans les bouches trop hâtives aujourd’hui de se refermer sur l’appât, et ce jour-là la brioche aura séché et se sera aigrie. Malheureusement, on se sera accoutumé peu à peu à mordre dedans, et l’on finira par croire que le pain américain était meilleur que le pain canadien. Et voilà la première étape de l’assimilation.
— C’est bien ainsi que j’appréhende cette étape, dit Du Calvet avec admiration.
— Il est d’autant plus facile pour nous de prévoir et d’appréhender, reprit le jeune homme avec une gravité vraiment impressionnante, que nous avons pour nous guider l’histoire de la fondation et de l’écroulement des grands empires des temps reculés. Prenez Rome, par exemple. Voyons d’abord la fusion des Latins, des Sabins et des Étrusques. Nos voisins n’ont-ils pas commencé par la fusion ? Comptons : les Américains, les Anglais, les Hollandais !… Voilà les maîtres ! Après la fusion les Romains se virent donc des maîtres auprès des petits peuples qui les avoisinaient. Ils fondèrent la république, croyant que cette forme de gouvernement serait plus élastique pour le succès de leurs projets. Ils invitèrent les peuplades voisines à se joindre à eux. Ils usèrent de promesses. On tendit un appât irrésistible. La république grandissait, les maîtres devenaient des puissants, l’ambition se développait. Quelques petites nations refusèrent de se joindre à la belle république ; celle-ci les prit par la force des armes. De ce jour la puissance romaine existait, mais elle manquait encore de solidité à cause de trop de matériaux dissemblables. On songea à l’assimilation, non par la force, mais par la ruse. Les maîtres dirent à leurs subordonnés : — « Ne vous gênez pas, vous êtes dans votre maison » !… Alors les subordonnés demandèrent des droits de céans. Les maîtres se mirent à rire. Les subordonnés s’aperçurent qu’ils n’étaient pas dans leur maison. Donc surgirent les luttes terribles qui ensanglantèrent Rome. Les Plébéiens attaquèrent les Patriciens… Plus tard ceux-ci se rendirent aux revendications de ceux-là. Mais il faut tenir compte que « ceux-là » n’étaient plus ce qu’ils avaient été lors de leur entrée dans la maison républicaine : maintenant ils se proclamaient d’aussi bons romains que les Patriciens : l’assimilation s’était accomplie. Les Américains sont en train de répéter l’histoire romaine : les Patriciens tendent la main aux plébéiens, c’est-à-dire aux Canadiens. Ils disent : « Entrez dans notre maison » ! Les Canadiens entrent, mais ils y sont tout à fait étrangers. Ils se disent : « Nous nous y ferons » !… Oui, mais pour s’y faire il leur faudra bien et nécessairement jouer le rôle des Plébéiens de Rome. Et ce rôle commencera dès que la république voisine aura été reconnue par l’Angleterre. Alors qu’arrivera-t-il ?… Oh ! cela pourra prendre du temps, mais il arrivera que tous les éléments divers et si dissemblables qui serviront à la construction de cette machine et qui en formeront comme l’essieu ne se souviendront plus de leur origine première.
— Et cette machine, demanda Du Calvet excessivement impressionné par le langage pondéré et grave du jeune homme, que penses-tu qu’elle puisse devenir ?
— Votre question nous ramène à l’unité politique, chose que je crois tout à fait imaginaire, du moins en ce qui regarde un pays aussi mélangé d’ingrédients si divers et si variés que l’était Rome. L’assimilation, quoique réussie, ne peut être parfaite. Dans tout corps sociétaire d’apparence solide toujours réside l’individualisme, et cet individualisme représente dans le corps le matériel défectueux. Plus il entre, dans la construction, de ce matériel défectueux, plus le bâtiment penche vers l’écroulement. Il arrive donc, mon père, qu’un jour la machine casse… tel le grand Empire Romain !
— Et tels, ajouta Du Calvet, tous les grands empires composés de matières hétéroclites. Mais alors que deviennent, non les matières premières, mais les matières secondaires ?
— Les Plébéiens, voulez-vous dire ?
— Oui, sourit Du Calvet, c’est une figure que je voulais faire.
— Je vous comprends, sourit également le jeune homme. Les Plébéiens, mon père, se trouvent, le plus souvent jetés à la porte.
— Ils n’ont plus de maison ?
— Ils n’ont plus de patrie. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Où vont-ils ?… Ils l’ignorent. Hier, c’étaient des Romains ; aujourd’hui ils sont devenus peuples errants, inconnus et méprisés. Il leur faudra donc recommencer à se faire une patrie, ils se joindront à d’autres Plébéiens également d’origine inconnue, ou d’origine si lointaine et si vague qu’elle leur paraîtra étrangère. Mais alors ayant perdu toute énergie de race, tout caractère distinctif, ces plébéiens malheureux retomberont sous la main d’un autre maître. C’est ainsi que tant de races et de peuples anciens ont tout à fait disparu et dont il ne nous sera jamais possible de connaître ni l’origine ni l’existence.
— Donc une race meurt ? interrogea Du Calvet.
— Elle est sujette à la mort, mon père. Mais il est certain, tout comme l’individu, qu’une race bien constituée peut vivre plus longtemps qu’une autre race.
— Ainsi donc, par exemple, la race Canadienne, constituée de bons et sains matériaux français, peut vivre longtemps ?
— Aussi longtemps que le monde pourra vivre lui-même ; mais à condition que nous n’allions pas nous jeter dans la lutte contre les Patriciens.
— N’avons-nous pas ici, dans notre Canada, les mêmes luttes à engager ?
— Mais ici, mon père, remarquez-le, nous sommes dans notre maison, et c’est à nous qu’il importe de n’en pas sortir !