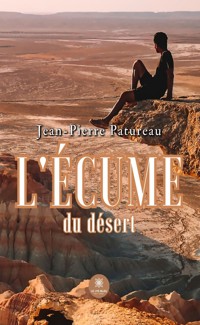Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Bretagne, 1914. Dans un petit village en bordure de l’Odet, un jeune paysan parti à la guerre disparaît, laissant sa fiancée et ses parents désœuvrés. Anna, sa promise, se refuse à croire que son bien-aimé fait partie des milliers de morts victimes de la Grande Guerre. Ferme dans cet espoir, elle est prête à consacrer sa vie à la recherche de son seul amour…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ingénieur de formation,
Jean-Pierre Patureau était consultant en gestion d’entreprise et management lorsqu’en 2016 une rupture d’anévrisme cérébral et un AVC le plongèrent dans le coma pendant près d’un mois. Dès lors lui vint le besoin de rééduquer son cerveau endommagé. Alors, il se mit à l’écriture qui fut sa bouée de secours.
L’espoir est sa première réalisation littéraire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Pierre Patureau
L’espoir
Roman
© Lys Bleu Éditions – Jean-Pierre Patureau
ISBN : 979-10-377-9495-6
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À Edith,
qui m’a aidé à sortir du coma en juin 2016,
me serrant la main ;
À Maryvonne, qui m’a autorisé à lui écrire en 2017,
me permettant de progresser dans l’art de l’écriture ;
À mon meilleur ami, le docteur Jean-Jacques Bus,
ancien chirurgien qui a connu le neurochirurgien,
le docteur Vargas, qui m’a permis de survivre ;
À feu mon père qui m’a donné confiance en moi ;
À tous ceux qui liront ce roman,
m’encourageant à en commettre d’autres.
Toute la sagesse humaine
Se résume en deux mots :
Attendre et Espérer.
A. Dumas Père
Prologue
Note à l’attention des lecteurs
Ce récit se déroule à Plomelin, village breton en pays de Cornouaille, proche de la mer, à à peine dix kilomètres au sud de Quimper. Tous les personnages intervenant ici sont fictifs et émanent de la pure imagination de l’auteur, mis à part :
Toutefois, nous pourrions dire qu’Anna, l’héroïne principale, est le modèle de plusieurs milliers de jeunes femmes qui ont vécu et survécu à la Grande Guerre, dans des conditions de vie paysanne et avec ce singulier mélange d’attente, de détresse et d’espoir.
Les parents, Marie-Jeanne et Eugène, l’instituteur Pierre, les garçons de ferme, Erwan et Lucien, le cultivateur Mahé, le négociant, Jaouen, sont aussi des modèles de ces braves gens qui vécurent ces périodes troublées. Finalement, tous ces personnages ont existé. Nous ne faisons que révéler leur anonymat, ici, même celui de Jean, le personnage disparu et tant aimé dans cette histoire…
I
L’annonce
Le front, mardi 29 octobre 1918
Ma petite Anna chérie,
C’est un homme soldat qui t’écrit, témoin de la barbarie de la guerre, et très malheureux de ne pas t’avoir pris dans ses bras depuis bien si longtemps.
Ce soldat ne sait pas où il puise ses ressources pour t’écrire, tant le désespoir l’a accompagné ces dernières semaines. Bien souvent, nous, pauvres soldats, glissons dans le désespoir le plus sombre. Toutefois, le désespoir nous invite à faire renaître les jours anciens. Le désespoir est le témoignage que nous sommes encore en vie, tant de nos compagnons n’ont pas eu cette chance. Souvent, nous nous posons la question : demain lesquels d’entre nous seront-ils encore en vie ? Serais-je moi-même encore en vie ? Je n’ai pas vu Alibert aujourd’hui, ni Jean, ni Louis, que sont-ils devenus ? Chacun de mes compagnons dans ce guêpier sait qu’il peut mourir demain, sans savoir pourquoi véritablement ? Oui, la mort surveille ses proies sur nos champs de bataille, elle recherche les âmes qui viendront nourrir le sel de la terre et enrichir l’esprit des vivants. Sur tous les champs de bataille, dans les tranchées, dans les fortifications, dans nos abris, nos casemates, la mort se manifeste en une onde légère qui accable et noircit notre imagination, mais nous rappelle que nous sommes en vie, cependant, sous surveillance, comme si nous étions sous tutelle, et en sursis. Alors j’étouffe en mon cœur la voix pernicieuse qui me rappelle que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Bien mieux que l’arithmétique, que l’histoire et la géographie, la guerre nous enseigne ce qu’est la vie bien que paradoxalement, la guerre diffuse avant tout la mort. Mais singulièrement, elle nous apprend surtout comme la vie est cruelle.
Pourtant, crois comme la délicatesse de ce moment que je partage avec toi remplit mon cœur de douceur.
Cet hiver de 1918, que nous craignons si pénible, ne s’est pas encore manifesté avec une plus grande cruauté que celle à laquelle nous expose la guerre. Nous avons eu de belles journées en octobre, prolongées par de magnifiques crépuscules. À la place du soleil disparu s’éternisaient des nuages d’or d’une pureté et d’une délicatesse sans égales. Des nuées de passereaux printaniers, chardonnerets, fauvettes sont venues nous saluer tous les jours, mais aussi de funèbres pèlerins des mers arctiques, les cygnes noirs. Qui dit cygnes noirs, selon la légende, ici, dit neige et tempête.
Et puis, tu sais, Anna chérie, souvent je pense aux chênes merveilleux qui bordent l’Odet, parce que je n’ai devant moi que des arbres dénudés qui étalent leurs moignons à vif, tout hachés de mitraille.
Je ne veux pas t’alarmer, ma chère Anna, et je dois te dire que je ressens qu’un esprit, un souffle étrange, une âme mystérieuse me donne l’espoir de te retrouver, avec certitude, avec une mystérieuse et généreuse certitude. Je veux que mon passage sur cette terre serve à quelque chose et t’apporte le bonheur que je croyais t’avoir apporté le jour où je t’ai rencontrée à l’orphelinat de Quimper, alors que je cherchais une employée pour la ferme, chère Anna.
Des bruits courent que l’armistice est proche. Le commandant Le Goff nous a dit que la mobilisation se ferait avant la Noël. La deuxième division américaine, depuis la bataille du bois de Belleau, nous avait redonné espoir. Au moment où je t’écris, l’espoir a revêtu des yeux câlins et je me vois enfin te serrer à nouveau dans mes bras et nous promener ensemble, main dans la main, tout le long de l’Odet et dévorer du regard les beaux arbres vivants.
Comme la pensée et le souvenir de ta main dans la mienne me donnent une saveur d’humanité, ce qui nous manque, pauvres misérables soldats, et un appétit de bonté et de bonheur, Anna chérie.
Tu m’écris dans ta dernière lettre que les parents sont bien fatigués à la ferme. Heureusement que tu les soutiens avec ton cœur et ton courage, car je sais que ma pauvre sœur Lucienne a d’autres préoccupations avec les garçons de la ville.
C’est, j’espère, ma dernière lettre avant mon retour. La prochaine fois que tu prendras connaissance de mes nouvelles, ce sera de ma propre voix en posant tes lèvres sur les miennes, Anna chérie. Prends soin de mes parents et transmets-leur toute l’affection qu’un fils peut abandonner à ses parents. Je sais que tu sauras leur transmettre l’émotion et le bel enthousiasme qui gonfle mon cœur, à la pensée de vous retrouver, Anna chérie. Quant à toi, sois heureuse, dans quelques semaines ce sera à moi de prendre soin de toi, pour toujours.
Ton Jean qui t’aime
La ferme était calme quand Anna lut cette courte lettre le mardi 5 novembre 1918. C’était une modeste ferme bretonne du village de Plomelin dans le Finistère, tout proche de la rivière l’Odet en pays de Cornouaille, à peine à dix kilomètres au sud de Quimper. La ferme avait été bâtie comme beaucoup de longères bretonnes. Un long bâtiment de granit abritait la quiétude de ses hôtes dans la pièce principale. À la gauche de la porte d’entrée, un évier de pierre invitait les paysans à se laver les mains dès leur arrivée. Une large et profonde cheminée les accueillait sur le devant. Cette pièce était meublée d’une longue table en chêne massif, au beau milieu, et contre les murs blanchis à la chaux, un pétrin et un vaisselier garni d’assiettes en faïence « Henriot » de Quimper. À sa droite, un fourneau en fonte restait allumé toute la journée. Dans le fond, à droite, deux chambres avaient été ménagées peu avant la guerre. L’une était occupée par le père Eugène et la mère Marie-Jeanne, spacieuse, et l’autre par Jean, plus modeste. Derrière le mur des deux chambres, se trouvaient une étable pour les deux vaches et, séparée d’une cloison de bois, une autre étable pour le percheron. Enfin, séparée encore d’une mince cloison avait été rajoutée la chambre d’Erwan et Lucien, les deux garçons de ferme, qui venaient de l’orphelinat public de Quimper. La chambre était meublée de pauvres lits garnis de sacs remplis de paille, d’une modeste armoire en pin et d’un prie-Dieu. Un petit escalier extérieur en bois, attenant à la pièce principale, permettait d’accéder à l’étage où la chambre de Lucienne avait été aménagée, contiguë au grenier dans lequel le foin était remisé. Quelques années avant son départ à la guerre, Jean avait aidé le père pour remplacer le chaume sur le toit, par de l’ardoise du pays au teint bleuté.
Jean était le fils aîné. Il avait passé son certificat d’études brillamment et l’instituteur, monsieur Le Guen, voulait que ses parents l’inscrivent au lycée de Quimper. Mais la ferme avait plus besoin de bras que de cerveaux, d’autant qu’il en deviendrait le maître au décès de son père, le plus tard possible, aimait dire Jean. Puis la guerre l’avait happé en 1914 à dix-huit ans, comme presque tous les hommes valides de ce petit village de deux mille âmes à peine.
Anna avait fort à faire avec l’absence de Jean. Elle entretenait seule au quotidien la porcherie, avec sa vingtaine de porcs, dont les cinq truies. Du haut de son petit mètre cinquante-cinq ou cinquante-huit, pas plus, elle prenait soin de ces animaux à tous les stades de leur développement : le naissage, le sevrage et l’engraissement. Il y avait aussi le linge à laver, chaque lundi, au lavoir de Lestremeur et les vêtements de chacun à entretenir, à rapiécer, à repriser (heureusement, avec l’aide de la mère Marie-Jeanne). Au quotidien, il fallait préparer les repas de la ferme pour les parents, la sœur Lucienne, les deux garçons de fermes, Erwan et Lucien, ainsi que pour les journaliers qui cultivaient le blé noir dont la récolte venait de prendre fin, en octobre. Le soir, il fallait aider à la traite des vaches et à la vente du lait aux habitants du village. La ferme avait aussi un petit élevage de poules et de lapins. Et puis il y avait la culture des pommiers à cidre, sur une étendue de deux hectares. La cueillette avait pris fin la dernière semaine de septembre. Depuis l’absence de Jean, Anna était chargée du lavage, du broyage, du pressage, de la mise en fût, de la mise en bouteille et du négoce. Lucienne qui avait dix-sept ans ne participait pas aux travaux. Jean manquait terriblement à la ferme et tout autant à Anna.
Ils se marieront à l’été prochain, quand les premières traces de la guerre auront été effacées. Les premières, celles qui sont en surface, parce que l’on sait avec les courriers des soldats de Plomelin qu’il faudra des années, peut-être une génération pour regarder de nouveau le ciel merveilleux de la Bretagne avec des yeux asséchés. Et puis l’on sait aussi que plus de cent dix hommes de la commune ne reviendraient pas. Et puis il y a ceux qui reviendront de la guerre, mais qui ne pourront plus cultiver la terre.
Anna souhaitait, grâce à cette lettre de Jean, qu’il revienne sain et sauf. Elle n’espérait plus que cela. Peu importaient les journées de travail qui durent quatorze heures si son Jean revient en entier.
Anna avait attendu le soir, après tous les travaux, pour relire la lettre de Jean. Elle y mit beaucoup de peine, mais y trouva un grand réconfort. Elle lisait à la lueur de la mince bougie, dans la chambre de Jean qu’elle occupait en son absence. C’était une modeste, mais jolie chambre, attenante à la pièce principale de la maison de granit. De la petite fenêtre, Anna pouvait contempler un verger magnifique et un séquoia centenaire. Sous la fenêtre, les magnolias aux couleurs rouge-rubis n’avaient jamais manqué une floraison depuis qu’elle était à la ferme.
Anna était orpheline. Elle avait été placée dès ses 13 ans à la ferme et l’instruction qu’elle possédait avait été assurée par l’orphelinat, c’est-à-dire l’instruction du cœur, la générosité, la probité, la droiture, l’honnêteté, la loyauté, la sincérité, le dévouement. Mais elle connaissait peu de choses apprises par les livres parce qu’il n’y avait pas de livre à l’orphelinat. Ce qu’elle connaissait des livres, ce sont les récits de Jean, le soir, après les champs, quand ils se retrouvaient seuls. Il aimait lire près de la cheminée allumée, fumant la pipe, avec Anna à ses côtés qui tricotait. Anna se plaçait tout près et vivait dans le regard de Jean les émotions du récit. Parfois, il lisait à voix haute. Le reste du temps, elle s’émerveillait dans les yeux de Jean, en minaudant des petits regards furtifs.
Anna décryptait plus qu’elle ne lisait et ne savait pratiquement pas écrire. Toutes les lettres qu’elle avait envoyées à Jean avaient été rédigées avec l’aide de l’instituteur, le gentil monsieur Pierre qu’elle irait voir demain matin avant l’école pour lui demander une fois encore son aide.
En effet, le vendredi 6 très tôt, avant le début de la classe, elle attendait Monsieur Pierre sous le préau de l’école.
Bonjour, Anna, je crois deviner la raison de ta visite, dit-il, sur un ton affable. Voilà plus d’un mois que tu n’as pas écrit à Jean, n’est-ce pas vrai Anna ?
Il avait le même âge qu’Anna, vingt-deux ans. C’était son premier poste d’instituteur, lui le Parisien. De belle allure, mesurant dans les un mètre soixante-dix comme Jean, il était solide et fier. Il avait toutefois été réformé à cause d’une maladie aux poumons. Il était arrivé il y a deux ans avec une petite valise et l’ambition de transmettre à ce village breton ce que l’instruction lui avait apporté de plus précieux : la liberté.
Oui, monsieur Pierre, vous le savez, comme d’habitude, je suis tellement confuse, dit-elle.
Il ne faut pas Anna, répondit Pierre. Tu sais bien que je t’ai proposé moi-même cette aide. À ce que m’en a dit monsieur Le Guen, mon prédécesseur, Jean était l’élève le plus brillant du canton. Avec l’instruction qu’il a, c’est lui qui devrait faire l’école ici.
Merci, monsieur Pierre, mais je suis si confuse une fois encore, dit-elle.
Anna lui dicta une lettre empreinte de gentillesse, mais de beaucoup de pudeur concernant ses sentiments. Pierre rendait les tournures de phrase plus jolies.
Anna dicta :
Mon Jean adoré,
Je suis désemparée d’avoir si peu d’instruction. Tu m’as proposé cent fois de m’apprendre à écrire. Tu me disais souvent « l’apprentissage de la vie commence avec l’apprentissage de la lecture et de l’écriture ». Je ne pensais pas que le destin me mettrait à si lourde épreuve, un jour, et dévoilerait autant mon ignorance. Je bénis ton retour pour ne plus avoir à me montrer aussi sotte devant toi et monsieur Pierre.
Quand tu reviendras, tu verras tes pauvres parents bien changés. Tu ne devras pas t’inquiéter, c’est ton absence qui les fait vieillir. Ta présence sera le meilleur remède et dès janvier, nous mettrons en bouteille le cidre avec le père et la mère. L’été a été chaud et la récolte qui a pris fin il y a un mois est très abondante. Tu pourras t’enivrer de chouchen pendant que je me griserai de ta présence, je m’étourdirai à t’écouter me raconter ta guerre et tu seras témoin du sinistre naufrage de mon cœur pris dans la tempête causée par ton retour.
Ta sœur est insouciante, c’est ce qui la protège de notre mal à tes parents et à moi : le manque de toi.
Je pourrais dicter à monsieur Pierre des heures durant le besoin que j’ai de te revoir, cette attente qui fait que pas une seconde n’est pas imprégnée de toi, mais je ne peux abuser plus longtemps de sa gentillesse. Quand tu seras là, je te promets d’écouter tes leçons d’écriture pour que plus jamais je sois obligée de mendier pour te dire comme tu me manques, d’ailleurs tu ne me manqueras plus jamais.
Prends soin de toi, le peu de temps que tu es encore loin de moi. Ensuite, c’est moi qui prendrais soin de toi, pour toujours.
Ton Anna qui t’attend et qui t’aime
Ce sera la dernière lettre, se disait-elle, et bientôt elle pourra prouver ses sentiments à Jean autrement que par le truchement de monsieur Pierre, à partir de phrases maladroites et pudiques.
L’instituteur avait apporté plusieurs touches personnelles pour que Jean ressente profondément la tendresse et l’amour de sa chère Anna. Il demanda à Anna de signer de son prénom, avec des caractères qui ressemblaient à des barres, et mit la lettre dans une enveloppe qu’il sortit du tiroir de son bureau.
La lettre d’Anna était partie le samedi 7 novembre au matin, quand Fernand, le facteur du village, était venu donner des nouvelles rassurantes du front. Jean devrait la recevoir le jeudi 12 ou vendredi 13 novembre. Partout dans le village, on annonçait la fin de la guerre. On disait même que l’armistice serait signé le 11 novembre. Anna se languissait de retrouver son Jean. Elle trouvait dans l’attente toute la force et le courage qui étaient nécessaires à son dur labeur. Quand la bruine estompait l’horizon, les nuages bas laissaient filtrer des rais de lumière dorée dans lesquels Anna semblait lire l’annonce du retour de son homme. Le village de Plomelin se préparait au retour des vainqueurs. Les femmes avaient ressorti leur tricot et le soir à la veillée, elles confectionnaient des napperons, des gilets et des gants au point d’Irlande. Le fond du tricot était picoté d’arceaux illustrés d’étoiles, de fleurs, de roues et de roses. Pour certaines, les plus démunies, le picot bigouden était réalisé au crochet. Un fil très fin et un cordon devenaient dans les mains de ces femmes avec l’aide d’un crochet une véritable œuvre d’art. Tous les jours, dans le ciel, on entendait les cris des mouettes qui descendaient de l’Odet pour rejoindre à Bénodet l’ouverture sur l’Océan. Souvent elles faisaient un détour dans les terres et clamaient haut et fort le retour de la paix. L’instituteur du village disait même qu’il fallait voir dans le vol de ces mouettes celui de la colombe qui avait annoncé à Noé, un rameau d’olivier dans le bec, la décrue des eaux. Anna était enfin de nouveau heureuse. Elle avait ressorti son costume de fête, avec un tablier bleu, celui qu’aimait Jean. Elle ne portait pas la coiffe « Borledenn », cette modeste coiffe, si éloignée de la Quimpéroise haute de plus de trente centimètres, en forme de cheminée. La Borledenn à bord plat était constituée de trois pièces en filet brodé et de satin dont les grandes ailes tombent latéralement encadrant les côtés du visage.