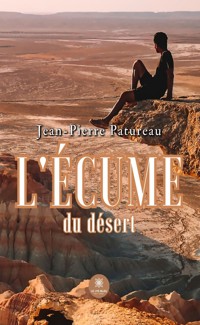
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Un instituteur parisien vivant en Somalie est appelé à faire un don de sang pour sauver la vie d’un jeune garçon somali. De manière inexplicable, après la transfusion, sa peau autrefois blanche devient noire. Ce changement étonnant entraîne une série d’événements tumultueux qui le conduit derrière les barreaux et le condamne à une fin tragique. Parviendra-t-il à échapper à ce sombre destin ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ingénieur de formation, Jean-Pierre Patureau était consultant en gestion d’entreprise et management lorsqu’en 2016 une rupture d’anévrisme cérébral et un AVC le plongèrent dans le coma pendant près d’un mois. Dès lors lui vint le besoin de rééduquer son cerveau endommagé. Alors, il se mit à l’écriture qui fut sa bouée de secours. "L’écume du désert" est sa seconde production littéraire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Pierre Patureau
L’écume du désert
Roman
© Lys Bleu Éditions – Jean-Pierre Patureau
ISBN : 979-10-377-9899-2
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À Edith,
qui m’a aidé à sortir du coma en juin 2016,
me serrant la main ;
À Maryvonne, qui m’a autorisé à lui écrire en 2017,
me permettant de progresser dans l’art de l’écriture ;
À mon meilleur ami, le docteur Jean-Jacques Bus,
ancien chirurgien qui a connu le neurochirurgien,
le docteur Vargas, qui m’a permis de survivre ;
À feu mon père qui m’a donné confiance en moi ;
À tous ceux qui liront ce roman,
m’encourageant à en commettre d’autres.
La sagesse ne convient pas en toute occasion ; il faut quelquefois être un peu fou avec les fous.
Ménandre
Prologue
L’histoire que je vais vous raconter est étonnante. Elle s’est produite il y a plus de cinquante ans dans un des pays les plus beaux et les plus cruels de la planète, là où la vie a pris sa source il y a si longtemps que, souillée par les hommes et oubliée par le temps, la source s’est tarie.
Dans ce pays, les désillusions des hommes ont rempli les lacs de larmes au goût tellement amer qu’ils sont aujourd’hui asséchés. La lumière du jour se noie dans un désert brûlant. Les paysages de pierres noircies préfigurent l’enfer. C’est là que l’Afrique a placé une corne abondante de misère : la Somalie.
Alain fut le héros de cette histoire, bien malgré lui. Bien des sons l’interpellent encore. Si un écho résonne en vous, répondez-lui, car toute ressemblance avec des personnages qui auraient existé ne serait pas fortuite, pour chacun qui s’y reconnaîtrait.
Selon que vous soyez un peu cartésien, de nature logique ou au contraire un familier du rêve, arrêtez-vous un instant avec notre héros. Son histoire aurait pu vous arriver. Lui, c’est vous, c’est moi !
Alors, embarquez, un moment, fermez les yeux et suivez le chemin où les étoiles embrasent le désert.
« Une journée nouvelle sortait de la nuit. Elle cachait encore un peu de timidité sous des aspects brumeux. Mais bientôt, quand la clarté sera totale, le jour sera moins câlin. Alain aura quitté cette plage où il s’était endormi, hier au soir, noyé de sommeil.
La plage est perdue à un de ces bouts du monde où les hommes ne se rendent que par hasard.
Elle est suspendue à la corne de l’Afrique sur une terre où ne poussent que la grisaille et la poussière, sur fond de misère et coloris de tristesse.
Ici la vie, après y avoir trouvé son origine, s’est mise en sommeil. Curieusement le nom de ce pays est proche du mot sommeil : la Somalie. »
Le réveil
Djibouti, le 2 février 1970
Une journée nouvelle sortait de la nuit. Elle cachait encore un peu de timidité sous des aspects brumeux. Mais bientôt, quand la clarté sera totale, le jour sera moins câlin. Alain aura quitté cette plage où il s’était endormi, hier au soir, noyé de sommeil.
La plage est perdue à un de ces bouts du monde où les hommes ne se rendent que par hasard.
Elle est suspendue à la corne de l’Afrique sur une terre où ne poussent que la grisaille et la poussière, sur fond de misère et coloris de tristesse.
Ici la vie, après y avoir trouvé son origine, s’est mise en sommeil. Oui, curieusement, le nom de ce pays est proche du mot sommeil : la Somalie.
Ici c’est le reste du monde, le monde de l’oubli dans un climat cruel, inhumain, hostile à tout ce qui est étranger. Ici les horloges ne tournent pas comme ailleurs. Le jour se lève aussi vite qu’il se couche. Dès quatre heures du matin, la lumière crève le ciel et la chaleur descend, comme une couverture, légère.
Alain se sentait encore empli de son somme, les yeux mi-clos, la peau marquée, tirée, les vêtements froissés.
Il besognait d’abord à retirer le sable qu’il avait dans la bouche et sur tout le visage, puis il se levait s’étirant et entreprit de marcher le long du rivage silencieux avant de rentrer chez lui.
La mer bruissait lentement. À chaque son, une écume nouvelle se frottait sur le sol pour le protéger du soleil qui bientôt le rendrait brûlant. Le sable était blanc et léger. Ses pieds encore peu assurés, Alain marchait à tâtons.
La plage s’étendait comme un drap agité par les tourments de la nuit. Des plis soulignaient les frissons du vent nocturne que la mer avait avalés. L’horizon se dévoilait sous un halo de lumière. Les yeux d’Alain s’ouvraient au jour.
Mal à l’aise au début, il s’habituait vite et découvrit le plaisir de laisser le poids de son corps s’enfoncer sur la grève, songeant qu’elle était à même d’amortir tous les fardeaux du monde.
Il se laissait aller ainsi, occupé simplement à suivre du regard les maisons jaunes ou orange de la ville vers lesquelles ses pas le menaient.
L’air était un mélange d’eau et de poix que le soleil commençait à réchauffer. L’envie de se laver à l’eau douce lui fit presser le pas.
Il lui restait plus de trois heures avant de se rendre à l’école. Il préférait traverser la ville à pied et sentir la fraîcheur que les pierres des maisons avaient pu garder de la nuit.
Du haut du minaret, le muezzin appelait à la prière. En même temps la foule commençait à s’agiter dans la ville. Elle venait de toutes parts, encore muette. La rue se coloriait, elle prenait vie.
Alain traversait la place du marché où étaient posés à même le sol tous les fruits de ce beau pays d’Afrique. Des fruits rouges, jaunes, oranges qui déclinaient chacun la couleur du soleil. La place inondée de lumière suait de tous les parfums exotiques. Un sublime mélange d’arachides et de primeurs colorait la lumière du jour. La place était immense, à même le ciel dans lequel piquait la tour de la mosquée. Les odeurs des fruits s’évaporaient dans l’air encore frais et vagabond. Des saveurs étonnantes inondaient les sens. La joie s’installait au gré d’aromates, d’essences, d’effluves, d’exhalaisons, de bouquets ou de senteurs sauvages.
Les femmes aux vêtements amples s’affairaient, des femmes fortes, bien en chair, au sourire large, trimballant un lot de bijoux nacrés, dorés, brillant et tintant. Les hommes allaient à la prière.
L’immeuble où habitait Alain était situé dans une petite rue commerçante de la ville, entre un marchand de « hi-fi » et un autre marchand de « hi-fi » et face à un autre marchand de « hi-fi ».
Isolée, à quelques mètres, une maison hindoue avait ouvert un commerce de confection ; puis plus loin, un épicier, dont Alain ne se souvient pas avoir vu la boutique fermée. L’épicier faisait rêver avec ses étalages de conserves datant d’une autre époque, mélangées aux boîtes de Coca-Cola et de Fanta orange.
Alain monta les deux étages sans éclairer les murs dont la peinture écaillait sa misère. Il ouvrit la porte qui n’était pas fermée à clef. Une chaleur moite avait corrompu l’odeur du matin frêle. Il entrouvrit la fenêtre de la pièce, poussa un rideau qui séparait simplement la chambre de la cuisine et s’assit dans un fauteuil de rotin. Il se sentait mal à l’aise dans ses vêtements froissés de la nuit. Il se dépêcha de les ôter.
Devant lui, sur un petit meuble de bois, la photo de son amie Perla le regardait. Il lui sourit, laissant poindre sa tendresse.
Perla, c’est son univers à lui comme chante Brel. Perla, c’est aussi son oxygène, c’est aussi son ciel étoilé, aussi son sentier d’insouciance, son océan de quiétude, son chemin lumineux, son verger de bonheur, sa réserve de joies, son puits d’espérance. Perla, c’est aussi tout cela et il ne saura jamais expliquer pourquoi il l’aime autant. Cela a commencé un jour d’octobre, comme une vraie révolution d’où naquit en lui ce sentiment délicieux.
Perla, c’est plus que toutes les jeunes femmes qu’il avait rencontrées, c’est la grâce en image, c’est le modèle de ce qui est beau, et qu’on ne connaît qu’en rêve. C’est le modèle de ce qui est bon et que l’on imagine à peine, c’est l’esquisse du monde meilleur, du monde plus beau. Perla, c’est un ange de contes de fées. C’est un ange, ni femme, ni enfant, ni mère, ni maîtresse, béni d’aucun Dieu, mais qui rassemble les éclats du soleil, les silences de la lune, la douceur des songes, la beauté des fleurs, les fleurs de la vie, leurs parfums, le rêve qu’elles évoquent, la quiétude qu’elles diffusent.
La douche, puis le café ravigotèrent Alain. Il enfila des vêtements propres et se dépêcha de corriger les copies de ses élèves avant de rejoindre l’école.
Quand il redescendit deux heures plus tard, la ville avait changé. Elle avait retrouvé son lot de commerçants et de mendiants.
Djibout, comme prononcent les autochtones, change à chaque instant.
Sa lumière varie du lever du jour au coucher du soleil, plus intense, plus violente, puis douce reposante et complice de la lune pour s’éteindre quand l’astre paraît.
Les odeurs se déplacent à mesure que le soleil réchauffe les rues, jusqu’au soir où la brise de nuit aspire le dernier relent.
Alain profitait de l’atmosphère nouvelle du petit matin quand seuls les commerçants ont gardé leur allure de la veille.
Son premier marchand du jour était Saïd, un petit cireur de chaussures qui l’attendait tous les matins et le suivait au bar de « l’Éthiopie » où ils prenaient leur croissant et chocolat chaud.
Ce matin, il eut bien du mal à trouver les mots familiers et les phrases toutes faites du point du jour.
La petite bouille ronde de Saïd gardait néanmoins un large sourire et sans rien se dire, ils convinrent d’un simple regard de se retrouver le lendemain matin.
Alain devait traverser la ville lentement pour se rendre à l’école, non pas que sa vieille 2CV fût poussive, mais afin d’éviter tous les dix mètres une chèvre ou un mouton qui, sans grande délectation, lui semblait-il, broutait les boîtes de carton que la nature avaricieuse laissait en pâture. Les chèvres et les cartons faisaient partie du décor. Inconsciemment, ils convenaient à la ville, à son image et à sa culture.
Alain prévoyait bien ces arrêts, mais ne parvenait pas toujours à être ponctuel, ce qui réjouissait ses élèves, surtout les retardataires qu’il croisait et qui faisaient le plein d’énergie, en jetant à coups de pied des boîtes de carton sur la chaussée.
Laurent Saïd Dirie, le directeur de l’école, avait fait installer, depuis peu, une sonnerie qui retentit quand il gara sa voiture près des baraquements de tôles assemblées sur des piliers de bois vermoulu. L’école était ainsi bâtie de bric et de broc, de ce dont les garnisons militaires et les administrations environnantes se débarrassaient, de planches trouées, de panneaux gondolés, de métaux vieillis, de caisses vides, de bancs rapportés des écoles désaffectées et de tableaux plus très noirs tant les termites y avaient goûté. Elle se mêlait à la couleur locale des pauvres habitations construites à même le sol terreux, dans ce pays qui préfigure l’enfer.
L’arrivée à l’école
— Bonjour.
Un brouhaha sourd et continu lui répondit.
À part les enfants du premier rang, qu’Alain entendit lui rendre le bonjour, l’ensemble des élèves, une cinquantaine selon les jours, dans une pièce devant en contenir à peine la moitié, étaient occupés à parler et à chahuter.
Les discussions du second rang étaient toujours sérieuses. Mais dès le troisième, c’était chahut, bagarre, cris, cela jusqu’au septième.
La salle était petite et les pupitres en bois comme ceux de son enfance, serrés de près, étaient posés à même le sol terreux, dur et noir. Un large ventilateur accroché au plafond brassait toujours le même air vicié avec un grincement de moulin à café.
Le pitoyable bureau d’Alain, vermoulu, n’était pas épargné par la poussière que le ventilateur redistribuait à chaque coup de pale. Il y posa malgré tout les copies qu’il avait apportées. Elles déplacèrent un épais nuage.
Tout l’air était gris. Comme la grisaille de la couleur des murs de la pièce, des murs de bois troués en beaucoup d’endroits d’où quelques mères surveillaient, chaque jour, leurs enfants ; les filles surtout.
Les filles rassemblées au premier rang ne participaient pas au bruit. Leur visage doux était reposant pour Alain.
Il s’assit pour attendre le silence ; selon les jours, il mettait deux à trois minutes à s’installer.
Les filles souriaient, amusées du rapport de force établi tous les matins entre les bruiteurs et l’instituteur. Elles savaient que le chahut finirait par cesser net, lassé de ne trouver aucun obstacle. Le ventilateur se mettrait alors à larmoyer.
En fait, ce fut le directeur qui provoqua le silence en entrant brusquement, comme à son habitude.
— Bonjour, Alain.
— Bonjour, Laurent.
— Tiens, dit-il, une convocation du service d’hygiène de la ville qui te demande de bien vouloir te rendre à l’hôpital cet après-midi pour donner ton sang.
Doté d’un rhésus O négatif, c’est-à-dire donneur universel, il lui était déjà arrivé d’être convoqué de la sorte.
Il prit le papier et le glissa dans sa poche.
Dès que Laurent referma la porte, le bruit reprit comme s’il devait être un fond naturel à la classe.
— Bon, ça suffit ou on fait une dictée.
Cette phrase avait un pouvoir magique qu’Alain utilisait souvent.
Malgré le silence qui tomba aussitôt, il décida que la dictée serait faite.
Comme tous les maîtres d’école du monde, il arpentait les rangées. Il ne lui fallait que quelques enjambées pour se rendre du premier au dernier rang. Au fond, à droite du mur, un grand trou s’ouvrait sur la classe voisine. Ce n’était pas une fenêtre, mais un trou tout simplement qui devait s’agrandir d’année en année grâce à la malice des écoliers et la complicité des instituteurs. De ce trou apparaissait souvent en relief une tête rieuse qui animait joyeusement avec une allure de bouffon le décor triste du mur décati.
La matinée passa très vite. La sonnerie ranima le chahut qu’Alain laissa évacuer en rangeant son bureau.
Dehors, Perla l’attendait. Son teint prêté aux délices et aux caprices de l’air du temps faisait de son visage un précieux témoin de sa pensée où toutes les émotions graves ou heureuses qui la traversaient s’exprimaient comme des notes de musique.
Elle était vêtue, comme à son habitude de vêtements légers et sombres sur lesquels pendaient, mi-longs, ses cheveux souples et bruns.
Il lui sourit en la voyant. C’était devenu un réflexe.
— Bonjour, toi.
— Bonjour.
— On va manger vite fait chez Ali, je dois passer à l’hôpital donner mon sang.
— Non, j’ai pris deux serviettes, je voudrais aller me baigner.
— Maintenant ? À cette heure-ci, en plein soleil ?
— Eh bien, ça rendra ton sang plus liquide, ironisa Perla.
En riant, il lui prit la main et l’entraîna en courant vers la voiture.
— De toute façon avec cette chaleur, on n’a pas très faim. On achètera des mangues sur la plage avec un coca ; veux-tu, Alain ? Mais dis-moi, tu me parais fatigué ?
— Je ne sais pas ce qu’il m’est arrivé cette nuit j’ai très mal dormi, j’ai eu des sueurs, j’ai fait des cauchemars. Je fais souvent ce rêve étrange, ce trou noir dans lequel je plonge. Je dois être trop fatigué. Je me reposerai sur le sable.
Quelques minutes plus tard, ils se laissaient bercer par une onde vertueuse, allongés sur le sable de la plage, le corps insouciant enivré des senteurs marines.
Le soleil tapait fort, dans cette mer aux fonds si généreux. La plage était calme, presque déserte, offerte à tous les deux.
Alain allait s’endormir, quand Perla lui aspergea le visage d’eau salée qui lui piqua les lèvres et ce qui le fit bondir dans la mer où il nagea longtemps.
L’eau était chaude et caressante. Alain se laissait reposer sur la crête, prêtant son flanc au soleil qui avait participé à la création de cette étonnante partie du monde. C’est du moins ainsi qu’Alain le concevait, charmé par la mer Rouge où se côtoient les effets les plus énigmatiques de la planète.
Sur ce territoire du bout du monde, le rouge et le noir intriguent, le soleil et la nuit ourdissent, l’eau et le feu conspirent. Tout ce qui est étranger se sent ennemi et admirateur à la fois. En ce moment même, Alain était pris entre l’admiration et la peur, le vertige et l’émerveillement, l’ivresse et la solitude de ce voyage au bout du monde.
La mer, en silence, le portait sur ses flots dociles pendant que la brise, infime, transportait ses pensées. La mer chaude effaçait ses fatigues et le soleil rouge nourrissait son corps.
À son retour Perla avait acheté deux mangues et deux boîtes de Coca-Cola fraîches qu’ils consommèrent, détendus.
Une heure s’était presque écoulée sans qu’ils eussent à se parler.
Ils restaient souvent de longs moments, ainsi, sans subir le temps qui passe érodant chaque seconde un peu de la mémoire des gens, mais pas celle de Perla et d’Alain qui se construit d’un souffle, d’une poussière de vie. Le silence de ces deux-là en disait plus que les plus belles déclarations de George Sand et de Musset. Le silence n’est pas un signe de fuite ou d’ennui ; c’est souvent une profonde marque de respect, pensait Alain. D’ailleurs Alain répétait souvent à Perla cette phrase de Musset à George Sand « l’absence ni le temps ne sont rien quand on s’aime ».
Avec Perla, Alain n’avait jamais ressenti l’ennui. Le temps, au contraire, passait très vite. Après des moments de grand silence, il pouvait toujours reconstituer chaque miette du temps écoulé sans en oublier une, si Perla le lui demandait. Il pouvait vivifier ce que les gens appellent le temps mort, l’embellir, lui trouver un écho, une lueur même qu’il justifiait dans l’éclat que Perla donnait à toute chose : à sa vie surtout. L’absence ni le temps ne sont rien quand on aime.
Il lui avait dit une fois :
— Tu sais, l’expression « entre nous ; entre nous c’est beau ; entre nous c’est bien, etc. » je ne conçois pas cette expression dans notre cas. Elle n’aurait pas de sens, car entre toi et moi il y a nous qui remplit tout. L’espace est une notion physique qui n’a pas le même sens au plan philosophique. Et je suis certain que l’espace se rétrécit ou s’écarte d’une personne à l’autre. Entre toi et moi, il ne reste plus d’espace, parfois même plus pour respirer.
Alain aurait pu profiter longtemps de ce bien-être, les yeux égarés sur les ondoiements de l’eau quand Perla lui demanda ce qu’il faisait ce soir.
Ils se connaissaient depuis six mois à la suite d’une rencontre furtive au croisement d’une rue. Les croisements de rues sont souvent les lieux que le destin choisit pour y fixer racine.
Pour Alain, un miracle se fit un jour d’octobre à cet angle de rue où il avait vu le visage de la femme qu’il devait trouver pour toute sa vie le plus joli du monde.
À partir de ce jour, il désira rencontrer Perla tous les jours, assidûment, amoureusement. Ils se sont rencontrés régulièrement, de plus en plus régulièrement et puis très vite une complicité s’est installée dans leurs goûts, dans leurs plaisirs, tout un ensemble de choses qu’ils avaient envie de partager. Il aurait voulu s’installer avec Perla. Il aurait pris un logement un peu plus grand que celui qu’il occupait et ils auraient fait un peu de place en eux, chacun l’un pour l’autre. Mais Perla, bien qu’elle ne prenne certainement pas beaucoup de place, n’en éprouvait pas le désir. Il ne voulait pas penser aux raisons, ça le rendait triste.
Ainsi, ils se voyaient un, deux, trois soirs par semaine, parfois furtivement, parfois sans avoir l’impression de s’être quittés un jour et sans avoir l’impression qu’ils se quitteront le lendemain matin.
— Ce soir j’ai un conseil de classe entre collègues. Je ne sais pas combien de temps ça va durer.
— D’accord, tu vas directement à l’hôpital ou tu peux me raccompagner au journal ?
Perla collaborait à un petit journal local dans lequel elle retraçait l’atmosphère de la cité, donnant plus de relief à la vie qui s’y déroulait que les quartiers en étaient pourvus.
— Profites-en ! Si l’infirmier ne sait pas désamorcer la pompe, tu n’es pas près de me revoir.
Alain n’aimait pas spécialement donner son sang. Ça laisse toujours une impression désagréable quand on puise quelque chose en soi, pensait-il. Et puis, on lui avait dit que ça faisait grossir.
Après avoir déposé Perla au journal, Alain se dépêcha de se rendre à l’hôpital situé à l’entrée de la ville, sur un immense terrain désertique nourri de la poussière grisâtre.
La prise de sang
En entrant dans l’hôpital, il lui vint l’envie d’aller voir Monique au pavillon des enfants malades. Monique est une jeune fille de quinze ans qui est affectée d’une hépatite virale. Le climat, la nourriture, le mode de vie ont contrarié quelque chose en cette jeune fille, comme à bon nombre d’enfants et de femmes, à Djibouti. C’est pourquoi il assiste régulièrement ces élèves en rupture de bancs du lycée. Il les fait travailler dans diverses disciplines. Il s’agit avant tout de donner un réconfort moral à ces adolescents, dans ces chambres austères qui ramassent la grisaille des pierres millénaires tachées de soleil.
Monique est une adorable jeune fille qui retournera un jour étudier dans les écoles de la métropole et qui bûche maintenant pour ne pas décevoir ses parents. Ces derniers sont présents chaque jour, à tour de rôle, quand il se rend en visite. Sa maman qui ne travaille pas est bien sûr très présente. Son papa dirige une entreprise de bâtiment de belle importance. C’est un ancien militaire qui, après avoir fait son temps, a décidé de monter son entreprise, comme beaucoup de ces anciens soldats des colonies. Son sérieux et son savoir-faire ont très vite été appréciés des autorités du territoire des Afars et des Issas. En peu de temps, il s’est imposé comme le chef de file des entrepreneurs locaux, s’imposant auprès de l’administration et des banques locales.
C’est un homme aux épaules solides et au regard droit.
Tous les jours, il trouve un petit moment pour aller embrasser Monique. Alain l’appelle monsieur Jeantot, de son vrai nom. Lui-même appelle familièrement l’instituteur « Alain ». Ils ont une estime mutuelle. D’ailleurs, il suffit d’entendre Monique parler de son père pour être séduit par cet homme. En quelque sorte, il représente un modèle ; le modèle du patron, le modèle du père, le modèle de la droiture.
Depuis deux mois qu’Alain connaît Monique, monsieur et madame Jeantot l’ont invité deux fois à dîner chez eux. Il y a retrouvé un peu des liens familiaux que l’éloignement avec sa famille avait fini par dénouer.
À chaque occasion, monsieur Jeantot fascinait Alain par sa simplicité et en même temps la puissance qu’il dégageait naturellement. Il était devenu très riche, mais n’étalait aucun luxe. Sa fille a raconté à Alain qu’à chaque fois qu’un ouvrier mariait sa fille, il payait la dot lui-même et achetait aux jeunes mariés tout le linge qui servirait à la naissance de leurs enfants.
Par ailleurs, il modulait les horaires du personnel pendant la période du Ramadan, il organisait chaque année une fête qui donnait l’occasion à chacun de rire et de mieux se connaître et surtout, il assurait à chacun une formation de façon à ce que personne ne se sente dépendant des autres. Personne n’était dépendant de lui, mais il était indispensable à tout le monde, dans cette ville où les plus grands contrebandiers avaient fait commerce de chair et de fusils, il n’y a pas bien longtemps, encore. Une grande demeure en ruine qui avait appartenu à Henri De Monfreid, sur la route qui mène en Éthiopie, en aurait témoigné si les pierres noircies avaient gardé un peu du bruit des caravanes qui se perd un peu plus chaque jour dans la nuit des temps.
Alain se dépêcha de franchir le perron du pavillon des enfants malades. Il reconnut les infirmières, mignonnes, qui lui faisaient chaque fois un sourire prometteur. Quand il entra dans la chambre de Monique, il trouva le lit vide. La pièce était vide en fait ; aucune affaire personnelle et cette odeur aseptisée ! Il allait chercher l’infirmière-chef quand celle-ci entra brusquement :
— Vous ne savez pas ? lui dit-elle. Le père de Monique est mort la nuit dernière.
Que ne l’a-t-il su ? comment a-t-il pu mourir, lui ? Pourquoi lui ? Au-delà de toute forme de chagrin personnel, Alain pensait à tous les gens qu’il laissait, seuls. Il décida de rendre visite à madame Jeantot et à sa famille aussitôt après la prise de sang.
Il sortit du bâtiment pour se retrouver immédiatement dans la grisaille.
En effet, dès qu’il eut franchi le perron, une triste impression d’abandon lui prit en voyant traîner cette poussière dans un lieu qui se devait d’être si propre.
Sa gorge se noua.
De grosses mouches bruyantes circulaient en dominatrices dans une ambiance tiède et moite.
Il n’y avait personne pour le renseigner et il entrouvrit les portes battantes, accompagnant du regard les mouches qui volaient.
Deux autres portes battantes, plus grosses et plus lourdes que les précédentes s’offraient à lui. Il les poussa. Il s’arrêta net.
La pièce devant lui était lugubre. Il y régnait une atmosphère de vieille salle de projection comme on en trouvait autrefois au fond des bistrots de campagne où la fumée de cigarette se mélangeait à la lueur du projecteur. Et cette lueur, si basse, dans une pièce si petite rassemblait en essaims tous les microbes des lieux.
Dans cette pièce, parmi la chaleur moite, où se déplaçait une poussière pétrie dans les sanglots du ventilateur, deux hommes vêtus de blanc, autour d’une table recouverte d’un drap, mesuraient leurs gestes dans un silence de prière : Alain était entré dans le bloc opératoire, comme on entre dans un bar.
Il s’excusa et allait sortir quand un des hommes en blanc l’interpella.
— C’est pour le sang ?
— Oui.
— Venez ! On a besoin de vous.
Une boule se forma dans sa gorge et ses pieds lui semblèrent collés au sol.
— Venez, on n’a pas le temps de transfuser dans un flacon. Toutes vos analyses étaient bonnes la dernière fois, vous allez directement donner au receveur.
Il dit tout cela très vite comme si tout était naturel, sans laisser à Alain le choix.
Alain était comme un automate : sa tête voulait rebrousser chemin, ses pieds qui étaient décollés, avançaient vers la table blanche.
Sa bouche parvint à articuler :
— Ce n’est pas dangereux comme ça ?
— Mais non, ça ira vite.
— Ah bon ! dans ce cas !
Il s’assit près d’un corps étendu et inconscient. C’était un jeune noir, de son âge, une vingtaine d’années, les traits fins, un Éthiopien sans doute.
On lui noua un cordon de caoutchouc autour du bras, lui frotta la peau d’un coton imbibé d’alcool et lui enfonça dans une veine, à la jointure du bras et de l’avant-bras, une grosse aiguille argentée reliée à un tuyau transparent. On enfonça dans l’avant-bras de l’Éthiopien, l’autre extrémité du tuyau, au moyen d’une aiguille identique.
— Qu’est-ce qu’il a ? demanda Alain.
— La rate écrasée dans un accident.
— Oh !
Alain ne savait pas exactement où se trouvait la rate, mais il sentit un poids sur l’estomac et une nouvelle boule dans la gorge.
Il commença à ressentir une sensation dans le bras, comme d’habitude, mais cette fois, elle était toute autre, lui sembla-t-il. Elle n’était pas provoquée par le phénomène régulier du pompage du sang qui s’élance par saccades, au rythme toujours égal des battements du cœur.
C’était un mouvement mécanique, identique à celui d’une bielle qui transformait le mouvement rectiligne de son sang, partant de son cœur vers son bras et cheminant dans le tuyau transparent, en un mouvement désordonné, à la fois circulaire et suivant des axes différents.
Puis il lui prit des picotements. Ils descendaient sur son corps avec la finesse de la pointe d’une aiguille, sur le ventre, le bas ventre, les cuisses, les jambes, les pieds, et ils remontaient des orteils qui le démangeaient, des jambes, des cuisses, de tout le corps jusqu’à la tête qu’il sentit enfler comme une baudruche. Tout le corps le démangeait sans qu’il ne trouve la ressource de se gratter. Sa peau subissait une étreinte, de l’intérieur et de l’extérieur. Il lui semblait qu’elle se durcissait, qu’elle craquait, qu’elle se gonflait. Une forte chaleur se dégageait. Sa tempe en témoignait, de grosses gouttes tièdes envahirent son visage, puis tout son corps. La chemise et le pantalon lui collèrent à la peau. Il était dans un bain de vapeur. Les picotements avaient cessé, sa peau ne craquait plus, comme huilée, elle laissait glisser l’eau qui lui échappait.
Soudain ses yeux longtemps restés fixés au plafond qui, en entrant lui avait paru blanc, furent recouverts d’un voile trouble. Et le blanc passa, presque imperceptiblement, de demi-teinte en demi-teinte, au gris, puis au noir. Au même moment, des lumières apparurent comme des étoiles, en lot, toutes vibrantes du désir de paraître. Et elles vibraient, virevoltaient, s’enchevêtraient, poussaient les espaces et se débattaient en un champ de bataille étincelant sur lequel il se trouvait être le témoin, au milieu d’un masque noir qui le regardait et de ces lumières qui se départageaient enfin en devenant de plus en plus grosses et de plus en plus brillantes, quand elles éclatèrent soudain, les unes après les autres, chacune à leur tour, en ordre calculé, au rythme de la précédente, ne laissant aucune nuée, aucune trace, aucun désordre, mais un noir, un noir immense.
D’un sursaut violent, Alain leva la tête et regardait son corps, ses bras, ses pieds : ils étaient noirs. Il était devenu noir.
Et là, il s’évanouit.





























