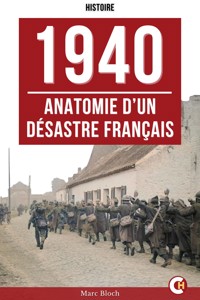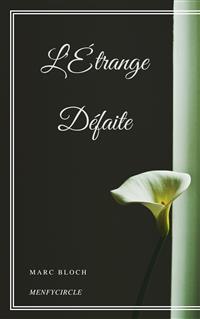Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Historien,
Marc Bloch relate les mensonges et les erreurs militaires commises lors des débuts de la seconde guerre mondiale du côté français.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’Étrange Défaite
Marc Bloch
1 - Présentation du témoin
Ces pages seront-elles jamais publiées ? Je ne sais. Il est probable, en tout cas, que, de longtemps, elles ne pourront être connues, sinon sous le manteau, en dehors de mon entourage immédiat. Je me suis cependant décidé à les écrire. L’effort sera rude : combien il me semblerait plus commode de céder aux conseils de la fatigue et du découragement ! Mais un témoignage ne vaut que fixé dans sa première fraîcheur et je ne puis me persuader que celui-ci doive être tout à fait inutile. Un jour viendra, tôt ou tard, j’en ai la ferme espérance, où la France verra de nouveau s’épanouir, sur son vieux sol béni déjà de tant de moissons, la liberté de pensée et de jugement. Alors les dossiers cachés s’ouvriront ; les brumes, qu’autour du plus atroce effondrement de notre histoire commencent, dès maintenant, à accumuler tantôt l’ignorance et tantôt la mauvaise foi, se lèveront peu à peu ; et peut-être les chercheurs occupés à les percer trouveront-ils quelque profit à feuilleter, s’ils le savent découvrir, ce procès-verbal de l’an 1940. Je n’écris pas ici mes souvenirs. Les petites aventures personnelles d’un soldat, parmi beaucoup, importent, en ce moment, assez peu et nous avons d’autres soucis que de rechercher le chatouillement du pittoresque ou de l’humour. Mais un témoin a besoin d’un état civil. Avant même de faire le point de ce que j’ai pu voir, il convient de dire avec quels yeux je l’ai vu. Écrire et enseigner l’histoire : tel est, depuis tantôt trente-quatre ans, mon métier. Il m’a amené à feuilleter beaucoup de documents d’âges divers, pour y faire, de mon mieux, le tri du vrai et du faux ; à beaucoup regarder et observer, aussi. Car j’ai toujours pensé qu’un historien a pour premier devoir, comme disait mon maître Pirenne, de s’intéresser « à la vie ». L’attention particulière que j’ai accordée, dans mes travaux, aux choses rurales a achevé de me convaincre que, sans se pencher sur le présent, il est impossible de comprendre le passé ; à l’historien des campagnes, de bons yeux pour contempler la forme des champs ne sont pas moins indispensables qu’une certaine aptitude à déchiffrer de vieux grimoires. Ce sont ces mêmes habitudes de critique, d’observation et, j’espère, d’honnêteté, que j’ai essayé d’appliquer à l’étude des tragiques événements dont je me suis trouvé un très modeste acteur. La profession que j’ai choisie passe, ordinairement, pour des moins aventureuses. Mais mon destin, commun, sur ce point, avec celui de presque toute ma génération, m’a jeté, par deux fois, à vingt et un ans d’intervalle, hors de ces paisibles chemins. Il m’a, en outre, procuré, sur les différents aspects de la nation en armes, une expérience d’une étendue, je crois, assez exceptionnelle. J’ai fait deux guerres. J’ai commencé la première au mois d’août 1914, comme sergent d’infanterie : en pleine troupe, par conséquent, et presque au niveau du simple soldat. Je l’ai continuée, successivement, comme chef de section, comme officier de renseignements, attaché à un état-major de régiment, enfin, avec le grade de capitaine, dans les fonctions d’adjoint à mon chef de corps. Ma seconde guerre, j’en ai vécu la plus grande partie à l’autre extrémité de l’échelle : dans un état-major d’armée, en relations fréquentes avec le G. Q. G. Tranchant à travers les institutions et les milieux humains, la coupe, on le voit, n’a pas manqué de variété. Je suis Juif, sinon par la religion, que je ne pratique point, non plus que nulle autre, du moins par la naissance. Je n’en tire ni orgueil ni honte, étant, je l’espère, assez bon historien pour n’ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe et la notion même de race pure une absurdité particulièrement flagrante, lorsqu’elle prétend s’appliquer, comme ici, à ce qui fut, en réalité, un groupe de croyants, recrutés, jadis, dans tout le monde méditerranéen, turco-khazar et slave. Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas : en face d’un antisémite. Mais peut-être les personnes qui s’opposeront à mon témoignage chercheront-elles à le ruiner en me traitant de « métèque ». Je leur répondrai, sans plus, que mon arrière-grand-père fut soldat, en 93 ; que mon père, en 1870, servit dans Strasbourg assiégé ; que mes deux oncles et lui quittèrent volontairement leur Alsace natale, après son annexion au IIe Reich ; que j’ai été élevé dans le culte de ces traditions patriotiques, dont les Israélites de l’exode alsacien furent toujours les plus fervents mainteneurs ; que la France, enfin, dont certains conspireraient volontiers à m’expulser aujourd’hui et peut-être (qui sait ?) y réussiront, demeurera, quoi qu’il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J’y suis né, j’ai bu aux sources de sa culture, j’ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé, à mon tour, de la défendre de mon mieux. Un jeune officier me disait, alors que nous devisions sur le pas d’une porte, dans Malo-les-Bains bombardé : « Cette guerre m’a appris beaucoup de choses. Celle-ci entre autres : qu’il y a des militaires de profession qui ne seront jamais des guerriers ; des civils, au contraire, qui, par nature, sont des guerriers. » Et il ajoutait : « Je ne m’en serais, je vous l’avoue, jamais douté avant le 10 mai : vous, vous êtes un guerrier. » La formule peut paraître naïve. Je ne la crois pas tout à fait fausse ; ni dans ses applications générales ni même, si je m’interroge avec sincérité, quant à ce qui me touche personnellement. Un médecin de l’armée, qui fut mon compagnon au 4e bureau de l’état-major, aimait à me persifler gentiment en m’accusant, moi vieux professeur, « d’avoir plus que personne l’esprit militaire » : ce qui, d’ailleurs, signifiait tout bonnement, j’imagine, que j’ai toujours eu le goût de l’ordre dans le commandement. Je suis revenu de la précédente guerre avec quatre citations ; je ne pense pas me tromper en supposant que, si l’entrée inopinée des Allemands à Rennes n’avait arrêté net les propositions de la 1re armée, je n’aurais pas regagné mes foyers, après cette guerre-ci, sans un ruban de plus sur ma vareuse [1] . En 1915, après une convalescence, j’ai rejoint le front avant mon tour, comme volontaire. En 1939, je me suis laissé maintenir en activité, malgré mon âge et mes six enfants, qui m’avaient, depuis longtemps, donné le droit de pendre au clou mon uniforme. De ces faits et de ces témoignages, je ne tire nulle vanité : j’ai, pour cela, vu trop de braves et humbles gens accomplir leur devoir, sans emphase, beaucoup mieux que moi et dans des conditions beaucoup plus difficiles. Simplement, si le lecteur, tout à l’heure, devant certains propos d’une franchise un peu rude, se sentait tenté de crier au parti pris, je lui demande de se souvenir que cet observateur, ennemi d’une molle indulgence, ne servit pas contre son gré et ne fut point, par ses chefs, ou ses camarades, jugé un trop mauvais soldat. Voici, maintenant, l’exact bilan de ce qu’il m’a été donné de faire et, par conséquent, de voir, dans la dernière guerre. Comme je l’ai dit plus haut, je m’étais, dans l’intervalle entre les deux guerres, constamment refusé à profiter des dispositions législatives qui m’auraient permis d’échapper à toute obligation militaire. Mais, bien qu’inscrit, dès 1919, au service d’état-major, je ne me pliai jamais à suivre le moindre cours dit « de perfectionnement ». Dans le principe, je reconnais que j’eus tort. Mon excuse est que ces années-là, précisément, se trouvèrent coïncider avec la période de ma vie durant laquelle j’ai, tant bien que mal, produit l’essentiel de mon œuvre d’historien, qui me laissait bien peu de loisirs. Ma consolation, je la puise dans les expériences mêmes de la campagne : assurément, le reflet de l’enseignement de l’École de Guerre, auquel je me suis ainsi soustrait, ne m’eût inspiré que bien peu d’idées justes. Comme l’armée de ce temps estimait, avant tout, les bons élèves, elle ne manqua point de me tenir rigueur de mon obstinée école buissonnière. Elle sut même m’en punir doublement. Capitaine de 1918, je n’avais pas cessé de l’être en 1938, lors de ma première mobilisation. Capitaine, je me retrouvai, encore, au mois d’août 1939, malgré une proposition d’avancement, signée par les chefs qui m’avaient vu au travail ; capitaine, toujours, lorsque, le 11 juillet 1940, je déposai l’uniforme. Tel fut mon premier châtiment, qui m’a laissé sans rancune comme sans tristesse. Le second m’atteignit dans mon affectation de mobilisation. J’avais d’abord appartenu, sur le papier, à un 2e bureau de corps d’armée : ce qui, le 2e bureau étant chargé des renseignements, ne paraissait pas, on l’avouera, pour un historien, un trop mauvais emploi ; puis, plus modestement déjà, à un état-major d’infanterie divisionnaire. Mais bientôt on me fit quitter les formations des armées, pour me précipiter dans les inglorieux services du territoire : en l’espèce, l’état-major d’un groupe de subdivisions. Ce groupe-là, à vrai dire, avait son siège à Strasbourg, où chacun voyait alors la première proie offerte aux bombes allemandes. Il y aurait eu, me semblait-il, une certaine inélégance à me dérober à un poste ainsi placé. Ce sentiment, confirmé par la paresse naturelle à laquelle je succombe aisément, lorsqu’il s’agit de ma propre personne, m’empêcha de tenter les démarches qui m’auraient peut-être permis de trouver mieux. Un ami, cependant, s’efforça, peu avant la guerre, de me faire entrer au 2e bureau du G. Q. G. ; il ne put réussir à temps. Ce fut donc au groupe de subdivisions de Strasbourg, qu’après y avoir accompli deux brèves périodes d’instruction, je fus appelé d’abord en septembre 1938, lors de l’alerte de Munich ; puis, une seconde fois, au mois de mars suivant, pour quelques heures seulement (ma convocation m’avait touché à Cambridge, d’où il me fallut revenir en toute hâte) ; enfin, le 24 août de cette même fatidique année 1939. Je n’ai, au bout du compte, pas trop regretté cette affectation. La besogne d’un état-major de groupe de subdivisions est, en soi, assez morne. Mais c’est, sur une entrée en guerre, un bon observatoire. Du moins, tel fut le cas, durant les deux ou trois premières semaines. La mobilisation, proprement dite, s’effectuait, pour une large part, sous notre contrôle. Que se passa-t-il, ensuite, dans les états-majors, de même type, qui fonctionnaient dans l’intérieur du pays ? J’imagine que, cette première fièvre une fois épuisée, ils conservèrent, malgré tout, une certaine activité, faite d’innombrables paperasses et de beaucoup de menues histoires. Le nôtre, qui avait bientôt quitté Strasbourg pour se replier sur Molsheim, au pied des Vosges, était, là encore, implanté en pleine zone des armées. Lorsque la VIe armée se fut décidée, d’ailleurs avec une étonnante lenteur, à mettre en place ses propres organes de commandement, notre rôle, déjà progressivement amenuisé, se réduisit presque à néant. Alors se succédèrent d’interminables et torpides journées. Nous étions cinq : un général de brigade, un lieutenant-colonel, deux capitaines, un lieutenant. Je nous revois encore, face à face dans notre salle d’école, tous tendus vers un même souhait : que quelque papier, apporté par un courrier inopiné, nous fournît enfin l’occasion de rédiger un autre papier. Le plus jeune des deux capitaines était le plus heureux, il distribuait des laissez-passer ! Un historien ne s’ennuie pas facilement : il peut toujours se souvenir, observer, écrire. Mais l’inutilité, quand la nation se bat, est un sentiment insupportable. Notre général appartenait au cadre de réserve. On finit par renvoyer cet excellent homme à ses études, c’est-à-dire, pour l’essentiel, à la pêche à la ligne. Le reste de l’état-major fut fondu avec celui du groupe de subdivisions de Saverne. Personnellement, je ne passai, pourtant, que deux jours dans cette aimable petite ville, alors fort encombrée. Je m’étais découvert une voie d’accès auprès d’un haut personnage du G. Q. G. Obtenir un meilleur poste, « par relations », l’acte ne compte point parmi ceux dont il y ait lieu de tirer beaucoup de fierté. Était-ce ma faute, cependant, si aucun autre moyen ne s’offrait de trouver pour ma bonne volonté un plus utile emploi ? Grâce à ce puissant intercesseur, je reçus, au début d’octobre, un avis de mutation. J’étais affecté à l’état-major de la Ire armée, que je rejoignis, sans tarder, à Bohain, en Picardie. L’ordre du G. Q. G. m’assignait une fonction précise : celle d’officier de liaison avec les forces britanniques. Je devais figurer, à ce titre, au 2e bureau. Mais deux autres capitaines arrivèrent bientôt, précédés par des notes qui définissaient leur emploi mot pour mot dans les mêmes termes que le mien. Le chef d’état-major jugea qu’il y avait pléthore ; mieux valait, pensait-il, que chacun des principaux organes de l’armée eût ses moyens propres de contact avec nos voisins du corps expéditionnaire. Il nous répartit donc entre les divers bureaux, à l’exception, seulement, du 1er, dont le rôle, qui est de veiller sur les effectifs et la discipline, ne comporte guère de fenêtres ouvertes sur l’extérieur. Je me trouvai, pour ma part, versé au 4e, qui a la charge de la circulation, de la main-d’œuvre et des ravitaillements. J’y conservais, en principe, le même service, mi d’information, mi de diplomatie. On verra plus loin comment, très malheureusement et bien contre mon gré, ces attributions se révélèrent, à l’expérience, de plus en plus insignifiantes. Allais-je retomber dans l’oisiveté dont j’avais, une première fois, tant souffert ? Je m’en désolais déjà quand l’officier chargé du ravitaillement en essence ayant été appelé à un autre poste, on me désigna pour prendre sa place. Me voici donc devenu, du jour au lendemain, le grand maître des carburants, dans l’armée la plus motorisée de tout le front français. Ma première impression fut une terreur panique : car je me rendais bien compte que ce service ne manquerait pas d’entraîner, en cas d’opérations actives, les responsabilités les plus lourdes, et j’en ignorais jusqu’au rudiment. « Pourvu, écrivais-je à ma femme, que Hitler consente à rester sage encore pendant quelques semaines ! » Mais il n’est pas, je crois, de poste de direction que tout homme d’esprit un peu clair, s’il travaille d’arrache-pied, ne puisse se mettre en mesure de remplir convenablement. J’appris de mon mieux mon nouveau métier. Dans cet effort, j’eus une grande chance : je trouvai, dans le commandant du parc d’essence de l’armée, le guide le plus sûr et le plus désintéressé. C’est la première fois que j’inscris ici le nom du capitaine Lachamp. Ce n’est assurément pas la dernière. L’amer arrière-goût que me laisse cette guerre, mal conduite et plus mal terminée encore, ne fait que m’en rendre plus chers les rares souvenirs lumineux. Rencontrer un homme vraiment homme est toujours une joie ; travailler avec lui, dans une parfaite communauté d’intentions, et sentir cette collaboration s’épanouir, peu à peu, en une solide amitié, l’action ne connaît guère de récompenses plus que celles-là précieuses. À dire vrai, mes nouvelles fonctions ne me donnèrent beaucoup à faire que durant la période d’apprentissage. Après quoi, je glissai, comme tous mes camarades, à la vie sans fièvre d’un bureaucrate d’armée. Je n’étais pas oisif, certes ; je n’étais pas, non plus, fort occupé et mes besognes quotidiennes ne me procuraient qu’une faible dose d’excitation cérébrale. Je pus, par bonheur, leur adjoindre, pendant quelques semaines, une tâche supplémentaire, spontanément choisie. Je m’étais aperçu que nous n’avions, sur les dépôts d’essence situés en territoire belge, que des renseignements absurdement insuffisants : carence redoutable pour une armée que sa mission propre, connue de nous tous, appelait à pénétrer en Belgique, aussitôt que les Allemands, de leur côté, en auraient eux-mêmes violé la frontière. Certaines relations personnelles me permirent de compléter et préciser sensiblement ce dossier. Il y fallut beaucoup de démarches, dont mon expérience des milieux d’états-majors tira de grands profits. J’appris alors, en particulier, comment, entre gens de bureaux, s’ils sont courtois, on traduit ce qui, en bon français, se dit simplement : « se mêler de ce qui ne vous regarde pas » – car, en somme, l’enquête, dont j’avais pris l’initiative, si utiles qu’en pussent être les résultats, n’appartenait, en aucune façon, à mon service régulier. Cela se nomme, en appuyant la phrase d’un discret sourire : « avoir du dynamisme ». Mais cette occupation même n’eut qu’un temps. Réduit dorénavant, jour après jour, à recenser des bidons ou à calculer, au compte-gouttes, des allocations d’essence, j’eus de nouveau, peut-être à tort, le sentiment que ce que je pouvais posséder de forces intellectuelles et d’esprit d’entreprise n’était pas trop bien employé. L’ennui de ces longs mois de l’hiver et du printemps 1939-1940, qui a rongé tant d’intelligences, pesait lourdement sur le morne Bohain. Plus ou moins intoxiqué sans doute, à mon tour, par ses subtils poisons, je songeais sérieusement, je l’avoue, à chercher autre chose, voire à solliciter, une fois l’été passé, de reprendre tout simplement ma place à la Sorbonne, quand éclata le coup de tonnerre du 10 mai. Combien il fut inattendu, rien ne le montrera mieux qu’un petit souvenir personnel. Je m’étais rendu le 9 à Paris, pour gagner, le lendemain matin, de bonne heure, Meaux. Là je devais me procurer, auprès du Service des Carburants de l’état-major général, quelques carnets de ces bons d’essence qui, distribués aux unités par mes soins, leur servaient à opérer réglementairement leurs perceptions. À mon arrivée à Meaux, j’ignorais encore tout des événements de la nuit. Ces messieurs du G. Q. G. furent naturellement fort étonnés de voir apparaître, en une pareille conjoncture, pour une mission si peu guerrière, un officier venu tout exprès d’une des armées du front de Belgique. Après quelques minutes de quiproquo, je compris enfin les raisons de cet accueil un peu gêné : juste à temps pour me précipiter à la gare, traverser Paris et, y ayant pris d’assaut un train invraisemblablement bondé, rejoindre enfin mon poste. Ce que furent les trois semaines qui suivirent, je me suis promis de ne pas le raconter ici en détail. Il sera temps, tout à l’heure, d’en tirer les leçons. Quelques images, choisies parmi la foule de celles qui se pressent à ma mémoire, suffiront à jalonner le cours de ces journées et de ces nuits, toutes remplies par la grande tragédie de la campagne du Nord. Voici, d’abord, le lycée de jeunes filles de Valenciennes désigné pour être notre P. C. de départ, avant ce P. C. belge que prévoyait le thème de la manœuvre, et que nous n’occupâmes jamais. Tout près, nous allions contempler, d’un œil encore neuf, les maisons ruinées par le premier bombardement. Je pus m’échapper, à deux reprises, pour des randonnées en Belgique. Elles plaisaient à mon humeur nomade, que mes chefs n’approuvèrent pas toujours. Le 11, j’allai seulement jusqu’à Mons. Le 12, beaucoup plus loin, vers Nivelles, Fleurus et Charleroi. Le long des routes, profitant des loisirs de la Pentecôte, les mineurs du Borinage, du pas de leurs portes, acclamaient les autos françaises. Légèrement vallonnées, parées de leurs verdures printanières, les campagnes où, naguère, autour de Ligny et des Quatre-Bras, se battit l’armée de Ney, étaient charmantes. Mais déjà de longues colonnes de civils, chassés du pays de Liège, poussaient, sur les bas-côtés, la classique voiture d’enfant de l’évacué, chargée des bagages les plus hétéroclites ; et, symptôme plus inquiétant, des soldats belges, débandés, commençaient à se glisser à travers les villages. Puis vinrent, après les premiers espoirs, les premières angoisses. On se prit à parler de la brèche de la Meuse. Il fallut tenter de ravitailler par là-bas des divisions, jetées dans la bataille et tout aussitôt volatilisées. Enfin, l’armée refoulée vers le Sud-Ouest, l’état-major se replia, le 18 mai, sur Douai. Nous y habitâmes, moins de deux jours, une école encore, aux portes de la ville : logés déjà, à Bohain, à l’école des filles, nous étions décidément voués aux lieux pédagogiques. Tout autour, les bombes pleuvaient dru sur la gare, les rues principales, les terrains d’aviation. Cependant, j’apprenais, presque chaque jour, qu’un dépôt d’essence de plus, parmi ceux de l’arrière, était tombé aux mains des Allemands. Nos beaux bacs de Saint-Quentin et de Cambrai, que nous avions jalousement réservés à assurer, par envoi progressif vers l’avant, le ravitaillement des unités au combat, nos chers dépôts « de bled », où les bidons se dissimulaient astucieusement sous les arbres des parcs ou les toits de briqueteries abandonnées : sur rien de tout cela, l’armée ne pouvait plus compter. Bientôt, il fallut de nouveau plier bagage. On avait d’abord décidé de me laisser, avec deux camarades, à Douai, en P. C. avancé. Mais cette mission, comme tant d’autres alors, ne dura que quelques heures ; et, filant à travers le pays noir, parmi les crassiers, dont beaucoup, cocassement effondrés sous les bombes, commençaient déjà à perdre la netteté de leurs lignes d’épuré, je rejoignis, à Lens, notre quatrième et dernière école (19 mai). C’était, cette fois, une école maternelle. Fait au gabarit d’enfants en bas âge, le mobilier ne nous laissait le choix qu’entre deux formes de courbatures : fatigue de la station debout, indéfiniment prolongée ; contorsions d’un corps assis dans un espace trop étroit, les genoux, repliés à hauteur du ventre, venant s’écorcher au bord du pupitre. Encore n’était-il pas toujours commode de choisir : le besoin de rédiger quelque note de service nous avait-il contraints de nous asseoir ? il fallait, pour s’extraire de la cangue, de longs efforts. Cet étrange supplice, la laideur du paysage, l’envahissante saleté des poussières de charbon, tout, en ces tristes lieux, semblait s’accorder à notre angoisse grandissante. L’affreux P. C., vraiment, que ce groupe scolaire de Lens et bien digne d’une défaite ! Oublierai-je jamais la soirée du 20 mai ? Dans la nuit tombante, alors qu’au loin fumait Arras en feu, je vis mon chef de bureau s’approcher de moi. Il me dit, à mi-voix, désignant du doigt sur une carte murale pour écolier l’embouchure de la Somme : « Les Boches sont là ! » Puis il revint et murmura : « Ne le racontez pas trop. » Je venais de demander au téléphone le G. Q. G. ; ce fut seulement, je l’avoue, après avoir plusieurs fois répété ma tentative que je compris pleinement ce que comportent d’abandon ces mots tragiques : « une armée cernée ». Nous émigrâmes peu après (le 22 mai), vers le Nord, à Estaires-sur-la-Lys. Mais ce carrefour était peu sûr. Les aviateurs allemands ne cherchaient guère à atteindre personnellement les états-majors ; il y aurait eu beaucoup de présomption à leur demander de nous éviter. Dès la première après-midi, une bombe, sans toucher directement l’auberge où nous gîtions, en ébranla avec assez de force la cheminée et les murs pour couvrir nos habits, nos papiers et nos visages d’une innommable suie. L’avertissement fut entendu. En pleine nuit, un ordre de départ me tira du lit où, pour la première fois depuis bien des jours, pour la dernière de la campagne, je jouissais du doux sommeil que procurent de vrais draps. Ce fut, d’ailleurs, pour ne nous mettre en route que le jour depuis longtemps levé ; l’art, si nécessaire, du repos, manqua toujours à notre état-major. Dans la matinée, après un assez long circuit, destiné, comme d’habitude, à rameuter mon parc d’essence, je rejoignis, au sud de Lille, le château d’Attiches, où mes camarades étaient déjà rassemblés (23 mai). Ce château était, dans un très beau parc, une lourde bâtisse ornée, sur la façade, d’affreuses céramiques et meublée dans le style cossu, sombre et vaguement moyenâgeux que la haute bourgeoisie, vers la fin du siècle dernier, considérait comme le cadre obligé d’une existence prétendument seigneuriale. Dans un coin de la salle à manger, où nous travaillions, le châtelain, par une attention que nous jugeâmes prématurée, avait entassé tout un monceau de couronnes mortuaires. Ce fut là que, dès l’après-midi du 23, notre 4e bureau se scinda, définitivement, en deux sections. L’une, formant échelon arrière, se rendit immédiatement sur la côte, pour y régler les ravitaillements par mer. L’autre – dont je fus – demeura sur place, avec le commandant de l’armée. La plus éloignée du front était en fait destinée à subir les plus violents bombardements. Ce fut une ironie du destin que, sur le moment, personne, je crois, n’avait prévue. En toute innocence, nous nous tenions certainement, à l’avant, pour plus menacés par les bombes – qui, en vérité, ne cessèrent de tomber dans nos environs – surtout, pour plus exposés à la captivité. Et, comme l’échelon de repli, s’il se trouva comprendre des hommes d’un indiscutable courage, en réunissait aussi quelques-uns auxquels cette retraite ne sembla pas trop désagréable, nous avions le sentiment de former, plus près de la ligne de feu, une petite société choisie, où régna constamment une excellente atmosphère de cordialité et d’entraide. Si bien qu’un de nos camarades, simple lieutenant de réserve mais, dans le civil, président d’une grande chambre de commerce du Nord, ayant été désigné pour s’en aller sur le littoral, il refusa hardiment de se soumettre. Notre sous-chef de bureau, qui, par une bizarre contradiction avec les usages militaires les mieux reçus, accompagnait, vers l’arrière, le chef même, prit fort mal une attitude si opposée à la sienne propre. Blanc de colère, il traîna le rebelle devant la plus haute autorité de l’état-major. Ce fut, à sa grande surprise, pour voir approuver cette brave désobéissance. Une autre scène encore reste associée dans ma mémoire à l’image de la salle à manger d’Attiches : un des plus affreux spectacles humains, en vérité, auxquels il m’ait jamais été donné d’assister. Toute une matinée, nous y pûmes voir, affaissé sur une chaise, près de la porte, un personnage qui, le visage morne et l’œil éteint, mâchonnait d’innombrables cigarettes. Aucun insigne n’était bien clairement visible sur sa manche, les passants le coudoyaient, sans lui accorder plus d’attention qu’au dernier des plantons. C’était, pourtant, un général de division placé, la veille encore, à la tête même d’une de nos plus brillantes unités. Mais un général depuis quelques heures cassé de son commandement. Pour ivrognerie, murmurait-on, à tort ou à raison. Il attendait d’avoir avec le chef de l’armée un ultime entretien longuement retardé. Il l’obtint, enfin, vers midi. L’entrevue ne dura que quelques minutes et nous ne revîmes plus jamais notre hôte d’un lamentable matin. Puis ce fut (depuis le 26) notre dernier P. C. : de l’autre côté de Lille, vers le nord-ouest, à Steenwerk, une aimable villa, claire et de bon ton. Dans la maison voisine habitait le général Prioux. Il venait de prendre le commandement de l’armée, à la place du général Blanchard, passé au groupe d’armées. L’étreinte ennemie se faisait de plus en plus impérieuse, le problème commençait à se poser de la destruction, par le feu, des importants dépôts d’essence de Lille. Toute la journée du 27 et la nuit suivante se passèrent, pour moi, à tenter d’obtenir une décision. Il n’y eut pas moins de quatre ordres et contrordres successifs. Le dernier, qui prescrivait de tout détruire, faillit bien ne pas atteindre le but. Mon motocycliste partit dans la nuit. Il n’arriva jamais. Quel qu’ait été son destin, je n’ai pas le droit d’avoir des remords. Mon devoir était d’assurer l’envoi du pli. J’aurais manqué à ma mission en le portant moi-même. Comment, cependant, me défendrais-je d’un pincement de cœur, à la pensée que, sur un mot de moi, un brave garçon est peut-être allé à la mort ? La précédente guerre avait déjà chargé ma mémoire de quelques souvenirs de cette sorte : j’ai là de quoi venir parfois me lanciner, dans mes veilles, jusqu’à ce qu’en moi s’évanouisse toute conscience. Heureusement, je pus faire réexpédier l’ordre et le grand feu s’alluma à temps. Juste à temps. Car l’armée se retirait déjà derrière la Lys et, de là, vers la côte. Pas tout entière, cependant. Le soir du 28, le général Prioux nous fit savoir que, désespérant d’assurer la retraite de deux au moins de ses divisions, il avait décidé de rester lui-même à Steenwerk et d’y attendre l’ennemi. Ne retenant à ses côtés que quelques officiers, il invitait la plupart d’entre nous à gagner, dans la nuit, le littoral, afin de nous y embarquer. J’allai le trouver, peu après, pour me faire confirmer l’ordre de vider, mettre hors d’usage et abandonner les camions-citernes. C’était priver l’armée de ses dernières gouttes d’essence et je n’avais pas cru pouvoir prendre sur moi une résolution si grave, bien qu’elle découlât clairement des autres dispositions du moment. Notre grand chef arpentait mélancoliquement le vestibule de sa maison : triste destin, en vérité, que celui de cet homme, enlevé au corps de cavalerie qu’il avait, je crois, fort honorablement commandé, pour prendre, en dernière heure, la direction d’une armée en déroute et accepter, à la place du vrai responsable de la défaite, une ingrate captivité ! Puis je rentrai à notre villa. J’avais déjà, dans la journée, brûlé, conformément à nos instructions, mes archives, y compris le cahier sur lequel était inscrite, au jour le jour, toute l’histoire de mon service. Que ne donnerais-je, aujourd’hui, pour le tenir en main, ce cher cahier vert ! Je précipitai également, dans le fourneau de la popote, ma correspondance personnelle – car il nous était interdit de nous alourdir de bagages – et je fis choix, dans ma cantine, pour les emporter avec moi, de quelques objets particulièrement précieux ou utiles. J’en oubliai d’ailleurs les trois quarts. Du moins, ai-je pu alors échanger ma vieille vareuse de travail contre un vêtement en meilleur état. Plus heureux, en cela, que le général commandant l’artillerie de l’armée. Ce très digne homme qui, par un point d’honneur peut-être excessif, avait voulu demeurer avec le général Prioux, ne disposait plus de ses cantines, prématurément expédiées sur Dunkerque. Il ne lui restait que la vareuse qu’il portait sur lui et elle était trouée au coude. Il en gémissait hautement : se faire faire prisonnier, passe encore : mais en haillons ! Rira qui voudra, je trouve, je l’avoue pour ma part, quelque noblesse à ce sentiment. Nous partîmes donc dans la nuit, en une longue et lente colonne d’autos, qui se glissa à travers le territoire belge : car les routes françaises étaient déjà coupées. Au petit jour, nous avions à peine fait une dizaine de kilomètres. Comment avons-nous réussi à échapper aux éclaireurs motorisés de l’ennemi ? Encore aujourd’hui, je me l’explique mal. Le fait est, pourtant, que, tantôt en voiture, tantôt à pied, j’arrivai, vers la fin de la matinée, à Hondschoote. Restait à atteindre la côte. J’unis mes efforts à ceux du capitaine Lachamp, retrouvé là-bas, pour chercher à rejoindre le gros du parc d’essence, qui, parti bien avant nous, avait reçu comme point de rassemblement, Bray-les-Dunes. Nous tentâmes, en voiture, la route de Furnes. Ce fut pour nous heurter, d’abord, à des ponts déjà coupés, puis, sur la chaussée principale, à un invraisemblable embouteillage de camions, arrêtés, tête-bêche, par files de trois. Par-derrière, un officier de chars, arguant d’une mission urgente, réclamait à grands cris le passage. Nous nous employâmes, pendant plus d’une heure, à dégager au moins une trouée. Un général de division, rencontré par hasard, me demanda ce que je faisais là. Mis au courant, il se laissa recruter pour nous aider et s’en acquitta, je dois le dire, avec zèle. Nos efforts réussirent enfin. Mais il était trop tard pour songer à poursuivre notre chemin – aussi bien, qui nous garantissait que nous ne nous cognerions pas, plus loin, à de nouveaux obstacles ? – et, bredouilles, nous n’eûmes qu’à regagner Hondschoote. De là, à la nuit tombante, nous repartîmes, à pied cette fois et par un trajet plus direct : un piéton pouvait se faufiler, là où une auto n’eût jamais passé. Marche affreuse, du moins dans ses dix derniers kilomètres, qu’il fallut franchir parmi d’extraordinaires entassements de camions à peine visibles dans une obscurité de plus en plus épaisse. Le parc était bien à Bray. Il m’offrit l’hospitalité dans une maison abandonnée. Il m’offrit même à boire. Malheureusement – près de là, les chirurgiens de l’hôpital de Zuydcoote n’eurent que trop de raisons de le savoir, – tout ce littoral, bordé vers l’arrière de marais et de polders envahis par le sel, se trouvait alors, par suite de la rupture des canalisations, presque complètement privé d’eau. Nous n’eûmes, pour apaiser notre soif, qu’un verre de champagne. Combien une bonne lampée, à une fontaine bien fraîche, eût été plus douce à mon gosier !