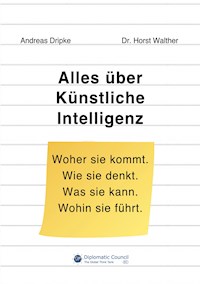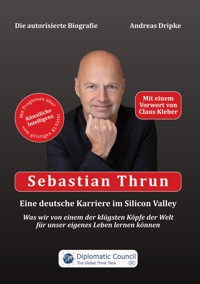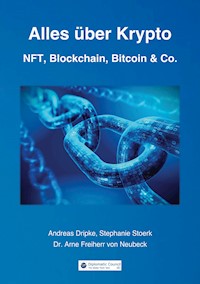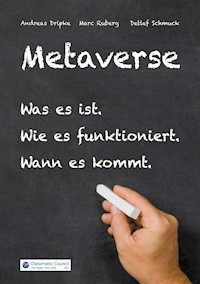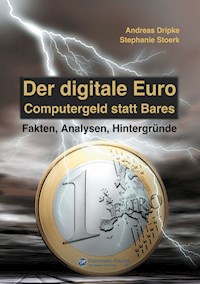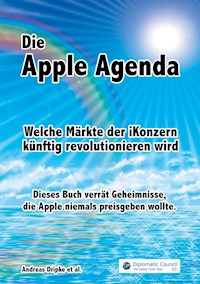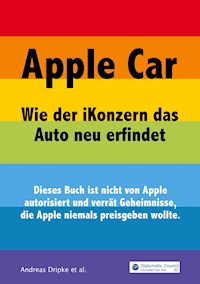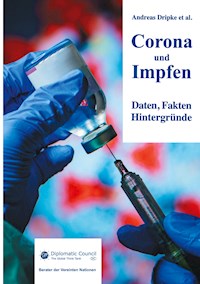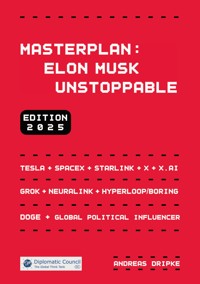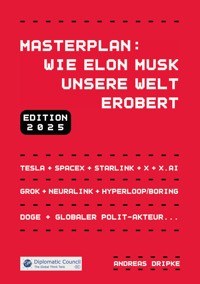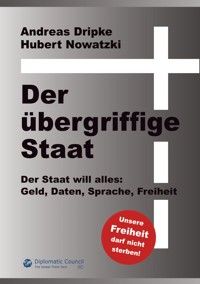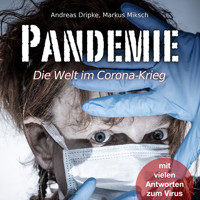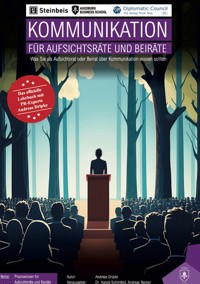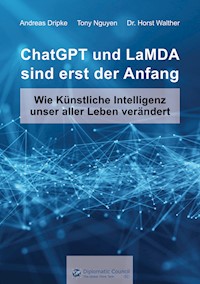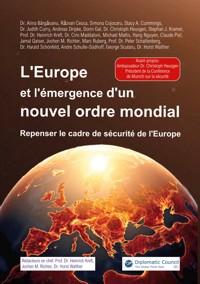
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre est une lecture incontournable pour quiconque s'intéresse à l'avenir de l'Europe. Dans un ordre mondial en mutation, où le destin de l'Europe ne doit plus dépendre des actions d'autres grandes puissances, nous plaidons pour une démarche proactive afin de construire une Europe capable et confiante. Le livre n'hésite pas à identifier les défis majeurs - qu'il s'agisse de la défense, des menaces cybernétiques ou du climat, pour n'en citer que quelques-uns. Chaque chapitre, rédigé par l'un des 22 auteurs éminents, spécialistes dans leurs domaines respectifs, propose des solutions concrètes pour aborder ces enjeux. Les auteurs : Dr Christoph Heusgen, président de la Conférence de Munich sur la sécurité, ambassadeur ; Dr. Alina Bargaoanu, Professeure, Membre du conseil consultatif de l'EDMO ; Razvan Ceuca, Expert en relations internationales, New Strategy Center, Roumanie ; Simona Cojocaru, Secrétaire d'État au ministère de la défense, Roumanie ; Stacy A. Cummings, Directrice générale de l'Agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN ; Dr. Judith Curry, Présidente du Climate Forecast Applications Network ; Andreas Dripke, Président exécutif du Diplomatic Council ; Dorin Gal, Conseiller politique auprès du ministère roumain de la Défense ; Stephan J. Kramer, Président de l'Office de protection de la Constitution de Thuringe ; Prof. Dr. Heinrich Kreft, Président du Diplomatic Council, Ambassadeur (honoraire), Éditeur ; Dr. Ciro Maddaloni, Analyste politique, Giornale Diplomatico ; Michael Mattis, Fondateur et PDG de Silicon Valley Europe ; Claude Piel, Journaliste, Consule pour paix du Diplomatic Council ; Jamal Qaiser, Commissaire aux affaires de l'ONU du Diplomatic Council ; Jochen M. Richter, Président du Forum mondial de la sécurité du Diplomatic Council, Éditeur ; Marc Ruberg, Responsable du réseau universitaire du Bade-Wurtemberg ; Prof. Dr. Peter Schallenberg, Professeur Titulaire de la chaire de théologie morale et d'éthique à la Faculté de théologie de Paderborn ; Dr. Harald Schönfeld, Fondateur et PDG de butterflymanager et United Interim ; Andre Schulte-Südhoff, Directeur général et actionnaire de Schuko ; George Scutaru, Fondateur et PDG du New Strategy Center, Roumanie ; Dr. Horst Walther, Commissaire aux affaires de l'ONU du Diplomatic Council, Éditeur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 768
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Merci à Guy Dockendorf
qui a relu la traduction française à titre bénévole
1ère édition 2025
Tous les ouvrages publiés par les Éditions du Conseil diplomatique sont rédigés avec soin. Néanmoins, les auteurs, les rédacteurs et les éditeurs déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude des informations, des notes et des conseils contenus dans ces ouvrages, ainsi qu'en cas d'éventuelles erreurs d'impression.
2025 Diplomatic Council (DC) Publishing, Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Allemagne
E-Mail [email protected]
Web : www.diplomatic-council.org
Tous les droits sont réservés, en particulier ceux de la traduction dans d'autres langues. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit par photocopie, microfilm ou tout autre procédé ni transférée ou traduite dans un langage utilisable par des machines, notamment des machines de traitement de données, sans l'autorisation écrite de l'éditeur. La reproduction de désignations de produits, de noms commerciaux ou d'autres marques dans ce livre ne permet pas de supposer qu'ils peuvent être utilisés librement par quiconque. Au contraire, il peut s'agir de marques déposées ou d'autres marques légalement protégées, même si elles ne sont pas spécifiquement désignées comme telles.
Le contenu de cet ouvrage reflète les points de vue et les opinions de l'auteur. Ceux-ci ne reflètent pas nécessairement les points de vue et/ou les opinions du Conseil diplomatique et/ou de ses membres. Les auteurs sont seuls responsables des textes, y compris des illustrations et des graphiques.
Note sur le langage approprié au genre
Dans cet ouvrage, comme dans tous les livres publiés par DC Publishing, le genre masculin, tel que "scientifique", "manager" ou "expert", se réfère toujours au terme indépendant du genre, c'est-à-dire à tous les genres (!). Toutes les dérogations à cette règle sont clairement signalées sur le plan linguistique, par exemple par des mots tels que "mâle" ou "femelle".
Table des matières
Préambule
Avant-propos
Prologue
L'Europe et le nouvel ordre mondial qui se dessine
Qu'est-ce que la sécurité?
Introduction
La sécurité, un défi linguistique
Concepts de sécurité
Définir la sécurité
Différentes formes de sécurité
Évaluation des risques, sécurité et paix
Questions institutionnelles relatives à la sécurité
Évolution historique du concept de sécurité
Qu'est-ce qui serait "suffisant"?
Conclusions
L'évolution de l'ordre mondial
Introduction
L'ordre international après la Seconde Guerre mondiale
La courte vie de l'ordre libéral mondial
La crise de l'ordre mondial libéral
Changements structurels mondiaux depuis 1990
L'organisation croissante du Sud global
Les Défis pour l’Occident
Make America Great Again - Trump 2.0
L'Europe doit surmonter sa faiblesse économique
Refonder l'ordre international basé sur des règles
Introduction
Approche
L'ordre mondial fondé sur des règles
Les Nations Unies
Le système de Bretton Woods
Le Fonds monétaire international (FMI)
La Banque mondiale
L'OMC (anciennement GATT)
OMC, FMI et Banque mondiale - une vue d'ensemble
Résumé
Le rôle de l'Europe dans un monde multipolaire
Approche
L'ordre mondial que nous attendons dans 10 à 15 ans
Les grandes puissances de demain
Les résistances au nouvel ordre mondial
Les défis à venir
L’Europe dans le nouvel ordre mondial
Résumé
Appel à l'action
Dissuasion au XXIe siècle
Introduction
L'OTAN et l'Union européenne
L'importance croissante de l'espace
Guerre hybride et cyberdissuasion
Dissuasion et connectivité en mer Noire
Dissuasion et sécurité énergétique
Résumé
Une voie vers l'avenir
Désinformation et menaces hybrides
Introduction
Armement écosystème d'information hyperconnecté
Opérations d'information de la Russie
Plusieurs facteurs se renforcent mutuellement
Désinformation et propagande
Lutter contre la désinformation hybride
Moins de grands discours, plus de collaboration
Cyber-résilience : une urgence absolue
Moteurs des attaques: cibles et auteurs
Alerte urgente pour la société numérique
Éducation et sensibilisation
Nouvelles exigences réglementaires
Utilisation responsable et approche collaborative
Cybercriminalité : un marché en expansion
Impact des réseaux et échanges mondiaux
Sociétés européennes dans la défense
Introduction
Une définition de la résilience
Entretien avec M. Sönke Marahrens
Qu'est-ce que la résilience?
Modèle suédois de résilience
Modèle finlandais
Modèles suisse et luxembourgeois
Conclusions
Sécuriser la chaîne d'approvisionnement
Introduction
Risques, thèses et stratégies
Menaces de cybersécurité
Catastrophes naturelles et changement climatique
Dépendance à l'égard des fournisseurs individuels
Perspectives de la pratique entrepreneuriale
Défauts de qualité et contrefaçon de produits
Complexité réglementaire et risques de non-conformité
Conditions de travail et risques éthiques
Perturbation technologique/intelligence artificielle (IA)
Instabilité financière des fournisseurs
Managers de transition pour les chaînes mondiales
Lutte contre le changement climatique
Introduction
Évaluation des risques climatiques
Gestion des risques climatiques
Entreprises familiales et sécurité climatique
Opportunités pour une économie résiliente au climat
Autres aspects à ne pas négliger
L’or bleu en Europe : Enjeux et Sécurité
Ce qui pourrait être une conclusion
Appel à l'action
Liste des auteurs
Dr. Alina Bârgăoanu
Răzvan Ceuca
Simona Cojocaru
Stacy A. Cummings
Dr. Judith Curry
Andreas Dripke
Dorin Gal
Stephan J. Kramer
Prof. Dr. Heinrich Kreft
Dr. Ciro Maddaloni
Michael Mattis
Hang Nguyen
Claude Piel
Jamal Qaiser
Jochen M. Richter
Marc Ruberg
Prof. Dr. Peter Schallenberg
Dr. Harald Schönfeld
André Schulte-Südhoff
George Scutaru
Dr. Horst Walther
Livres des Éditions du Conseil diplomatique
À propos du Conseil diplomatique
Références
Préambule
Hang Nguyen, éditrice, secrétaire général du Diplomatic Council
En tant que groupe de réflexion mondial, le Conseil diplomatique est synonyme d'esprits brillants qui, par le biais d'analyses fondées et d'une clairvoyance sans faille, non seulement abordent des questions d'actualité pertinentes pour l'humanité, mais proposent également des solutions pour surmonter les défis présents et futurs. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cet ouvrage.
Vingt-et-un auteurs renommés, des sommités dans leurs domaines respectifs, ont créé un ouvrage unique. Il ne s'agit pas seulement d'une évaluation perspicace de la situation actuelle, mais aussi de pistes pour un avenir exempt de conflits violents ou de guerres.
En tant que réfugié de la guerre du Viêt Nam - une guerre que j'ai vécue de près lorsque j'étais enfant - j'ai été témoin des horreurs de la guerre. Cette expérience a fait naître en moi un désir profondément ancré d'un monde pacifique, ou du moins d'un monde sans guerres. Tant que l'humanité existera, il y aura toujours des opinions et des intérêts divergents, ce qui entraînera des conflits. Le grand défi consiste à résoudre ces conflits de manière non violente - ou éventuellement à les laisser sans solution. Un conflit non résolu n'apportera peut-être pas l'harmonie, mais il est toujours préférable à une solution violente. Nous ne devons en aucun cas permettre que la guerre soit perçue comme une extension de la politique ; nous devons surmonter "Clausewitz"!
C'est pourquoi je suis profondément reconnaissant aux vingtet-un auteurs qui se sont réunis dans cet ouvrage pour tracer les voies d'un monde plus pacifique. Leurs efforts inlassables ont permis de rassembler sur des idées sur la manière dont notre ordre mondial va évoluer et sur le rôle que l'Europe devrait jouer dans cette transformation.
Au-delà des auteurs, je remercie tout particulièrement les trois rédacteurs, Jochen M. Richter, Horst Walther et Prof. Dr. Heinrich Kreft, tous membres honorables de notre Diplomatic Council. C'est grâce à eux que ce travail unique a pu voir le jour.
En tant qu'éditeur du Diplomatic Council, je ne peux cacher ma joie et ma fierté de voir ce livre publié par notre maison d'édition. Il reflète parfaitement les valeurs de notre groupe de réflexion : un large éventail d'opinions avec un objectif unique - contribuer à un monde où nos enfants et petits-enfants peuvent vivre en paix.
Hang Nguyen
Secrétaire général, Diplomatic Council
Avant-propos
Ambassadeur Dr. Christoph Heusgen
Lorsque les visionnaires fondateurs de l'Union européenne ont uni leurs forces pour créer une nouvelle Europe après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient animés par un objectif primordial : empêcher que ne se reproduisent les conflits brutaux qui ont marqué le continent de 1870 à 1945. Ils ont réussi au-delà de toute attente. Au fond, l'Europe connaît aujourd'hui la plus longue période de paix de son histoire.
Les conflits ne se règlent plus sur le champ de bataille, mais par le dialogue au sein des institutions européennes - le Parlement, le Conseil et la Cour de justice. Notre destin n'est plus décidé par la règle du plus fort, mais par l'État de droit. Cette réalisation est tout à fait remarquable. Pourtant, aujourd'hui, nous considérons trop souvent l'Union européenne et les réalisations de ces dernières décennies comme acquises.
Nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer sur nos lauriers. Cette ère de paix n'est pas garantie pour durer. Aujourd'hui, des forces internes et externes s'emploient à déstabiliser les fondements de l'Union européenne. L'autorité de ses institutions est remise en question ; on a de plus en plus l'impression que les gouvernements des États membres ne partagent pas tous les valeurs fondamentales inscrites dans les traités européens, et le nationalisme est de nouveau à la hausse. Ces défis ne doivent pas être ignorés : il faut les reconnaître et y apporter une réponse résolue.
Ce livre explore ces défis pressants et propose des stratégies pour les relever efficacement. L'Europe doit adapter ses politiques, répondre aux préoccupations des citoyens, communiquer ses décisions à l'adresse de manière transparente et rappeler sans cesse aux Européens que le maintien du rêve européen en vie vaut tous les efforts.
Ambassadeur Dr. Christoph Heusgen
Président de la Conférence de Munich sur la sécurité
Prologue
Jochen M. Richter et Dr. Horst Walther
L'Europe et le nouvel ordre mondial qui se dessine
On peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un ouvrage intitulé "L'Europe et le nouvel ordre mondial émergent" fasse des déclarations générales et pertinentes sur la forme que devrait prendre ce nouvel ordre mondial. En outre, les lecteurs peuvent s'attendre à un aperçu des acteurs clés et des forces qui façonneront leurs interactions. De cette analyse, des recommandations peuvent être tirées, et elles le seront d'ailleurs, au fur et à mesure du déroulement de cet ouvrage, qui commence par cette introduction et se poursuit jusqu'à l'épilogue, à travers douze chapitres rédigés par un éventail d'éminents contributeurs.
Un troisième thème crucial, qui revient tout au long de cette collection d'essais d'experts, est le sujet de la sécurité, examiné sous diverses perspectives et couvrant un large éventail d'aspects - des réflexions philosophiques aux demandes opérationnelles et pratiques enracinées dans les réalités actuelles, telles que la lutte actuelle entre l'Occident et la Russie au sujet de l'Ukraine.
Nous commençons donc par une question plus philosophique : "Qu'est-ce que la sécurité?" Alors que dans le passé, des efforts ont été faits pour définir la sécurité dans un sens purement négatif et objectif (comme l'absence de menaces), il est de plus en plus reconnu que la sécurité a également une dimension subjective. Différents individus, groupes ou États peuvent percevoir les menaces de différentes manières ; ce qui constitue une menace pour l'un n'est pas nécessairement perçu comme telle par l'autre. En adoptant une définition qui englobe à la fois les dimensions objective (protection contre les dangers) et subjective (perception des menaces) de la sécurité, nous ouvrons un large éventail de sujets de discussion.
Toutefois, avant d'aborder ces sujets, nous devons nous pencher sur la nécessité de réformer les organisations internationales existantes, qui font partie intégrante de l'ordre mondial actuel, souvent appelé "ordre fondé sur des règles". Une réflexion sur la sécurité de l'Europe ne peut se faire sans prendre en compte l'idéal européen, ses racines dans le siècle des Lumières, les valeurs européennes qui en découlent et l'équilibre constant entre liberté, cadres institutionnels et responsabilités.
Une fois ce contexte établi, nous passons à l'examen détaillé des éléments clés de la sécurité future de l'Europe que nous avons identifiés. Cela inclut le concept traditionnel de dissuasion et sa pertinence au 21e siècle, où les considérations éthiques jouent nécessairement un rôle.
Nous abordons également des éléments moins conventionnels, tels que les stratégies de cybersécurité, les menaces sécuritaires posées par les impacts de plus en plus évidents du changement climatique, et les défis de la lutte contre la désinformation et d'autres formes de menaces hybrides. En outre, nous explorons les concepts de résilience pour les sociétés européennes, y compris la protection des chaînes d'approvisionnement industrielles, et nous terminons la discussion en examinant des exemples de mobilisation sociétale à travers la notion de "défense totale".
Vingt-et-un auteurs, tous spécialistes dans leur domaine respectif, ont contribué à cet ouvrage. Ils sont présentés dans l'annexe de ce livre. Il convient de noter que les opinions exprimées dans ce livre sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de tous les contributeurs.
Toutefois, cette diversité permet d'examiner en détail les sujets susmentionnés et d'enrichir un discours aux multiples facettes. Mais ce livre s'efforce d'aller au-delà de la simple analyse des défis - un sujet pour lequel nous avons probablement déjà plus que suffisamment de matériel. L'objectif que nous nous sommes fixé est de proposer des idées sur la manière d'aller de l'avant, des moyens d'agir et des exemples qui font déjà la différence. Certains pourraient les considérer comme irréalistes, voire provocateurs. Dans ce cas, il y a matière à discussion. La critique doit toujours être constructive, c'est-à-dire que si nos suggestions ne sont pas partagées, nous espérons entendre des alternatives.
Après des décennies de stabilité relative, perçue comme telle, nous vivons aujourd'hui une période de turbulences. Cette stabilité était en effet perçue comme telle, si l'on se souvient des attaques terroristes régulières perpétrées en Europe entre les années 1970 et le milieu des années 1990, que ce soit par des organisations comme l'ETA, les Brigades rouges ou la FAR, pour n'en citer que quelques-unes. Et puis, bien sûr, les guerres sur le sol européen après la dissolution de l'ex-Yougoslavie. Et nous ne parlons même pas des nombreux conflits dans le monde.
Aujourd'hui, notre sécurité est déjà mise à mal, et nous serions bien avisés de nous préparer à d'autres menaces à l'avenir. Dans cet ouvrage, nous nous efforçons de poser les questions essentielles. Pour que l'ouvrage reste lisible, nous ne prétendons pas à l'exhaustivité et nous ne pouvons pas non plus fournir toutes les réponses. Cependant, nous espérons apporter de nouvelles perspectives au débat en cours. Ce faisant, nous aspirons à impliquer non seulement les experts en sécurité, mais aussi à favoriser un discours sociétal plus large.
Bien que ce livre aborde les défis et les pistes potentielles de progrès à partir de multiples points de vue, nous ne pouvons pas prétendre que ce site représente une vue d'ensemble exhaustive. Nous avons dû nous fixer des limites et l'objectif est de permettre un large débat.
Par conséquent, nous espérons que ce discours fera émerger l'Europe comme une entité capable, confiante, respectée et reconnue au niveau international, capable d'apporter une contribution significative à la transformation de ce monde en un lieu pacifique et durablement habitable, conformément aux objectifs du Conseil diplomatique.
Jochen M. Richter et Dr. Horst Walther
Initiateurs de ce livre
Qu'est-ce que la sécurité?
Jochen M. Richter
Introduction
Qu'est-ce que la sécurité? Une question plutôt philosophique, dont la réponse dépend de la personne interrogée, du moment de l'histoire et des circonstances de la vie. Cela suggère que la sécurité revêt différents aspects et a fait l'objet de diverses interprétations au fil du temps. Ce chapitre examine les origines du mot et les différents concepts de sécurité avant d'en donner une définition de base. Après une description des différentes formes de sécurité, nous nous pencherons sur la question de l'évaluation des risques et nous nous demanderons si la paix et la sécurité sont identiques ou, si ce n'est pas le cas, si elles sont liées et quel serait le lien entre elles. Nous aborderons ensuite certaines questions institutionnelles et nous examinerons les changements intervenus au cours de l'histoire. Avant de conclure, nous analyserons l'élément probablement le plus important : quel niveau de sécurité peut être atteint à quel prix, ce dernier ne s'entendant pas uniquement en termes monétaires?
Gardons à l'esprit que la sécurité a une composante individuelle ainsi qu'un aspect sociétal ou organisationnel. Nous attribuons tous à la sécurité un niveau d'importance individuel qui est déterminé par nos besoins et nos attentes. Vivant dans des communautés et étant organisés en États-nations, nos propres aspirations sont liées aux besoins communs en matière de sécurité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Compte tenu de la connectivité moderne dans le monde entier, la sécurité a également une dimension mondiale, ce qui complique encore une définition simple et donc facile à comprendre. En outre, une fois qu'une menace a été identifiée, la sécurité doit être classée par ordre de priorité et signifie qu'il faut savoir comment (rétablir) un environnement sûr. Comme nous le verrons aujourd'hui, il y a une prolifération très discutée de ce qui devrait être considéré comme la sécurité (nationale), ce qui conduit à une course à l'attention et aux ressources.
La sécurité, un défi linguistique
Mais commençons par une brève excursion linguistique. Les deux cultures et langues anciennes, le grec et le latin, connaissaient déjà les mots "être en sécurité" et "sécurité". En grec, asphaleia (ΑΣΦΑΛΕΙΑ) est lié à l'évitement ou à la prévention d'une erreur qui, négativement, conduirait à la défaite ou, positivement, assurerait la victoire et, par conséquent, la prospérité. Ce mot désigne le comportement humain qui crée l'environnement souhaité. En latin, son origine est sine cura, ce qui signifie être sans problème ou sans anxiété. Logiquement, le mot latin securitas fait référence à un état d'esprit de tranquillité ou à un sentiment de sécurité et de protection. En hébreu, le mot bitachon désigne un état de confiance attribué à Dieu. Le bitachon est lié à l'emunah, la compréhension que Dieu (hashem) est impliqué dans chaque action sur la planète. La langue arabe possède différents mots pour désigner la sécurité, le plus courant étan نt م لأ ا, dont la signification est toutefois très proche de celle des mots grecs et latins. De même, en chinois, il existe différents mots pour désigner la sécurité en fonction du contexte.a
Ce court voyage souligne la fluidité des idées autour de la sécurité, ce qui rend plutôt complexe l'énoncé d'une définition simple. Pour illustrer ce point, Saša Mijalković et Marija Popović Mančević ont rassemblé une série de définitions de la sécurité qu'elles ont identifiées dans le contexte du Conseil de sécurité des Nations unies1. Celles-ci vont de la simple absence de menaceb , à l'élargissement du concept, entre autres, au respect des droits fondamentauxc ou à la capacité de l'État et de la société à assurer un environnement sûrd , en passant par toute la complexité de la sécurité sectorielle, qu'il s'agisse de la sécurité des données ou de la sécurité routièree , pour ne citer que deux exemples.
Concepts de sécurité
Revenons à la déclaration d'ouverture concernant la nature changeante de la sécurité en termes d'opinions personnelles et de circonstances générales. On peut affirmer que les raisons des conflits ou des guerres sont aussi anciennes que l'humanité - voir l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible - et que, par conséquent, diverses influences au fil du temps ont apporté des changements aux éléments considérés comme faisant partie de la définition de la sécurité.
Lorsque l'humanité était encore nomade, la principale préoccupation était la sécurité de l'approvisionnement, principalement la nourriture et l'endroit où passer la nuit.
Le plus souvent, il s'agissait de simples essais et erreurs. Cependant, cela a conduit, d'une part, à un modèle de connaissance qui a été communiqué pour accroître le succès. D'autre part, l'évolution de l'humanité a permis l'augmentation des outils et des capacités qui ont stabilisé ce succès. Dès la création des colonies, la sécurité a pris une signification plus large. La protection des propriétés et de leurs limites est devenue une préoccupation. En outre, elle nécessitait une analyse de l'emplacement géographique à choisir, comme le fait que les premières colonies grecques étaient situées près de la mer. Comme nous le savons aujourd'hui, une telle analyse de sécurité présente toujours des avantages et des inconvénients. Dans cet exemple antique, la proximité de la mer offrait un accès aux approvisionnements (eau, poissons) et des connexions avec d'autres territoires. Cependant, elle était également synonyme d'insécurité, qu'il s'agisse de forces naturelles (par exemple, les inondations) ou d'attaques extérieures. Des mesures de protection ont donc dû être mises en œuvre, telles que la nomination de gardes et la construction de fortifications.2 , 3
Avec l'essor du commerce, de nouvelles considérations sont apparues, notamment la nécessité de disposer d'itinéraires sûrs et de règles de conduite élémentaires. Un autre sujet de discussion est peut-être le moment où l'avidité - ou, autrement dit, la question de savoir qui possède le plus et occupe donc une position plus forte dans les négociations - a été mêlée aux préoccupations en matière de sécurité. Bien entendu, les voyages, le commerce, etc. ont également eu des effets sur les migrations et, comme aujourd'hui, ont soulevé des questions quant à savoir si elles devaient être perçues comme positives ou comme une menace. Il convient de mentionner que la plupart des spécialistes dans le domaine de la théorie de l'évolution ont jusqu'à présent estimé que la violence est un ingrédient inhérent à l'être humain qui doit être contrôlé par la civilisation. Mais un nouveau livre 4 écrit par un biologiste évolutionniste, un archéologue et un historien contredit cette théorie. À l'aide de nombreux exemples, ils affirment qu'avec l'arrivée des colons, la combinaison d'une propriété à protéger et d'autres personnes désireuses d'en faire autant, le conflit est devenu partie intégrante de notre nature.
Étant donné la complexité de la définition directe de la sécurité, une conceptualisation de la sécurité apportera peut-être plus de clarté. Trois questions fondamentales sont au centre d'un riche débat universitaire sur les concepts de sécurité. La première concerne le lien entre la sécurité et les valeurs. La deuxième concerne la question que Richard Ullman a formulée comme suit : à quoi serait-on prêt à renoncer pour obtenir plus de sécurité?5 Le troisième élément est la question de savoir qui doit assurer la sécurité de qui. Comme le souligne David A. Baldwin 6 , les différentes considérations de sécurité concernent "l'individu (certains, la plupart ou tous les individus), l'État (certains, la plupart ou tous les États), le système international (certains, la plupart ou tous les systèmes internationaux), etc. Cela signifie qu'en fonction du temps et des circonstances, la sécurité est influencée par différentes considérations concernant ce qui nécessite une sécurité ou ce qui devrait être sécurisé. Jaroław Prońko 7 affirme donc que "la vision du monde ainsi que les connaissances et l'expérience aident les humains à déterminer ce qui est important et précieux pour eux."
La question de M. Ullman met en évidence le fait que la sécurité a un coût, non seulement en termes de mesures nécessitant des investissements, mais aussi en termes de perte de liberté. Ce dernier point devient évident si l'on pense aux discussions les plus récentes autour des concepts de sécurité impliquant la reconnaissance faciale et l'utilisation de l'IA, par exemple la sécurisation des Jeux olympiques de Paris. De même, la réintroduction potentielle d'un service militaire obligatoire implique une certaine perte de liberté individuelle. Cela dit, il convient de lire ces déclarations sans se demander si la réduction inhérente de la liberté est nécessaire pour obtenir un niveau de sécurité plus élevé. La question reste de savoir qui doit juger de l'équilibre entre ces intérêts contradictoires.
Ces réflexions nous amènent au troisième point mentionné précédemment, à savoir qui doit assurer la sécurité. Beaucoup seraient probablement d'accord avec pour dire que "le monopole de l'usage de la force" est "un concept qui est fortement lié à l'idée d'un État qui assure la sécurité".8 De même, Arnold Wolfers9 a défini la sécurité comme une valeur "qu'une nation peut avoir plus ou moins et qu'elle peut aspirer à avoir dans une mesure plus ou moins grande".
À partir de cette description, il devient évident que la sécurité est avant tout une question de confiance. Confiance dans les moyens appropriés, abordables et les moins invasifs d'organiser la sécurité. Mais même si cette confiance était considérée comme acquise, sans l'implication active de l'individu, l'organisation de la sécurité serait impossible. Cela va bien au-delà de l'accomplissement éventuel d'un service militaire. La protection civile est ici un mot-clé sur lequel nous reviendrons au chapitre 9 à propos du concept de défense totale. Ken Booth10 souligne que l'action humaine (même en prenant une décision) est la réaction à un risque qui entraîne des conséquences (parfois indésirables) pour l'avenir.
Cela nous amène à la question de savoir comment définir un risque et s'il diffère d'une menace. Cette définition a-t-elle changé et, dans l'affirmative, pourquoi? Alors que le risque et son potentiel de nuisance sont aussi anciens que l'humanité, David Garland, dans sa publication de 2003 (11 ), a observé que le risque "est venu, de nulle part, occuper le devant de la scène dans la politique et la théorie sociale contemporaines". Cela signifie que le risque est un enfant de la modernité 12 qui traite des incertitudes de l'avenir. Par conséquent, la sécurité est à la fois une réalité et le sentiment d'une personne à l'égard d'une situation ou d'un scénario. Elle est à la fois réelle et hypothétique et, inévitablement, la (ré)action a des conséquences pour les autres. Permettez-moi d'illustrer cela en relation avec le débat actuel sur la réduction des risques, sur lequel nous reviendrons au chapitre 10, et qui porte sur la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Si certains affirment que la réduction des risques signifie que le commerce devrait principalement, voire uniquement, se faire avec des partenaires dignes de confiance, qui dit que ces partenaires peuvent satisfaire tous les besoins? Deuxièmement, si ce n'est pas le cas, est-il acceptable et réaliste de s'accommoder du fait que certains besoins ne peuvent plus être satisfaits? Et troisièmement, indépendamment de cette question, qui peut être sûr que le partenaire de confiance d'aujourd'hui le sera encore dans, disons, cinq ans? Cet aspect a été bien abordé dans une interview de l'experte américaine en sécurité Lisa Curtis13 , interrogée sur la coopération militaire dans le contexte des relations entre les États-Unis et l'Inde. L'interviewer s'est étonné du fait que les États-Unis aient mis fin à leur coopération avec la Turquie concernant l'avion de combat F35 en 2019, alors qu'ils viennent de conclure un accord de coopération sur les moteurs d'avion de combat avec l'Inde. Dans les deux cas, les accords militaires respectifs avec la Russie étaient une source de préoccupation, mais ont conduit à des décisions différentes.
Définir la sécurité
Définition de base de la sécurité : la sécurité est la protection de quelqu'un (un individu, un groupe ou une entité) qui perçoit un risque (ou du moins identifie une probabilité de menace) et qui, en conséquence, élabore des moyens d'atténuation afin d'être à l'abri du danger ou de pouvoir conserver ce qui a de la valeur.
Ce type de définition anticipée de la sécurité a été très présent lors de la récente pandémie de Covid. L'incertitude quant aux risques et l'évaluation changeante des mesures qui pourraient être efficaces ont entraîné une perte de liberté qui fait l'objet de nombreux débats aujourd'hui. Pourtant, la capacité de collaboration de la communauté scientifique a permis une stratégie de vaccination rapide, même si son déploiement a engendré des inégalités qui divisent la communauté internationale. En outre, certaines personnes se sont senties menacées par la façon dont la vaccination a été qualifiée d'inévitable. Cela démontre que les considérations de sécurité s'accompagnent souvent de dilemmes moraux. C'est pourquoi ce livre abordera également certains de ces aspects.
Différentes formes de sécurité
Outre la sécurité en termes de sûreté des individus ou des États, et donc de règles, de lois, de politiques et de militaires, la littérature aborde de nombreux autres aspects de notre vie quotidienne qui sont aujourd'hui liés à la sécurité. Les éléments examinés ci-après ne peuvent fournir qu'un aperçu limité. La question se pose alors de savoir pourquoi une description aussi partielle? La réponse est que les menaces dans ces domaines ont acquis une telle attention qu'elles ne peuvent être négligées ni par la politique ni par la réflexion sur les moyens de les prévenir.
Daniel W. Dezner a observé dans un article récent14 qu'"il est vrai que la mondialisation économique et l'évolution technologique rapide ont augmenté le nombre de menaces non conventionnelles ... ajoutant de nouveaux éléments au domaine de ... la sécurité sans se débarrasser des anciens".
Ce processus a débuté dès les années 1970 et a conduit, au fil du temps, à inclure les ressources et les questions liées à l'environnement et à la démographie dans les questions de sécurité. Ce fut également le début de ce que l'on appelle aujourd'hui la "définition élargie de la sécurité". David A. Baldwin affirme ainsi que "la sécurité économique, la sécurité environnementale, la sécurité identitaire, la sécurité sociale et la sécurité militaire sont des formes différentes de sécurité, mais pas des concepts fondamentalement différents".
En outre, l'identification d'une menace dans l'un de ces domaines conduit à ce que l'on appelle la titrisation. Le terme "titrisation 15 peut avoir différentes significations selon le contexte, mais il est le plus souvent utilisé dans deux domaines distincts : la finance et les relations internationales (études de sécurité). Alors qu'en finance, la titrisation est avant tout un outil économique permettant d'emballer et de vendre des actifs financiers, de répartir les risques et d'améliorer la liquidité, dans les relations internationales, il s'agit d'un processus politique et social dans lequel les problèmes sont présentés comme des menaces qui justifient des actions extraordinaires. Dans les deux cas, la titrisation consiste à faire passer quelque chose dans une nouvelle catégorie, soit en transformant des actifs en titres, soit en transformant des problèmes en menaces pour la sécurité. Dans ce chapitre, la titrisation concerne l'élévation d'une menace à un niveau existentiel, conduisant à des mesures d'urgence. Celles-ci risquent d'entraver (inutilement) les libertés individuelles. Toutefois, ce type d'attention portée à un problème peut également débloquer l'innovation, comme nous le verrons dans l'un des domaines décrits.
Nous examinerons ci-après les éléments relatifs à la sécurité environnementale, énergétique, sanitaire, hydrique et alimentaire. La sécurité environnementale a été indirectement mentionnée lors de l'ouverture en évoquant les moyens de vivre en fonction de l'endroit où l'on s'installe en termes géographiques. Aujourd'hui, la sécurité environnementale est liée à la durabilité et donc à des concepts visant à préserver l'avenir des prochaines générations sur terre. Le Fonds pour l'environnement mondial a défini dans son rapport de 201416 la sécurité environnementale comme "un ensemble de questions" qui implique le rôle que l'environnement et les ressources naturelles peuvent jouer dans la paix et la sécurité, y compris les causes environnementales et les moteurs de conflit, les impacts environnementaux des conflits, la récupération de l'environnement et la consolidation de la paix après les conflits.
Les discussions au niveau international ont porté sur des intérêts très différents (par exemple, le problème des déchets occidentaux en Afrique ou les îles du monde entier menacées par l'élévation du niveau des mers), y compris le débat complexe sur la nécessité d'une compensation de la part des nations plus riches ou des organisations internationales. Bien entendu, ces préoccupations sont étroitement liées à la question complexe des migrations.
Les préoccupations dans ce domaine ont également conduit à des actions telles que la loi européenne sur les matières premières, qui a été décrite à juste titre comme un exercice d'équilibre diplomatique : "L'Europe est donc prise dans un exercice d'équilibre diplomatique entre la Chine et les États-Unis. Dans le même temps, elle doit réfléchir attentivement à la manière de traiter avec les nouveaux acteurs émergents17
Conformément aux considérations exposées ci-dessus, le domaine suivant à mentionner est la sécurité énergétique18 , avec un accent sur l'énergie durable. Les progrès technologiques ont entraîné de nombreux changements dans ce domaine, depuis l'utilisation de base du feu et du bois, l'électrification des maisons et des villes, l'utilisation du charbon et de matériaux similaires pour le chauffage, jusqu'au chauffage central au gaz et à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Depuis l'avènement de l'électrification, la nécessité de garantir un approvisionnement suffisant - souvent par le biais du commerce - est devenue essentielle et, par conséquent, une question potentielle de conflit d'intérêts. Dans un souci de durabilité, les formes d'énergie renouvelables sont au centre de l'attention. En général, la disponibilité de l'énergie, son infrastructure, ses prix et son niveau d'efficacité ont des effets sur la société, l'environnement et la gouvernance. L'infrastructure est de plus en plus une question d'interopérabilité, alors que pour certaines parties du monde (par exemple l'Afrique), la disponibilité de l'énergie reste un besoin fondamental. Pour beaucoup, les coupures d'électricité signifient une limitation drastique de ce que nous considérons comme la vie quotidienne, allant du manque d'eau douce à l'interruption des services de santé, sans parler de l'impact sur l'industrie. Les mesures de sécurité sont coûteuses et la prévention des menaces a gagné en intérêt. Dans le même temps, la soif de toujours plus d'énergie est évidente, comme le décrit régulièrement l'Agence internationale de l'énergie.
Dans le passé, la santé et la sécurité étaient souvent considérées comme la relation entre les capacités militaires et les maladies ou comme une conséquence pour la santé humaine et la disponibilité des services de santé dans les conflits armés. Ebola a marqué un tournant en mettant en évidence le potentiel mondial des maladies infectieuses. Avec Covid, on a atteint un nouveau niveau de préoccupations en matière de sécurité et de mesures publiques drastiques. La garantie d'un fonctionnement efficace des services de santé publique ainsi que l'accès aux médicaments et aux vaccins sont devenus des éléments du débat public. Il est probable que cela reste le cas, car les scientifiques prévoient d'autres événements de cette nature. Par conséquent, les priorités en matière de sécurité nationale incluent les mesures correspondantes.
De même, la sécurité de l'eau à l'heure où le changement climatique entraîne une augmentation des sécheresses et une tendance croissante à l'urbanisation est devenue plus prioritaire que par le passé. Après l'été le plus chaud de l'histoire, marqué par une pénurie d'eau douce, les inondations de la mi-septembre en Europe centrale ont rappelé avec force ce problème de sécurité. Si l'on regarde à travers le monde, les besoins et donc les mesures implicites diffèrent grandement, sans parler du fait que les intérêts et les façons d'agir dépendent des connaissances et des ressources (financières) disponibles. Le rapport 2018 sur l'urbanisation mondiale19 indique que plus de la moitié de la population mondiale vit dans des zones urbaines, un chiffre qui devrait atteindre 68 % d'ici 2050. Par conséquent, les Nations unies ont élaboré un cadre pour la sécurité de l'eau, conformément à leurs objectifs de développement durable. Toutefois, comme nous l'avons déjà dit, un intérêt accru conduit également à l'innovation. Un article récent fait référence à la biodésalinisation à l'aide de bactéries, qui permet d'obtenir 965 litres d'eau purifiée à partir de 1 000 litres d'eau de mer. Outre une bien meilleure utilisation de l'énergie nécessaire, souvent grâce aux énergies renouvelables, ce système encore expérimental pourrait même fournir certains matériaux rares qui pourraient être intéressants pour l'industrie. 20
La sécurité alimentaire est influencée par l'évolution de l'environnement, la croissance démographique et, partant, l'augmentation des besoins et des intérêts économiques, ce qui entraîne notamment la déforestation. Ce débat et ces prédictions de pénurie n'ont rien de nouveau si l'on remonte à 1789. Cette année-là, le philosophe et économiste britannique Thomas Robert Malthus a publié un ouvrage très controversé intitulé "Essai sur le principe de population". Il y affirme que les populations vont croître jusqu'à ce qu'elles n'aient plus assez de ressources pour nourrir tout le monde. Il a en outre souligné le potentiel de conflit.21 Cependant, les critiques citent la révolution verte des années 1960 en Inde et la croissance de la population européenne après la Seconde Guerre mondiale, qualifiant sa théorie de dépassée. Bien que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ait publié une déclaration sur la sécurité alimentaire mondiale en 1996, il est trop évident que le monde est loin d'avoir atteint cet objectif. De même, le rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance a mis en évidence le lien entre durabilité, limitation des ressources et impacts environnementaux de la population et de la croissance économique. Publié en 1972, ce rapport utilise des modèles informatiques pour prévoir les conséquences d'une croissance économique et démographique incontrôlée sur les ressources de la planète. Toutefois, ces conclusions n'ont pas été exemptes de critiques.22 Si les conflits sont souvent à l'origine de ces catastrophes, les scientifiques mettent également en garde contre les changements environnementaux qui mettent en péril la continuité de l'approvisionnement alimentaire. En outre, l'avenir de l'agriculture, un sujet extrêmement complexe, consiste notamment à trouver un équilibre entre la nécessité de réduire les émissions et les intérêts (divergents) du commerce mondial. Enfin, la forte dépendance à l'égard des cultures et des engrais durables d'un nombre limité de producteurs est un autre facteur souvent considéré comme une question de sécurité.
Un domaine que l'on pourrait avoir oublié ici est celui de la cybersécurité23 . Mais cet aspect important a sa propre place dans ce livre, au chapitre 8.
De même, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, bien que mentionnée dans sa dimension historique au début, n'est pas détaillée ici, car elle mérite son propre chapitre. Nous renvoyons donc le lecteur au chapitre 10.
L'espace extra-atmosphérique est un domaine plus récent qui fait l'objet d'une attention croissante. Toutefois, pour ne pas perdre de vue notre objectif, nous nous abstiendrons d'entrer dans une description détaillée des défis à relever. Les lecteurs intéressés par ces aspects trouveront une excellente introduction dans le livre de Tim Marshall intitulé "The Future of Geography" (L'avenir de la géographie).
Pour conclure ces réflexions, il faudrait énumérer de nombreux autres éléments qui font l'objet d'un débat controversé, notamment la sécurité émotionnelle. Pour la jeune génération en particulier, il s'agit d'un défi à relever à une époque où l'on constate une connectivité toujours plus grande, mais aussi des niveaux élevés de solitude.
Évaluation des risques, sécurité et paix
Pour créer ou maintenir la sécurité, il est nécessaire d'évaluer les risques et les menaces. Une menace est un événement malveillant qui profite d'une vulnérabilité, tandis que le dommage est le résultat de la concrétisation d'une telle menace. Pour ce faire, il faut analyser et hiérarchiser la probabilité par rapport à d'autres menaces.
Le risque est toujours présent et il est souvent impossible de connaître tous les facteurs influençant le risque ou le niveau de risque à lui attribuer. Pourquoi le risque est-il omniprésent alors que les menaces sont qualifiées différemment? Le risque est présent dans toute activité, en particulier si l'on pense aux accidents qui se produisent souvent parce que nous sommes simplement distraits. De même, le risque d'être pris dans une catastrophe (naturelle) est quelque chose que nous devons accepter comme quelque chose que nous, en tant qu'individus, avons très peu, voire probablement aucun moyen d'influencer.
Cela nous ramène à la question que Daniel W. Dezner a soulevée dans son article mentionné plus haut. Comment une évaluation sérieuse des risques peut-elle avoir lieu si l'on a trop de questions sur la table? Ou comme il l'a dit : "Une fois qu'une menace pour la sécurité nationale a été établie, il est rare qu'une administration lui retire sa priorité. Il en résulte qu'il est plus facile de vendre de la sécurité que de la diplomatie". Ce qui a pour effet supplémentaire que "dans un monde où les budgets sont limités, les entrepreneurs de la politique sont prêts à présenter leurs problèmes favoris comme des problèmes de sécurité nationale pour débloquer des ressources". Tout ce dilemme est ce qui a été décrit précédemment comme la sécurisation, ce qui signifie également que "si tout est défini comme sécurité nationale, rien n'est une priorité de sécurité nationale", comme l'a fait remarquer Daniel W. Dezner.
Outre cette lutte, nous ne pouvons pas discuter de la question de la sécurité sans examiner la relation entre la sécurité et la paix. Si la sécurité est plus qu'une simple capacité de survie, c'est-à-dire la possibilité de prospérer, qu'est-ce que la paix?
Le dictionnaire Oxford précise que la paix est l'absence de trouble ou la tranquillité et donne comme exemple qu'"il voulait juste boire quelques bières en paix". Mais bien sûr, ce n'est pas de cette paix qu'il s'agit.
Si la paix est, dans son étymologie, un voeu souhaitant le bien de l'autre, elle remonte aussi aux mariages arrangés par la diplomatie pour maintenir des relations amicales avec les voisins. Si l'on regarde les exemples de la Grèce antique ou de l'époque romaine, il apparaît clairement que la paix n'est pas toujours obtenue par des moyens pacifiques, mais qu'elle peut aussi être obtenue par la force. Ou comme l'a dit Madeleine Albright dans une interview : "Je crois en la paixf , mais je ne suis pas pacifiste. Et je crois qu'il y a des moments où l'usage de la force peut réellement apporter la stabilité et sauver beaucoup de gens".24
Le sociologue norvégien Johan Galtung, récemment décédé, est probablement l'analyste le plus influent en matière de paix.25 Dans son article de 1969, il affirme que la paix doit être définie non seulement comme l'absence de violence, mais aussi comme la réalisation d'objectifs sociaux largement acceptés. Cela l'a amené à définir que la violence peut prendre différentes formes. La violence structurelle, qu'il associe à l'empêchement de satisfaire les besoins humains fondamentaux. En outre, il a défini la violence culturelle à travers les idées, le langage et l'art qui affectent souvent certains groupes de personnes. Et bien sûr, la violence directe, en tant qu'acte commis par une personne qui peut être rendue responsable du préjudice causé.
Plus important encore, il a plaidé en faveur de la résolution des conflits par le biais de la consolidation et du maintien de la paix. La consolidation de la paix nécessite non seulement d'examiner les causes profondes d'un conflit, mais aussi de disposer de la capacité de gérer la paix. Une autre considération dans ce contexte est la différenciation entre la paix négative et la paix positive. Alors que la paix négative est l'absence de violence, la paix positive nécessite des relations de collaboration et de soutien. De telles relations nécessitent des institutions. Nous examinerons ci-après certains développements clés, mais cet ouvrage proposera des réflexions plus détaillées sur les institutions dans les chapitres 4 et 5.
Pour ajouter une réflexion sous un angle différent, il convient de citer Christopher S. Browning : "Les spécialistes du tiersmonde, par exemple, ont fait valoir que la priorité accordée à la sécurité de l'État pouvait avoir du sens dans un contexte occidental et développé, mais qu'elle était moins convaincante dans les pays en développement où les structures étatiques cohésives étaient souvent absentes et où la légitimité interne des régimes en place faisait souvent défaut26.
Pour revenir à la question initiale, je dirais que la sécurité est un état caractérisé par l'absence de préjudice, nécessitant des mesures (parfois énergiques) pour établir et maintenir un tel état. La paix va plus loin et envisage des situations à moyen ou long terme et est souvent liée à des questions de justice, comme l'a dit l'évêque Desmond Tutu. L'obtention de la justice est souvent l'élément de négociation le plus difficile dans la construction de la paix. Pour qu'un tel processus soit couronné de succès, les institutions sont inévitables.
Questions institutionnelles relatives à la sécurité
Le besoin d'institutions et la question de la dimension mondiale de la sécurité font l'objet d'un débat de longue date. Emmanuel Kant, dans son Droit cosmopolite, établit une distinction entre les États et les individus ayant des relations avec d'autres États ou individus, soulignant que l'entrée sur le territoire d'un autre État doit rester une décision libre de l'État d'accueil. Un refus ne doit pas conduire à la destruction de l'autre. En même temps, il était en faveur d'une citoyenneté mondiale afin d'établir un ordre global.
En outre, Kant, dans son ouvrage intitulé "La paix perpétuelle g a reconnu la nature mondiale de la sécurité en déclarant que "les peuples de la terre ont atteint un stade de communauté tel qu'une violation des droits en un lieu est ressentie partout". Cela ressemble beaucoup au monde interconnecté d'aujourd'hui.
Le concept de liberté et d'égalité de Jean Jacques Rousseau signifie que "d'abord, les libertés civiles - la liberté politique : la sécurité et la sûreté des citoyens - ne peuvent être violées ni par les torts de l'individu , ni par ceux de l'État. Les personnes ont intrinsèquement le droit de protéger leur sécurité, mais lorsqu'elles concluent le contrat social, elles confient leur sécurité à la société civile. Cela implique que l'État a l'obligation de protéger cette sécurité".
Les déclarations sont une combinaison intéressante de libertés et d'obligations que l'époque des Lumières a encouragées et favorisées. En même temps, il est fait référence aux États, bien que les États au sens d'États-nations soient apparus plus tard dans l'histoire. Alors, quand qualifierait-on un accord de paix basé sur des institutions? Je dirais que le traité de Westphalie (1648), à la différence du traité d'Utrecht (1713), devrait être considéré comme fondé sur des institutions. Le premier s'est déroulé sous la forme d'un congrès, ou plus exactement de deux congrès parallèles. En outre, une grande partie des discussions sur les conditions d'un accord ont été menées par des légations. En outre, les conditions comprenaient, outre le règlement (dans une certaine mesure) des intérêts divergents qui étaient à l'origine de la guerre de Trente Ans, également des questions relatives à une (certaine) compensation des dommages. Cependant, comme lors du congrès de Vienne, tous les participants n'étaient pas égaux.27
La formation de partenariats de sécurité est un autre développement qui a été renforcé par ces accords fondés sur des traités. Bien entendu, la stabilité de ces programmes de soutien a souvent été de courte durée. Bien plus tard, ces partenariats de sécurité sont devenus ce que l'on appelle la sécurité collective. Cela signifie que les membres d'un tel accord de coopération s'engagent non seulement à renoncer à l'usage ou à la menace de la force mais, plus important encore, à garantir réciproquement une assistance militaire en cas d'agression ou de menace militaire à l'encontre d'un ou de plusieurs membres. Le traité de Locarno de 1925 et, bien sûr, l'OTAN sont des exemples connus d'organisations de sécurité collective. Les raisons d'adhérer à de tels régimes sont multiples, souvent motivées par la prise de conscience que les moyens dont on dispose ne permettent pas d'assurer un niveau de sécurité suffisant. Mais pour cela, il faut partager les valeurs sous-jacentes et avoir généralement confiance dans les autres membres. On peut également penser à une sécurité collective gérée par un membre principal tandis que les autres (sous une certaine pression) se contentent de suivre et de partager leurs moyens de dissuasion.
Les derniers efforts de l'Union européenne pour soutenir les garanties de sécurité de l'OTAN par le biais du partage des charges et de la division du travail (voir les déclarations conjointes UE-OTAN) sont un autre exemple de système de sécurité collective. Il reste à voir quelle place l'Union européenne peut prendre dans le système de collaboration. De même, les effets de la présence d'un commissaire européen à la défense sont encore inconnus.
Lorsque l'on parle d'institutions liées à la sécurité, il faut en citer quelques autres, même si certaines d'entre elles se sont retrouvées, récemment, dans des eaux troubles. Je commence par les Nations unies, surtout connues pour leurs missions de maintien de la paix et le Conseil de sécurité qui se penche régulièrement sur les situations de conflit afin de trouver un terrain d'entente sur la question de savoir s'il faut agir pour rétablir la sécurité, voire la paix, et comment le faire. Un chapitre spécifique sera consacré aux défis actuels.
Un principe doit être mentionné dans ce contexte, à savoir le droit de protéger, qui a été établi par la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États. Bien que cette commission ait remis son rapport sur la signification du droit de protéger et sur les cas dans lesquels les interventions humanitaires peuvent porter atteinte à la souveraineté de l'État, le débat sur ces principes se poursuit encore aujourd'hui. Un aspect clé est la question de la défense préventive, où le dilemme moral est apparent : qu'est-ce qui pèse le plus : la souveraineté de l'État ou la nécessité d'éviter une catastrophe humanitaire (par exemple, un génocide)? Un autre débat tourne autour de la notion de "grande échelle", un terme vague dont la définition dépend souvent de la quantité de preuves objectives qui peuvent être produites et obtenues. La Cour pénale internationale a développé des stratégies pour soutenir les pays touchés par de tels actes malveillants.
Mary Kaldor affirme que "l'on tient pour acquis que la seule alternative à la négociation politique est l'intervention militaire, à laquelle l'Occident est réticent et les autres puissances opposées". Par conséquent, je mentionnerai deux angles supplémentaires de la dimension institutionnelle de la sécurité, qui ne sont pas non plus en mesure de remplir leur mandat compte tenu de la situation mondiale actuelle. Le premier est l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), une organisation dont le mandat s'articule autour de trois axes. Le premier est la coopération politico-militaire qui doit permettre d'éviter les conflits (armés). Le deuxième est la promotion de la paix par le biais d'une démocratie durable et du développement économique. Le dernier s'articule autour des droits de l'homme. Comme indiqué précédemment, les divergences de vues ont entraîné le blocage de cette organisation.
L'autre qui doit être mentionné est le TNP (Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires), un instrument qui a longtemps maintenu l'équilibre des pouvoirs sur la base de la doctrine de la destruction mutuelle assurée (DMA). Cela signifiait et signifie toujours que toute utilisation à grande échelle d'armes nucléaires conduirait à terme à l'éradication de l'humanité sur terre. Toutefois, ce concept d'équilibre des pouvoirs n'a pas eu pour effet de réduire le nombre de pays dotés de capacités nucléaires ; au contraire, un plus grand nombre de pays possèdent aujourd'hui des armes nucléaires. Malgré une réduction du nombre de têtes de guerre aux États-Unis et en Russie, les mécanismes de contrôle sont aujourd'hui si défaillants que les chiffres actuels relèvent plus de la conjecture que de l'objectivité.
Une question pertinente qui en découle est de savoir s'il est possible de revenir à une ère plus consultative et s'il est possible de renforcer ces institutions ou d'identifier des alternatives viables. Malheureusement, trop de dirigeants semblent privilégier le conflit, conformément à la théorie du général prussien Carl von Clausewitz qui affirmait que la guerre mène en fin de compte à la paix. Cette perspective, à mon avis sarcastique, et ses conséquences ont été bien décrites dans un article de la NZZ intitulé "La guerre permanente assure en Russie et au Congo le pouvoir des kleptocrates". L'auteur affirme que le concept de Clausewitz "en théorie" peut fonctionner, mais qu'en pratique, il ne fait que dissimuler la faiblesse qui conduit à l'exploitation du pays par ceux qui sont au pouvoir.28
Une dernière réflexion sur les institutions et la sécurité. Dans les démocraties modernes, un autre élément important est présent, le contrôle civil de l'armée. 29 Les exemples les plus marquants sont les dispositions constitutionnelles qui limitent les pouvoirs de décision de l'armée. Bien que l'on puisse parfois entendre des critiques selon lesquelles cette construction ralentit la prise de décision, je dirais qu'il s'agit d'un autre niveau de contrôle et d'équilibre, conformément à la citation susmentionnée de Mme Kaldor. Compte tenu notamment de la nécessité de prendre des décisions immédiates dans certaines circonstances, des dispositions ont été introduites pour permettre une autorisation rétroactive. Cela permet au moins de suivre l'évolution de la situation et, le cas échéant, de réajuster les mesures.
Évolution historique du concept de sécurité
Cette section pourrait, en théorie, remplir un séminaire universitaire entier et ce texte ne peut donc être qu'une illustration des nombreux aspects de la sécurité.
Dans son ouvrage "Le Léviathan" de 1651, le philosophe Thomas Hobbes définit une vie sans sécurité comme "solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte".30 Cette citation est mise en exergue parce qu'elle révèle un dilemme clé inhérent à la sécurité : ses valeurs sous-jacentes et ses attentes. Par exemple, si nous manquions d'eau pour boire et cuisiner, la vie serait plutôt misérable et, en fin de compte, menacerait la vie. En effet, il s'agit d'un risque pour la sécurité. Toutefois, comme l'a déclaré à juste titre David A. Baldwin, "le roi Midas a appris il y a longtemps que ... la valeur de quelque chose ... est le résultat de conditions sociales externes". La question se pose donc de savoir si la sécurité en tant que valeur est beaucoup plus importante que d'autres valeurs dans la vie. Mais comme nous le savons tous, la sécurité absolue n'existe pas.
Outre cette complexité, le débat sur la sécurité au cours des années 1960 a été influencé par les "paradoxes de la proximité".31 Avec l'augmentation de l'interconnectivité et de la mondialisation, les effets ont souvent été quelque peu idéalisés tandis que les facteurs de risque n'étaient analysés que dans certains cercles. Cependant, la tendance à considérer la sécurité dans son contexte global a vu le jour. Mais la question se pose alors de savoir qui doit assurer la sécurité mondiale : la charte des Nations unies, l'OTAN, les organisations régionales telles que l'Union africaine ou l'ANASE? Christopher Daase commente que "la régionalisation du maintien de la paix est ambivalente".32 De plus, il affirme que "les problèmes de sécurité étaient traditionnellement reconnus comme des menaces basées sur la connaissance des acteurs hostiles ... et des capacités militaires". Mais aujourd'hui, les menaces hybrides, parfois combinées à une agression militaire (potentielle), constituent probablement le problème le plus important. C'est pourquoi, comme l'écrit M. Daase, nous avons besoin d'une politique de sécurité plus proactive.
En 1993, le professeur Stefan Fröhlich a publié ses réflexions sous le titre "la sécurité devient multidimensionnelle". 33 Les changements intervenus en Europe après les révolutions de 1989 étaient encore très récents. Le débat s'est donc concentré sur la question de savoir si les troubles économiques pouvaient devenir le véritable danger de l'époque.
En 2005, le professeur Eckart Conze a écrit sur "la quête de sécurité". La nature changeante de la sécurité, du point de vue de l'Allemagne de l'Ouest , est décrite comme suit : "Au cours des années 1950, la République fédérale s'est concentrée sur la sécurité extérieure contre l'Union soviétique. Les mouvements écologistes des années 1970 et 1980 ont mis en péril la sécurité des ressources naturelles. Depuis les années 1990, les travailleurs craignent la perte de la sécurité de l'emploi et l'érosion des systèmes de sécurité sociale en raison de la mondialisation. Enfin, le terrorisme international pourrait avoir entraîné un "retour de l'insécurité" depuis 2001". 34 Toutefois, comme nous l'avons décrit précédemment, aucune des préoccupations antérieures en matière de sécurité n'a complètement disparu. Le cocktail des questions de sécurité est devenu plus riche, peut-être même légèrement flou, confus.
Le dernier exemple en date de ce cocktail de menaces est l'espace. Les exemples suivants illustrent le double aspect de la sécurité et de l'espace. Plusieurs analystes ont examiné le concept stratégique de l'OTAN en mettant l'accent sur l'espace extra-atmosphérique. Dans le résumé, on peut lire : "La coopération spatiale entre les États membres de l'OTAN est essentielle pour faire face à l'évolution des défis posés par d'éventuelles activités militaires dans l'espace. Cette coopération s'articule autour de trois éléments clés : les applications polyvalentes de l'espace, le nombre croissant d'acteurs, de capteurs et de systèmes, et les progrès rapides de la technologie. Ces éléments ont créé de nouvelles opportunités tout en introduisant de nouveaux risques, vulnérabilités et menaces pour la sécurité et la prospérité des Alliés. L'OTAN doit donc évaluer de manière critique comment elle peut maintenir son avantage stratégique dans l'espace, de la même manière qu'elle le fait dans les quatre autres domaines opérationnels interconnectés, en réponse à l'importance croissante de l'espace dans la guerre moderne".35
Le lecteur peut maintenant se demander ce qu'il en est de l'autre côté. Peggy Hollinger a écrit en mai 2024 sur les capteurs orbitaux qui pourraient aider les entreprises à atteindre leurs objectifs climatiques.36 Bien que cette technologie soit encore très récente, que les coûts créent pour l'instant des barrières et que les réglementations soient plutôt disparates, l'article fait référence au potentiel, à savoir qu'après le lancement l'année dernière de "son premier satellite détecteur de CO₂", GHGSat "espère élargir la gamme des polluants qu'il détectera depuis l'espace, aux oxydes d'azote ou de soufre et à d'autres." En outre, "d'autres start-ups, comme l'israélienne Momentick, développent également des algorithmes pour explorer les données recueillies par les satellites existants, au lieu de faire voler leurs propres constellations. La constellation Copernicus de l'Union européenne est la plus grande constellation d'observation de la Terre au monde et les données recueillies par ses satellites Sentinel sont libres d'utilisation. L'utilisation de logiciels intelligents pour exploiter cette infrastructure existante permet de réduire les coûts. Ces innovations positives ainsi que les projets visant à limiter les effets néfastes d'une trop grande quantité de débris spatiaux posent la question de la sécurisation de l'espace extraatmosphérique. J'ajoute ici que les situations dangereuses créées récemment par le brouillage du signal GPS, largement utilisé, posent un grave problème de sécurité et mettent en évidence l'absence de règles applicables.
Une dernière tendance doit être mentionnée, à savoir ce que le Dr Sabine Selchow a appelé la "dynamique d'une "internationalisation" des questions de sécurité (mondiale)". Je le mentionne à la fin de ces réflexions pour souligner l'aspect souligné dans le chapitre récemment cité, à savoir "faire participer le public" et créer ainsi "un environnement de sécurité qui rend les individus responsables de la sécurisation". Mais cela signifie-t-il que nous devrions nous contenter d'être attentifs ou que nous devrions nous sentir profondément concernés? Une telle attitude créerait-elle, ou a-t-elle créé, un sentiment général d'insécurité en percevant certains groupes de personnes ou comportements comme des menaces inhérentes à la sécurité? Quel niveau de sécurité peut-on atteindre?
Ce chapitre a fait référence à plusieurs reprises à la nature relative de la sécurité. Nous avons vu qu'elle dépendait d'un ensemble de valeurs, de circonstances générales de la vie, de tendances, etc., laissant de côté l'adage bien connu de l'impossibilité d'une sécurité absolue.
Lors de mes recherches pour ce chapitre, je me suis également demandé si l'on pouvait trouver des données quelque peu fiables sur la manière dont la sécurité est répartie dans le monde. Bien sûr, ceux qui suivent l'évolution de la situation, que ce soit pour des raisons professionnelles ou parce qu'ils voyagent souvent, savent où nous en sommes aujourd'hui. Mais de manière beaucoup plus générale, qui pourrait dire que la sécurité dans tel ou tel pays est, sur une échelle de 1 à 10, d'un niveau x? Je suis sûr que le lecteur sait que je reviens sur ce qui a été exposé tout à l'heure, de quelle sécurité parle-t-on? Que je puisse entrer et sortir du pays sans difficultés, que j'aie accès à de l'eau potable et à des aliments sains ou que je puisse accéder à l'internet, que ce soit pour les affaires ou les loisirs? Il existe en effet plusieurs sources permettant d'identifier les destinations à risque. Cependant, je dirais que c'est souvent du point de vue de ceux qui établissent ces classements indubitablement utiles. Aucun d'entre eux ne donne une bonne vue d'ensemble de la situation d'un pays ou d'une région par rapport aux nombreux aspects de la sécurité.
Cette section aborde trois aspects de la sécurité. Le premier concerne la question de savoir qui assure la sécurité, le deuxième celle de savoir quel niveau de sécurité est suffisant et le dernier celle de quelques scénarios de sécurité concrets.