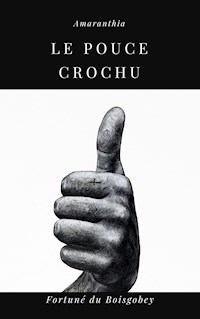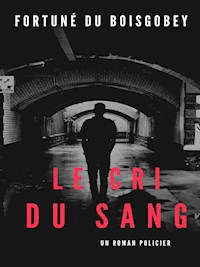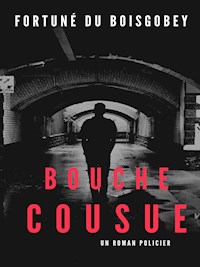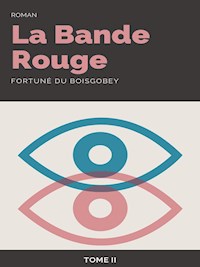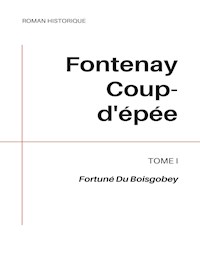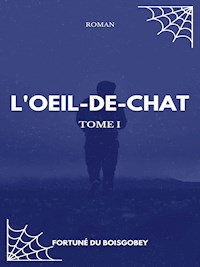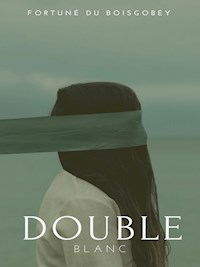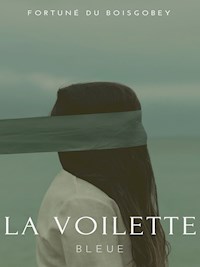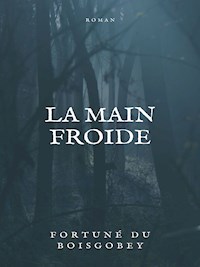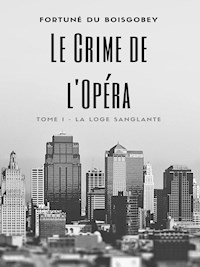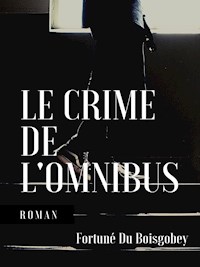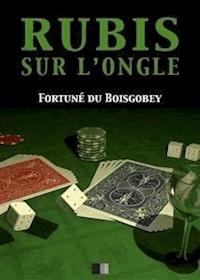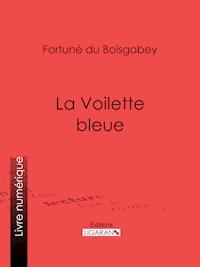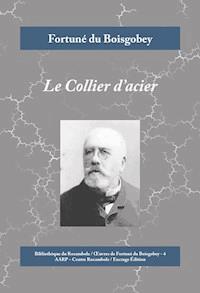Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encrage Édition
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Œuvres de Fortuné de Boisgobey
- Sprache: Französisch
Quand l'aristocratie enquête autour d'un crime
Fortuné du Boisgobey débute réellement sa carrière de romancier par les romans « judiciaires » dont le thème principal est la narration d’une action criminelle et de la lutte entreprise contre son ou ses auteurs. Ce roman-ci possède la particularité d’une construction en deux temps, après avoir débuté, de manière très moderne pour l’époque, par une séquence anticipée.
Le schéma principal de la première partie est celui qui va très souvent s’imposer à l’auteur : un personnage de la classe aristocratique, ici le vicomte Henri de Servon, se trouve confronté à un mystère d’apparence criminel et décide d’enquêter à son sujet ; ce qui ne va pas forcément sans risque puisqu’il finit par se retrouver en prison… Et il se trouve confronté à un mystérieux étranger, M. de Pancorvo, un Sud-Américain fort riche.
La seconde partie repose sur un procédé typique des feuilletons du Second Empire : le récit rapporté. Ici, il n’est pas question de manuscrit retrouvé ou de confession in extremis, mais du témoignage, à la barre d’un tribunal, d’un personnage qui sait ce qui s’est passé et va pouvoir révéler le fin mot de l’histoire.
A noter l’intervention du policier Jottrat, personnage qui sera l’un des héros principaux d’un prochain roman,
Disparu !
Le roman est publié d’abord dans le
Petit Moniteur Universel du Soir, du 10 juin au 14 août 1869 ; il paraît en librairie chez Dentu en 1878, sous le titre :
Une affaire mystérieuse.
A l'aide du policier Jottrat, Fortuné du Boisgobey livre un roman policier rythmé, dont l'intrigue judiciaire est élégamment construite.
EXTRAIT
Les événements politiques qui remplirent les six premiers mois de 1848 ne laissaient guère de place à d’autres préoccupations.
L’intérêt qui s’attache aux curiosités judiciaires s’était reporté tout entier sur les combats de la rue ou sur les luttes de la tribune, et les faits singuliers qui se déroulèrent à cette époque dans le monde parisien le plus élevé passèrent à peu près inaperçus.
Après la révolution de février, les clubs élégants étaient restés longtemps déserts ; mais, vers la fin de l’été, les fidèles de la vie à grandes guides commencèrent à reprendre leurs habitudes.
On revenait dîner au Café de Paris ; on retournait au théâtre ; on se remettait à jouer et à souper.
A jouer surtout.
Il semblait qu’on voulût se dédommager d’une interruption forcée, et l’on reprit les parties avec une ardeur qui s’expliquait peut-être aussi par l’incertitude de l’avenir.
C’était surtout dans un des cercles les plus renommés du Paris d’alors que les gros joueurs se donnaient rendez-vous, et, chaque nuit, autour d’une table de baccarat dressée au milieu du grand salon rouge, on perdait et on gagnait des sommes énormes.
A voir l’or et les billets de banque s’entasser sur le tapis vert, on ne se serait pas douté que les valeurs industrielles étaient en baisse et que les fermages ne se payaient guère.
L’argent, qui se cachait partout et qui fuyait les affaires, se montrait hardiment au jeu, et changeait de mains entre une heure et cinq heures du matin avec une facilité incroyable.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Fortuné du Boisgobey est né en 1821 et mort en 1891. Écrivain emblématique du XIXe siècle, il s'est essayé au genre du roman policier, judiciaire et historique. Ayant connu un succès considérable de son vivant, il est considéré comme l'un des plus grands feuilletonistes de la littérature française. Il fut à la tête de la Société des Gens de Lettres entre 1885 et 1886.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage est proposé dans le cadre des ressources du Centre Rocambole accessible par Internet à l’adresse :
www.lerocambole.net
Bibliothèque du Rocambole
Œuvres de Fortuné du Boisgobey - 2
collection dirigée par Alfu
Fortuné du Boisgobey
L’Homme sans nom
(Une affaire mystérieuse)
1869
AARP — Centre Rocambole
Encrageédition
© 2011
ISBN 978-2-36058-902-9
Préface
d’Alfu
Fortuné du Boisgobey 1débute sa carrière de romancier — si l’on exclut quelques essais de jeunesse — par les romans « judiciaires » dont le thème principal est la narration d’une action criminelle et de la lutte entreprise contre son ou ses auteurs.
Ce roman-ci possède la particularité d’une construction en deux temps, après avoir débuté, de manière très moderne pour l’époque, par une séquence anticipée, autrement dit la relation d’un épisode qui ne pourra être réellement compris par le lecteur que plus tard quand l’ensemble de l’histoire lui aura été conté.
Le schéma principal de la première partie est celui qui va très souvent s’imposer à l’auteur : un personnage de la classe aristocratique, ici le vicomte Henri de Servon, se trouve confronté à un mystère d’apparence criminel et décide d’enquêter à son sujet ; ce qui ne va pas forcément sans risque puisqu’il finit par se retrouver en prison… Et il se trouve confronté à un mystérieux étranger, M. de Pancorvo, un Sud-Américain fort riche — dont M. de Noreff, le comte Borodino, Wilfrid Wassmann et tant d’autres seront les dignes successeurs dans l’œuvre de l’auteur !
La seconde partie repose sur un procédé typique des feuilletons du Second Empire : le récit rapporté. Ici, il n’est pas question de manuscrit retrouvé ou de confessionin extremis, mais du témoignage, à la barre d’un tribunal, d’un personnage qui sait ce qui s’est passé et va pouvoir révéler le fin mot de l’histoire.
Dans cette histoire-là, il est question de marine — autre grand thème des romans populaires de l’époque, d’Eugène Sue à Jules Verne ! Et même de plongée sous-marine.
Et il est question de duel… en chambre !
Mais il est aussi question d’enquête policière, avec relevé d’indices et inductions.
« Robert avait assisté souvent dans son bourg de Whitstable à des paris engagés sur ces machines, qui se composent de deux roues séparées par un siège étroit, et il avait été émerveillé de la vitesse avec laquelle elles franchissaient l’espace. […]
Les ressorts, rouillés comme s’ils avaient séjourné longtemps dans l’eau, étaient en partie brisés, et Robert apprit que les gamins venaient de découvrir cet instrument au fond d’une citerne abandonnée. […]
Du choc imprévu de ses pensées, un rapprochement avait jailli.
Ce berger qui, dans la nuit du crime, avait vu passer un voyageur fantastique, cette course diabolique sur un appareil étrange, tout lui était expliqué. » (p. 161)
Enfin, le moindre mérite de ce roman n’est pas de dénoncer une pratique ayant encore malheureusement cours en plein dix-neuvième siècle : la traite des Noirs.
A noter pour finir, l’intervention d’un personnage qui sera l’un des héros principaux d’un prochain roman : le policier Jottrat 2.
Le roman est publié d’abord dans lePetit Moniteur Universel du Soir, du 10 juin au 14 août 1869 ; il paraît en librairie chez Dentu en 1878, sous le titre :Une affaire mystérieuse.
1Pour une approche plus complète de l’auteur et de son œuvre, lire le n°1 de la revueLe Rocambole.
2LireDisparu !dans la même collection.
Prologue
L’été de 1846 touchait à sa fin. Par une magnifique journée du mois de septembre, deux douaniers achevaient leur faction sur la côte escarpée qui borde l’entrée du golfe de Saint-Tropez, dans le Var.
Il était près de midi, et il faisait une chaleur torride.
Pour s’abriter du soleil, ils s’étaient couchés à l’ombre d’un buisson de lentisques qui les cachait parfaitement, et tout près d’une fontaine dont le voisinage leur donnait un peu de fraîcheur.
A leurs pieds s’étendait à perte de vue la Méditerranée, unie et calme comme un lac.
Un temps pareil n’est pas favorable aux contrebandiers, et il y avait bien peu de chances de faire une capture.
D’ailleurs, on n’apercevait pas une voile. Du bleu partout, sauf un petit noir à l’horizon qui pouvait bien être un nuage ou un rocher.
Au bout d’une demi-heure, il sembla aux douaniers que le point noir grossissait.
Une heure après, il n’y avait plus de doute : le point noir était une barque, et cette barque venait droit sur la côte.
Cela n’avait rien que de très naturel.
Au bout de deux heures, la barque était à une portée de fusil de la plage, et on distinguait parfaitement l’homme qui la conduisait.
Cet homme était seul et ramait vigoureusement de ses deux avirons ; il s’arrêtait de temps en temps et semblait chercher à reconnaître un point du rivage.
Les deux douaniers, couchés sur le haut de la falaise, étaient complètement invisibles.
Bientôt le rameur parut avoir trouvé ce qu’il cherchait, car il aborda, sauta à terre et tira sa barque un peu sur le sable, pour que le flot ne l’entraînât pas.
Après cette opération, il regarda encore la côte, comme pour s’assurer qu’elle était déserte, et, satisfait sans doute du résultat de son examen, il se mit à courir à toutes jambes vers la falaise.
Les douaniers pensèrent que cela valait la peine d’être observé, et ils observèrent.
L’homme grimpait sans hésiter par un étroit sentier qui conduisait en droite ligne à la fontaine.
Ils le voyaient maintenant de très près. Ce n’était pas un pêcheur de la côte : les douaniers les connaissaient tous.
C’était au moins singulier.
Arrivé au haut de la falaise, l’homme s’arrêta un instant, regarda autour de lui, et, ne voyant personne, il courut à la source, se jeta à plat ventre, et se mit à boire à pleine bouche et à même la fontaine.
Evidemment il mourait de soif.
Il but longuement, se trempa la tête, s’aspergea, barbota pendant un grand quart d’heure.
Puis il se releva, regarda encore à droite et à gauche, et parut se disposer à regagner sa barque.
A ce moment, les douaniers jugèrent convenable d’apparaître.
Ils n’avaient à l’endroit de cet inconnu aucune idée bien arrêtée ; mais il leur semblait étrange qu’on vînt de la pleine mer exprès pour boire à une fontaine.
Ils se dressèrent donc tout à coup, et leur brusque apparition produisit sur le buveur un effet extraordinaire.
Il se mit aussitôt à dégringoler par la falaise, dans la direction de sa barque.
Il courut comme une chèvre et du pas d’un homme qui a fréquenté longtemps le pays.
Un homme qui se sauve est toujours suspect, et, dans tous les pays, on court après lui.
Les douaniers n’eurent garde de manquer à cet usage.
Ils rejoignirent le fuyard, et ils lui mirent la main au collet au moment où il touchait presque à la barque.
L’homme se débattit vigoureusement ; mais après une courte lutte, il fut terrassé et solidement attaché.
Il avait le regard effaré d’une bête fauve prise au piège, et il portait au front une blessure récente.
Son costume se composait d’un pantalon de toile à voiles et d’un chapeau de paille troué comme une écumoire.
Pas de paletot, pas de chemise, pas de souliers. Les marins provençaux ne s’habillent pas comme les canotiers de la Seine ; mais enfin ils s’habillent, et l’inconnu n’était pas habillé du tout.
Une toilette aussi succincte était éminemment suspecte. Ce fut bien pis quand on examina la barque ; elle était aussi nue que l’homme qui la montait : elle contenait deux avirons, et pas autre chose.
Ni mât, ni voile, ni gouvernail ; pas de provisions, pas même une cruche d’eau ; pas de nom ni de numéro à l’arrière.
Les douaniers commencèrent à questionner l’inconnu, mais ils n’en tirèrent aucune réponse. Assez embarrassés de leur capture, ils se décidèrent à le conduire au bourg le plus voisin, qui possédait un juge de paix et une prison.
L’homme se laissa mener sans résistance et sans prononcer une parole. Ce n’est qu’en arrivant à la geôle qu’il ouvrit la bouche pour dire : « J’ai faim ».
On lui donna un pain de munition qu’il dévora en quelques minutes, et on alla chercher le juge de paix, qui l’interrogea sans pouvoir en obtenir une réponse, et qui, ne sachant trop qu’en faire, l’expédia entre deux gendarmes au chef-lieu de l’arrondissement, comme prévenu de vagabondage.
Un vagabond de la mer !
Là, le juge chargé de l’instruction essaya à son tour de faire parler cet étrange prisonnier. Mais toute l’habileté d’un magistrat habitué à déjouer les ruses des prévenus vint échouer contre une défense bien simple.
L’inconnu ne mentait pas : il se taisait.
Ce silence obstiné donnait à un vulgaire délit de vagabondage les proportions d’une grosse affaire criminelle.
Un homme qui refuse de dire ce qu’il est, ce qu’il a fait, d’où il vient, doit avoir pour se taire de bien graves motifs, quand il sait que ce refus peut le retenir longtemps en prison. D’ailleurs, on ne vient pas presque nu se rafraîchir sur une côte déserte ; on ne se promène pas sans vêtements, sans eau et sans vivres dans une barque sans numéro.
Il y avait là un mystère qui cachait très probablement un crime.
— Mais lequel ?
La première idée qui se présentait était celle d’un massacre en pleine mer, commis par l’équipage révolté de quelque navire ; mais alors, comment ce malheureux se trouvait-il abandonné dans ce canot délabré ?
Une circonstance ajoutait encore à l’obscurité qui couvrait cette affaire.
Pour trouver la fontaine, qu’on n’apercevait pas de la mer, il fallait avoir pratiqué la côte.
L’homme était donc déjà venu dans ce pays, où cependant pas un habitant ne le reconnaissait. L’examen de sa personne ne pouvait guère aider à éclaircir ce mystère.
Il n’était ni vieux ni jeune, ni beau ni laid, ni gras ni maigre.
Ce n’était pas ce qu’on appelle un homme comme il faut ; ce n’était pas non plus un paysan ni un matelot.
En un mot, on voyait très bien ce qu’il n’était pas ; on ne voyait pas du tout ce qu’il était.
En présence de cette énigme vivante, le juge se trouva fort embarrassé.
C’était un magistrat encore jeune et plein de zèle ; il avait à sa disposition les moyens si nombreux et si puissants dont la loi a armé l’instruction criminelle, et il résolut de les employer tous, s’il le fallait.
Il commença par faire venir de Toulon des agents de la chiourme, car on pouvait avoir affaire tout simplement à un évadé du bagne.
Ces agents déclarèrent que l’inconnu n’avait jamais été leur pensionnaire.
Il s’adressa à tous les parquets de France et d’Italie, en leur envoyant le signalement de l’individu, pour savoir s’il ne s’appliquait pas à quelque fugitif de leur ressort. Il reçut de tous des réponses négatives.
Il écrivit dans tous les ports des côtes voisines pour demander si une barque n’avait pas été volée quelque part.
Aucun des renseignements obtenus ne parut se rapporter au canot monté par le prisonnier.
Le juge se décida à mettre en œuvre ces misérables qu’on appelle en argot de prison desmoutons, c’est-à-dire qu’on donne au pauvre diable deux compagnons de chambre chargés de l’épier et de le faire parler.
Ils en furent pour leurs frais d’éloquence.
Le camarade, qui causait volontiers sur des sujets indifférents, leur glissait entre les doigts dès qu’il voyait poindre la moindre allusion à ses aventures.
Enfin on était allé jusqu’à user d’un moyen extrême : on avait pris les noms des malfaiteurs évadés ou contumaces dont les signalements offraient quelque ressemblance avec l’inconnu, et, la nuit, au milieu de son sommeil, on le réveillait brusquement en l’appelant d’un de ces noms-là.
On espérait que si on tombait sur le sien, il ne serait pas maître d’un premier mouvement.
Jamais il ne s’y laissa prendre.
Arrivé à ce degré de mystère, l’affaire prenait les proportions d’une lutte d’amour-propre entre le juge et l’homme-problème.
Mais on ne pouvait prolonger indéfiniment la situation et tenir l’inconnu en prison préventive jusqu’à ce qu’il lui plût de parler.
De guerre lasse, on le renvoya comme vagabond devant le tribunal de police correctionnelle.
Son affaire avait attiré à l’audience toute la population de la petite ville, et même quelques étrangers qui étaient venus passer l’automne en Provence.
L’un d’eux, le vicomte Henri de Servon, camarade de collège du juge d’instruction, chez lequel il était venu prendre domicile pour un mois, s’était intéressé à cette histoire avec la curiosité d’un Parisien désœuvré.
Il était allé voir l’inconnu en prison, et il se trouva au premier rang à l’audience.
Le prévenu ne se présenta pas vêtu du costume par trop succinct qu’il portait dans sa barque. On lui avait donné les habits de la prison : veste et pantalon de grosse laine.
C’était un homme de taille moyenne, plutôt grand. Il devait avoir de quarante-cinq à cinquante ans. Ses cheveux et sa barbe, qu’il portait tout entière, étaient restés très noirs. Ses traits, peu réguliers, n’étaient pas déplaisants, et ses yeux bruns avaient une expression douce et intelligente.
Le soleil avait répandu sur sa peau une teinte de bistre qui dénotait une profession exposée à l’air, comme celle de chasseur ou de marin.
Ses mains, sans être celles d’un ouvrier, avaient travaillé.
Son langage était correct et dépourvu de tout accent.
On s’attendait à une audience dramatique ; on fut complètement trompé.
Le prévenu resta calme, muet, impénétrable.
On le pressa de questions, on lui tendit des pièges, on lui représenta les conséquences de son entêtement. Tout fut inutile.
L’inconnu ne se départit jamais de sa douceur obstinée, et en entendant lire le jugement qui le condamnait, pour vagabondage, au maximum de la peine, — un an et un jour de prison, — il eut l’attitude d’un homme résigné à toutes les conséquences d’une résolution prise.
Il avait fallu pourtant lui donner un nom, afin de baptiser la condamnation, pour ainsi dire, et on l’appela Jacques, comme l’avaient fait déjà les gardiens de la prison, dans l’embarras où ils s’étaient trouvés pour le désigner.
Peu de jours après, l’homme sans nom était dirigé sur une maison de réclusion, dans un département voisin.
La toile tombait avant le dénouement du drame.
Henri de Servon s’était passionné pour cette énigme sans mot, comme il se serait passionné pour une grosse partie à son cercle, et avant de rentrer à Paris, il eut l’idée de faire déposer au greffe cinq cents francs pour qu’on les remît au prisonnier à l’expiration de sa peine.
C’était un placement au profit de sa curiosité.
Il s’était dit qu’une fois ses comptes réglés avec la justice, l’inconnu le rembourserait avec le récit de ses aventures.
Le calcul ne se trouva pas juste.
Un an après, le vicomte apprit que l’homme avait fait les douze mois de prison sans trahir son incognito et qu’il était allé habiter Marseille sous la surveillance de la police.
Mais ce fut tout. L’homme sans nom ne donna pas signe de vie. Il n’écrivit même pas pour remercier, quoique l’argent lui eût été remis fidèlement à sa sortie.
La révolution de février survint quelque temps après, et Henri de Servon avait à peu près oublié cette histoire, quand, vers la fin de l’année 1848, il se trouva mêlé à des aventures bien autrement étranges.
1.
Les événements politiques qui remplirent les six premiers mois de 1848 ne laissaient guère de place à d’autres préoccupations.
L’intérêt qui s’attache aux curiosités judiciaires s’était reporté tout entier sur les combats de la rue ou sur les luttes de la tribune, et les faits singuliers qui se déroulèrent à cette époque dans le monde parisien le plus élevé passèrent à peu près inaperçus.
Après la révolution de février, les clubs élégants étaient restés longtemps déserts ; mais, vers la fin de l’été, les fidèles de la vie à grandes guides commencèrent à reprendre leurs habitudes.
On revenait dîner au Café de Paris ; on retournait au théâtre ; on se remettait à jouer et à souper.
A jouer surtout.
Il semblait qu’on voulût se dédommager d’une interruption forcée, et l’on reprit les parties avec une ardeur qui s’expliquait peut-être aussi par l’incertitude de l’avenir.
C’était surtout dans un des cercles les plus renommés du Paris d’alors que les gros joueurs se donnaient rendez-vous, et, chaque nuit, autour d’une table de baccarat dressée au milieu du grand salon rouge, on perdait et on gagnait des sommes énormes.
A voir l’or et les billets de banque s’entasser sur le tapis vert, on ne se serait pas douté que les valeurs industrielles étaient en baisse et que les fermages ne se payaient guère.
L’argent, qui se cachait partout et qui fuyait les affaires, se montrait hardiment au jeu, et changeait de mains entre une heure et cinq heures du matin avec une facilité incroyable.
Un jour, au plus fort de cette fièvre, vers la fin du mois d’octobre, un des membres les plus assidus du cercle cessa tout à coup d’y paraître.
C’était un jeune gentilhomme fort riche, originaire du Languedoc, qui était venu passer l’hiver à Paris et qui avait gagné depuis un mois des sommes importantes.
D’abord on s’inquiéta peu de son absence, car l’intimité entre joueurs ne dépasse guère les limites du tapis vert ; mais on ne tarda pas à apprendre qu’il n’avait pas reparu à son domicile depuis plusieurs jours.
Sa famille s’était émue et le faisait chercher.
M. de Sieurac — c’était son nom — avait quitté le cercle un matin, vers quatre heures, et depuis l’instant où il avait franchi la porte de la rue, on ne retrouvait de lui aucune trace.
Il était probable qu’il avait, suivant son habitude, pris une voiture pour se rendre dans le faubourg Saint-Germain, où il demeurait ; mais les cochers de place et de remise qu’on interrogea ne purent donner aucun renseignement précis.
Un seul affirma que, cette nuit-là, il avait conduit à la gare du chemin de fer de Rouen un voyageur dont le signalement se rapportait à celui du jeune homme disparu.
Il était bien difficile de croire qu’à pareille heure, sans bagages et en toilette de soirée, M. de Sieurac se fût mis en route pour une destination inconnue.
On pensa à un suicide.
C’est une hypothèse toujours admissible quand il s’agit d’un joueur.
Mais, outre qu’il était fort riche, M. de Sieurac avait toujours été heureux à la partie, et, la nuit même de sa disparition, il avait gagné une très forte somme.
On ne lui connaissait d’ailleurs aucun chagrin.
Il était insensé de croire qu’un homme dans cette situation d’esprit et de fortune avait été se jeter à la Seine après une nuit joyeuse et fructueuse.
Il était plus naturel de croire à un crime, et on se dit que dans le portefeuille de M. de Sieurac il y avait bien de quoi tenter les voleurs qui, en ce temps de crise financière, rencontraient rarement de pareilles aubaines.
Mais, depuis deux ans à peu près, les bandes d’escarpesqui infestaient les rues de Paris vers la fin du règne de Louis-Philippe avaient entièrement disparu.
Les derniers débris de ces redoutables associations de malfaiteurs avaient été jugés et condamnés en 1846, et, depuis lors, il n’avait plus été question d’attaques nocturnes.
Les recherches que la police dirigea dans ce sens n’aboutirent à rien.
Le seul indice recueilli fut la découverte du portefeuille de M. de Sieurac, qu’on ramassa déchiré et souillé de boue dans les terrains déserts qui s’étendaient alors près de la barrière du Roule.
Inutile de dire que ce portefeuille était parfaitement vide.
Ce fut tout.
On explora inutilement la rivière et le canal. Le corps de M. de Sieurac ne fut pas retrouvé.
Cette étrange disparition occupa tout Paris pendant huit jours ; mais, une semaine après l’événement, Paris l’avait déjà oublié, et au cercle, où M. de Sieurac était fort connu et assez aimé, sa mort probable n’arrêta pas le baccarat une seule nuit.
Un mois ne s’était pas écoulé qu’une aventure, moins tragique il est vrai, advint à un des joueurs les plus assidus de la grosse partie.
C’était un officier de l’armée d’Afrique qui était venu passer à Paris quelques mois de congé.
Il était riche et joueur déterminé ; mais il apportait, dans l’exercice de sa passion favorite, une régularité toute militaire.
A minuit, il s’asseyait à la table de baccarat, et à trois heures précises il quittait la partie, qu’il fût en bénéfice ou en perte.
A trois heures et quelques minutes, quel que fût le temps, il s’acheminait à pied vers son domicile, situé rue de Bourgogne, en sifflant une vieille fanfare d’Afrique.
Il jouait le plus souvent avec une mauvaise chance marquée ; mais quand, par hasard, la veine lui souriait, il la poussait avec la vigueur d’un spahi habitué à charger à fond, et il enlevait parfois de très gros gains.
Un soir, ou plutôt un matin, qu’il rentrait chez lui, après avoir gagné une bataille chaudement disputée, il lui sembla voir des ombres suspectes se glisser le long du mur d’un grand jardin, à l’angle du quai d’Orsay.
Le capitaine Laverdan avait trop pratiqué en Algérie la guerre d’embuscades pour ne pas se défier des coins obscurs, et il savait qu’en chemin suspect il ne faut pas tourner trop court.
Il eut donc soin de se tenir au milieu de la chaussée, et, par surcroît de précaution, il dégaina une courte épée cachée dans sa canne.
En même temps il marchait vers l’entrée de la rue de Bourgogne en s’éclairant militairement, c’est-à-dire en regardant à droite et à gauche.
Un pas, un coup d’œil.
Bien lui en prit.
Au moment où il dépassait une porte basse qui s’ouvrait dans le mur du Palais-Bourbon, il vit un homme s’élancer sur lui, et il se sentit saisir par-derrière.
Une main vigoureuse lui serrait le cou, et une autre main fouillait sa poitrine.
Mais le capitaine n’avait pas oublié l’école du sabre. Il exécuta un en arrière pointez ! qui fit lâcher prise à l’agresseur, et il se retourna vivement pour faire face à l’ennemi.
Le coup avait dû porter, car le voleur chancelait ; mais, à ce moment, deux autres coquins arrivaient à la rescousse, et l’officier jugea opportun de battre en retraite.
Il ne fut pas poursuivi.
Le lendemain, cette histoire était la nouvelle du cercle.
Cette fois, on était fixé : c’était bien une attaque nocturne en règle, et la police, à laquelle le capitaine alla faire sa déclaration, se mit en campagne avec ardeur.
Un des assaillants avait dû être grièvement blessé, car il avait largement arrosé de sang les pavés de la paisible rue de Bourgogne ; à l’aide de cet indice, le chef de la brigade de sûreté se faisait fort de mettre la main sur la bande.
Quand il se commet un crime de ce genre, on sait à peu près dans quelle catégorie de coquins il faut chercher le coupable, et un coup d’épée est une marque qui ne s’efface pas du jour au lendemain.
Mais on explora en vain les garnis mal famés et les estaminets borgnes ; on ne découvrit pas le moindre blessé suspect.
La bande, s’il y en avait une, s’était encore une fois évanouie comme un fantôme insaisissable.
Rien ne rattachait cette tentative de vol à la mort trop probable de M. Sieurac, et pourtant les deux aventures présentaient une coïncidence singulière.
Le capitaine si heureusement sauvé et le jeune homme si tristement disparu portaient tous les deux dans leur poche une grosse somme et venaient tous les deux de gagner au baccarat.
Si les voleurs connaissaient cette circonstance, ils avaient dû être renseignés par des témoins de la partie.
Quelque inadmissible que parût cette supposition, la police, défiante de sa nature, ne crut pas inutile de faire à petit bruit une enquête dans le cercle.
On se renseigna sur les gens de service ; on les surveilla, et on ne découvrit absolument rien.
Il ne résulta de toutes ces recherches qu’une sorte de malaise général dans le cercle.
On se regardait, et on s’observait. Il y avait des soupçons dans l’air. Mais la partie ne s’arrêta pas pour si peu.
Henri de Servon se trouvait absent au moment où se passaient ces singuliers événements.
Après la révolution de février, il avait quitté Paris pour aller vendre une terre de Bretagne, et il avait été retenu à la campagne beaucoup plus longtemps qu’il ne le pensait.
C’était alors un homme de trente ans, qui avait les défauts et les qualités du temps et du milieu où il vivait.
Bien né, bien élevé et suffisamment intelligent, il avait gâté tous ces avantages par une incurable légèreté et un goût immodéré pour la vie facile.
Du reste, s’il avait compromis sa fortune et manqué son existence, il n’était pas devenu méchant.
L’indulgence un peu banale qu’il pratiquait l’avait conduit à des imprudences, à des relations fâcheuses ; mais du moins cela n’avait pas gâté son cœur.
Le hasard de sa naissance et ses relations en avaient fait ce qu’on appelait alors un viveur.
Au fond, c’était un curieux, un chercheur, et il n’avait guère que la passion de l’inconnu.
Les derniers événements avaient achevé d’ébranler sa fortune déjà fortement entamée ; il avait prolongé son séjour en Bretagne pour tâcher de réparer quelques brèches, et il était rentré à Paris avec des projets d’économie et de sagesse.
Depuis son retour, il s’était même abstenu par système de mettre les pieds au cercle.
Un soir pourtant, excédé d’un spectacle des plus maussades qu’il venait de subir dans un petit théâtre, il eut l’idée de monter au club.
A sa grande surprise, il trouva devant la cheminée du salon une réunion des plus animées.
Il était évident qu’il venait de se passer un événement extraordinaire.
Tout le monde parlait à la fois.
Henri de Servon ne comprit rien d’abord à la conversation, puis il finit par saisir au vol quelques phrases.
— Ce pauvre baron ! disait-on. Pour une fois qu’il lui arrive de faire un gros gain, c’est vraiment par trop de déveine.
— On le dit très malade.
— Est-ce des coups qu’il a reçus ou de la peur qu’il a eue ?
— Ce qui doit le vexer le plus, c’est que le médecin l’a mis à la diète jusqu’à nouvel ordre.
Evidemment, il s’agissait du baron de Saint-Mandrier, personnage ridicule, bien connu de Servon, et membre assidu du cercle, où sa gourmandise lui avait acquis une notoriété peu enviable.
La veille, à la suite d’un copieux dîner, le baron, fort prudent d’ordinaire partout ailleurs qu’à table, n’avait pas craint d’aborder la grosse partie.
Cette audace fut récompensée par une chance inouïe, et, vers trois heures du matin, il quittait triomphalement la place avec un bénéfice de mille louis, autrement dit, en langue vulgaire, d’une vingtaine de mille francs.
Mais cette nuit si bien commencée avait fort mal fini.
En regagnant à pied la rue d’Anjou où il demeurait, le pauvre baron avait été assailli, près du monument expiatoire de Louis XVI, par des voleurs qui l’avaient à moitié étranglé et lui avaient pris son argent.
Les détails manquaient ; mais le fait n’était que trop certain, et les commentaires abondaient.
— Décidément, les brigands nocturnes, dit un jeune homme, ont la main heureuse, et ils s’adressent de préférence aux joueurs favorisés par le sort.
Sur quoi un des causeurs les plus animés s’écria :
— C’est alors le vrai moment d’entamer une forte partie, avec cette condition préalable que les gagnants s’engageront à rentrer chez eux à pied. Nous verrons si la bande est bien informée.
La proposition fut acceptée avec enthousiasme.
Servon, qui n’avait pas envie de prendre part à la fête, finit par se laisser tenter, tout en se promettant de modérer beaucoup ses mises.
Mais il suffit souvent d’un gros joueur pour faire monter une partie, et, ce soir-là, il s’en trouvait un très capable de pousser à des enjeux fort élevés.
C’était un étranger, membre du cercle depuis quelques mois seulement.
On l’appelait M. de Pancorvo, et on le disait chargé d’une mission par une république quelconque de l’Amérique du Sud.
Il passait pour fort riche, menait assez grand train, jouait très cher et très heureusement, parlait purement le français et montrait les façons de bonne compagnie, ce qui est une qualité assez rare chez les citoyens nés dans les parages de l’Equateur.
Au physique, c’était ce qu’on appelle un bel homme. Grand, mince de taille, large d’épaules, il paraissait doué d’une vigueur peu commune, malgré son âge, qui approchait visiblement de la cinquantaine.
Ses traits étaient réguliers et ses yeux remarquablement vifs et intelligents.
On l’aimait assez, quoiqu’il gagnait très souvent, circonstance peu propre à attirer les sympathies dans un cercle.
Pour sa part, Servon éprouvait, à son endroit, une certaine répulsion qui n’allait pas, d’ailleurs, jusqu’à l’empêcher d’entretenir avec lui ces relations familières qui sont la monnaie courante de la vie de cercle, et qui n’engagent absolument à rien.
Il avait souvent fait la partie de M. de Pancorvo, et elle lui avait même coûté très cher, car ce gentilhomme transatlantique jouait merveilleusement tous les jeux et s’y montrait aussi heureux qu’habile.
Le soir de la partie qu’on nomma séance tenante la partie du baron, en l’honneur de la mésaventure de l’infortuné Saint-Mandrier, la chance revint à Servon dès le début et lui resta fidèle jusqu’à la fin.
Vers quatre heures du matin, il avait gagné soixante-cinq mille francs.
Les perdants se consolèrent en organisant une scie.
On rappela que le vicomte devait rentrer chez lui à pied, et on se plut à lui raconter dans tous ses détails la funeste aventure de la veille.
On fit observer qu’il n’était pas bien solide, et que les voleurs auraient bon marché de lui. On lui signala les coins dangereux qu’il avait à tourner, et on finit par rédiger d’avance l’article que la Gazette des Tribunaux ne pouvait manquer de publier le lendemain, et qui devait naturellement se terminer par les mots sacramentels : La justice informe.
Servon reçut ce feu roulant avec la sérénité d’un homme auquel un portefeuille promptement et heureusement garni vient d’apporter une gaieté à l’épreuve de toutes les plaisanteries.
Il annonça qu’il comptait parfaitement rentrer à pied, et pour se préparer au voyage, il demanda un perdreau froid et une bouteille de Branne-Mouton.
M. de Pancorvo, qui par extraordinaire avait perdu, soupa à côté de lui.
Il raconta des histoires d’outre-mer assez originales, et Servon finit par oublier tout à fait les attaques nocturnes.
Cinq heures sonnaient quand ils descendirent ensemble l’escalier du cercle, à la grande joie des domestiques, obligés de veiller pour eux seuls, car les autres joueurs étaient déjà partis.
Un fiacre obstiné stationnait encore dans la rue.
M. de Pancorvo réveilla le cocher en disant au vicomte :
— J’espère que vous allez me permettre de vous ramener chez vous. Vous demeurez, je crois, dans les Champs-Elysées, et j’habite au haut du faubourg Saint-Honoré. Votre domicile est sur mon chemin, et d’ailleurs nous n’avons pas le choix : pas un seul cab à l’horizon.
— Non pas, non pas, répondit Servon ; je veux rentrer à pied. J’ai gagné ce soir, et il est convenu que je n’ai pas le droit de me faire traîner. Je veux avoir un voyage d’aventures à raconter demain, et je verrai bien si messieurs les voleurs sauront reconnaître en ma personne un capitaliste de fraîche date.
— Quoi ! vous pensez encore à cette sotte histoire ? Laissez donc ces aventures-là au pauvre baron, qui n’est pas brave et qui en a été quitte pour son argent. Si par impossible pareille rencontre vous arrivait, je suis sûr que vous seriez homme à vous faire tuer pour ne pas céder à des coquins sans vous défendre.
— Ma foi ! non. J’ai là-dessus des idées arrêtées depuis que j’ai voyagé en Italie. J’avais toujours soin dans ce beau pays de n’emporter aucune arme avec moi, de peur de me laisser aller à tirer un brigand, ce qui est un genre de sport fort dangereux.
— Ainsi, vous n’avez pas même le revolver des Yankees ou le simple casse-tête des policemen ?
— Rien que ma canne. Elle a une pomme en or, et je compte l’offrir poliment à mon assassin.
— Allons ! décidément, je ne veux pas vous empêcher d’être un héros. Bonsoir donc, et bonne chance !
Sur ce dernier mot, M. de Pancorvo monta dans le fiacre, qui tourna péniblement sur ses roues et commença à cheminer de ce train que les rosses de louage adoptent spécialement à minuit.
A quelque dix pas, Servon vit la tête du voyageur passer par la portière, et il crut d’abord qu’on l’appelait ; mais il comprit bientôt qu’il s’agissait d’un colloque avec le cocher auquel M. de Pancorvo reprochait son allure.
Il trouva sans doute, pour le décider à marcher plus vite, quelque argument efficace, car un coup de fouet vigoureusement appliqué vint sangler le malheureux cheval, qui prit le galop dans la direction de la Madeleine.
Le vicomte mit sa canne sous son bras, ses mains dans les poches de son paletot, et commença à suivre le boulevard de ce pas allègre de l’homme heureux.
Il faisait un temps superbe, sec et pas trop froid, un vrai temps pour marcher après souper.
La chaussée et les larges trottoirs du boulevard étaient absolument déserts, et Servon arriva à la rue Royale sans rencontrer personne.
Un peu plus loin, il se heurta presque à un individu qui débouchait de la rue Saint-Honoré, et qui changea brusquement de direction en se jetant sur le trottoir opposé.
M. de Servon eut un soupçon d’inquiétude.
Cette espèce d’abordage lui remit en mémoire l’aventure du baron, et il se dit qu’il ne tiendrait qu’à lui de prendre cet homme pour un voleur, et de se figurer que son air martial l’avait mis en fuite.
A l’entrée de la place de la Concorde, Servon remarqua que le passant prenait le même chemin que lui.
On le suivait peut-être.
Pour s’en assurer, il s’arrêta un instant près de l’obélisque, et il vit que l’homme ralentissait le pas.
Le vicomte commençait à regretter de ne pas avoir accepté le fiacre de M. de Pancorvo ; mais, après quelques secondes d’hésitation, il se trouva parfaitement ridicule, et il s’engagea bravement dans l’avenue des Champs-Elysées, sans regarder derrière lui.
Pourtant, un peu avant d’arriver au rond-point, il ne put s’empêcher de se retourner, et il constata sûrement cette fois que le même personnage le suivait à distance.
Cela pouvait, après tout, être très naturel.
Néanmoins, Servon crut devoir hâter le pas.
Du rond-point à la rue qu’il habitait, il n’y avait pas pour trois minutes de chemin, et il n’avait plus à s’inquiéter longtemps.
Il prit l’allée des Veuves ; mais avant de tourner l’angle pour entrer dans la rue qu’il habitait, il se retourna une dernière fois, et il aperçut l’homme à cinquante pas en arrière, ce qui le rassura tout à fait.
Au même instant, il se sentit saisir brusquement par le cou.
Avant que le vicomte de Servon eût eu le temps de faire un seul mouvement, une main exercée avait serré sa cravate avec une telle vigueur, que la respiration lui manqua complètement.
Il agita un instant ses bras dans le vide ; ses yeux se fermèrent ; il s’affaissa sur lui-même, et, sans s’évanouir tout à fait, il ne perçut plus que des sensations vagues.
Il lui sembla bien qu’on s’appuyait sur sa poitrine, qu’on ouvrait son paletot et qu’on le fouaillait ; mais tout se passa si vite, qu’il en eut à peine conscience.
Il n’aurait pu dire combien de minutes s’écoulèrent jusqu’au moment où il sentit qu’on desserrait le nœud de sa cravate et où il entendit une voix qui disait :
— Je suis arrivé trop tard.
Il ouvrit les yeux : un homme était penché sur lui. Par un mouvement instinctif, il chercha à le saisir ; mais cet inconnu se dégagea et se mit à courir vers les Champs-Elysées.
Servon n’avait pas eu le temps de distinguer ses traits ; seulement, il lui sembla bien reconnaître la taille et la tournure de l’homme qui l’avait suivi.
Il se releva alors, et constata avec un vif plaisir qu’il n’était pas blessé ; mais il s’aperçut avec beaucoup moins de satisfaction qu’on lui avait enlevé son portefeuille.
Il se traîna péniblement jusqu’à sa porte et rentra chez lui, tout dolent et tout honteux.
Dès que le pauvre vicomte fut en possession de ses facultés, il se mit à réfléchir à sa sotte aventure.
Il n’y avait pas moyen de se le dissimuler : il s’était bêtement laissé dévaliser, tout comme le baron de Saint-Mandrier.
Ce rapprochement ajouta encore à sa mauvaise humeur, et il commença à ruminer toutes sortes de projets de vengeance.
Il lui tardait qu’il fit jour, pour aller porter sa plainte au bureau de police.
Peu à peu cependant, cette excitation se calma, et il se dit qu’il était inutile de se vanter de cette ridicule aventure.
Il n’avait pas envie de servir de texte à une conversation autour de la cheminée du cercle, et l’idée seule de passer à l’état de fait divers, et de figurer sous l’initiale X… dans quelque chronique de journal, l’exaspérait au possible.
Après mûre réflexion, il conclut que le parti le plus sage était de dévorer sa honte et sa perte sans se plaindre.
Une fois cette résolution prise, Servon se bassina le cou, autour duquel sa cravate avait laissé un sillon rouge très nettement dessiné, et il se mit au lit.
Mais il lui faut impossible de dormir.
Tous les détails de sa malencontreuse soirée se représentaient à son esprit avec une netteté singulière.
Il était évident qu’on l’avait attendu à un endroit où l’on savait qu’il devait passer. L’attaque avait été brusque et trop bien calculée pour qu’on pût croire à une rencontre fortuite.
Il était clair aussi qu’on le savait possesseur d’un portefeuille bien garni, puisque le voleur avait fouillé sans hésiter à la place où était l’argent.
Il fallait donc croire qu’un membre du cercle donnait des renseignements aux escarpes, à moins qu’il n’opérât lui-même.
Cela paraissait pourtant invraisemblable.
Le vicomte avait bien lu l’histoire de l’orfèvre Cardillac, qui assassinait ses pratiques pour leur reprendre les joyaux qu’il leur avait vendus ; mais cela se passait sous Louis XIV, et ce procédé pour se couvrir de ses pertes de jeu paraissait peu praticable de nos jours.
Bien d’autres côtés de l’histoire restaient tout aussi incompréhensibles.
Servon avait évidemment été suivi ; mais l’homme qui l’avait attaqué ne pouvait pas être celui qu’il avait à ses trousses depuis la rue Royale, puisque, au moment où il s’était senti harponné, il venait de voir son suiveur à cinquante pas derrière lui.
Maintenant, ce suiveur était-il un complice chargé de surveiller ses mouvements, ou bien au contraire un agent à la piste du voleur ?
Les mots que le vicomte avait entendus : Je suis arrivé trop tard, semblaient confirmer la dernière supposition ; mais alors, pourquoi cet agent secourable s’était-il enfui comme s’il eût craint d’être reconnu ?
Ce qui était certain, c’est qu’il avait été volé et à moitié étranglé ; donc, ce soir-là, il eut bien de la peine à croire que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes.
La fatigue, heureusement, finit par amener le sommeil, et il dormit huit heures sans bouger.
Quand il ouvrit les yeux, vers midi, les rideaux fermés ne laissaient entrer dans sa chambre qu’un demi-jour, et c’est à peine s’il distingua un assez gros paquet cacheté de cire rouge que probablement son domestique venait de déposer sur la table de nuit.
Cela avait la physionomie d’une lettre officielle, et comme le vicomte n’entretenait guère alors de relations avec les hauts fonctionnaires, l’aspect de l’enveloppe le surprit.
Il n’avait pour la prendre qu’à étendre la main ; mais il se donna le plaisir de rêver un peu à ce qu’elle pouvait contenir.
Il se berçait donc de douces chimères en regardant avec des yeux à demi-clos le pli mystérieux, quand il lui vint tout à coup l’idée assez ridicule que le préfet de police lui écrivait pour lui annoncer l’arrestation de son voleur.
Sans plus réfléchir, il saisit le paquet et fit sauter l’enveloppe.
Exprimer la stupéfaction dans laquelle tomba Henri de Servon, à la vue de son contenu, serait impossible.
Cette ouverture grise cachait une liasse de billets de la Banque de France.
Le vicomte les compta. Il y en avait soixante-cinq.
On lui renvoyait son argent.
Il commençait déjà à croire qu’il ne s’était pas trompé et que la police était décidément une bien admirable institution, quand il s’aperçut que sous les billets il y avait une lettre.
C’était une feuille unique de papier commun qui portait ces mots, tracés d’une main ferme et d’une grosse écriture ayant un caractère tout particulier :
Monsieur,
Vous pouvez user sans scrupule de cet argent.
C’est une restitution.
Il n’y avait pas de signature.
Décidément, l’aventure tournait au fantastique. C’était un conte des Mille et une Nuits qui commençait.
Il fallait évidemment que le voleur eût été dépouillé du produit de son crime.
Le vicomte se demanda d’abord à qui il avait bien pu rendre un service capable d’engendrer une reconnaissance aussi positive.
Il eut beau chercher, il ne se rappela pas avoir jamais sauvé la vie à personne, ni même l’honneur, ce qui eût été plus difficile.
Un autre point semblait à Servon tout aussi mystérieux.
Ce sauveur providentiel savait donc qu’on devait le voler cette nuit-là, puisqu’il avait surveillé le voleur.
Au milieu de ces réflexions, il vint tout à coup au vicomte une idée qui lui parut un trait de lumière.
Il se dit que son aventure n’était pas autre chose qu’une farce organisée au cercle.
La restitution anonyme complétait la mystification, qui ne pouvait pas décemment être poussée jusqu’à garder l’argent volé.
Mais la plaisanterie passait les bornes. On l’avait renversé, à demi-étranglé, et Servon, quoique fort habitué à toutes les excentricités, prit celle-là fort mal.
Son irritation redoubla, quand il lui vint à l’esprit que le Pancorvo avait dû se charger d’exécuter cette déplorable farce.
Le vicomte se rappela sa conversation à la porte du cercle. Pancorvo l’avait adroitement questionné pour savoir s’il ne portait pas d’armes, et il avait sans doute filé à fond de train avec son fiacre, pour aller s’embusquer au coin de l’allée des Veuves.
Le personnage plaisait déjà très médiocrement à Servon, qui ne fut pas très fâché de trouver l’occasion de lui chercher une bonne querelle.
Seulement, il voulait être sûr de son fait avant d’agir, et il adopta un plan très simple.
Pour qu’une mystification soit complète, il faut que la victime apprenne qu’elle a été mystifiée, et il était probable qu’on ne différerait pas beaucoup le plaisir de se moquer de lui.
Il résolut donc d’aller au cercle comme à l’ordinaire, de ne pas dire un mot de son aventure et d’attendre que les aimables plaisants se dénonçassent d’eux-mêmes.
Quant à la lettre mystérieuse, elle avait été remise chez le portier le matin, vers dix heures, par un commissionnaire tout à fait inconnu.
Le vicomte passa la journée dans un état de surexcitation nerveuse assez singulier.
Il était tout à la fois vexé d’avoir servi de plastron à des imbéciles, et content d’avoir retrouvé son argent.
Au fond, l’irritation dominait.
Ce fut donc sous l’influence d’un agacement très prononcé qu’il fit son entrée au cercle, vers minuit.
La bande de la veille s’y trouvait au grand complet ; mais la conversation avait changé de sujet, et on discutait très sérieusement sur la supériorité des cochers anglais.
Il n’était pas plus question de l’aventure du baron que de l’assassinat du duc de Guise.
Servon eu conclut, avec l’entêtement des gens coiffés d’une idée, que c’était un jeu concerté et qu’on attendait sa narration.
Aussi, tout en observant du coin de l’œil, il entama une théorie sur la manière de conduire à grandes guides.
A son profond étonnement, on l’écouta, on lui répondit, et il ne surprit pas l’apparence d’un sourire et d’un signe d’intelligence.
M. de Pancorvo jouait au piquet à trois pas du groupe. Il salua le vicomte avec sa politesse accoutumée et de l’air le plus naturel du monde.
Cette abstention universelle déconcerta tout à fait ce pauvre Servon.
Il essaya bien encore de provoquer les allusions en remettant sur le tapis l’affaire du baron, mais il n’eut aucun succès. Le vent avait tourné.
Seul, M. de Pancorvo parut un instant vouloir empaumer la voie, comme disent les chasseurs.
Il demanda au vicomte s’il n’avait pas fait de mauvaises rencontres, et celui-ci répondit sèchement qu’on n’avait jamais que les aventures qu’on voulait avoir.
Mais l’étranger s’inclina en homme qui ne veut pas relever un propos saugrenu et continua tranquillement sa partie.
Servon commença dès lors à se dire que cette histoire était plus sérieuse qu’il ne l’avait cru, et qu’il devait réellement exister au cercle un brigand déguisé.
Désorienté de plus en plus, il rentra chez lui fort perplexe, en ayant soin cette fois de prendre une voiture.
Il pensa encore à s’adresser tout simplement à la police ; mais il réfléchit qu’il faudrait disposer une plainte, s’astreindre à une foule de démarches ennuyeuses, et il revint à l’idée de se taire.
Seulement, comme il voulait avant tout en finir avec ce ridicule mystère, le vicomte résolut de faire sa police lui-même.
2.
Précisément le vicomte était alors fort désœuvré ; son cœur, par hasard, était entièrement libre, et sa tête tout à fait exempte de préoccupations.
Il se trouvait donc dans d’excellentes dispositions pour se donner les émotions d’une chasse à l’homme. Malheureusement, il n’avait que des notions très confuses sur le métier de fileur.
La pratique lui manquait absolument. Pour faire son apprentissage, il commença par le chapitre des informations.
Un instinct vague le poussait à croire que le Sud-Américain Pancorvo devait être, sinon l’auteur, au moins le complice de l’attaque nocturne si adroitement exécutée sur sa personne.
Cette idée l’obsédait, et il voulait avoir le dernier mot de cette énigme.
Il fallait d’abord savoir au juste ce qu’était ce personnage.
A première vue, la chose ne semblait pas très difficile.
On ne tombe pas dans un cercle comme un aérolithe ; il faut y être présenté par quelqu’un.
Servon s’enquit donc des parrains de M. de Pancorvo, et il apprit que l’un était le vice-président du cercle, gentilhomme de bonne souche et d’une honorabilité indiscutable.
L’autre, Charles de Précey, se trouvait être l’un des camarades d’enfance du vicomte et le meilleur de ses amis. Henri alla le trouver, et Charles lui apprit tout ce qu’il savait, c’est-à-dire fort peu de chose.
L’année précédente, Précey avait entrepris un grand voyage en Orient, où il avait rencontré M. de Pancorvo, qui faisait aussi la tournée du Levant.
Ils s’étaient associés pour traverser l’Asie-Mineure, visiter la Palestine, remonter le Nil jusqu’à la seconde cataracte, et dans ce voyage long et pénible, l’ami du vicomte avait eu mainte occasion d’apprécier les mérites de son compagnon de route.
M. de Pancorvo était aimable et instruit. Il savait une foule de langues, et entre autres le turc et l’arabe, avantage précieux dans une excursion orientale.
De plus, il paraissait fort riche et voyageait muni d’amples lettres de crédit.
Il parlait du reste fort peu de ce qui le concernait personnellement.
Précey savait cependant qu’il possédait une grande fortune — grâce à la découverte d’une mine d’or située quelque part, dans une île de l’Océan Indien ou dans la Cordilière des Andes, — qu’il avait été élevé en Angleterre et qu’il était dans l’intention de se fixer en France.
En arrivant à Paris, M. de Pancorvo avait prié son compagnon de voyage de le présenter à son cercle. Celui-ci y avait consenti volontiers ; et cela s’était fait avec le concours du vice-président, qui, sans connaître l’Américain, s’en était pleinement rapporté au patronage de Précey.
Depuis son admission, Pancorvo avait mené la vie de tous les étrangers riches qui viennent se divertir en France.
On le rencontrait un peu dans tous les mondes ; il allait beaucoup au théâtre et se montrait au bois dans des voitures bien tenues et bien attelées.
Cependant, on devinait quelque chose de mystérieux dans ses allures. Personne n’avait pu pénétrer jusqu’ici dans son hôtel.
Il connaissait tout Paris — le tout Paris des premières représentations et des courses, — mais il ne voyait intimement aucun homme comme il faut.
Ces renseignements sommaires donnaient pourtant si peu de prise au soupçon, que Servon se demanda d’abord s’il ne faisait pas fausse route.
Il se décida néanmoins à pousser l’enquête plus loin et à s’attacher aux pas de M. de Pancorvo.
Avant de tenter une entreprise assez ridicule en réalité et quelque peu dangereuse, il voulut d’abord apprendre à se déguiser, ce qui est l’ABC de la profession.
Il avait assez couru le monde des théâtres pour connaître quelques acteurs, et il s’adressa à l’un d’eux, passé maître dans l’art de se grimer, sous le prétexte assez plausible de se mettre en état de jouer la comédie de château.
En quelques semaines il apprit à se faire des sourcils et des rides, à changer la forme de son nez, à allonger sa bouche et à se déguiser les yeux.
Il sut coller sur ses joues les barbes les plus variées, et il acheta un assortiment complet de perruques.
Se hasardant bientôt à sortir affublé de différents costumes, il ne fut pas trop mécontent de lui-même.
Peu à peu l’aplomb lui vint, et il finit par prendre un si grand plaisir à cette existence à la façon du prince Rodolphe des Mystères de Paris, que pour rien au monde il n’eût renoncé à son projet.
Malgré tout le temps que lui prenait cette occupation, le vicomte ne changea ostensiblement rien à ses habitudes, et surtout se montra au cercle régulièrement tous les soirs.
Son professeur de déguisement avait mis une chambre à sa disposition. Il allait s’y habiller, et, ses excursions achevées, il y venait reprendre ses vêtements ordinaires.
Au bout de deux mois, son éducation fut complète, et il entra résolument en campagne.
M. de Pancorvo habitait, rue de Valois-du-Roule, un charmant petit hôtel entre cour et jardin.
En face de la porte cochère, une boutique de marchand de vins, la seule qui s’ouvrit dans cette rue aristocratique, servait de lieu de rendez-vous à toute la livrée du quartier.
La veille de Noël, par une belle matinée d’hiver, un grand gaillard, qui avait la tournure d’un groom de bonne maison, et qui n’était autre que le vicomte Henri, se présenta au comptoir du père Labriche et s’y fit servir un verre d’absinthe.
Ce père Labriche, ex-valet de chambre d’un marquis, avait gardé de son ancienne profession un certain air de dignité qui contrastait singulièrement avec son métier de marchand de vins.
D’ailleurs, grâce aux relations qu’il avait conservées dans les grandes maisons, il n’avait pas son pareil pour trouver une place aux cuisiniers sans emploi et aux cochers en rupture de fouet.
Aussi exerçait-il sur sa clientèle, presque exclusivement composée de domestiques, une influence incontestée.
Servon s’était préalablement renseigné sur ce personnage, et il espérait bien utiliser un homme qui connaissait tous les habitants de ce faubourg élégant : maîtres et valets.
— Joli froid, m’sieu Labriche, dit-il en saluant poliment le marchand de vins, qui de son comptoir avait fait un trône. Il fait meilleur chez vous que sur un siège, les guides en main.
— C’est vrai, mon garçon, répondit le majestueux cabaretier en servant l’absinthe à ce consommateur inconnu ; mais il me semble qu’on ne vous voit pas souvent par ici, car je ne vous reconnais pas du tout.