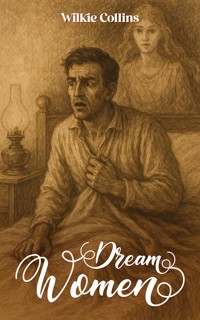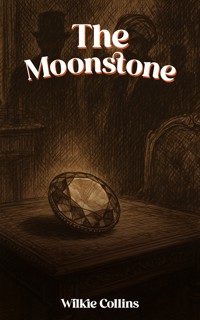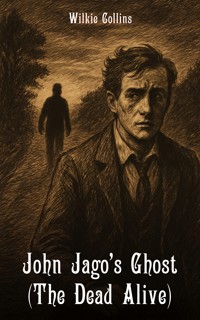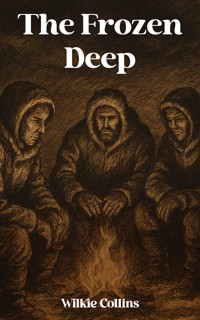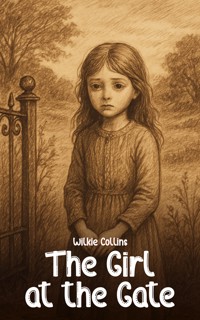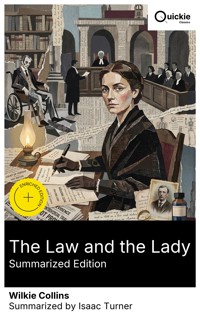Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Le précurseur de la «detective novel», le «Gaboriau anglais», les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier le premier grand auteur de romans policiers anglais, des années avant Arthur Conan Doyle et son SHerlock Holmes. Après un mariage scandaleux, Lord Montbarry décède en voyage de noces dans un hôtel à Venise. Malgré les circonstances troubles ,une enquête diligentée par les assurances ne trouve rien de suspect... Mais alors, pourquoi la veuve Montbarry semble sombrer dans la folie, comme sous le poids d'un secret terrible ?...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L'Hôtel hanté
L'Hôtel hantéPREMIÈRE PARTIEIIIIIIIVDEUXIÈME PARTIEVVIVIIVIIIIXXXITROISIÈME PARTIEXIIXIIIXIVQUATRIÈME PARTIEXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIPOST SCRIPTUMPage de copyrightL'Hôtel hanté
Wilkie Collins
PREMIÈRE PARTIE
I
En 1860, la réputation du docteur Wybrow, de Londres, était arrivée à son apogée. Les gens bien informés affirmaient que, de tous les médecins en renom, c'était lui qui gagnait le plus d'argent.
Un après-midi, vers la fin de l'été, le docteur venait de finir son déjeuner après une matinée d'un travail excessif. Son cabinet de consultation n'avait pas désempli et il tenait déjà à la main une longue liste de visites à faire, lorsque son domestique lui annonça qu'une dame désirait lui parler.
« Qui est-ce ? demanda-t-il. Une étrangère ?
– Oui, monsieur.
– Je ne reçois pas en dehors de mes heures de consultation. Indiquez-les lui et renvoyez-la.
– Je les lui ai indiquées, monsieur.
– Eh bien ?
– Elle ne veut pas s'en aller.
– Elle ne veut pas s'en aller ? répéta en souriant le médecin. »
C'était une sorte d'original que le docteur Wybrow, et il y avait dans l'insistance de l'inconnue une bizarrerie qui l'amusait.
« Cette dame obstinée vous a-t-elle donné son nom ?
– Non, monsieur. Elle a refusé ; elle dit qu'elle ne vous retiendra pas cinq minutes, et que la chose est trop importante pour attendre jusqu'à demain. Elle est là dans le cabinet de consultation, et je ne sais comment la faire sortir. »
Le docteur Wybrow réfléchit un instant. Depuis plus de trente ans qu'il exerçait la médecine, il avait appris à connaître les femmes et les avait toutes étudiées, surtout celles qui ne savent pas la valeur du temps, et qui, usant du privilège de leur sexe, n'hésitent jamais à le faire perdre aux autres. Un coup d'œil à sa montre lui prouva qu'il fallait bientôt commencer sa tournée chez ses malades. Il se décida donc à prendre le parti le plus sage : à fuir.
« La voiture est-elle là ? demanda-t-il.
– Oui, monsieur.
– Très bien. Ouvrez la porte sans faire de bruit, et laissez la dame tranquillement en possession du cabinet de consultation. Quand elle sera fatiguée d'attendre, vous savez ce qu'il y a à lui dire. Si elle demande quand je serai rentré, dites que je dîne à mon cercle et que je passe la soirée au théâtre. Maintenant, doucement, Thomas ! Si nos souliers craquent, je suis perdu. »
Puis il prit sans bruit le chemin de l'antichambre, suivi par le domestique marchant sur la pointe des pieds.
La dame se douta-t-elle de cette fuite ? Les souliers de Thomas craquèrent-ils ? Peu importe ; ce qu'il y a de certain, c'est qu'au moment où le docteur passa devant son cabinet, la porte s'ouvrit. L'inconnue apparut sur le seuil et lui posa la main sur le bras.
« Je vous supplie, monsieur, de ne pas vous en aller sans m'écouter un instant. »
Elle prononça ces paroles à voix basse, et cependant d'un ton plein de fermeté. Elle avait un accent étranger. Ses doigts serraient doucement, mais aussi résolument, le bras du docteur.
Son geste et ses paroles n'eurent aucun effet sur le médecin, mais à la vue de la figure de celle qui le regardait, il s'arrêta net ; le contraste frappant qui existait entre la pâleur mortelle du teint et les grands yeux noirs pleins de vie, brillant d'un reflet métallique, dardés sur lui, le cloua à sa place.
Ses vêtements étaient de couleur sombre et d'un goût parfait, elle semblait avoir trente ans. Ses traits : le nez, la bouche et le menton étaient d'une délicatesse de forme qu'on rencontre rarement chez les Anglaises. C'était, sans contredit, une belle personne, malgré la pâleur terrible de son teint et le défaut moins apparent d'un manque absolu de douceur dans les yeux. Le premier moment de surprise passé, le docteur se demanda s'il n'avait pas devant lui un sujet curieux à étudier. Le cas pouvait être nouveau et intéressant. Cela m'en a tout l'air, pensa-t-il, et vaut peut-être la peine d'attendre.
Elle pensa qu'elle avait produit sur lui une violente impression, et desserra la main qu'elle avait posée sur le bras du docteur.
« Vous avez consolé bien des malheureuses dans votre vie, dit-elle. Consolez-en une de plus aujourd'hui. »
Sans attendre de réponse, elle se dirigea de nouveau vers le cabinet de consultation.
Le docteur la suivit et ferma la porte. Il la fit asseoir sur un fauteuil, en face de la fenêtre. Le soleil, ce qui est rare à Londres, était éblouissant cet après-midi-là. Une lumière éclatante l'enveloppa. Ses yeux la supportèrent avec la fixité des yeux d'un aigle. La pâleur uniforme de son visage paraissait alors plus effroyablement livide que jamais. Pour la première fois depuis bien des années, le docteur sentit son pouls battre plus fort en présence d'un malade.
Elle avait demandé qu'on l'écoutât, et maintenant elle semblait n'avoir plus rien à dire. Une torpeur étrange s'était emparée de cette femme si résolue. Forcé de parler le premier, le docteur lui demanda simplement, avec la phrase sacramentelle, ce qu'il pouvait faire pour elle. Le son de cette voix parut la réveiller ; fixant toujours la lumière, elle dit tout à coup :
« J'ai une question pénible à vous faire.
– Qu'est-ce donc ? »
Son regard allait doucement de la fenêtre au docteur. Sans la moindre trace d'agitation, elle posa ainsi sa pénible question :
« Je veux savoir si je suis en danger de devenir folle ? »
À cette demande, les uns auraient ri, d'autres se seraient alarmés. Le docteur Wybrow, lui, n'éprouva que du désappointement. Était-ce donc là le cas extraordinaire qu'il avait espéré en se fiant légèrement aux apparences ? Sa nouvelle cliente n'était-elle qu'une femme hypocondriaque dont la maladie venait d'un estomac dérangé et d'un cerveau faible ?
« Pourquoi venez-vous chez moi ? lui demanda-t-il brusquement. Pourquoi ne consultez-vous pas un médecin spécial, un aliéniste ? »
Elle répondit aussitôt :
« Si je ne vais pas chez un de ces médecins-là, c'est justement parce qu'il serait un spécialiste et qu'ils ont tous la funeste habitude de juger invariablement tout le monde d'après les mêmes règles et les mêmes préceptes. Je viens chez vous, parce que mon cas est en dehors de toutes les lois de la nature, parce que vous êtes fameux dans votre art pour la découverte des maladies qui ont une cause mystérieuse. Êtes-vous satisfait ? »
Il était plus que satisfait. Il ne s'était donc pas trompé, sa première idée avait été la bonne, Cette femme savait bien à qui elle s'adressait. Ce qui l'avait élevé à la fortune et à la renommée lui, docteur Wybrow, c'était la sûreté de son diagnostic, la perspicacité, sans rivale parmi ses confrères, avec laquelle il prévoyait les maladies dont ceux qui venaient le consulter pouvaient être atteints dans un temps plus ou moins éloigné.
« Je suis à votre disposition, répondit-il, je vais essayer de découvrir ce que vous avez. »
Il posa quelques-unes de ces questions que les médecins ont l'habitude de faire ; la patiente répondit promptement et avec clarté ; sa conclusion fut que cette dame étrange était, au moral comme au physique, en parfaite santé. Il se mit ensuite à examiner les principaux organes de la vie. Ni son oreille ni son stéthoscope ne lui révélèrent rien d'anormal. Avec cette admirable patience et ce dévouement à son art qui l'avaient distingué dès le temps où il étudiait la médecine, il continua son examen, toujours sans résultat. Non seulement il n'y avait aucune prédisposition à une maladie du cerveau, mais il n'y avait même pas le plus léger trouble du système nerveux.
« Aucun de vos organes n'est atteint, dit-il ; je ne peux même pas me rendre compte de votre extrême pâleur. Vous êtes pour moi une énigme.
– Ma pâleur n'est rien, répondit-elle avec un peu d'impatience. Dans ma jeunesse, j'ai failli mourir empoisonnée ; depuis, mes couleurs n'ont jamais reparu, et ma peau est si délicate qu'elle ne peut supporter le fard. Mais ceci n'a aucune importance. Je voulais avoir votre opinion, je croyais en vous, et maintenant je suis toute désappointée. »
Elle laissa tomber sa tête sur sa poitrine.
– Et c'est ainsi que tout cela finit, dit-elle en elle-même amèrement.
Le docteur parut touché ; peut-être serait-il plus exact de dire que son amour-propre de médecin était un peu blessé.
« Cela peut encore se terminer comme vous le voulez, dit-il, si vous prenez la peine de m'aider un peu. »
Elle releva la tête. Ses yeux étincelaient.
« Expliquez-vous ; comment puis-je vous aider ?
– Avouez, madame, que vous venez chez moi un peu comme un sphinx. Vous voulez que je découvre l'énigme avec le seul secours de mon art. La science peut faire beaucoup, mais non pas tout. Voyons, quelque chose doit vous être arrivé, quelque chose qui n'a aucun rapport à votre état de santé et qui vous a effrayée ; sans cela, vous ne seriez jamais venue me consulter. Est-ce la vérité ?
– C'est la vérité, dit-elle vivement. Je recommence à avoir confiance en vous.
– Très bien. Vous ne devez pas supposer que je vais découvrir la cause morale qui vous a mise dans l'état où vous êtes : tout ce que je puis faire, c'est de voir qu'il n'y a aucune raison de craindre pour votre santé, et, à moins que vous ne me preniez comme confident, je ne puis rien de plus. »
Elle se leva, fit le tour de la chambre.
« Supposons que je vous dise tout, répondit-elle. Mais faites bien attention que je ne nommerai personne.
– Je ne vous demande pas de noms, les faits seuls me suffisent.
– Les faits sont de peu d'importance, reprit-elle, je n'ai que des impressions personnelles à vous révéler, et vous me prendrez probablement pour une folle imaginaire, quand vous m'aurez entendue. Qu'importe ! Je vais faire mon possible pour vous contenter. Je commence par les faits, puisque vous le voulez. Mais croyez-moi, cela ne vous servira pas à grand'chose. »
Elle s'assit de nouveau et commença avec la plus grande sincérité la plus étrange et la plus bizarre de toutes les confessions qu'eût jamais entendues le docteur.
II
« Je suis veuve, monsieur, c'est un fait : je vais me remarier, c'est encore un fait ».
Elle s'arrêta et sourit à quelque pensée qui lui traversa l'esprit. Ce sourire fit mauvaise impression sur le docteur Wybrow : il avait quelque chose de triste et de cruel à la fois, il se dessina lentement sur ses lèvres et disparut soudain.
Le docteur se demanda s'il avait bien fait de céder à son premier mouvement. Il songea avec un certain regret à ses malades qui l'attendaient.
La dame continua :
« Mon prochain mariage, dit-elle, se rattache à une circonstance assez délicate. Le gentleman dont je dois être la femme était engagé à une autre personne, quand le hasard fit qu'il me rencontra à l'étranger. Cette personne, faites bien attention, est de sa famille. C'est sa cousine. Je lui ai innocemment volé son fiancé, j'ai détruit toutes les espérances de sa vie. Innocemment, dis-je, parce qu'il ne m'a révélé son engagement antérieur qu'après que je lui ai eu moi-même accordé ma main. Quand nous nous revîmes en Angleterre, et quand il craignit sans doute que l'affaire ne vînt à ma connaissance, il m'avoua la vérité. Naturellement je fus indignée. Il avait une excuse toute prête : il me montra une lettre de sa cousine lui rendant sa parole. Je n'ai jamais rien lu de plus noble, d'un esprit plus élevé. J'en pleurai, moi, qui n'ai pas trouvé de larmes à verser sur mes propres douleurs ! Si la lettre lui avait laissé l'espoir d'être pardonné, j'aurais positivement refusé de l'épouser. Mais la fermeté de cette lettre sans colère, sans un mot de reproche, faisant au contraire des souhaits pour son bonheur, la fermeté dont elle était empreinte ne pouvait lui laisser d'espoir. Il me supplia d'avoir pitié de lui, de ne pas oublier son amour pour moi. Vous savez ce que sont les femmes. Moi aussi j'eus le cœur tendre, je donnai mon consentement, et dans huit jours – je tremble quand j'y songe – nous serons mariés. »
Elle tremblait réellement ; elle fut obligée de s'arrêter quelques instants avant de reprendre. Le docteur, attendant toujours la révélation de quelque fait important, commençait à craindre d'avoir à subir un long récit.
«Pardonnez-moi, madame, dit-il, de vous rappeler que j'ai des personnes souffrantes qui attendent ma visite ; plus vite vous arriverez au but, mieux cela vaudra pour mes malades et pour moi ».
L'étrange sourire si triste et si froid reparut sur les lèvres de l'inconnue :
« Rien de ce que je dis n'est inutile, vous le verrez vous-même dans un moment. »
Elle continua en ces termes :
« Hier, – ne craignez pas une longue histoire, monsieur, – hier même, je venais de prendre part à un de vos lunch anglais, lorsqu'une dame qui m'était tout à fait inconnue arriva. Elle était en retard : nous avions déjà quitté la table, nous étions dans le salon. Elle prit par hasard une chaise à côté de la mienne ; on nous présenta l'une à l'autre. Je connaissais son nom, elle connaissait aussi le mien. C'était la femme à laquelle j'avais volé son fiancé, la femme qui avait écrit la lettre dont je vous ai parlé. Écoutez, maintenant ! vous vous êtes montré impatient parce que je ne vous ai pas intéressé jusqu'à présent ; si je vous ai donné quelques détails, c'était pour vous prouver que je n'ai jamais eu contre cette dame le moindre sentiment d'hostilité. J'avais pour elle de la sympathie, je l'admirais presque, je n'avais donc rien à me reprocher à son égard. Retenez-le bien, c'est fort important, comme vous le verrez tout à l'heure. Quant à elle, je sais que les circonstances qui ont dicté ma conduite lui ont été expliquées dans tous leurs détails, je sais qu'elle ne me blâme en aucune façon. Et maintenant que vous savez tout, expliquez-moi, si vous le pouvez, pourquoi, quand je me suis levée et que mes yeux ont rencontré les siens, pourquoi j'ai senti un manteau de glace m'envelopper, un frisson parcourir mes membres, une peur mortelle s'abattre sur moi pour la première fois de ma vie ».
Le docteur commençait à s'intéresser au récit.
« Y avait-il donc, demanda-t-il, dans l'air ou dans l'attitude de cette dame quelque chose qui ait pu vous frapper ?
– Rien, répondit-on brusquement. Voici son portrait : une Anglaise comme elles le sont toutes, avec des yeux bleus, froids et clairs, le teint rosé, les manières pleines de politesse et de froideur, la bouche grande et réjouie, des joues et un menton gros, et c'est tout.
– Quand vos yeux se sont rencontrés, y avait-il dans son regard une expression quelconque qui vous ait frappée ?
– Je n'y ai découvert que la curiosité bien naturelle de voir la femme qui lui avait été préférée, et peut-être aussi quelque étonnement de ne pas la trouver plus belle et plus charmante : ces deux sentiments, contenus dans les limites des convenances du monde, sont les seuls que j'aie pu deviner ; ils n'ont du reste fait que paraître et disparaître. En proie à une horrible agitation, toutes mes facultés se troublaient ; si j'avais pu marcher, je me serais précipitée hors de la chambre, tant cette femme me faisait peur. Mais c'est à peine si je pus me lever, je tombai à la renverse sur ma chaise, regardant toujours ces yeux bleus et calmes qui me fixaient alors avec une douce expression de surprise, et cependant j'étais là comme un oiseau fasciné par un serpent. Son âme plongeait dans la mienne, l'enveloppant d'une crainte mortelle. Je vous dis mon impression telle que je l'ai ressentie, dans toute son horreur et dans toute sa folie. Cette femme, j'en suis sûre, est destinée, sans le savoir, à être le mauvais génie de ma vie. Ses yeux limpides ont découvert en moi des germes de méchanceté cachée que je ne connaissais pas moi-même jusqu'au moment où je les ai sentis tressaillir sous son regard. À partir d'aujourd'hui, si dans ma vie je commets des fautes, si je me laisse entraîner au crime, c'est elle qui m'en fera payer la peine involontairement, je le crois ; mais involontairement ou non, ce sera elle. En un instant, toutes ces pensées traversèrent mon esprit et se peignirent sur mes traits. Cette bonne créature s'inquiéta de moi. « La chaleur étouffante de cette pièce vous a fait mal, voulez-vous mon flacon ? » me dit-elle doucement, puis je ne me souviens plus de rien. J'étais évanouie. Quand je repris connaissance, tout le monde était parti ; seule la maîtresse de la maison était avec moi. Je ne pus tout d'abord prononcer une parole ; l'impression terrible que j'ai essayé de décrire me revint aussi violente que quand je la ressentis. Dès que je pus parler, je la suppliai de me dire toute la vérité sur la femme que j'avais supplantée, j'avais un faible espoir que sa bonne réputation ne fût pas réellement méritée, que sa lettre fût une adroite hypocrisie ; enfin j'espérais qu'elle nourrissait contre moi une haine soigneusement cachée.
Non ! La personne à qui je m'adressais avait été son amie d'enfance, elle la connaissait aussi bien que si elle eût été sa sœur, elle m'affirma qu'elle était aussi bonne, aussi douce, aussi incapable de haïr que la sainte la plus parfaite qui ait jamais été. Mon seul, mon unique espoir m'échappait donc. J'aurais voulu croire que ce que j'avais éprouvé en présence de cette femme était un avertissement de me tenir en garde contre elle, comme contre un ennemi ; après ce qu'on venait de m'en dire, cela était impossible. Il me restait encore un effort à faire, je le fis. J'allai chez celui que je dois épouser lui demander de me rendre ma parole. Il refusa, Je déclarai que, malgré tout, je voulais rompre. Il me fit voir alors des lettres de ses sœurs, des lettres de ses frères et de ses meilleurs amis ; toutes l'engageaient à bien réfléchir avant de faire de moi sa femme ; toutes répétant les bruits qui ont couru sur moi à Paris, à Vienne et à Londres, autant de mensonges infâmes. « Si vous refusez de m'épouser, me dit-il, c'est que vous reconnaîtrez que ces bruits sont fondés. Vous avouerez que vous avez peur d'affronter le monde à mon bras. » Que pouvais-je répondre ? Il n'y avait pas à discuter. Il avait pleinement raison ; si je persistais dans mon refus, c'était l'entière destruction de ma réputation. Je consentis donc à ce que le mariage ait lieu, comme nous l'avions arrêté, et je le quittai. C'était hier. Je suis ici, toujours avec mon idée fixe : cette femme est appelée à avoir une influence fatale sur ma vie. Je suis ici et je pose la seule question que j'aie à faire, au seul homme qui puisse y répondre. Pour la dernière fois, monsieur, que suis-je ? Un démon qui a vu l'ange vengeur ou une pauvre folle trompée par l'imagination déréglée d'un esprit en délire ? »
Le docteur Wybrow se leva de sa chaise pour terminer l'entretien.
Il était fortement et péniblement impressionné par ce qu'il avait entendu.
À mesure qu'il avait écouté ce récit, la conviction qu'il était en face d'une méchante femme s'était ancrée dans son esprit. Il essaya, mais en vain, de la regarder comme une personne à plaindre, comme une malheureuse femme d'une imagination sensible et maladive sentant se développer les germes du mal que nous avons tous en nous, et essayant réellement de réagir contre cette fatale influence, et d'ouvrir son cœur aux conseils du bien. Mais une mauvaise pensée lui souffla ces mots aussi distinctement que s'il l'eût entendu à son oreille : Fais attention, tu crois trop en elle.
« Je vous ai déjà donné mon opinion, dit-il ; il n'y a chez vous aucun symptôme de dérangement d'esprit présent ou à venir qu'un médecin puisse découvrir ; un médecin, vous m'entendez bien. Quant aux impressions que vous m'avez confiées, tout ce que je puis vous dire, c'est que vous êtes, je crois, dans un cas où l'on a plus besoin de conseils s'appliquant à l'âme qu'au corps. Soyez certaine que ce que vous m'avez dit dans ce cabinet n'en sortira pas. Votre confession restera secrète, je vous l'affirme. »
Elle l'écouta avec une sorte de résignation soumise jusqu'à la fin.
« Est-ce là tout ? demanda-t-elle.
– C'est tout, répondit-il.
– Permettez-moi de vous remercier, monsieur, reprit-elle en mettant un petit rouleau d'argent sur la table ».
Elle se leva. Ses yeux noirs et brillants avaient une expression de désespoir si poignant et si horrible dans leur plainte silencieuse, que le docteur détourna la tête, incapable d'en supporter la vue. L'idée de garder non seulement de l'argent, mais même une chose qui lui eût appartenu, ou à laquelle elle eût touché, lui était insupportable. Soudain, toujours sans la regarder, il lui tendit le rouleau en disant :
« Reprenez-le, je ne veux pas être payé. »
Elle, sans faire attention, sans entendre, les yeux toujours levés au ciel se parlant à elle-même, s'écria :
« Attendons la fin, car j'ai fini avec la lutte ; je me soumets. »
Elle rabattit son voile sur son visage, salua le docteur et quitta le cabinet.
Il sonna, la reconduisit jusqu'à l'antichambre, et, comme le domestique refermait la porte derrière elle, un éclair de curiosité indigne de lui et en même temps irrésistible traversa l'esprit du docteur. C'est en rougissant qu'il dit à son domestique :
« Suivez-la chez elle, et sachez son nom. »
Pendant un instant le serviteur regarda le maître, se demandant s'il en croirait ses oreilles. Le docteur Wybrow le fixa en silence. Le domestique comprit ce que ce silence signifiait, il prit son chapeau et s'élança dans la rue. Le docteur rentra dans son cabinet. À peine y fut-il qu'un changement subit se fit en lui. Cette femme avait-elle donc apporté chez lui une épidémie de mauvais sentiments. Y avait-il déjà succombé ?
Quel besoin avait-il de se rabaisser aux yeux de son propre domestique ? Sa conduite était indigne d'un honnête homme ; d'un homme qui l'avait fidèlement servi depuis des années, il venait de faire un espion !
Irrité à cette seule pensée, il courut à l'antichambre et en ouvrit la porte. Le domestique avait disparu ; il était trop tard pour le rappeler. Il ne lui restait qu'un moyen d'oublier le mépris qu'il se sentait pour lui-même : le travail. Il monta en voiture et fit ses visites à ses malades.
Si ce fameux médecin avait pu détruire sa réputation, il l'aurait fait cet après-midi même. Jamais encore il ne s'était montré si peu soigneux de ses malades. Jamais encore il n'avait remis au lendemain l'ordonnance qui aurait dû être écrite à l'instant même, le diagnostic qui aurait dû être donné instantanément. Il rentra chez lui de meilleure heure que de coutume, fort mécontent.
Le domestique était de retour. Le docteur Wybrow n'osait plus le questionner ; mais avant d'être interrogé, il rendit compte du résultat de sa mission.
« La dame s'appelle la comtesse Narona. Elle demeure à… »
Sans en entendre davantage, le docteur fit un signe de tête comme pour remercier et entra dans son cabinet. L'argent qu'il avait refusé était encore sur la table, dans son petit rouleau de papier blanc. Il le mit sous une enveloppe qu'il cacheta : il le destinait au tronc pour les pauvres du bureau de police voisin ; puis, appelant le domestique, il lui donna l'ordre de le porter au magistrat dès le lendemain matin. Fidèle à ses devoirs, le domestique fit la question accoutumée :
« Monsieur dîne-t-il chez lui aujourd'hui ? »
Après un moment d'hésitation, le docteur dit :
« Non, je vais dîner au cercle. »
De toutes les qualités morales, celle qui se perd le plus facilement est sans contredit la conscience. L'esprit humain, dans certains cas, n'a pas de juge plus sévère qu'elle ; dans d'autres, au contraire, l'esprit et la conscience sont au mieux ensemble et vivent en harmonie comme deux complices. Quand le docteur Wybrow sortit de chez lui pour la seconde fois, il ne chercha même pas à se cacher à lui-même que la seule raison pour dîner au cercle était de chercher à savoir ce que le monde disait de la comtesse Narona.
III
Il fut un temps où l'homme, à l'affût de toutes les médisances recherchait la société des femmes. Maintenant l'homme fait mieux : il va à son cercle et entre dans le fumoir.
Le docteur Wybrow alluma donc son cigare et regarda autour de lui : ses semblables étaient réunis en conclave. La salle était pleine, mais la conversation encore languissante. Le docteur, sans s'en douter y apporta l'entrain qui y manquait. Quand il eut demandé si quelqu'un connaissait la comtesse Narona, il lui fut répondu par une sorte de tollé général indiquant l'étonnement. Jamais, telle était du moins l'opinion du conclave, jamais on n'avait encore fait une question aussi absurde ! Tout le monde, au moins toute personne ayant la plus petite place dans ce qu'on appelle la société, connaissait la comtesse Narona. Une aventurière à la réputation européenne aussi noire que possible, d'ailleurs, tel fut en trois mots le portrait de cette femme au teint pâle et aux yeux étincelants. Puis, passant aux détails, chaque membre du cercle ajouta un souvenir scandaleux à la liste de ceux qu'on attribuait à la comtesse. Il était douteux qu'elle fût réellement ce qu'elle prétendait être, une grande dame dalmatienne. Il était douteux qu'elle eût jamais été mariée au comte dont elle prétendait être la veuve. Il était douteux que l'homme qui l'accompagnait dans ses voyages, sous le nom de baron Rivar, et en qualité de frère, fût véritablement son frère. On prétendait que le baron était un joueur connu dans tous les tapis verts du continent. On prétendait que sa soi-disant sœur avait été mêlée à une cause célèbre relative à un empoisonnement, à Vienne ; – qu'elle était connue à Milan comme une espionne de l'Autriche ; – que son appartement à Paris avait été dénoncé à la police comme un véritable tripot, et que son apparition récente en Angleterre était le résultat naturel de cette dernière découverte. Un seul membre de l'assemblée des fumeurs prit la défense de cette femme si gravement outragée, et déclara que sa réputation avait été cruellement et injustement noircie. Mais cet homme était un avocat, son intervention ne servit à rien ; on l'attribua naturellement à l'amour de la contradiction qu'éprouvent tous les gens de son métier. On lui demanda ironiquement ce qu'il pensait des circonstances à la suite desquelles la comtesse en était arrivée à promettre sa main ; il répondit d'une manière très caractéristique, qu'il pensait que les circonstances auxquelles on faisait allusion n'avaient rien que de fort honorable pour les deux personnes qui y étaient intéressées, et qu'il regardait le futur mari de la dame comme un homme des plus heureux et des plus dignes d'envie. Le docteur provoqua alors un nouveau cri d'étonnement en demandant le nom de la personne que la comtesse allait épouser.
Tous ses amis du fumoir déclarèrent à l'unanimité que le célèbre médecin devait être un frère de la Belle au Bois-Dormant, et qu'il venait à peine de se réveiller d'une léthargie de vingt ans. C'était parfait de dire qu'il était tout à sa profession et qu'il n'avait ni le temps ni le goût de ramasser dans les dîners ou dans les bals les bouts de conversations qui arrivaient à ses oreilles ; mais un homme qui ne savait pas que la comtesse Narona avait emprunté de l'argent à Hombourg à lord Montbarry, et l'avait ensuite amené à lui faire une proposition de mariage, n'avait probablement jamais entendu parler non plus de lord Montbarry lui-même. Les plus jeunes membres du cercle, amis de la plaisanterie, envoyèrent le domestique chercher un dictionnaire de la noblesse et lurent pour le docteur, à haute voix, la généalogie de la personne en question, l'agrémentant de commentaires variés qu'ils y intercalaient à l'usage du docteur.
Herbert John Westwick. Premier baron Montbarry, de Montbarry, comté du roi en Irlande. Créé pair pour des services militaires distingués dans les Indes. Né en 1812. « Âgé de quarante-huit ans, docteur. » En ce moment non marié. « Sera marié la semaine prochaine, docteur, à la délicieuse créature dont nous avons parlé. » Héritier présomptif : le frère cadet de Sa Seigneurie, Stephen Robert, marié à Ella, la plus jeune fille du révérend Silas Marden, recteur de Rumigate, a trois filles de son mariage. Les plus jeunes frères de Sa Seigneurie, Francis et Henry, non mariés. Sœurs de Sa Seigneurie, lady Barville, mariée à sir Théodore Barville, Bart ; et Anne, veuve de feu Peter Narbury, esq., de Narbury Cross. « Retenez bien, docteur, la famille de sa Seigneurie. Trois frères Westwick, Stephen, Francis et Henry ; et deux sœurs, lady Barville et Mrs Narbury. Pas un des cinq ne sera présent au mariage, et il n'en est pas un des cinq qui ne fera tout son possible pour l'empêcher, si la comtesse en donne le moindre prétexte. Ajoutez à ces membres hostiles de la famille une autre parente offensée qui n'est pas mentionnée dans le dictionnaire, une jeune demoiselle. »
Un cri soudain de protestation partant de tous les côtés de la salle arrêta la révélation qui allait suivre et délivra le docteur d'une plus longue persécution.
« Ne dites pas le nom de la pauvre fille ; c'est de fort mauvais goût de plaisanter sur ce qui lui est arrivé ; elle s'est conduite fort bien, malgré les honteuses provocations auxquelles elle a été en butte ; il n'y a qu'une excuse pour Montbarry : il est fou ou imbécile. »
C'est en ces termes ou à peu près que chacun s'exprima. En causant intimement avec son plus proche voisin, le docteur découvrit que la dame de laquelle on causait lui était déjà connue par la confession de la comtesse : c'était la personne abandonnée par lord Montbarry. Son nom était Agnès Lockwood. On disait qu'elle était de beaucoup supérieure à la comtesse et qu'elle était en outre de quelques années moins âgée. Faisant d'ailleurs toutes les réserves possibles sur les mauvaises actions que les hommes commettent chaque jour dans leurs relations avec les femmes, la conduite de Montbarry semblait des plus blâmables. Sur ce point, chacun était d'accord, y compris l'avocat.
Aucun d'entre eux ne put ou ne voulut se souvenir des monstrueux exemples qu'il y a de l'influence irrésistible que certaines femmes ont sur les hommes, en dépit de leur laideur. Les membres du cercle qui s'étonnaient le plus du choix de Montbarry étaient justement ceux que la comtesse, malgré son défaut de beauté, eût très aisément fascinés si elle eût voulu s'en donner la peine.
Pendant que le mariage de la comtesse était encore le pivot de la conversation, un membre du cercle entra dans le fumoir. Son apparition fit faire aussitôt un silence absolu. Le voisin du docteur Wybrow lui dit tout bas :
« Le frère de Montbarry, Henry Westwick ? »
Le nouveau venu regarda lentement autour de lui en souriant amèrement :
« Vous parlez de mon frère ? dit-il. Ne faites pas attention à moi. Aucun de vous ne peut avoir pour lui plus de mépris que je n'en ai moi-même. Continuez, messieurs, continuez ! »
Un seul des assistants prit le nouveau venu au mot. C'était l'avocat qui avait déjà tenté la défense de la comtesse.
« Je reste donc seul de mon opinion, dit-il, mais je n'ai pas honte de la répéter devant qui que ce soit. Je considère la comtesse Narona comme fort injustement soupçonnée. Pourquoi ne deviendrait-elle pas la femme de lord Montbarry ? Qui de nous peut dire qu'elle fait une spéculation, par exemple, en l'épousant ? »
Le frère de Montbarry se retourna brusquement vers celui qui venait de parler :
« Moi je le dis ! » répliqua-t-il.
La réponse aurait pu désarçonner certaines gens, mais l'avocat resta impassible et continua à défendre le terrain qu'il avait choisi.
« Je crois que je suis dans le vrai, reprit-il en disant que le revenu de Sa Seigneurie est plus que suffisant pour fournir à ses besoins sa vie durant ; j'ajoute que c'est un revenu provenant presque entièrement de propriétés en terres situées en Irlande et dont chaque arpent est substitué ».
Le frère de Montbarry fit un signe d'assentiment pour faire comprendre qu'il n'y avait pas d'objection possible sur ce point.
« Si Sa Seigneurie décède en premier, continua l'avocat, on m'a dit que le seul legs qu'il peut faire à sa veuve consiste en fermages sur la propriété, ne s'élevant pas à plus de 400 livres par an. Ses pensions, ses retraites, c'est un fait bien connu, s'éteignent avec lui.
« Quatre cents livres par an, voilà donc tout ce qu'il peut donner à la comtesse, s'il la laisse veuve.
– Quatre cents livres par an, ce n'est pas tout. Mon frère a assuré sa vie pour 10, 000 livres qu'il a léguées à la comtesse au cas où il mourrait avant elle. »
Cette déclaration produisit un certain effet. Chacun se regarda en répétant ces trois mots : – Dix mille livres ! Poussé au pied du mur, le notaire fit un dernier effort pour défendre sa position.
« Puis-je vous demander qui a fait de cet arrangement une condition du mariage ? dit-il ; ce n'est sûrement pas la comtesse elle-même ?
– C'est le frère de la comtesse, ce qui revient absolument au même, répondit Henry Westwick. »
Après cela, il n'y avait plus à discuter, au moins tant que le frère de Montbarry serait présent. La conversation changea donc, et le médecin rentra chez lui.
Mais sa curiosité malsaine sur la comtesse n'était pas encore satisfaite. Dans ses moments de loisir, il pensait à la famille de lord Montbarry et se demandait si elle réussirait en définitive à empêcher le mariage. Chaque jour il se prenait à désirer connaître le malheureux à qui on avait ainsi tourné la tête. Chaque jour, durant le court espace de temps qui devait s'écouler avant le mariage, Il se rendit au cercle pour tâcher d'apprendre quelques nouvelles. Rien ne s'était passé, c'est tout ce que l'on savait au cercle. La position de la comtesse était toujours inébranlable : lord Montbarry voulait plus que jamais épouser cette femme. Tous deux étaient catholiques, le mariage devait être célébré à la chapelle de la place d'Espagne. Voilà tout ce que le docteur apprit de nouveau.
Le jour de la cérémonie, après avoir lutté quelques instants avec lui-même, il se décida à sacrifier pour un jour ses malades et leurs guinées, et se dirigea, sans en rien dire vers la chapelle. Sur la fin de sa vie, il entrait en colère quand quelqu'un lui rappelait sa conduite ce jour-là !
Le mariage fut, pour ainsi dire, secret. Une voiture fermée attendait à la porte de l'église ; quelques personnes appartenant pour la plupart à la basse classe, et presque toutes de vieilles femmes, étaient éparpillées dans l'intérieur de l'église. Le docteur aperçut cependant quelques rares visages de quelques-uns des membres du cercle, attirés comme lui par la curiosité. Quatre personnes seulement étaient devant l'autel : la mariée, le marié et leurs deux témoins. Un de ces derniers était une vieille femme, qui pouvait passer pour la camériste ou la dame de compagnie de la comtesse ; l'autre était sans aucun doute son frère, le baron Rivar. Toutes les personnes faisant partie de la noce, la mariée elle-même, portaient leurs costumes habituels du matin. Lord Montbarry était un homme d'âge moyen, au type militaire, n'ayant rien de remarquable ni dans la démarche, ni dans la physionomie. Le baron Rivar, lui, était la personnification d'un autre type bien connu. On rencontre à Paris presque à chaque pas, sur les boulevards, ces moustaches cirées en pointes, ces yeux hardis, ces cheveux noirs frisés et épais, en un mot cette tête portée arrogamment ; il ne ressemblait en rien à sa sœur.
Le prêtre qui officiait était un pauvre bon vieillard remplissant les devoirs de son ministère avec une sorte de résignation et ressentant des douleurs rhumatismales chaque fois qu'il était obligé de s'agenouiller.
La personne sur qui aurait dû se concentrer toute la curiosité des assistants, la comtesse, souleva son voile au commencement de la cérémonie ; mais sa robe, d'une extrême simplicité, n'appelait pas longtemps les regards. Jamais mariage ne fut moins intéressant et plus bourgeois que celui-là. De temps en temps le docteur jetait un coup d'œil vers la porte, comme s'il attendait la subite intervention de quelqu'un qui viendrait révéler un terrible secret et s'opposer à la continuation de la cérémonie. Rien de semblable n'arriva, rien d'extraordinaire, rien de dramatique.
Étroitement liés l'un à l'autre par un éternel serment, les deux époux disparurent suivis de leurs témoins, pour aller signer sur le registre à la sacristie ; cependant le docteur attendait toujours et continuait à nourrir l'espoir obstiné qu'un événement inattendu et important devait certainement arriver.
Mais le temps passa et le couple uni rentra dans l'église, se dirigeant cette fois vers la porte.
Le docteur, afin de n'être pas vu, essaya de se cacher ; à sa grande surprise, la comtesse l'aperçut. Il l'entendit dire à son mari :
« Un moment, je vous prie, je vois un ami, »