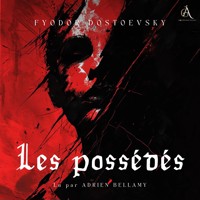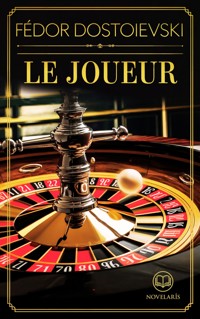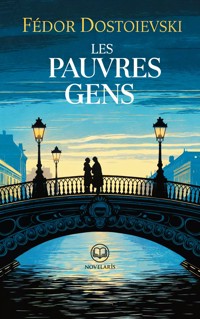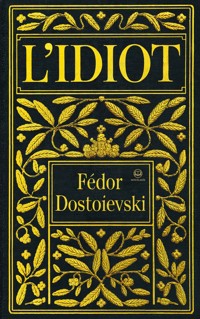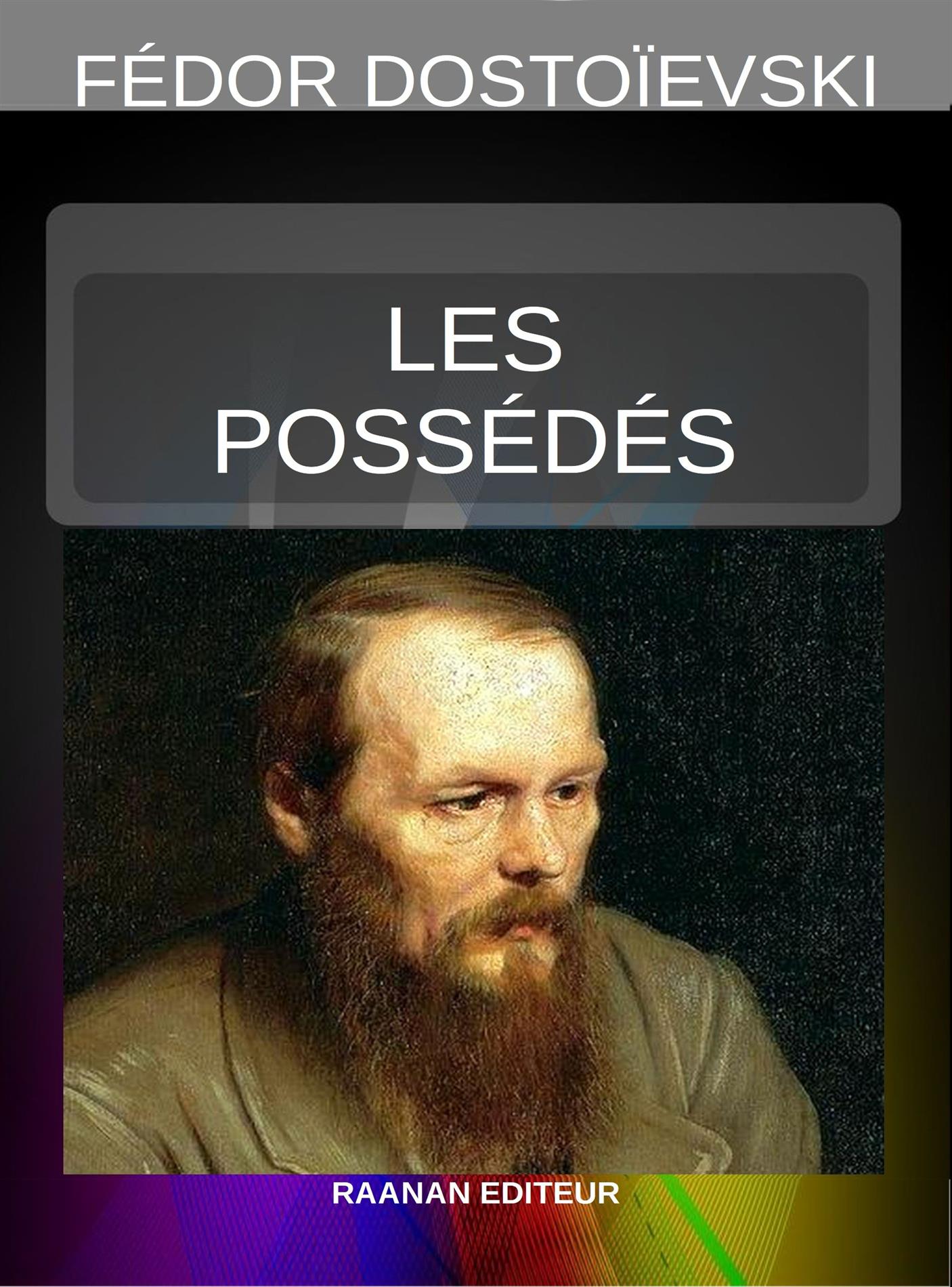3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L’Idiot est un roman de l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski publié en 1874.
Le prince Mychkine est un être fondamentalement bon, mais sa bonté confine à la naïveté et à l’idiotie, même s’il est capable d’analyses psychologiques très fines. Après avoir passé sa jeunesse en Suisse dans un sanatorium pour soigner son épilepsie, il retourne en Russie pour pénétrer les cercles fermés de la société russe, sans sou ni attache, mais avec son titre de noblesse et un certificat de recommandation en poche. Il se retrouve par hasard mêlé à un projet de mariage concernant Nastassia Filippovna, jeune femme très belle, adulée par un grand nombre de soupirants, mais dont le seul amant est Totzky, son tuteur de 55 ans qui l’a élevée et en a fait sa maîtresse dès la petite adolescence…
|Wikipédia|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SOMMMAIRE
TOME I
AVERTISSEMENT
PREMIÈRE PARTIE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
DEUXIÈME PARTIE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
TOME II
XI
XII
TROISIÈME PARTIE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
QUATRIÈME PARTIE
I
II
III
IV 12
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII CONCLUSION
Notes
FEDOR MIKHAÏLOVITCH DOSTOÏEVSKI
L’IDIOT
2 Tomes
roman
Traduction par Victor Derély . Plon.
Raanan Éditeur
Livre 165| édition2
L’IDIOT
TOME I
AVERTISSEMENT
On me pardonnera de revenir encore une fois à Dostoïevsky. À peine connu par quelques traductions, l’étrange écrivain a été exalté, puis dénigré outre mesure. Aujourd’hui seulement on pourra porter sur lui un jugement équitable et complet ; voici la pièce capitale du dossier, le livre tantôt profond, tantôt absurde, qui demeura toujours son œuvre de prédilection ; le romancier y a mis toute son âme trouble, tout son idéal maladif.
Devant la critique littéraire, l’Idiot ne soutient pas la comparaison avec Crime et Châtiment. Le début est alerte et habile, les principaux personnages nous sont familiers dès les premières pages ; mais bientôt un brouillard fantastique nous les dérobe ; ils se perdent au milieu d’innombrables figures qui viennent grimacer au premier plan. Ce livre n’a pas l’unité et l’intensité d’action de l’autre roman ; il ne nous montre pas, comme ce dernier, un drame moral où toutes les parties s’enchaînent et poussent le lecteur, haletant d’angoisse, vers une conclusion logique. Ce n’est pas aux lettrés que je le recommande, bien qu’en y regardant de près ils soient contraints d’admirer l’art prodigieux dépensé pour un assez maigre résultat ; ils se lasseront vite de ces intrigues bizarres, obscures, sans lien apparent, à moins qu’ils ne s’égayent aux dépens de ce Russe, naïf imitateur d’Eugène Sue dans la préparation de ses coups de théâtre. Par contre, je ne crois pas qu’il y ait une lecture plus passionnante pour le médecin, le physiologiste, le philosophe, pour tous ceux que préoccupe l’étude de cette mystérieuse machine à penser, logée dans l’animal humain.
L’idée mère de l’Idiot est celle-ci : un cerveau, atteint dans quelques-uns des ressorts que nous considérons comme essentiels, et qui ne nous servent que pour le mal, peut rester supérieur aux autres intellectuellement et moralement, – moralement surtout. Dostoïevsky a imaginé un type assez proche de l’innocent des campagnes russes, du saint populaire, tel que le béatifiait la piété du moyen âge ; il a reconstruit ce type avec les données de la physiologie, il l’a haussé de plusieurs degrés sur l’échelle sociale ; il l’a transporté dans la vie moderne la plus compliquée ; et il a voulu que cette créature inachevée joignit la prééminence de l’esprit à celle de la vertu. Il a voulu plus encore ; pour bien mesurer toute l’audace de sa pensée, il faut rechercher la genèse de l’Idiot. Je crois qu’on peut l’établir presque à coup sûr. L’écrivain a d’abord songé au Don Quichotte ; il y fait clairement allusion en un passage. Le roman de Cervantes a toujours un attrait particulier pour les imaginations russes ; il avait déjà fourni à Gogol l’idée première et le cadre des Âmes mortes ; il suggéra à Dostoïevsky le désir d’incarner à son tour, en un personnage symbolique, l’éternelle protestation de l’idéal contre le train fâcheux du monde. Mais, aussitôt engagé dans cette voie, notre mystique recule plus loin et monte plus haut ; nourri comme il l’est de la moelle évangélique, une illumination lui vient ; pourquoi ne pas réaliser dans un être vivant la parole du Maître : « Soyez comme des petits enfants. » Tel sera le prince Muichkine, « l’Idiot ». Écoutez-le parler et s’analyser lui-même : « L’homme aux soins duquel j’étais confié me dit un jour que dans sa conviction intime, j’étais un enfant et rien autre qu’un enfant, au sens propre du mot ; que par la taille et le visage je paraissais un adulte ; mais que, par le développement, l’âme, le caractère, et peut-être même par l’esprit, je n’étais pas un adulte ; et que tel je resterai, même si je vis jusqu’à soixante ans. Cela me fit rire ; il se trompait, sans doute ; pourquoi serais-je un petit enfant ? Mais la vérité, c’est que je n’aime pas me trouver avec les grandes personnes, parce que je ne sais que leur dire. »
Pour qu’on ne se méprenne pas sur l’intention, l’auteur nous montre d’abord, avec beaucoup d’adresse, le doux infirme vivant dans la société des enfants ses pareils et adoré d’eux. Puis il le plonge dans un milieu de coquins, d’usuriers, d’âmes perdues ; dès qu’ils entrent en contact avec lui, les plus pervers sont relevés, attendris, rachetés au moins pour une heure. Toutes les femmes sont attirées vers ce malade par un entraînement mystique ; il leur rend un amour de compassion, un sentiment qui semble tomber de plus haut et ignorer les liens de chair, amour d’un esprit céleste pour une créature terrestre. C’est peut-être le trait le plus original et le plus obscur des romans de Dostoïevsky, cette conception subtile, tout ensemble ascétique et passionnée, du plus humain des sentiments, qui ne garde chez lui rien d’humain.
Est-ce donc une pure abstraction, cette figure ridicule et touchante du prince Muichkine ? Non, car un écrivain aussi personnel ne pouvait renoncer à se peindre dans le fils préféré de son imagination. Il lui communique une partie de sa propre âme, celle qu’il estime la meilleure ; il lui prête ses idées dirigeantes, ses sensations habituelles, et jusqu’à sa constitution. Pour commencer, il le gratifie de son mal terrible, l’épilepsie ; et par l’action de ce mal sur les centres nerveux, il justifie la conformation intellectuelle de son héros : je ne dis pas la déformation, ce serait aller directement contre la pensée de l’auteur. Ce que le mal sacré a paralysé dans cet organisme, ce sont toutes les mauvaises végétations du cœur et de l’esprit, les passions brutales, l’égoïsme, l’ironie, l’habileté mondaine. De là ce sobriquet, l’Idiot, donné à la créature d’exception par tous ceux qui sont incapables de comprendre sa grandeur idéale.
Le sujet ainsi préparé, il fallait gagner cette gageure ; le faire évoluer dans un monde contre lequel il n’est pas armé, au milieu des gens les plus retors et des intrigues les plus embrouillées ; lui maintenir dans ce monde, sans trop d’invraisemblances, une supériorité constante ; montrer sans cesse la réussite inespérée de ses gaucheries, le triomphe de sa bonté maladroite sur les plans les mieux ourdis ; faire de « l’Idiot », enfin, le deus ex machina qui dénoue tous les imbroglios par le seul effet de sa droiture. Dostoïevsky a gagné la gageure dans les meilleures parties de son roman. Le prince Muichkine est simple avec les simples, il cause d’abondance de cœur avec un laquais auquel il découvre toutes ses pensées, et ailleurs avec l’homme qui vient de le souffleter. L’écrivain a su s’y prendre de telle sorte que l’idée de bassesse n’effleure pas un instant l’esprit du lecteur. Vis-à-vis des sages selon le monde, ce simple sera plus sage qu’eux, il trouvera les paroles qui confondent les docteurs. Ici, Dostoïevsky est dans son véritable élément ; il concentre dans quelques mots, avec un rare bonheur, toute la substance de ses méditations, tout ce christianisme essentiel qui fait le fond de son âme. Qu’elles sont parfois gracieuses ou profondes, les paroles de « l’Idiot » ! Soit qu’il dise, en parlant de ses petits amis : « L’âme se guérit près des enfants et par eux » ; soit qu’il réponde, en défendant un malheureux qu’on juge trop sévèrement : « C’est une erreur de juger l’homme comme vous faites ; il n’y a pas de tendresse en vous, il n’y a que le sentiment de la stricte justice ; donc vous devez être injuste. » À un malade condamné à une mort prochaine, il jette cet adieu : « Passez devant nous et pardonnez-nous notre bonheur. » Souvent, ce sont des mots d’un ascétisme transcendant : « Peut-être me méprisez-vous parce que je ne suis pas digne de ma souffrance », dit ce même mourant. — « Celui à qui il a été donné de souffrir davantage, c’est qu’il est digne de souffrir davantage. »
Et l’instant d’après, ce même homme fera ou dira les choses les plus baroques ; non point, remarquez-le bien, que l’auteur les lui prête pour s’égayer ou pour accuser un côté comique dans la figure de l’idiot ; cet auteur pense lui-même ces choses baroques d’aussi bonne foi qu’il pensait tout à l’heure des choses sublimes. Le sens du ridicule lui est totalement étranger, ainsi qu’à la plus grande partie de ses lecteurs ; auteur et lecteurs s’indigneraient en nous voyant rire aux larmes sur telle page de l’Idiot ; ils ne comprendraient pas pourquoi ce livre nous fait l’effet d’un monstre chimérique, né d’un accouplement d’idées disparates ; quelque chose comme un recueil des pensées de Marc-Aurèle, revu par MM. Clairville et Siraudin. Nous, d’autre part, avec notre finesse d’ironie, nous sommes presque incapables de comprendre cet esprit sauvage, illuminé, sérieux ; et la difficulté est d’autant plus grande que, pour mieux nous dérouter, il emprunte nos masques et nos vieux habits. À qui lirait quelques pages au hasard, ce roman semblerait une imitation des Mystères de Paris ; pour que l’innocent Muichkine sorte à son avantage de tous les pièges qu’on lui tend, Dostoïevsky a dû mettre en branle tous les ressorts du vieil Ambigu : rencontres fortuites et à point nommé d’une multitude de gens, héritages soudains, suppositions d’enfants, entrevues secrètes de nobles dames et de courtisanes. C’est par son bizarre amalgame que ce livre est si hautement symbolique du pays où il a été écrit ; ce pays revêt notre défroque, elle paraît d’autant plus grotesque qu’il la porte avec une grave gaucherie, et sous cette mascarade on trouve un fonds de pensées vierges, originales et puissantes, caractéristiques d’une race inconnue.
En effet, si folle que soit la débauche d’imagination mystique dans ce roman, le lecteur français se tromperait en le jugeant tout à fait irréel. L’idiot, les personnages invraisemblables qui se pressent autour de lui, les petites intrigues saugrenues où ils dépensent leur activité, tout ce monde et tous ces faits reprennent corps et réalité, quand on les replace dans certains milieux russes. Ainsi, j’ai cru longtemps qu’en imaginant ce type abstrait, Dostoïevsky avait franchement perdu terre et lâché la bride à sa fantaisie ; je l’ai cru jusqu’au jour où le hasard me fit rencontrer, précisément dans les conditions de vie où l’on nous représente le prince Muichkine, un homme qui eût pu lui servir de prototype ; victime, comme le héros du roman, d’une étrange maladie nerveuse, tenu pour idiot au jugement commun, doué pourtant de qualités intellectuelles et morales au-dessus de l’ordinaire, sans aucun aloi douteux. Ce jour-là, j’ai compris qu’il ne faut jamais accuser un artiste d’invention arbitraire, et que les formes innombrables de la vie ont toujours pu fournir un modèle à ses créations les plus surprenantes. De même pour ces femmes au cœur détraqué qui se disputent l’amour de l’idiot, Nastasia, Aglaé ; et pour tous ces coquins qui apparaissent et disparaissent comme des ombres au tournant des pages, chuchotant leurs secrets.
Un trait général différencie ces personnages de ceux auxquels nous sommes habitués et les rend absolument inacceptables pour les bonnes gens de chez nous. Ce trait, le voici : ils ne font pas ce qu’ils veulent de leur esprit. Un honnête Latin fait ce qu’il veut de son esprit, ou du moins il le croit ; il ne doute pas de son pouvoir pour enrayer, régler et diriger cette force soumise. Chez les Russes de Dostoïevsky, elle est indisciplinée ; leur pensée, débandée comme un ressort de machine qui échappe au mécanicien, procède par sauts et par bonds, avec des transitions subites des larmes au rire ; on croit entendre des pensionnaires de la Salpêtrière. De plus, cette pensée est compliquée et subtile au delà de toute imagination ; telle phrase toute simple en apparence cache une demi-douzaine d’intentions équivoques ; elle fait songer au roman qu’écrirait un Peau-Rouge, si le don d’écrire lui venait subitement. À chaque instant, dans un dialogue d’affaires ou d’amour, sans motif plausible, une tempête nerveuse secoue les deux interlocuteurs ; ils se taisent, ramassés sur eux-mêmes pour l’attaque, se défient et se meurtrissent le cœur réciproquement, comme deux bêtes féroces ; après quoi l’entretien reprend son cours naturel.
Une silhouette se détache avec une vigueur particulière parmi tous ces êtres fantastiques ; celle du marchand Rogojine. Il fera plus que tous les autres crier à l’invraisemblance ; c’est pourtant le type qui a le plus de chances d’être vrai, dans le milieu où Dostoïevsky l’a cherché ; nul homme ne peut pousser l’excès et la bizarrerie de nature aussi loin qu’un marchand russe quand il s’y met. Ce Rogojine est un fauve dangereux, affolé par la passion. Il fait planer sur tout le récit une épouvante mystérieuse ; on sent sur soi le regard énigmatique de ces yeux immobiles, qui guettent et fascinent le prince Muichkine au détour des rues. Rogojine aime une femme qui lui échappe sans cesse au moment où il croit la posséder, attirée qu’elle est par le timide et inconcevable sortilège de l’idiot ; dans la scène finale du roman, il prend cette malheureuse et la tue ; Muichkine vient le rejoindre au pied du lit où gît leur maîtresse ; les deux hommes la veillent ensemble, et ils causent, très-calmes, réconciliés. Cette scène est peut-être la plus puissante que Dostoïevsky ait jamais écrite. On se tromperait en jugeant sur ma rapide analyse qu’elle relève du mélodrame vulgaire ; les pages les plus tragiques de Macbeth ou d’Othello ne donnent pas une impression pareille de terreur concentrée. C’est fou, mais non pas à coup sûr de la folie qui fait sourire ; de celle qui glace et devient vite contagieuse au premier chef.
C’est fou ! Voilà bien certainement ce qu’on dira chez nous de ce livre, des personnages et des événements qui le remplissent. Et l’on se demandera une fois de plus si la littérature a le droit de s’attacher à des exceptions maladive. Je voudrais présenter à ce propos quelques brèves observations. Le roman en général, et celui de Dostoïevsky plus que tout autre, a pour objet de nous peindre des états de passion. Est-il téméraire d’affirmer que tout état passionnel est un commencement de folie, ou, si l’on aime mieux, une folie momentanée ? que les mouvements désordonnés de l’esprit et leurs signes extérieurs sont les mêmes, dans l’aliénation constitutionnelle qui tombe sous le diagnostic du médecin, et dans l’aliénation passagère pour laquelle on ne réclame pas le secours de ce médecin ? Qu’on veuille bien examiner à ce point de vue toute la littérature classique. Je ne parle même pas de Shakspeare, il me fournirait des arguments trop faciles ; mais des écrivains les plus mesurés, les moins suspects de se complaire aux singularités pathologiques, d’un Euripide ou d’un Racine. Voyez, écoutez Oreste, Phèdre, Hermione ; le désordre des sentiments et des idées, le désordre des gestes, quand un acteur de génie interprète ces rôles, est-ce autre chose en principe que la folie délirante, telle qu’un aliéniste l’observe dans sa clinique ? Sans doute les convenances de l’art classique ont beaucoup atténué l’excès d’impulsion dans ces sentiments et ces gestes ; c’est une question de nuances ; mais les phénomènes sont du même ordre, sur ce théâtre où l’on représente des scènes de passion, et à l’asile où l’on traite des monomanes, des agités. Si, au lieu de ces héros relativement contenus, vous ramenez sur le théâtre Hamlet ou Macbeth, il n’y a plus aucune différence dans l’expression des deux folies. Ainsi, la littérature, qu’elle le veuille ou non, étudie un cas de maladie, elle fait de la pathologie mentale, chaque fois qu’elle nous dépeint un état passionnel très-caractérisé.
Ce qui distingue les écrivains classiques d’un Dostoïevsky, — en dehors des questions de mesure et d’intensité, — c’est que les premiers n’ont jamais soupçonné qu’ils s’aventuraient sur un terrain où leur art se rencontrait avec celui du médecin. Des rapports étroits qui existent entre leurs personnages et les victimes d’une affection morbide, ils n’ont pas conclu à l’identité de cause. Au contraire, le romancier russe a la connaissance de ces rapports. Il considère la folie comme un phénomène d’ordre général, normal en un sens, que tout être humain subit à certains moments et jusqu’à un certain degré. En dehors même de ces moments, il constate dans la plupart des cerveaux certaines particularités natives, du même ordre que celles qui reçoivent un stigmate officiel et conduisent leur homme à l’hospice. Bien plus, il admet que ces conformations singulières sont parfois un titre à notre admiration et à notre respect, comme elles deviennent dans d’autres cas un objet de dégoût et de réprobation.
J’effleure à peine les questions que ce livre soulève. À chacun de les poursuivre aussi loin que bon lui semble. J’en ai dit assez pour indiquer quelle sorte d’intérêt il faut chercher dans cette nouvelle œuvre de Dostoïevsky. Elle a peut-être le tort de venir trop tôt. Dans cinquante ans quand la science de l’homme aura imposé au grand public la lente et inévitable révolution à laquelle nous assistons, quand il aura fallu rayer des dictionnaires usuel beaucoup de vieux vocables, dont l’acception trop étroite ne répond plus à l’état de nos connaissances, — et en premier lieu les mots de fou, de folie, — on s’apercevra que ce Russe audacieux a remué bien des problèmes qui seront alors sinon résolus, du moins franchement acceptés par tous. On lui saura gré, au milieu de beaucoup d’exagérations et d’enfantillages, d’avoir su concilier ses intuitions physiologiques avec un idéal moral et religieux, de ne s’être pas révolté contre un mystère qu’il faut bien admettre, sous peine de méconnaître l’une des deux évidences, celle du cœur ou celle de la raison.
Ceux qui aiment à réfléchir sur ces matières liront l’Idiot jusqu’au bout ; ceux-là aussi qui ne plaignent pas leurs nerfs, qui se plaisent aux cours et aux expériences de M. Charcot. Ce ne sera pas le cas, je le crains, pour la clientèle habituelle des romans. Jugez donc, un roman qui fait penser autant qu’un traité de philosophie, et travailler l’esprit autant qu’un texte hiéroglyphique ! Notre éducation littéraire nous a enseigné le respect des genres, et nous ne souffrons pas qu’on les mêle ; il y a le livre qui doit faire penser et celui qui ne le doit pas ; nous lisons volontiers les deux, mais chacun à son heure ; ici, Paul de Kock et Ponson du Terrail ; là, Malebranche ou Claude Bernard. Je devais prévenir loyalement que, dans cette fiction barbare, Dostoïevsky a mêlé les genres. Ceux que l’exercice de penser fatigue trop ne seront pas pris en guet-apens.
E. M. de Vogüé.
PREMIÈRE PARTIE
I
C’était à la fin de novembre ; par un temps de dégel, humide et brumeux, le train de Varsovie arrivait à toute vapeur à Pétersbourg. Le brouillard était tel qu’à neuf heures du matin on voyait à peine clair ; à droite et à gauche de la voie ferrée il était difficile d’apercevoir quelque chose par les fenêtres du wagon. Dans le nombre des voyageurs, il y en avait bien quelques-uns qui revenaient de l’étranger, mais les voitures les plus remplies étaient celles de troisième classe, et les gens de peu qui les occupaient ne venaient pas de fort loin. Tous étaient fatigués, transis ; tous avaient les yeux appesantis par une nuit d’insomnie ; le brouillard mettait une pâleur jaunâtre sur tous les visages.
Depuis l’aurore, dans un des compartiments de troisième classe, se trouvaient assis en face l’un de l’autre, près de la même fenêtre, deux voyageurs, — tous deux jeunes, tous deux vêtus sans élégance, tous deux porteurs de physionomies assez remarquables, tous deux, enfin, désireux d’entrer en conversation ensemble. Si chacun d’eux avait su ce que son vis-à-vis offrait de particulièrement curieux en ce moment, ils se seraient sans doute étonnés du hasard étrange qui les avait mis en face l’un de l’autre dans un wagon de troisième classe, sur la ligne de Varsovie à Pétersbourg. L’un d’eux, âgé de vingt-sept ans, était de petite taille ; il avait des cheveux crépus et presque noirs, des yeux gris, petits, mais pleins de feu. Son nez était épaté, ses pommettes saillantes ; ses lèvres minces esquissaient continuellement un sourire effronté, moqueur et même méchant ; mais le front, haut et bien modelé, corrigeait l’impression déplaisante que produisait le bas de la figure. Ce qui frappait surtout dans ce visage, c’était sa pâleur cadavérique. Quoique le jeune homme fût d’une constitution assez robuste, cette pâleur donnait à l’ensemble de sa physionomie un air d’épuisement, et, en même temps, quelque chose de douloureusement passionné qui ne s’harmonisait ni avec le sourire impudent des lèvres, ni avec l’expression hardie et présomptueuse du regard. Chaudement enveloppé dans une large pelisse d’agneau, il n’avait pas eu froid la nuit, tandis que la fraîcheur nocturne de l’automne russe avait glacé son voisin, qui, évidemment, n’était pas préparé à l’affronter. Ce dernier avait sur lui un gros manteau pourvu d’un immense capuchon et privé de manches, comme en portent les touristes qui, en hiver, visitent la haute Italie ou la Suisse. Mais ce qui était bon pour voyager dans ces contrées devenait tout à fait insuffisant en Russie. Le possesseur de ce manteau, jeune homme de vingt-six ou vingt-sept ans, était d’une taille un peu au-dessus de la moyenne ; il avait des cheveux blonds et épais, des joues creuses, une petite barbe pointue et presque complètement blanche. Ses yeux étaient grands, bleus et fixes ; leur regard doux mais pesant offrait cette expression étrange qui révèle à certains observateurs un individu sujet aux attaques d’épilepsie. Le jeune homme avait des traits agréables, fins et délicats, mais son visage était pâle et même, en ce moment, bleui par le froid. Ses mains tenaient un petit paquet, — probablement tout son bagage, — enveloppé dans un vieux foulard passé de couleur. Ses pieds étaient chaussés de souliers aux semelles épaisses, et, — autre particularité contraire aux usages russes, — il portait des guêtres. L’homme à la pelisse d’agneau examina, un peu par désœuvrement, tout l’extérieur de son voisin, et à la fin lui adressa la parole.
— Vous êtes frileux ? demanda-t-il avec un haussement d’épaules.
En même temps, il avait sur les lèvres ce sourire inconvenant par lequel les gens mal élevés expriment quelquefois leur satisfaction à la vue des misères du prochain.
— Très-frileux, répondit avec un empressement extraordinaire l’interpellé, — et, remarquez, ce n’est encore que le dégel. Que serait-ce s’il gelait ? Je ne pensais même pas qu’il faisait si froid chez nous. Je n’ai plus l’habitude de ce climat.
— Vous arrivez de l’étranger, sans doute ?
— Oui, de la Suisse.
— Fu — u !…
Le voyageur aux cheveux noirs siffla et se mit à rire.
La conversation s’engagea. Avec une complaisance étonnante, le jeune homme blond répondit à toutes les questions de son interlocuteur, sans remarquer aucunement combien certaines d’entre elles étaient déplacées. Interrogé, il fit connaître, notamment, qu’en effet, pendant longtemps, plus de quatre ans, il avait séjourné hors de la Russie : on l’avait envoyé à l’étranger parce qu’il était malade ; il souffrait d’une singulière affection nerveuse caractérisée par des tremblements et des convulsions ; c’était quelque chose dans le genre de l’épilepsie ou de la danse de Saint-Guy. En l’écoutant, l’homme aux cheveux noirs sourit plusieurs fois, surtout quand, à la question : « Eh bien, vous a-t-on guéri ? » son voisin eut répondu : « Non, on ne m’a pas guéri ».
— Hé ! sans doute ils vous ont fait débourser pour rien beaucoup d’argent, et ici nous avons foi en eux ! observa aigrement le voyageur à la pelisse d’agneau.
— C’est l’exacte vérité ! ajouta un monsieur mal mis qui se trouvait assis près d’eux ; — c’est parfaitement vrai, ils ne font qu’absorber en pure perte toutes les ressources de la Russie !
Celui qui venait de se mêler à la conversation avait la tournure d’un scribe de chancellerie ; c’était un robuste quadragénaire au nez rouge et au visage bourgeonné.
— Oh ! combien vous vous trompez en ce qui me concerne ? reprit d’un ton doux et conciliant le client de la médecine suisse : — assurément je ne puis contester vos dires, parce que je ne sais pas tout, mais mon docteur s’est saigné pour me fournir les moyens de revenir en Russie, et, pendant près de deux ans, il m’a gardé là-bas à ses frais.
— Comment ? il n’y avait personne pour le payer ? demanda le voyageur aux cheveux noirs.
— Non ; monsieur Pavlichtcheff, qui pourvoyait à mon entretien en Suisse, est mort il y a deux ans ; j’ai écrit ensuite ici à la générale Epantchine, ma parente éloignée, mais je n’ai pas reçu de réponse. Là-dessus, je suis parti.
— Où allez-vous donc ?
— Vous me demandez où je compte descendre ?… Ma foi, je n’en sais rien encore… c’est comme cela tombera…
— Vous n’êtes pas encore fixé ?
Et, de nouveau, le voyageur aux cheveux noirs se mit à rire, ainsi que le monsieur au nez rouge.
— J’ai peur que tout votre avoir ne soit contenu dans ce foulard ?… dit le premier.
— Je le parierais, ajouta le second d’un air extrêmement satisfait ; — je suis sûr qu’à cela se réduit tout votre bagage ; du reste, pauvreté n’est pas vice.
La supposition de ces deux messieurs se trouvait être conforme à la réalité, et le jeune homme blond n’hésita pas une minute à le reconnaître.
— Votre petit paquet ne laisse pas d’avoir une certaine importance, continua l’employé, après qu’ils eurent ri tout leur soûl (chose à noter, celui dont ils se moquaient avait fini lui-même, en les regardant, par s’associer à leur hilarité, ce qui les avait fait rire de plus belle), — et quoiqu’on puisse parier que les rouleaux de napoléons et de frédérics d’or y brillent par leur absence, cependant… si, en sus de ce modeste bagage, vous possédez une parente comme la générale Épantchine, cela ne sera pas sans modifier passablement la signification de votre petit paquet. Bien entendu, ce que j’en dis, c’est seulement pour le cas où la générale Épantchine serait effectivement votre parente, et où vous ne vous tromperiez point, par distraction… ce qui est on ne peut plus naturel à l’homme… s’il a beaucoup d’imagination.
— Oh ! vous avez encore deviné juste, répondit le voyageur blond ; — en effet, voyez-vous, je me trompe presque, je veux dire qu’elle est à peine ma parente. C’est au point que je ne me suis nullement étonné de son silence. Je m’y attendais.
— Vous avez fait inutilement la dépense d’un timbre-poste. Hum… au moins vous êtes franc et naïf, cela est louable ! Hum… nous connaissons le général Épantchine parce que tout le monde le connaît. Le défunt monsieur Pavlichtcheff qui pourvoyait à votre entretien en Suisse, nous l’avons aussi connu, si toutefois c’était Nicolas Andréiévitch Pavlichtcheff, car il y avait deux cousins germains qui portaient ce nom. L’autre habite encore en Crimée ; mais Nicolas Andréiévitch, celui qui est mort, était un homme considéré, il possédait de hautes relations et il a eu dans son temps quatre mille âmes…
— C’est bien lui, on l’appelait Nicolas Andréiévitch Pavlichtcheff, répondit le jeune homme, et il regarda attentivement ce monsieur qui savait tout.
Ces gens si bien informés se rencontrent parfois, et même assez fréquemment, dans une certaine couche sociale. Il n’est rien qu’ils ne sachent ; toute leur curiosité d’esprit, toutes leurs facultés d’investigation sont incessamment tournées du même côté, sans doute en l’absence d’intérêts vitaux plus importants, comme dirait un penseur moderne. Du reste, cette omniscience qu’ils possèdent est circonscrite à un domaine assez restreint : ils savent où sert un tel, qui connaît, combien il a de fortune, où il a été gouverneur, avec qui il s’est marié, ce que sa femme lui a apporté en dot, quels sont ses cousins germains et issus de germains, etc., etc. La plupart du temps, les messieurs qui sont ainsi au courant de toutes choses ont des habits troués au coude et touchent par mois dix-sept roubles d’honoraires, mais ils trouvent dans leur savoir une satisfaction d’amour-propre qui les console au milieu de l’adversité.
Pendant toute cette conversation, le jeune homme aux cheveux noirs regardait négligemment par la fenêtre, bâillait, et avait hâte d’être arrivé au terme de son voyage. Il semblait distrait, fort distrait, presque inquiet ; sa manière d’être devint même étrange : parfois il regardait sans voir, écoutait sans entendre, riait sans savoir lui-même pourquoi.
— Mais permettez, avec qui ai-je l’honneur ?….. demanda tout à coup le monsieur bourgeonné au propriétaire du petit paquet.
— Le prince Léon Nikolaïévitch Muichkine, lui fut-il immédiatement répondu.
— Le prince Muichkine ? Léon Nikolaïévitch ?
Je ne connais pas. Je n’en ai même jamais entendu parler, dit en réfléchissant l’employé ; — je ne parle pas du nom, le nom est historique, on peut et on doit le trouver dans l’histoire de Karamzine ; je parle du personnage, il ne se rencontre plus nulle part de princes Muichkine et même la renommée a cessé de s’occuper d’eux.
— Oh ! je crois bien ! reprit aussitôt le jeune homme ; — à présent il n’existe plus d’autres princes Muichkine que moi ; je dois être le dernier. Quant à mes ancêtres, depuis plusieurs générations, c’étaient des gentilshommes paysans. Mon père, du reste, a été sous-lieutenant dans l’armée. Mais je ne sais pas comment la générale Épantchine se trouve être une princesse Muichkine ; c’est aussi la dernière dans son genre|1|…
— Hé, hé, hé ! la dernière dans son genre ! Comme vous avez tourné cela ! fit en riant l’employé.
Le mot amena aussi un sourire sur les lèvres du monsieur aux cheveux noirs. Le prince fut un peu étonné d’avoir commis un calembour, d’ailleurs, assez mauvais.
— Figurez-vous que j’ai dit cela tout à fait sans y penser, expliqua-t-il enfin.
— Cela se comprend, cela se comprend, répondit gaiement l’employé.
— Mais là-bas, prince, vous étudiiez, vous aviez un professeur ? demanda soudain l’autre voyageur.
— Oui… j’étudiais…
— Eh bien, moi, je n’ai jamais rien appris.
— Je n’ai pas non plus acquis beaucoup d’instruction, observa le prince, comme s’il eût voulu s’excuser, — mon état de santé ne me permettait pas de faire des études suivies.
— Connaissez-vous les Rogojine ? reprit vivement le jeune homme aux cheveux noirs.
— Non, je ne les connais pas du tout. Je ne connais presque personne en Russie. Vous êtes un Rogojine ?
— Oui, je m’appelle Parfène Rogojine.
— Parfène ? Mais ne seriez-vous pas un de ces Rogojine… commença l’employé avec une gravité renforcée.
— Oui, un de ceux-là même, répondit impatiemment le jeune homme sans laisser au monsieur bourgeonné le temps d’achever sa phrase ; du reste, pendant toute cette conversation, il ne s’était pas une seule fois adressé à lui et n’avait jamais causé qu’avec le prince.
L’employé stupéfait ouvrit de grands yeux, et tout son visage prit à l’instant une expression de respect servile, craintif même.
— Mais… comment cela ? poursuivit-il ; — vous seriez le fils de ce même Sémen Parfénovitch Rogojine, bourgeois notable héréditaire, qui est mort il y a un mois, laissant un capital de deux millions et demi ?
— Et comment as-tu su qu’il avait laissé deux millions et demi de capital net ? répliqua le voyageur aux cheveux noirs sans daigner cette fois encore regarder le monsieur bourgeonné, et il ajouta en le montrant des yeux au prince : — Voyez donc, il n’a pas plutôt appris la chose qu’il fait déjà le chien couchant ! Mais c’est la vérité que mon père est mort et qu’après un mois passé à Pskoff je reviens chez moi dans l’accoutrement d’un va-nu-pieds. Ni mon coquin de frère ni ma mère ne m’ont rien envoyé ; je n’ai reçu ni argent ni avis ! On n’en aurait pas usé autrement à l’égard d’un chien ! La fièvre m’a tenu alité à Pskoff pendant tout un mois !
— Mais maintenant vous allez toucher d’un seul coup un joli petit million, si pas plus ; oh ! Seigneur ! dit le monsieur bourgeonné en frappant ses mains l’une contre l’autre.
— Eh bien, qu’est-ce que ça peut lui faire ? dites-le-moi, je vous prie, reprit Rogojine en désignant de nouveau le fonctionnaire par un geste irrité : — je ne te donnerai pas un kopek, lors même que tu marcherais devant moi les pieds en l’air.
— C’est ce que je ferai.
— A-t-on jamais vu cela ! Mais tu peux bien danser pendant toute une semaine, je ne te donnerai rien !
— Eh bien, ne me donne rien ! C’est ce que je veux ; ne me donne rien ! Mais je danserai. Je planterai là ma femme, mes petits enfants, et je danserai devant toi.
Pouah ! fit le jeune homme aux cheveux noirs en lançant un jet de salive, et il s’adressa ensuite au prince : — Tenez, il y a cinq semaines, je n’avais d’autre bagage qu’un petit paquet comme le vôtre quand je me suis enfui de la maison paternelle pour aller à Pskoff, chez ma tante. Là, je suis tombé malade, et, en mon absence, mon père est mort. Il a été emporté par une attaque d’apoplexie. Mémoire éternelle au défunt, mais peu s’en est fallu qu’il ne m’ait fait mourir sous les coups ! Le croirez-vous, prince ? si je ne m’étais pas sauvé de chez lui, il m’aurait certainement tué.
— Vous aviez d’une façon quelconque excité sa colère ? demanda le prince, qui considérait avec une vive curiosité ce millionnaire si pauvrement vêtu. Du reste, indépendamment de la grosse fortune dont il se trouvait hériter, le propriétaire de la pelisse d’agneau avait encore en lui quelque chose qui étonnait et intéressait Muichkine. Lui-même, de son côté, aimait à s’entretenir avec le prince. Toutefois, s’il causait volontiers, c’était moins par un besoin naïf d’épanchement que pour fournir un dérivatif à son agitation. On aurait dit qu’il avait encore la fièvre. Quant à l’employé, suspendu aux lèvres de Rogojine, il retenait son souffle et recueillait, comme un diamant, chaque parole qui sortait de la bouche du jeune homme.
— Sans doute il était furieux, et peut-être avait-il lieu de l’être, répondit Rogojine, — mais c’est surtout mon frère qui m’a nui dans son esprit. De ma mère il est inutile de parler ; elle est âgée, lit le ménologe, passe tout son temps avec de vieilles femmes et ne voit que par les yeux de mon frère Senka. Mais lui, pourquoi ne m’a-t-il pas prévenu en temps utile ? Nous comprenons cela ! À la vérité, j’étais alors sans connaissance. Il paraît, du reste, qu’on m’a expédié un télégramme. Malheureusement, il a été reçu par ma tante, qui est veuve depuis trente ans et ne voit, du matin au soir, que des iourodiviis |2|. Ce n’est pas une nonne, c’est encore pis. Le télégramme lui a fait peur, et, sans le décacheter, elle est allée le porter au bureau de police où il est resté jusqu’à ce moment. Je n’ai appris les choses que par une lettre de Vasili Vasilitch Konieff, il m’a tout révélé. Un poêle de brocart rehaussé de houppes en or filé recouvrait le cercueil de mon père : la nuit, mon frère a coupé ces houppes, se disant que « cela avait de la valeur » Eh bien, rien que pour ce seul fait, il est dans le cas d’aller en Sibérie, si je le veux, parce que c’est un vol sacrilége. Hein, qu’en dis-tu, tête à effrayer les moineaux ? demanda-t-il au monsieur bourgeonné. — Comment la loi qualifie-t-elle cela : spoliation des choses saintes ?
— Oui, oui, spoliation des choses saintes ! confirma aussitôt l’employé.
— On va en Sibérie pour cela ?
— Oui, oui ! On l’y enverra tout de suite !
— Ils me croient toujours malade, continua Rogojine en s’adressant au prince, — mais moi, subrepticement, sans rien dire, j’ai pris le train, bien qu’encore malade, et je suis parti pour Pétersbourg. Ce que mon frère Sémen Séménitch va être surpris quand il me verra arriver ! Il me desservait auprès du défunt, je le sais. Mais il est vrai aussi que, cette fois-là, si mon père s’est fâché contre moi, c’est à propos de Nastasia Philippovna. La faute en a été à moi seul, et je n’ai eu que ce que je méritais.
— À propos de Nastasia Philippovna ?… répéta servilement l’employé, à qui ce nom semblait rappeler quelque chose.
— Mais tu ne la connais pas ! cria Rogojine impatienté.
— Si fait, je la connais ! répliqua avec un accent de triomphe le monsieur bourgeonné.
— Allons donc ! Il y a de par le monde bien des Nastasia Philippovna ! Quel toupet tu as, vraiment ! J’étais sûr qu’un être pareil allait tout de suite s’accrocher à moi ! ajouta-t-il en s’adressant au prince.
— Peut-être que je la connais ! reprit l’employé : — Lébédeff a beaucoup de connaissances ! Votre Altesse m’invective, mais si je prouve que j’ai dit la vérité ?… Cette Nastasia Philippovna, à cause de qui votre père vous a donné des coups de trique, s’appelle, de son nom de famille, Barachkoff : c’est, pour ainsi dire, une dame de qualité, et aussi, dans son genre, une princesse. Elle est liée avec un certain propriétaire nommé Afanase Ivanovitch Totzky et elle n’a pas d’autre amant que lui. Ce Totzky est un gros capitaliste, membre de plusieurs sociétés financières et, comme tel, en relations d’affaires et d’amitié avec le général Épantchine…
— Eh diable ! mais c’est qu’il la connaît réellement ! fit Rogojine surpris.
— Il sait tout ! Lébédeff n’ignore rien ! Pendant deux mois, Altesse, j’ai roulé partout avec Alexis Likhatcheff, qui venait aussi de perdre son père ; il ne pouvait pas faire un pas sans Lébédeff. À présent il est détenu dans une prison pour dettes, mais alors il a eu l’occasion de les connaître toutes : et Armance, et Coralie, et la princesse Patzky, et Nastasia Philippovna.
Les lèvres de Rogojine blêmirent et commencèrent à trembler.
— Nastasia Philippovna ? Mais est-ce qu’elle a été avec Likhatcheff ?… demanda-t-il en lançant un regard de colère à l’employé.
— Non, pas du tout ! se hâta de répondre celui-ci. — Likhatcheff lui a en vain offert des sommes folles, il n’a rien pu obtenir d’elle ! Non, ce n’est pas comme Armance. Son seul amant est Totzky. Mais le soir on la voit dans sa loge au Grand Théâtre, ou au Théâtre Français, et les officiers qui sont là bavardent entre eux. Toutefois ils ne peuvent rien prouver. On se la montre, on dit : « Tenez, voilà cette Nastasia Philippovna », mais c’est tout ; on n’en dit pas plus, parce qu’il n’y a rien de plus à dire.
— C’est ainsi, en effet, observa Rogojine d’un air sombre ; — cela s’accorde bien avec ce que m’a dit, dans le temps, Zaliojeff. Alors, prince, je traversais la perspective Nevsky, vêtu d’une vieille redingote appartenant à mon père. Elle sortit d’un magasin et monta en voiture. Incontinent je me sentis comme percé d’un trait de feu. Je rencontrai Zaliojeff ; sa tenue ne ressemblait pas à la mienne : il était mis avec élégance et avait un lorgnon sur l’œil, tandis que moi, chez mon père, je portais des bottes de roussi. « Elle n’est pas de ton bord, me dit-il ; c’est une princesse, on l’appelle Nastasia Philippovna Barachkoff et elle vit avec Totzky. Maintenant celui-ci voudrait à tout prix se débarrasser d’elle, parce que, malgré ses cinquante-cinq ans, il a en vue un mariage avec la première beauté de tout Pétersbourg. » Zaliojeff ajouta que si j’allais ce soir-là au Grand Théâtre pour la représentation du ballet, je pourrais apercevoir Nastasia Philippovna dans une baignoire. Chez nous, il ne faisait pas bon aller voir un ballet, c’était s’exposer à être roué de coups par le père. Néanmoins, m’esquivant à la dérobée, j’allai passer une heure au théâtre et je revis Nastasia Philippovna ; de toute la nuit je ne pus dormir. Le lendemain, le défunt me remit deux titres de cinq pour cent, représentant chacun une valeur de cinq mille roubles. « Vends-les, me dit-il ; ensuite tu iras régler un compte de sept mille cinq cents roubles que j’ai chez les Andréieff et tu me rapporteras immédiatement le reste de l’argent. Ne t’amuse pas en route, je t’attends. » Je négociai les titres, mais, au lieu d’aller chez les Andréieff, je me rendis droit au Magasin Anglais. Là, j’achetai des pendeloques de diamants ; chacune était à peu près de la grosseur d’une noisette ; leur prix dépassait de quatre cents roubles la somme que j’avais en poche ; je me nommai et le marchand me fit crédit. Après cela, j’allai trouver Zaliojeff : « Viens avec moi chez Nastasia Philippovna », lui dis-je. Nous partîmes. Ce que j’avais alors sous mes pieds, devant moi, à mes côtés, je ne saurais le dire, je ne me le rappelle pas. Nous entrâmes dans la salle, elle-même vint nous recevoir. Je ne me fis point connaître et ce fut Zaliojeff qui prit la parole : « De la part de Parfène Rogojine », dit-il, « en souvenir de la rencontre d’hier ; veuillez accepter. » Elle ouvrit l’écrin, regarda les pendeloques et sourit. « Remerciez votre ami monsieur Rogojine de son aimable attention », répondit-elle, et, nous ayant fait une révérence, elle se retira. Eh bien, pourquoi ne suis-je pas mort en ce moment même ? Si j’avais pris sur moi de faire cette visite, c’est que je m’étais dit : « Peu importe, je n’en reviendrai pas vivant ! » Et le plus vexant pour moi, c’était de me voir éclipsé par cet animal de Zaliojeff. Avec ma petite taille et ma mise de larbin, je gardais un silence embarrassé, je me bornais à la contempler en ouvrant de grands yeux ; lui, au contraire, vêtu comme un gandin, pommadé, frisé, avait dans ses façons toute la désinvolture d’un homme du monde, et elle l’a certainement pris pour moi. Quand nous fûmes sortis, je lui dis : « À l’avenir, ne t’avise plus de m’accompagner, tu comprends ! » « Eh bien, mais à présent comment vas-tu faire pour rendre tes comptes à Sémen Parfénitch ? » me répondit-il en riant. J’avoue qu’alors j’avais plutôt envie d’aller me jeter à l’eau que de retourner chez mon père, mais je me dis : « Tant pis, advienne que pourra ! » et je revins à la maison comme un damné.
— Eh ! ouf ! fit l’employé avec une mimique exprimant l’épouvante, — c’est que le défunt vous expédiait un homme dans l’autre monde, pas seulement pour dix mille roubles, mais même pour dix roubles, expliqua-t-il au prince. Celui-ci considérait d’un œil curieux Rogojine, dont le visage semblait plus pâle encore en ce moment.
— Il expédiait dans l’autre monde ! Qu’en sais-tu ? vociféra le narrateur en réponse à l’employé, puis, se tournant vers le prince, il poursuivit son récit : — L’histoire ne tarda pas à arriver aux oreilles de mon père ; d’ailleurs, Zaliojeff était allé la raconter partout. Le vieillard me fit monter à l’étage supérieur de la maison, et, après s’y être enfermé avec moi, me rossa pendant une heure entière. « Ce n’est là qu’un commencement : ce soir je viendrai encore te régaler », me dit-il. Que pensez-vous qu’il fit ensuite ? Cet homme à cheveux blancs alla chez Nastasia Philippovna, la salua jusqu’à terre et se mit à la supplier en pleurant. À la fin elle alla chercher l’écrin et le lui jeta. « Tiens, vieille barbe, dit-elle, voilà tes boucles d’oreilles, mais elles ont acquis dix fois plus de prix à mes yeux maintenant que je sais à quel traitement Parfène s’est exposé pour me les offrir. Salue et remercie Parfène Séménitch ». Moi, pendant ce temps-là, avec la permission de ma mère, j’empruntais vingt roubles à Serge Protouchine et je partais pour Pskoff. J’y arrivai tremblant la fièvre. Les vieilles femmes se mirent à me faire la lecture du calendrier ecclésiastique. Ennuyé, j’allai dépenser dans les débits de boisson le reste de mon argent. Au sortir d’un cabaret, je roulai ivre-mort sur le pavé et je passai là toute la nuit. Le lendemain j’eus le délire. Ce ne fut pas sans peine que je repris l’usage de mes sens.
— Allons, allons, maintenant nous ferons la fête avec Nastasia Philippovna ! dit gaiement l’employé en se frottant les mains ; — à présent, monsieur, qu’importent ces boucles d’oreilles ? À présent nous lui en donnerons d’autres !…
— Si tu dis encore un seul mot au sujet de Nastasia Philippovna, je te fouetterai, quoique tu aies été le compagnon de Likhatcheff, cria Rogojine, et il saisit violemment le bras de Lébédeff.
— Si tu me fouettes, ce sera la preuve que tu ne me repousses pas ! Fouette-moi, les coups sont une prise de possession ! Quand on a fouetté quelqu’un, on a par cela même scellé… Mais nous voici arrivés !
Effectivement, le train entrait en gare. Quoique Rogojine eût dit qu’il était parti secrètement, plusieurs individus l’attendaient. En l’apercevant, ils commencèrent à crier et à agiter leurs chapkas.
— Tiens, Zaliojeff est là aussi ! murmura Rogojine, qui les considérait avec un sourire mêlé d’orgueil et de malignité ; puis tout à coup il s’adressa à Muichkine : — Prince, je ne sais pas pourquoi je t’ai pris en affection. C’est peut-être parce que je t’ai rencontré dans un pareil moment ; pourtant je l’ai aussi rencontré, continua-t-il en montrant Lébédeff, — et il n’a éveillé aucune sympathie en moi. Viens me voir, prince. Nous t’ôterons ces guêtres, je te donnerai une pelisse de martre numéro un ; je te ferai faire tout ce qu’il y a de mieux comme frac, un gilet blanc, ou un autre, à ton choix ; je fourrerai de l’argent plein tes poches et… nous irons chez Nastasia Philippovna ! Viendras-tu, oui ou non ?
— Prêtez l’oreille à ses paroles, prince Léon Nikolaïévitch ! dit solennellement l’employé. — Oh ! ne laissez pas échapper une si bonne occasion !
Le prince Muichkine se leva à demi, tendit poliment la main à Rogojine et lui répondit d’un ton aimable :
— J’irai vous voir avec le plus grand plaisir et je vous suis très-reconnaissant de l’amitié que vous me témoignez. Peut-être même passerai-je chez vous dès aujourd’hui, si j’ai le temps. Vous-même, je vous le dis franchement, vous m’avez beaucoup plu, surtout quand vous avez raconté cette histoire de pendeloques ; mais auparavant déjà vous me plaisiez, malgré votre air sombre. Je vous remercie aussi pour les vêtements et la pelisse que vous me promettez, car bientôt, en effet, j’aurai besoin de tout cela. En ce moment je possède à peine un kopek.
— Tu auras de l’argent, tu en auras dès ce soir, viens !
— Vous en aurez, répéta comme un écho l’employé, — pas plus tard que ce soir vous en aurez !
— Et êtes-vous grand amateur du sexe féminin, prince ? Dites-moi cela bien vite !
— N-n-non ! Voyez-vous, je… Vous ne le savez peut-être pas, mais, par suite de ma maladie congénitale, je n’ai même aucune connaissance de la femme.
— Eh bien, s’il en est ainsi, prince, s’écria Rogojine, — tu es un véritable iourodivii et Dieu aime les gens comme toi.
— Le Seigneur Dieu les aime, fit à son tour l’employé.
— Toi, suis-moi, taon, dit Rogojine à Lébédeff, et tous descendirent du train.
Lébédeff avait enfin atteint son but. Bientôt la bande bruyante partit dans la direction de la perspective Voznésensky. C’était du côté de la Litéinaïa que Muichkine devait aller. Le temps était humide. Le prince questionna les passants, et quand il sut qu’il avait trois verstes à faire pour arriver à destination, il se décida à prendre une voiture.
II
Le général Épantchine habitait une maison à lui, située à peu de distance de la Litéinaïa, près de la Transfiguration. Indépendamment de cet immeuble considérable dont il louait les cinq sixièmes, le général tirait un beau revenu d’une autre maison, très-vaste aussi, qu’il possédait dans la Sadovaïa. En outre, il était propriétaire d’une fabrique dans le district de Pétersbourg, et d’un domaine de grand rapport sis aux portes mêmes de la capitale. Autrefois, comme tout le monde le savait, ce personnage avait été intéressé dans les fermes, et maintenant il figurait parmi les gros actionnaires de plusieurs sociétés en commandite. On le disait très riche, très occupé, et très influent par ses relations. Il avait l’art de se rendre tout à fait nécessaire en certains endroits, notamment dans son service. Pourtant nul n’ignorait qu’Ivan Fédorovitch Épantchine était un homme sans éducation et qu’il avait commencé par être enfant de troupe. À coup sûr, ces humbles débuts, rapprochés de sa fortune présente, ne pouvaient que lui faire honneur, mais le général, quoique homme de sens, avait ses petites faiblesses et il n’aimait pas qu’on lui rappelât certaines choses. En tout cas, son intelligence et son habileté étaient incontestables. Par exemple, il avait pour système de ne pas se mettre en avant là où il fallait s’effacer, et, aux yeux de bien des gens, c’était un de ses principaux mérites de savoir toujours se tenir à sa place. Qu’auraient dit ceux qui le jugeaient de la sorte, s’ils avaient pu lire au fond de son âme ? Le fait est que, tout en joignant à une grande expérience de la vie plusieurs facultés très remarquables, Ivan Fédorovitch feignait d’agir moins d’après ses inspirations personnelles que comme exécuteur de la pensée d’autrui. Ajoutons que la chance ne cessait de le favoriser, même au jeu. Il risquait volontiers de grosses sommes sur le tapis vert, et, loin de cacher sa passion pour les cartes, il s’y adonnait avec une ostentation de parti pris. La société qu’il voyait était sans doute assez mêlée, mais exclusivement composée de « gros bonnets ». Le général Épantchine avait cinquante-six ans, — l’âge où, à proprement parler, commence la vraie vie. Physiquement, c’était un homme trapu, d’une complexion robuste et d’une santé florissante ; son teint ne manquait pas de fraîcheur et ses dents, quoique noires, tenaient solidement dans leurs alvéoles. Si, le matin, il montrait a ses employés un front soucieux, le soir, devant une table de jeu ou chez Son Altesse, sa physionomie redevenait souriante.
La famille du général se composait de sa femme et de trois filles adultes. N’étant encore que lieutenant, il avait épousé une demoiselle à peu près du même âge que lui ; elle ne possédait ni beauté ni instruction, et sa dot se réduisait à cinquante âmes. Néanmoins, jamais dans la suite on n’entendit le général se reprocher d’avoir fait un mariage hâtif, d’avoir cédé à l’entraînement irréfléchi de la jeunesse ; il avait pour sa femme un respect parfois poussé jusqu’à la crainte, et qui équivalait à de l’amour. La générale appartenait à la famille princière des Muichkine, maison peu illustre, mais fort ancienne, et elle était très-fière de son origine. Un des personnages influents d’alors, un de ces protecteurs qui vous protègent sans bourse délier, daigna s’intéresser à l’établissement de la jeune princesse. Un mot glissé par lui dans l’oreille d’Ivan Fédorovitch décida toute l’affaire. Pendant plus de vingt-cinq ans, les deux époux vécurent ensemble dans un accord presque parfait. Comme dernier rejeton d’une noble race, et peut-être aussi grâce à ses qualités personnelles, la générale avait réussi dès sa jeunesse à appeler sur elle la bienveillance de quelques dames très-haut placées. Plus tard, quand son mari fut parvenu à la fortune et à une brillante position officielle, elle commença à prendre pied dans le grand monde.
Sur ces entrefaites, les trois filles du général étaient arrivées à l’âge nubile. Si elles portaient le nom plébéien d’Épantchine, en revanche, par leur mère, elles appartenaient à l’aristocratie, elles avaient une jolie dot, leur père pouvait prétendre dans l’avenir à une très-haute situation, et, — détail de quelque importance aussi, — elles étaient toutes trois d’une beauté remarquable, sans en excepter l’aînée, Alexandra, qui comptait déjà cinq lustres révolus. La seconde, Adélaïde, avait vingt-trois ans, et la troisième, Aglaé, venait d’atteindre sa vingtième année. Celle-ci se trouvait être la plus belle des trois ; dans le monde, elle commençait à attirer l’attention. Mais il y avait plus : ces trois demoiselles se distinguaient par leur instruction, leur intelligence et leurs talents. On savait qu’elles s’aimaient beaucoup et se prêtaient un mutuel appui. On parlait même de sacrifices prétendument faits par les deux aînées en faveur de la plus jeune, — l’idole de toute la famille. Dans la société, loin de chercher à briller, elles étaient, au contraire, fort modestes. Personne ne pouvait les taxer d’orgueil ou d’arrogance ; on n’ignorait pas cependant qu’elles étaient fières et s’appréciaient à leur valeur. Alexandra était musicienne ; Adélaïde cultivait la peinture avec un réel succès ; toutefois, pendant plusieurs années puisque personne n’en sut rien, la chose ne se découvrit que dans les derniers temps, et encore par hasard. Bref, la voix publique faisait le plus grand éloge des trois sœurs. À la vérité, elles étaient aussi en butte à certains propos malveillants. On parlait avec épouvante de la quantité de livres qu’elles lisaient. Elles ne se pressaient pas de se marier ; elles ne prisaient que modérément le cercle dans lequel elles vivaient. Cela était d’autant plus remarquable qu’on connaissait la tendance, le caractère, les vues et les désirs de leurs parents.
Il n’était pas loin de onze heures lorsque le prince sonna chez le général. Celui-ci logeait au second étage et occupait un appartement aussi modeste que le lui permettait son rang dans la société. Un laquais en livrée ouvrit la porte et le prince dut entrer dans de longues explications avec cet homme qui le considérait, lui et son paquet, d’un air de défiance. À la fin, sur la déclaration plusieurs fois répétée qu’il était réellement le prince Muichkine et qu’il avait absolument besoin de voir le général pour une affaire urgente, le domestique l’introduisit dans une petite antichambre précédant le salon de réception et voisine du cabinet ; après quoi, il se retira, laissant le nouveau venu entre les mains d’un autre valet. Celui-ci, âgé d’une quarantaine d’années et vêtu d’un frac, était spécialement chargé d’annoncer les visiteurs à Son Excellence. Sa physionomie soucieuse montrait combien il était pénétré de l’importance de ses fonctions.
— Entrez un instant au salon et laissez ici votre paquet, dit-il en s’asseyant dans son fauteuil avec une gravité compassée ; en même temps, d’un œil étonné et sévère il examinait le prince, qui, sans se dessaisir de son modeste bagage, avait pris une chaise à côté de lui.
— Si vous le permettez, j’attendrai ici en votre compagnie ; qu’est-ce que je ferais là tout seul ?
— Puisque vous venez en visite, vous ne pouvez pas rester dans l’antichambre. C’est au général lui-même que vous désirez parler ?
Évidemment le laquais ne pouvait se faire à l’idée d’introduire un pareil visiteur ; voilà pourquoi il avait réitéré sa question.
— Oui, j’ai une affaire… commença le prince.
— Je ne vous demande pas quelle est votre affaire, la mienne est seulement de vous annoncer, mais, je vous l’ai déjà dit, il faut auparavant que je voie le secrétaire.
Le domestique se sentait de plus en plus enclin à la défiance : le prince différait trop des visiteurs ordinaires. Sans doute, le général ne recevait pas que du beau monde ; ceux-là surtout qui l’allaient voir pour affaires appartenaient souvent à des conditions fort diverses. Le valet de chambre savait très-bien cela et il avait pour consigne de se montrer assez coulant ; néanmoins, dans la circonstance présente, il n’osa rien prendre sur lui, jugeant que le mieux était de faire appel à l’intervention du secrétaire.
— Est-ce bien vrai que vous… venez de l’étranger ? demanda-t-il enfin comme malgré lui. Le courage lui manqua pour formuler la vraie question qu’il avait sur la langue : « Est-ce bien vrai que vous êtes le prince Muichkine ? »
— Oui, j’arrive directement de la gare. Vous vouliez, je crois, me demander si c’est vrai que je suis le prince Muichkine, mais la politesse vous a empêché de me faire cette question.
— Hum… proféra le laquais surpris.
— Je vous assure que je ne vous mens pas et que vous n’encourrez aucune responsabilité à cause de moi. Si je me présente ainsi vêtu et avec ce paquet, il n’y a pas lieu de s’en étonner : actuellement ma situation n’est pas brillante.
— Hum… Voyez-vous, ce n’est pas de cela que j’ai peur. Je suis ici pour annoncer et tout à l’heure le secrétaire va sortir. Ce serait seulement dans le cas où vous… Puis-je vous demander si vous ne venez pas chez le général comme besoigneux, pour solliciter un secours ?
— Oh ! non, à cet égard soyez parfaitement tranquille ; ce n’est pas cela qui m’amène.
— Excusez-moi, j’avais eu cette idée en considérant votre mise. Attendez le secrétaire ; pour le moment le général est occupé avec un colonel, mais vous allez voir arriver le secrétaire… de la Compagnie.
— Si je dois attendre longtemps, je vous demanderai la permission de fumer ici quelque part. J’ai sur moi une pipe et du tabac.
— Fumer ? se récria avec indignation le valet de chambre qui semblait à peine en croire ses oreilles ; — fumer ? Non, vous ne pouvez pas fumer ici, et vous n’auriez même pas dû y songer. Hé… c’est renversant !
— Oh ! il ne s’agissait pas pour moi de fumer dans cette chambre ; je sais bien que ce n’est pas permis ; je voulais seulement vous prier de m’indiquer un endroit où je pusse allumer une pipe, parce que j’ai cette habitude, et voilà trois heures que je n’ai pas fumé. Du reste, c’est comme il vous plaira ; vous savez, il y a un proverbe qui dit : Dans un monastère étranger…
— Eh bien, tel que vous êtes, comment vous annoncerais-je ? grommela presque involontairement le domestique. — D’abord, comme visiteur, votre place n’est pas ici, mais au salon, et, en restant dans l’antichambre, vous m’exposez à recevoir des reproches… Et vous avez l’intention d’habiter chez nous, n’est-ce pas ? ajouta-t-il en jetant encore un regard oblique sur le petit paquet qui ne cessait de le faire loucher.
— Non, je n’y songe pas. Lors même qu’on me le proposerait, je ne resterais pas ici. Le seul but de ma visite est de faire connaissance avec les maîtres de la maison, — rien de plus.
Cette réponse parut fort équivoque au soupçonneux valet de chambre.
— Comment ! faire connaissance ? reprit-il avec étonnement ; — mais vous avez commencé par me dire que vous veniez pour affaire !
— J’ai peut-être exagéré en parlant d’affaire. Oui, si vous voulez, c’est bien une affaire qui m’amène, en ce sens que j’ai un conseil à demander, mais je désire surtout me présenter à la famille Épantchine, parce que la générale est aussi une Muichkine et que nous nous trouvons être, elle et moi, les deux derniers descendants de cette race.
Les derniers mots du prince mirent le comble à l’inquiétude du domestique.
— Ainsi, par-dessus le marché, vous êtes un parent ? fit-il abasourdi.
― À peine. Sans doute, à la rigueur, cette parenté existe, mais elle est si éloignée qu’on peut la considérer comme nulle. Étant à l’étranger, j’ai une fois écrit à la générale et elle ne m’a pas répondu. Malgré cela, de retour ici, j’ai cru devoir me rappeler à son attention. J’entre dans toutes ces explications afin de dissiper vos doutes, parce que je vois que vous êtes toujours inquiet. Annoncez le prince Muichkine, et dès qu’on aura entendu ce nom, on sera fixé sur l’objet de ma visite. On me recevra ou on ne me recevra pas : dans le premier cas, ce sera bien ; dans le second, ce sera peut-être encore mieux. Mais je crois qu’on ne peut pas ne pas me recevoir ; la générale voudra voir l’unique représentant actuel de la famille dont elle sort ; d’après ce qui m’a été dit, elle prise très-haut sa naissance.