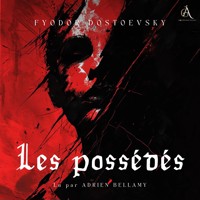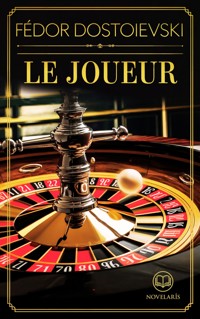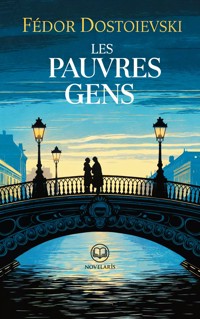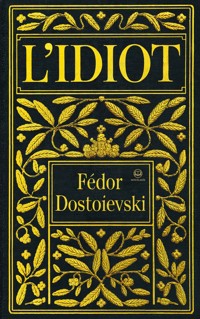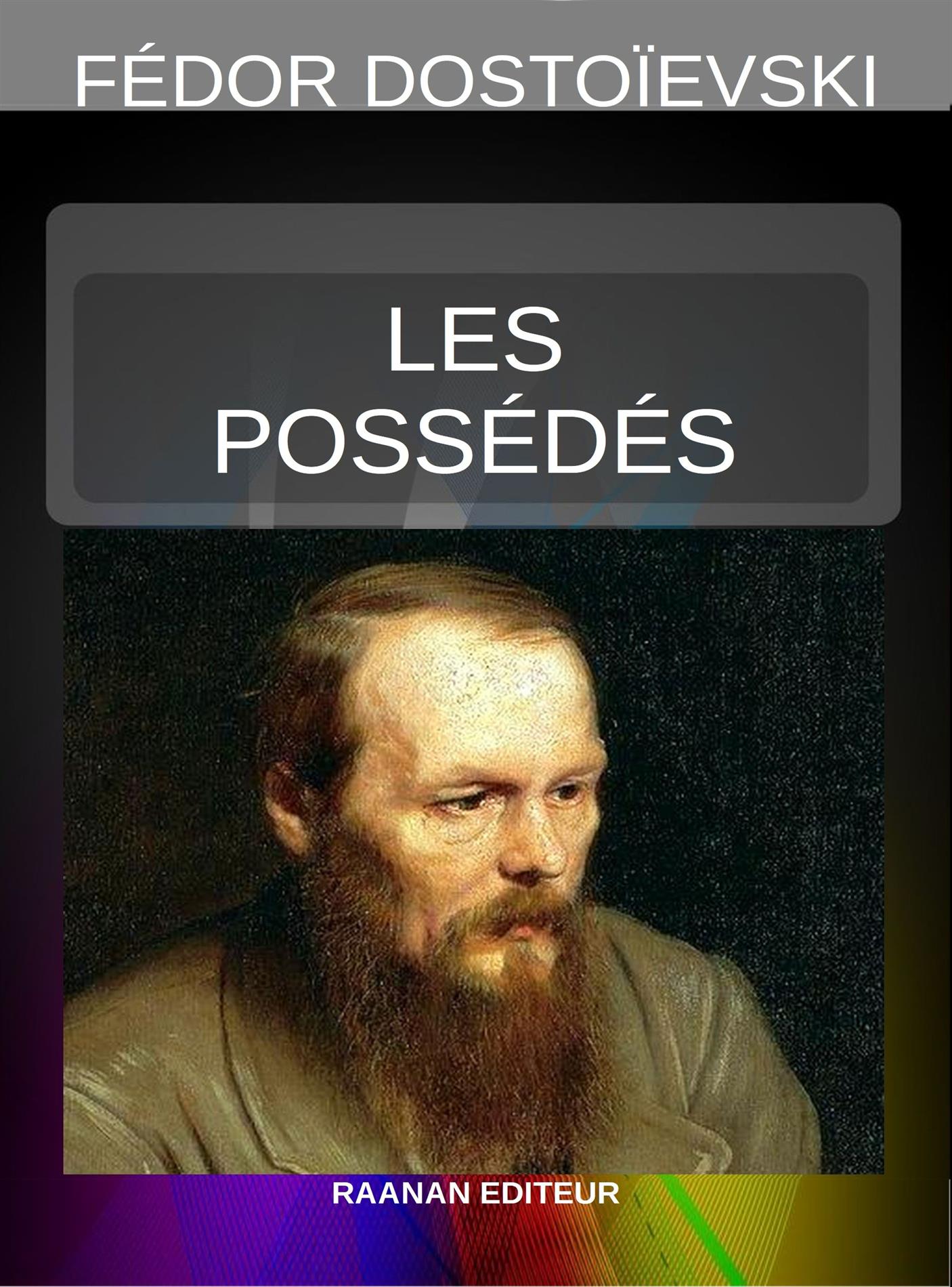1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les Frères Karamazov est le dernier roman de l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski.
Le roman explore des thèmes philosophiques et existentiels tels que Dieu, le libre arbitre ou la moralité. Il s’agit d’un drame spirituel où s’affrontent différentes visions morales concernant la foi, le doute, la raison et la Russie moderne.
Depuis sa publication, le livre est considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature.
Thème
| L’intrigue principale tourne autour des trois fils de Fiodor Pavlovitch Karamazov, un homme impudique, vulgaire et sans principes, et du parricide commis par l’un d’entre eux. En réalité, les enfants sont au nombre de quatre puisque le père donne naissance à un bâtard qu’il nommera Smerdiakov. Chacun des trois fils représente un idéal-type de la société russe de la fin du XIXe siècle : Alexeï, le benjamin, est un homme de foi ; Ivan, le deuxième fils, est un intellectuel matérialiste qui cherche à savoir si tout est permis, dans la mesure où Dieu n’existe pas ; Dmitri, leur très exalté demi-frère aîné, est un homme impétueux en qui le vice et la vertu se livrent une grande bataille : ce dernier incarne, selon l’auteur lui-même, « l’homme russe ».|
|Wikipédia|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SOMMMAIRE
TOME SECOND
LIVRE VII ALIOCHA
I L’odeur délétère
II Une telle minute
III L’oignon
IV Les noces de Cana
LIVRE VIII MITIA
I Kouzma Samsonov
II Liagavi
III Les mines d’or
IV Dans les ténèbres
V Une décision subite
VI C’est moi qui arrive !
VII Celui d’autrefois
VIII Délire
LIVRE IX L’INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
I Les débuts du fonctionnaire Perkhotine
II L’alarme
III Les tribulations d’une âme. Première tribulation
IV Deuxième tribulation
V Troisième tribulation
VI Le Procureur confond Mitia
VII Le grand secret de Mitia. On le raille
VIII Dépositions des témoins. Le « Petiot »
IX On emmène Mitia
LIVRE X LES GARÇONS
I Kolia Krassotkine
II Les gosses
III L’écolier
IV Scarabée
V Au chevet d’Ilioucha
VI Développement précoce
VII Ilioucha
LIVRE XI IVAN FIODOROVITCH
I Chez Grouchegnka
II Le pied malade
III Un Diablotin
IV L’hymne et le secret
V Ce n’est pas toi !
VI Première entrevue avec Smerdiakov
VII Deuxième entrevue avec Smerdiakov
VII Deuxième entrevue avec Smerdiakov
VIII Troisième et dernière entrevue avec Smerdiakov
IX Le Diable
X « C’est lui qui l’a dit ! »
LIVRE XII UNE ERREUR JUDICIAIRE
I Le jour fatal
II Des témoins dangereux
III L’expertise médicale et une livre de noisettes
IV La chance sourit à Mitia
V Brusque catastrophe
VI Le réquisitoire. Caractéristique
VII Aperçu historique
VIII Dissertation sur Smerdiakov
IX Psychologie à la vapeur. La troïka emportée. Péroraison.
X La plaidoirie
XI Ni argent, ni vol
XII Il n’y a pas eu assassinat
XIII Un Sophiste|87 |
XIV Les moujiks ont tenu ferme
ÉPILOGUE
I Projet d’évasion
II Pour un instant le mensonge devint vérité
III Enterrement d’Ilioucha. Allocution près de la pierre
Notes
FÉDOR DOSTOÏEVSKI
LES FRÈRES KARAMAZOV
Tome 2
roman
Traduit par Henri Mongault 1880, traduction 1923
Raanan Éditeur
Livre 209| édition 3
TOMESECOND
LIVRE VII ALIOCHA
I L’odeur délétère
Le corps du Père Zosime fut préparé pour l’inhumation d’après le rite établi. On ne lave pas les moines et les ascètes décédés, le fait est notoire. « Lorsqu’un moine est rappelé au Seigneur, lit-on dans le Grand Rituel, le frère préposé à cet effet frotte son corps à l’eau tiède, traçant au préalable, avec l’éponge, une croix sur le front du mort, sur la poitrine, les mains, les pieds et les genoux, rien de plus. » Ce fut le Père Païsius qui procéda à cette opération. Ensuite, il revêtit le défunt de l’habit monastique et l’enveloppa dans une chape, en la fendant un peu, comme il est prescrit, pour rappeler la forme de la croix. On lui posa sur la tête un capuce terminé par une croix à huit branches, le visage étant recouvert d’un voile noir, et dans les mains une icône du Sauveur. Le cadavre ainsi habillé fut mis vers le matin dans un cercueil préparé depuis longtemps. On décida de le laisser pour la journée dans la grande chambre qui servait de salon. Comme le défunt avait le rang de iéroskhimonakh|1|, il convenait de lire à son intention, non le Psautier mais l’Évangile. Après l’office des morts, le Père Joseph commença la lecture ; quant au Père Païsius, qui voulait le remplacer ensuite pour le reste de la journée et pour la nuit, il était en ce moment fort occupé et soucieux, ainsi que le supérieur de l’ermitage. On constatait, en effet, parmi la communauté et les laïcs survenus en foule, une agitation inouïe, inconvenante même, une attente fiévreuse. Les deux religieux faisaient tout leur possible pour calmer les esprits surexcités. Quand il fit suffisamment clair, on vit arriver des fidèles amenant avec eux leurs malades, surtout les enfants, comme s’ils n’attendaient que ce moment, espérant une guérison immédiate, qui ne pouvait tarder de s’opérer, d’après leur croyance. Ce fut alors seulement qu’on constata à quel point tous avaient l’habitude de considérer le défunt starets, de son vivant, comme un véritable saint. Et les nouveaux venus étaient loin d’appartenir tous au bas peuple. Cette anxieuse attente des croyants, qui se manifestait ouvertement, avec une impatience presque impérieuse, paraissait scandaleuse au Père Païsius et dépassait ses prévisions. Rencontrant des religieux tout émus, il leur parla ainsi :
« Cette attente frivole et immédiate de grandes choses n’est possible que parmi les laïcs et ne sied pas à nous autres. »
Mais on ne l’écoutait guère, et le Père Païsius s’en apercevait avec inquiétude, bien que lui-même (pour ne rien celer), tout en réprouvant des espoirs trop prompts qu’il trouvait frivoles et vains, les partageât secrètement dans le fond de son cœur, presque au même degré, ce dont il se rendait compte. Pourtant, certaines rencontres lui déplaisaient fort et excitaient des doutes en lui, par une sorte de pressentiment. C’est ainsi que, dans la foule qui encombrait la cellule, il remarqua avec répugnance (et se le reprocha aussitôt) la présence de Rakitine et du religieux d’Obdorsk, qui s’attardait au monastère. Tous deux parurent tout à coup suspects au Père Païsius, bien qu’ils ne fussent pas les seuls à cet égard. Au milieu de l’agitation générale, le moine d’Obdorsk se démenait plus que tous ; on le voyait partout en train de questionner, l’oreille aux aguets, chuchotant d’un air mystérieux. Il paraissait impatient et comme irrité de ce que le miracle si longtemps attendu ne se produisait point. Quant à Rakitine, il se trouvait de si bonne heure à l’ermitage, comme on l’apprit plus tard, d’après les instructions de Mme Khokhlakov. Dès que cette femme, bonne mais dépourvue de caractère, qui n’avait pas accès à l’ascétère, eut appris la nouvelle en s’éveillant, elle fut saisie d’une telle curiosité qu’elle envoya aussitôt Rakitine, avec mission de la tenir au courant par écrit, toutes les demi-heures environ, de tout ce qui arriverait. Elle tenait Rakitine pour un jeune homme d’une piété exemplaire, tant il était insinuant et savait se faire valoir aux yeux de chacun, pourvu qu’il y trouvât le moindre intérêt. Comme la journée s’annonçait belle, de nombreux fidèles se pressaient autour des tombes, dont la plupart avoisinaient l’église, tandis que d’autres étaient disséminées çà et là. Le Père Païsius, qui faisait le tour de l’ascétère, songea soudain à Aliocha, qu’il n’avait pas vu depuis longtemps. Il l’aperçut au même instant, dans le coin le plus reculé, près de l’enceinte, assis sur la pierre tombale d’un religieux, mort depuis bien des années et que son ascétisme avait rendu célèbre. Il tournait le dos à l’ermitage, faisant face à l’enceinte, et le monument le dissimulait presque. En s’approchant, le Père Païsius vit qu’il avait caché son visage dans ses mains et pleurait amèrement, le corps secoué par les sanglots. Il le considéra un instant.
« Assez pleuré, cher fils, assez, mon ami, dit-il enfin avec sympathie. Pourquoi pleures-tu ? Réjouis-toi, au contraire. Ignores-tu donc que ce jour est un jour sublime pour lui ? Pense seulement au lieu où il se trouve maintenant, à cette minute ! »
Aliocha regarda le moine, découvrit son visage gonflé de larmes comme celui d’un petit enfant, mais se détourna aussitôt et le recouvrit de ses mains.
« Peut-être as-tu raison de pleurer, proféra le Père Païsius d’un air pensif. C’est le Christ qui t’a envoyé ces larmes. » « Tes larmes d’attendrissement ne sont qu’un repos de l’âme et serviront à te distraire le cœur », ajouta-t-il à part soi, en songeant avec affection à Aliocha. Il se hâta de s’éloigner, sentant que lui aussi allait pleurer en le regardant.
Cependant le temps s’écoulait, les services funèbres se succédaient. Le Père Païsius remplaça le Père Joseph auprès du cercueil et poursuivit la lecture de l’Évangile. Mais avant trois heures de l’après-midi il arriva ce dont j’ai parlé à la fin du livre précédent, un événement si inattendu, si contraire à l’espérance générale que, je le répète, notre ville et ses environs s’en souviennent encore à l’heure actuelle. J’ajouterai qu’il me répugne presque de parler de cet événement scandaleux, au fond des plus banaux et des plus naturels, et je l’aurais certainement passé sous silence, s’il n’avait pas influé d’une façon décisive sur l’âme et le cœur du principal quoique futur héros de mon récit, Aliocha, provoquant en lui une sorte de révolution qui agita sa raison, mais l’affermit définitivement pour un but déterminé.
Lorsque, avant le jour, le corps du starets fut mis en bière et transporté dans la première chambre, quelqu’un demanda s’il fallait ouvrir les fenêtres. Mais cette question, posée incidemment, demeura sans réponse et presque inaperçue, sauf de quelques-uns. L’idée qu’un tel mort pût se corrompre et sentir mauvais leur parut absurde et fâcheuse (sinon comique), à cause du peu de foi et de la frivolité qu’elle révélait, car on attendait précisément le contraire. Un peu après midi commença une chose remarquée d’abord en silence par ceux qui allaient et venaient, chacun craignant visiblement de faire part à d’autres de sa pensée ; vers trois heures, cela fut constaté avec une telle évidence que la nouvelle se répandit parmi tous les visiteurs de l’ermitage, gagna le monastère où elle plongea tout le monde dans l’étonnement, et bientôt après atteignit la ville, agita les croyants et les incrédules. Ceux-ci se réjouirent ; quant aux croyants, il s’en trouva parmi eux pour se réjouir encore davantage, car « la chute du juste et sa honte font plaisir », comme disait le défunt dans une de ses leçons. Le fait est que le cercueil se mit à exhaler une odeur délétère, qui alla en augmentant. On chercherait en vain dans les annales de notre monastère un scandale pareil à celui qui se déroula parmi les religieux eux-mêmes, aussitôt après la constatation du fait, et qui eût été impossible en d’autres circonstances. Bien des années plus tard, certains d’entre eux se remémorant les incidents de cette journée, se demandaient avec effroi comment le scandale avait pu atteindre de telles proportions. Car, déjà auparavant, des religieux irréprochables, d’une sainteté reconnue, étaient décédés, et leurs cercueils avaient répandu une odeur délétère qui se manifestait naturellement, comme chez tous les morts, mais sans causer de scandale, ni même aucune émotion. Sans doute, d’après la tradition, les restes d’autres religieux, décédés depuis longtemps, avaient échappé à la corruption, ce dont la communauté conservait un souvenir ému et mystérieux, y voyant un fait miraculeux et la promesse d’une gloire encore plus grande provenant de leurs tombeaux, si telle était la volonté divine. Parmi eux, on gardait surtout la mémoire du starets Job, mort vers 1810, à l’âge de cent cinq ans, fameux ascète, grand jeûneur et silentiaire, dont la tombe était montrée avec vénération à tous les fidèles qui arrivaient pour la première fois au monastère, avec des allusions mystérieuses aux grandes espérances qu’elle suscitait. (C’était la tombe où le Père Païsius avait rencontré Aliocha, le matin.) À part lui, on citait également le Père Barsanuphe, le starets auquel avait succédé le Père Zosime, que, de son vivant, tous les fidèles fréquentant le monastère tenaient pour « innocent ». La tradition prétendait que ces deux personnages gisaient dans leur cercueil comme vivants, qu’on les avait inhumés intacts, que leurs visages même étaient en quelque sorte lumineux. D’autres rappelaient avec insistance que leurs corps exhalaient une odeur suave. Pourtant, malgré des souvenirs aussi suggestifs, il serait difficile d’expliquer exactement comment une scène aussi absurde, aussi choquante put se passer auprès du cercueil du Père Zosime. Quant à moi, je l’attribue à différentes causes qui agirent toutes ensemble. Ainsi, cette haine invétérée du starétisme, tenu pour une innovation pernicieuse, qui existait encore chez de nombreux moines. Ensuite, il y avait surtout l’envie qu’on portait à la sainteté du défunt, si solidement établie de son vivant qu’il était comme défendu de la discuter. Car, bien que le starets gagnât une foule de cœurs par l’amour plus que par les miracles et eût constitué comme une phalange de ceux qui l’aimaient, il s’était pourtant attiré, par là même, des envieux, puis des ennemis, tant déclarés que cachés, non seulement au monastère, mais parmi les laïcs. Bien qu’il n’eût causé de tort à personne, on disait : « Pourquoi passe-t-il pour saint ? » Et cette seule question, à force d’être répétée, avait fini par engendrer une haine inextinguible. Aussi, je pense que beaucoup, en apprenant qu’il sentait mauvais au bout de si peu de temps — car il n’y avait pas un jour qu’il était mort — furent ravis ; de même, cet événement fut presque un outrage et une offense personnelle pour certains des partisans du starets qui l’avaient révéré jusqu’alors. Voici dans quel ordre les choses se passèrent.
Dès que la corruption se fut déclarée, à l’air seul des religieux qui pénétraient dans la cellule, on pouvait deviner le motif qui les amenait. Celui qui entrait ressortait au bout d’un moment pour confirmer la nouvelle à la foule des autres qui l’attendaient. Les uns hochaient la tête avec tristesse, d’autres ne dissimulaient pas leur joie, qui éclatait dans leurs regards malveillants. Et personne ne leur faisait de reproches, personne n’élevait la voix en faveur du défunt, chose d’autant plus étrange que ses partisans formaient la majorité au monastère ; mais on voyait que le Seigneur lui-même permettait à la minorité de triompher provisoirement. Bientôt parurent dans la cellule, des laïcs, pour la plupart gens instruits, envoyés également comme émissaires. Le bas peuple n’entrait guère, bien qu’il se pressât en foule aux portes de l’ermitage. Il est incontestable que l’affluence des laïcs augmenta notablement après trois heures, par suite de cette nouvelle scandaleuse. Ceux qui ne seraient peut-être pas venus ce jour-là arrivaient maintenant à dessein, et parmi eux quelques personnes d’un rang notable. D’ailleurs, la décence n’était pas encore ouvertement troublée, et le Père Païsius, l’air sévère, continuait à lire l’Évangile à part, avec fermeté, comme s’il ne remarquait rien de ce qui se passait, bien qu’il eût déjà observé quelque chose d’insolite. Mais des voix d’abord timides, qui s’affermirent peu à peu et prirent de l’assurance, parvinrent jusqu’à lui : « Ainsi donc, le jugement de Dieu n’est pas celui des hommes ! » Cette réflexion fut formulée d’abord par un laïc, fonctionnaire de la ville, homme d’un certain âge, passant pour fort pieux ; il ne fit d’ailleurs que répéter à haute voix ce que les religieux se disaient depuis longtemps à l’oreille. Le pire, c’est qu’ils prononçaient cette parole pessimiste avec une sorte de satisfaction qui allait grandissant. Bientôt, la décence commença d’être troublée, on aurait dit que tous se sentaient autorisés à agir ainsi.
« Comment cela a-t-il pu se produire ? disaient quelques-uns, d’abord comme à regret ; il n’était pas corpulent, rien que la peau et les os, pourquoi sentirait-il mauvais ? — C’est un avertissement de Dieu, se hâtaient d’ajouter d’autres, dont l’opinion prévalait, car ils indiquaient que si l’odeur eût été naturelle, comme pour tout pécheur, elle se fût manifestée plus tard, après vingt-quatre heures au moins, mais ceci a devancé la nature, donc il faut y voir le doigt de Dieu. » Ce raisonnement était irréfutable. Le doux Père Joseph, le bibliothécaire, favori du défunt, se mit à objecter à certains médisants qu’ « il n’en était pas partout ainsi », que l’incorruptibilité du corps des justes n’était pas un dogme de l’orthodoxie, mais seulement une opinion, et que dans les régions les plus orthodoxes, au mont Athos, par exemple, on attache moins d’importance à l’odeur délétère ; ce n’est pas l’incorruptibilité physique qui passe là-bas pour le principal signe de la glorification des justes, mais la couleur de leurs os, après que leurs corps ont séjourné de longues années dans la terre : « Si les os deviennent jaunes comme la cire, cela signifie que le Seigneur a glorifié un juste ; mais s’ils sont noirs, c’est que le Seigneur ne l’en a pas jugé digne ; voilà comme on procède au mont Athos, sanctuaire où se conservent dans toute leur pureté les traditions de l’orthodoxie », conclut le Père Joseph. Mais les paroles de l’humble Père ne firent pas impression et provoquèrent même des reparties ironiques : « Tout ça, c’est de l’érudition et des nouveautés, inutile de l’écouter », décidèrent entre eux les religieux. « Nous gardons les anciens usages ; faudrait-il imiter toutes les nouveautés qui surgissent ? » ajoutaient d’autres. « Nous avons autant de saints qu’eux. Au mont Athos, sous le joug turc, ils ont tout oublié. L’orthodoxie s’est altérée chez eux depuis longtemps, ils n’ont même pas de cloches », renchérissaient les plus ironiques. Le Père Joseph se retira chagriné, d’autant plus qu’il avait exprimé son opinion avec peu d’assurance et sans trop y ajouter foi. Il prévoyait, dans son trouble, une scène choquante et un commencement d’insubordination. Peu à peu, à la suite du Père Joseph, toutes les voix raisonnables se turent. Comme par une sorte d’accord, tous ceux qui avaient aimé le défunt, accepté avec une tendre soumission l’institution du starétisme, furent soudain saisis d’effroi et se bornèrent à échanger de timides regards quand ils se rencontraient. Les ennemis du starétisme, en tant que nouveauté, relevaient fièrement la tête : « Non seulement le Père Barsanuphe ne sentait pas, mais il répandait une odeur suave, rappelaient-ils avec une joie maligne. Ses mérites et son rang lui avaient valu cette justification. » Ensuite, le blâme et même les accusations ne furent pas épargnés au défunt : « Il enseignait à tort que la vie est une grande joie et non une humiliation douloureuse » disaient quelques-uns parmi les plus bornés. « Il croyait d’après la nouvelle mode, n’admettait pas le feu matériel en enfer », ajoutaient d’autres encore plus obtus. « Il ne jeûnait pas rigoureusement, se permettait des douceurs, prenait des confitures de cerises avec le thé ; il les aimait beaucoup, les dames lui en envoyaient. Convient-il à un ascète de prendre du thé ? » disaient d’autres envieux. « Il trônait plein d’orgueil, rappelaient avec acharnement les plus malveillants ; il se croyait un saint, on s’agenouillait devant lui, il l’acceptait comme une chose due. » « Il abusait du sacrement de la confession », chuchotaient malignement les plus fougueux adversaires du starétisme, et parmi eux des religieux âgés, d’une dévotion rigoureuse, de vrais jeûneurs taciturnes, qui avaient gardé le silence durant la vie du défunt, mais ouvraient maintenant la bouche, chose déplorable, car leurs paroles influaient fortement sur les jeunes religieux, encore hésitants. Le moine de Saint-Sylvestre d’Obdorsk était tout oreilles, soupirait profondément, hochait la tête : « Le Père Théraponte avait raison hier », songeait-il à part lui, et juste à ce moment celui-ci parut, comme pour redoubler la confusion.
Nous avons déjà dit qu’il quittait rarement sa cellule du rucher, qu’il restait même longtemps sans aller à l’église et qu’on lui passait ces fantaisies comme à un soi-disant toqué, sans l’astreindre au règlement. Pour tout dire, on était bien obligé de se montrer tolérant envers lui. Car on se serait fait un scrupule d’imposer formellement la règle commune à un aussi grand jeûneur et silentiaire, qui priait jour et nuit, s’endormant même à genoux. « Il est plus saint que nous tous et ses austérités dépassent la règle, disaient les religieux ; s’il ne va pas à l’église, il sait lui-même quand y aller, il a sa propre règle. » C’était donc pour éviter un scandale qu’on laissait le Père Théraponte en repos. Comme tous le savaient, il éprouvait une véritable aversion pour le Père Zosime ; et soudain il apprit dans sa cellule que « le jugement de Dieu n’était pas celui des hommes et avait devancé la nature ». On peut croire que le moine d’Obdorsk, revenu plein d’effroi de sa visite la veille, était accouru un des premiers lui annoncer la nouvelle. J’ai mentionné aussi que le Père Païsius, qui lisait impassible l’Évangile devant le cercueil, sans voir ni entendre ce qui se passait au-dehors, avait pourtant pressenti l’essentiel, car il connaissait à fond son milieu. Il n’était pas troublé et, prêt à toute éventualité, observait d’un regard pénétrant l’agitation dont il prévoyait déjà le résultat. Tout à coup, un bruit insolite et inconvenant dans le vestibule frappa son oreille. La porte s’ouvrit toute grande et le Père Théraponte parut sur le seuil.
De la cellule, on distinguait nettement de nombreux moines qui l’avaient accompagné et se pressaient au bas du perron, et parmi eux des laïcs. Pourtant ils n’entrèrent pas, mais attendirent ce que dirait et ferait le Père Théraponte, car ils prévoyaient, non sans crainte malgré leur hardiesse, que celui-ci n’était pas venu pour rien. S’arrêtant sur le seuil, le Père Théraponte leva les bras, démasquant les yeux perçants et curieux de l’hôte d’Obdorsk, incapable de se retenir et monté seul derrière lui à cause de son extrême curiosité. Les autres, dès que la porte s’ouvrit avec fracas, reculèrent au contraire, en proie à une peur subite. Les bras levés, le père Théraponte vociféra :
« Je chasse les démons ! »
Il se mit aussitôt, en se tournant successivement aux quatre coins de la cellule, à faire le signe de la croix. Ceux qui l’accompagnaient comprirent aussitôt le sens de son acte, sachant que n’importe où il allait, avant de s’asseoir et de parler, il exorcisait le malin.
« Hors d’ici, Satan, hors d’ici ! répétait-il à chaque signe de croix. Je chasse les démons ! » hurla-t-il de nouveau. Son froc grossier était ceint d’une corde, sa chemise de chanvre laissait voir sa poitrine velue. Il avait les pieds entièrement nus. Dès qu’il agita les bras, on entendit cliqueter les lourdes chaînes qu’il portait sous le froc.
Le Père Païsius s’arrêta de lire, s’avança et se tint devant lui dans l’attente.
« Pourquoi es-tu venu, Révérend Père ? Pourquoi troubler l’ordre ? Pourquoi scandaliser l’humble troupeau ? proféra-t-il enfin en le regardant avec sévérité.
— Pourquoi je suis venu ? Que demandes-tu ? Que crois-tu ? cria le Père Théraponte d’un air égaré. Je suis venu chasser vos hôtes, les démons impurs. Je verrai si vous en avez hébergé beaucoup en mon absence. Je veux les balayer.
— Tu chasses le malin et peut-être le sers-tu toi-même, poursuivit intrépidement le Père Païsius. Qui peut dire de lui-même : « je suis saint ». Est-ce toi, mon Père ?
— Je suis souillé et non saint. Je ne m’assieds pas dans un fauteuil et je ne veux pas être adoré comme une idole ! tonna le Père Théraponte. À présent, les hommes ruinent la sainte foi. Le défunt, votre saint — et il se retourna vers la foule et désignant du doigt le cercueil — rejetait les démons. Il donnait une drogue contre eux. Et les voici qui pullulent chez vous, comme les araignées dans les coins. Maintenant, lui-même empeste. Nous voyons là un sérieux avertissement du Seigneur. »
C’était une allusion à un fait réel. Le malin était apparu à l’un des religieux, d’abord en songe, puis à l’état de veille. Épouvanté, il rapporta la chose au starets Zosime, qui lui prescrivit un jeûne rigoureux et des prières ferventes. Comme rien n’y faisait, il lui conseilla de prendre un remède, sans renoncer à ces pieuses pratiques. Beaucoup alors en furent choqués et discoururent entre eux en hochant la tête, surtout le Père Théraponte, auquel certains détracteurs s’étaient empressés de rapporter cette prescription « insolite » du starets.
« Va-t’en, Père ! dit impérieusement le Père Païsius, ce n’est pas aux hommes de juger, mais à Dieu. Peut-être voyons-nous ici un « avertissement » que personne n’est capable de comprendre, ni toi, ni moi. Va-t’en, Père, et ne scandalise pas le troupeau ! répéta-t-il d’un ton ferme.
— Il n’observait pas le jeûne prescrit aux profès, voilà d’où vient cet avertissement. Ceci est clair, c’est un péché de le dissimuler ! poursuivit le fanatique se laissant emporter par son zèle extravagant. — Il adorait les bonbons, les dames lui en apportaient dans leurs poches ; il sacrifiait à son ventre, il le remplissait de douceurs, il nourrissait son esprit de pensées arrogantes… Aussi a-t-il subi cette ignominie…
— Tes paroles sont futiles, Père ; j’admire ton ascétisme, mais tes paroles sont futiles, telles que les prononcerait dans le monde un jeune homme inconstant et étourdi. Va-t’en. Père, je te l’ordonne ! conclut le Père Païsius d’une voix tonnante.
— Je m’en vais ! proféra le Père Théraponte, comme déconcerté, mais toujours courroucé ; vous vous enorgueillissez de votre science devant ma nullité. Je suis arrivé ici peu instruit, j’y ai oublié ce que je savais, le Seigneur lui-même m’a préservé, moi chétif, de votre grande sagesse… »
Le Père Païsius, immobile devant lui, attendait avec fermeté.
Le Père Théraponte se tut quelques instants et soudain s’assombrit, porta la main droite à sa joue, et prononça d’une voix traînante, en regardant le cercueil du starets :
« Demain on chantera pour lui : Aide et Protecteur, hymne glorieux, et pour moi, quand je crèverai, seulement : Quelle vie bienheureuse, médiocre verset|2|, dit-il d’un ton de regret. Vous vous êtes enorgueillis et enflés, ce lieu est désert ! » hurla-t-il comme un insensé.
Puis, agitant les bras, il se détourna rapidement et descendit à la hâte les degrés du perron. La foule qui l’attendait hésita ; quelques-uns le suivirent aussitôt, d’autres tardèrent, car la cellule restait ouverte et le Père Païsius, sorti sur le perron, observait, immobile. Mais le vieux fanatique n’avait pas fini : à vingt pas il se tourna vers le soleil couchant, leva les bras en l’air et — comme fauché — s’écroula sur le sol en criant : « Mon Seigneur a vaincu ! Le Christ a vaincu le soleil couchant ! »
Il poussait des cris de forcené, les bras tendus vers le soleil et la face contre terre ; puis il se mit à pleurer comme un petit enfant, secoué par les sanglots, écartant les bras par terre.
Tous alors s’élancèrent vers lui, des exclamations retentirent, des sanglots… Une sorte de délire s’était emparé d’eux tous.
« Voilà un saint ! Voilà un juste ! s’écriait-on sans crainte ; il mérite d’être starets, ajoutaient d’autres avec emportement.
— Il ne voudra pas être starets… lui-même refusera… Il ne servira pas cette nouveauté maudite… Il n’ira pas imiter leurs folies », reprirent d’autres voix.
Il est difficile de se figurer ce qui serait arrivé, mais juste à ce moment la cloche appela au service divin. Tous se signèrent. Le Père Théraponte se releva, se signa lui aussi, puis se dirigea vers sa cellule sans se retourner, en tenant des propos incohérents. Un petit nombre le suivit, mais la plupart se dispersèrent, pressés d’aller à l’office. Le Père Païsius céda la place au Père Joseph et sortit. Les clameurs des fanatiques ne pouvaient l’ébranler, mais il sentit soudain une tristesse particulière lui envahir le cœur. Il comprit que cette angoisse provenait, en apparence, d’une cause insignifiante. Le fait est que, dans la foule qui se pressait à l’entrée de la cellule, il avait aperçu Aliocha parmi les agités et se souvenait d’avoir éprouvé alors une sorte de souffrance. « Ce jeune homme tiendrait-il maintenant une telle place dans mon cœur ? » se demanda-t-il avec surprise. À cet instant, Aliocha passa à côté de lui, se hâtant on ne savait où, mais pas du côté de l’église. Leurs regards se rencontrèrent. Aliocha détourna les yeux et les baissa ; rien qu’à son air le Père Païsius devina le profond changement qui s’opérait en lui en ce moment.
« As-tu aussi été séduit ? s’écria le Père Païsius. Serais-tu avec les gens de peu de foi ? » ajouta-t-il tristement.
Aliocha s’arrêta, le regarda vaguement, puis de nouveau il détourna les yeux et les baissa. Il se tenait de côté, sans faire face à son interlocuteur. Le Père Païsius l’observait avec attention.
« Où vas-tu si vite ? On sonne pour l’office, demanda-t-il encore, mais Aliocha ne répondit rien.
— Est-ce que tu quitterais l’ermitage sans autorisation, sans recevoir la bénédiction ? »
Tout à coup Aliocha eut un sourire contraint, jeta un regard des plus étranges sur le Père qui le questionnait, celui auquel l’avait confié, avant de mourir, son ancien directeur, le maître de son cœur et de son esprit, son starets bien-aimé ; puis, toujours sans répondre, il agita la main comme s’il n’avait cure de la déférence et se dirigea à pas rapides vers la sortie de l’ermitage.
« Tu reviendras ! » murmura le Père Païsius en le suivant des yeux avec une douloureuse surprise.
II Une telle minute
Le Père Païsius ne se trompait pas en décidant que son « cher garçon » reviendrait ; peut-être même avait-il soupçonné, sinon compris, le véritable état d’âme d’Aliocha. Néanmoins, j’avoue qu’il me serait maintenant très difficile de définir exactement ce moment étrange de la vie de mon jeune et sympathique héros. À la question attristée que le Père Païsius posait à Aliocha : « Serais-tu aussi avec les gens de peu de foi ? » je pourrais certes répondre avec fermeté à sa place : « Non, il n’est pas avec eux. » Bien plus, c’était même tout le contraire : son trouble provenait précisément de sa foi ardente. Il existait pourtant, ce trouble, et si douloureux que même longtemps après Aliocha considérait cette triste journée comme une des plus pénibles, des plus funestes de sa vie. Si l’on demande : « Est-il possible qu’il éprouvât tant d’angoisse et d’agitation uniquement parce que le corps de son starets, au lieu d’opérer des guérisons, s’était au contraire rapidement décomposé ? » je répondrai sans ambages : « Oui, c’est bien cela. » Je prierai toutefois le lecteur de ne pas trop se hâter de rire de la simplicité de mon jeune homme. Non seulement je n’ai pas l’intention de demander pardon pour lui ou d’excuser sa foi naïve, soit par sa jeunesse, soit par les faibles progrès réalisés dans ses études, etc., mais je déclare, au contraire, éprouver un sincère respect pour la nature de son cœur. Assurément, un autre jeune homme, accueillant avec réserve les impressions du cœur, tiède et non ardent dans ses affections, loyal, mais d’esprit trop judicieux pour son âge, un tel jeune homme, dis-je, eût évité ce qui arriva au mien ; mais dans certains cas il est plus honorable de céder à un entraînement déraisonnable, provoqué par un grand amour, que d’y résister. À plus forte raison dans la jeunesse, car selon moi un jeune homme constamment judicieux ne vaut pas grand-chose. « Mais, diront peut-être les gens raisonnables, tout jeune homme ne peut pas croire à un tel préjugé, et le vôtre n’est pas un modèle pour les autres. » À quoi je répondrai : « Oui, mon jeune homme croyait avec ferveur, totalement, mais je ne demanderai pas pardon pour lui. »
Bien que j’aie déclaré plus haut (peut-être avec trop de hâte) ne pas vouloir excuser ni justifier mon héros, je vois qu’une explication est nécessaire pour l’intelligence ultérieure du récit. Il ne s’agissait pas ici d’attendre des miracles avec une impatience frivole. Et ce n’est pas pour le triomphe de certaines convictions qu’Aliocha avait alors besoin de miracles, ni pour celui de quelque idée préconçue sur une autre, en aucune façon ; avant tout, au premier plan, surgissait devant lui la figure de son starets bien-aimé, du juste pour qui il avait un culte. C’est sur lui, sur lui seul que se concentrait parfois, au moins dans ses plus vifs élans, tout l’amour qu’il portait dans son jeune cœur « pour tous et tout ». À vrai dire, cet être incarnait depuis si longtemps à ses yeux l’idéal absolu, qu’il y aspirait de toutes les forces de sa jeunesse, exclusivement, jusqu’à en oublier, par moments, « tous et tout ». (Il se rappela par la suite avoir complètement oublié, en cette pénible journée, son frère Dmitri, dont il se préoccupait tant la veille ; oublié aussi de porter les deux cents roubles au père d’Ilioucha, comme il se l’était promis.) Ce n’étaient pas des miracles qu’il lui fallait, mais seulement la « justice suprême », violée à ses yeux, ce qui le navrait. Qu’importe que cette « justice » attendue par Aliocha prît par la force des choses la forme de miracles opérés immédiatement par la dépouille de son ancien directeur qu’il adorait ? C’est ce que pensait et attendait tout le monde, au monastère, même ceux devant lesquels il s’inclinait, le Père Païsius par exemple ; Aliocha, sans se laisser troubler par le doute, rêvait de la même façon qu’eux. Une année entière de vie monastique l’y avait préparé, son cœur était accoutumé à cette attente. Toutefois il n’avait pas seulement soif de miracles, mais encore de justice. Et celui qui aurait dû, d’après son espérance, être élevé au-dessus de tous, se trouvait abaissé et couvert de honte ! Pourquoi cela ? Qui était juge ? Ces questions tourmentaient son cœur innocent. Il avait été offensé et même irrité de voir le juste entre les justes livré aux railleries malveillantes de la foule frivole, si inférieure à lui. Qu’aucun miracle n’ait eu lieu, que l’attente générale ait été déçue, passe encore ! Mais pourquoi cette honte, cette décomposition hâtive qui « devançait la nature », comme disaient les méchants moines ? Pourquoi cet « avertissement » dont ils triomphaient avec le Père Théraponte, pourquoi s’y croyaient-ils autorisés ? Où était donc la Providence ? Pourquoi, pensait Aliocha, s’était-elle retirée « au moment décisif », paraissant se soumettre aux lois aveugles et impitoyables de la nature ?
Aussi le cœur d’Aliocha saignait ; comme nous l’avons déjà dit, il s’agissait de l’être qu’il chérissait le plus au monde, et qui était « couvert de honte et d’infamie ! » Plaintes futiles et déraisonnables, mais, je le répète pour la troisième fois (et peut-être avec frivolité, j’y consens) : je suis content que mon jeune homme ne se soit pas montré judicieux en un pareil moment, car le jugement vient toujours en son temps, quand on n’est pas sot ; mais quand viendra l’amour, s’il n’y en a pas dans un jeune cœur à un moment exceptionnel ? Il faut mentionner pourtant un phénomène étrange, mais passager, qui se manifesta dans l’esprit d’Aliocha à cet instant critique. C’était par intervalles une impression douloureuse résultant de la conversation de la veille avec son frère Ivan, qui l’obsédait maintenant. Non que ses croyances fondamentales fussent en rien ébranlées : en dépit de ses murmures subits, il aimait son Dieu et croyait fermement en lui. Pourtant une impression confuse, mais pénible et mauvaise, surgit dans son âme, et tendit à s’imposer de plus en plus.
À la nuit tombante, Rakitine, qui traversait le bois de pins pour aller au monastère, aperçut Aliocha, étendu sous un arbre, la face contre terre, immobile et paraissant dormir. Il s’approcha, l’interpella.
« C’est toi, Alexéi ? Est-il possible que tu… » proféra-t-il étonné, mais il n’acheva pas. Il voulait dire : « Est-il possible que tu en sois là ? » Aliocha ne tourna pas la tête, mais d’après un mouvement qu’il fit, Rakitine devina qu’il l’entendait et le comprenait. « Qu’as-tu donc ? poursuivit-il surpris, mais un sourire ironique apparaissait déjà sur ses lèvres. Écoute, je te cherche depuis plus de deux heures. Tu as disparu tout à coup. Que fais-tu donc ici ? Regarde-moi, au moins ! »
Aliocha releva la tête, s’assit en s’adossant à l’arbre. Il ne pleurait pas, mais son visage exprimait la souffrance ; on lisait dans ses yeux de l’irritation. D’ailleurs, il ne regardait pas Rakitine, mais à côté.
« Mais tu n’as plus le même visage ! Ta fameuse douceur a disparu. Te serais-tu fâché contre quelqu’un ? On t’a fait un affront ?
— Laisse-moi ! fit soudain Aliocha sans le regarder, avec un geste de lassitude.
— Oh, oh ! voilà comme nous sommes ! Un ange, crier comme les simples mortels ! Eh bien, Aliocha, franchement tu me surprends, moi que rien n’étonne. Je te croyais plus cultivé. »
Aliocha le regarda enfin, mais d’un air distrait, comme s’il le comprenait mal.
« Et tout ça, parce que ton vieux sent mauvais ! Croyais-tu sérieusement qu’il allait faire des miracles ? s’écria Rakitine avec un étonnement sincère.
— Je l’ai cru, je le crois, je veux le croire toujours ! Que te faut-il de plus ? fit Aliocha avec irritation.
— Rien du tout, mon cher. Que diable, les écoliers de treize ans n’y croient plus ! Alors, tu t’es fâché, te voilà maintenant en révolte contre ton Dieu : monsieur n’a pas reçu d’avancement, monsieur n’a pas été décoré ! Quelle misère ! »
Aliocha le regarda longuement, les yeux à demi fermés ; un éclair y passa… mais ce n’était pas de la colère contre Rakitine.
« Je ne me révolte pas contre mon Dieu, seulement je n’accepte pas son univers, fit-il avec un sourire contraint.
— Comment, tu n’acceptes pas l’univers ? répéta Rakitine après un instant de réflexion. Quel est ce galimatias ? »
Aliocha ne répondit pas.
« Laissons ces niaiseries ; au fait ! As-tu mangé aujourd’hui ?
— Je ne me souviens pas… Je crois que oui.
— Tu dois te restaurer, tu as l’air épuisé, cela fait peine à voir. Tu n’as pas dormi cette nuit, à ce qu’il paraît ; vous aviez une séance. Ensuite tout ce remue-ménage, ces simagrées. Bien sûr, tu n’as bouffé que du pain bénit. J’ai dans ma poche un saucisson que j’ai apporté tantôt de la ville à tout hasard, mais tu n’en voudrais pas…
— Donne.
— Hé ! hé ! Alors, c’est la révolte ouverte, les barricades ! Eh bien, frère, ne perdons pas de temps. Viens chez moi… Je boirais volontiers un verre d’eau-de-vie, je suis harassé. La vodka, bien sûr, ne te tente pas. Y goûterais-tu ?
— Donne toujours.
— Ah bah ! C’est bizarre ! s’exclama Rakitine en lui lançant un regard stupéfait. Quoi qu’il en soit, eau-de-vie ou saucisson ne sont pas à dédaigner, allons ! »
Aliocha se leva sans mot dire et suivit Rakitine.
« Si ton frère Ivan te voyait, c’est lui qui serait surpris ! À propos, sais-tu qu’il est parti ce matin pour Moscou ?
— Je le sais », dit Aliocha avec indifférence.
Soudain, l’image de Dmitri lui apparut, la durée d’un instant ; il se rappela vaguement une affaire urgente, un devoir impérieux à remplir, mais ce souvenir ne lui fit aucune impression, ne parvint pas jusqu’à son cœur, s’effaça aussitôt de sa mémoire. Par la suite, il devait longtemps s’en souvenir.
« Ton frère Ivan m’a traité une fois de « ganache libérale ». Toi-même m’as donné un jour à entendre que j’étais « malhonnête »… Soit. On va voir maintenant vos capacités et votre honnêteté (ceci fut chuchoté par Rakitine, à part soi). Écoute, reprit-il à haute voix, évitons le monastère, le sentier nous mène droit à la ville… Hem ! je dois passer chez la Khokhlakov. Je lui ai écrit les événements ; figure-toi qu’elle m’a répondu par un billet au crayon (elle adore écrire, cette dame) qu’« elle n’aurait jamais attendu une pareille conduite de la part d’un starets aussi respectable que le Père Zosime ! » Sic. Elle aussi s’est fâchée ; vous êtes tous les mêmes ! Attends ! »
Il s’arrêta brusquement et, la main sur l’épaule d’Aliocha :
« Sais-tu, Aliocha, dit-il d’un ton insinuant en le regardant dans les yeux, sous l’impression d’une idée subite qu’il craignait visiblement de formuler, malgré son air rieur, tant il avait peine à croire aux nouvelles dispositions d’Aliocha ; sais-tu où nous ferions bien d’aller ?
— Où tu voudras… ça m’est égal.
— Allons chez Grouchegnka, hein ! Veux-tu ? dit enfin Rakitine tout tremblant d’attente.
— Allons », répondit tranquillement Aliocha.
Rakitine s’attendait si peu à ce prompt consentement qu’il faillit faire un bond en arrière.
« À la bonne heure ! » allait-il s’écrier, mais il saisit Aliocha par le bras et l’entraîna rapidement, craignant de le voir changer d’avis.
Ils marchaient en silence, Rakitine avait peur de parler.
« Comme elle sera contente… » voulut-il dire, mais il se tut. Ce n’était certes pas pour faire plaisir à Grouchegnka qu’il lui amenait Aliocha ; un homme sérieux comme lui n’agissait que par intérêt. Il avait un double but : se venger d’abord, contempler « la honte du juste » et la « chute » probable d’Aliocha, « de saint devenu pécheur », ce dont il se réjouissait d’avance ; en outre, il avait en vue un avantage matériel dont il sera question plus loin.
« Voilà une occasion qu’il faut saisir aux cheveux », songeait-il avec une gaieté maligne.
III L’oignon
Grouchegnka habitait le quartier le plus animé, près de la place de l’Église, chez la veuve du marchand Morozov, où elle occupait dans la cour un petit pavillon en bois. La maison Morozov, une bâtisse en pierre, à deux étages, était vieille et laide ; la propriétaire, une femme âgée, y vivait seule avec deux nièces, des vieilles filles. Elle n’avait pas besoin de louer son pavillon, mais on savait qu’elle avait admis Grouchegnka comme locataire (quatre ans auparavant) pour complaire à son parent, le marchand Samsonov, protecteur attitré de la jeune fille. On disait que le vieux jaloux, en installant chez elle sa « favorite », comptait sur la vigilance de la vieille femme pour surveiller la conduite de sa locataire. Mais cette vigilance devint bientôt inutile, de sorte que Mme Morozov ne voyait que rarement Grouchegnka et avait cessé de l’importuner en l’espionnant. À vrai dire, quatre ans s’étaient déjà écoulés depuis que le vieillard avait ramené du chef-lieu cette jeune fille de dix-huit ans, timide, gênée, fluette, maigre, pensive et triste, et beaucoup d’eau avait passé sous les ponts. On ne savait rien de précis sur elle dans notre ville, on n’en apprit pas davantage plus tard, même lorsque beaucoup de personnes commencèrent à s’intéresser à la beauté accomplie qu’était devenue Agraféna Alexandrovna. On racontait qu’à dix-sept ans elle avait été séduite par un officier qui l’avait aussitôt abandonnée pour se marier, laissant la malheureuse dans la honte et la misère. On disait d’ailleurs que, malgré tout, Grouchegnka sortait d’une famille honorable et d’un milieu ecclésiastique, étant la fille d’un diacre en disponibilité, ou quelque chose d’approchant. En quatre ans, l’orpheline sensible, malheureuse, chétive, était devenue florissante, vermeille, une beauté russe, au caractère énergique, fière, effrontée, habile à manier l’argent, avare et avisée, qui avait su, honnêtement ou non, amasser un certain capital. Une seule chose ne laissait aucun doute, c’est que Grouchegnka était inaccessible et qu’à part le vieillard, son protecteur, personne, durant ces quatre années, n’avait pu se vanter de ses faveurs. Le fait était certain, car bien des soupirants s’étaient présentés, surtout les deux dernières années. Mais toutes les tentatives échouèrent et quelques-uns durent même battre en retraite, couverts de ridicule, grâce à la résistance de cette jeune personne au caractère énergique. On savait encore qu’elle s’occupait d’affaires, surtout depuis un an, et qu’elle y manifestait des capacités remarquables, si bien que beaucoup avaient fini par la traiter de juive. Non qu’elle prêtât à usure ; mais on savait, par exemple, qu’en compagnie de Fiodor Pavlovitch Karamazov elle avait racheté, pendant quelque temps, des billets à vil prix, au dixième de leur valeur, recouvrant ensuite, dans certains cas, la totalité de la créance. Le vieux Samsonov, que ses pieds enflés ne portaient plus depuis un an, veuf qui tyrannisait ses fils majeurs, capitaliste d’une avarice impitoyable, était tombé pourtant sous l’influence de sa protégée, qu’il avait tenue de court au début, à la portion congrue, « à l’huile de chènevis », disaient les railleurs. Mais Grouchegnka avait su s’émanciper, tout en lui inspirant une confiance sans bornes quant à sa fidélité. Ce vieillard, grand homme d’affaires, avait aussi un caractère remarquable : avare et dur comme pierre, bien que Grouchegnka l’eût subjugué au point qu’il ne pouvait se passer d’elle, il ne lui reconnut pas de capital important et, même si elle l’avait menacé de le quitter, il fût demeuré inflexible. En revanche, il lui réserva une certaine somme, et, quand on l’apprit, cela surprit tout le monde. « Tu n’es pas sotte, dit-il en lui assignant huit mille roubles, opère toi-même, mais sache qu’à part ta pension annuelle, comme auparavant, tu ne recevras rien de plus jusqu’à ma mort et que je ne te laisserai rien par testament. » Il tint parole, et ses fils, qu’il avait toujours gardés chez lui comme des domestiques avec leurs femmes et leurs enfants, héritèrent de tout ; Grouchegnka ne fut même pas mentionnée dans le testament. Par ses conseils sur la manière de faire valoir son capital, il l’aida notablement et lui indiqua des « affaires ». Quand Fiodor Pavlovitch Karamazov, entré en relation avec Grouchegnka à propos d’une opération « fortuite », finit par tomber amoureux d’elle jusqu’à en perdre la raison, le vieux Samsonov, qui avait déjà un pied dans la tombe, s’amusa beaucoup. Mais lorsque Dmitri Fiodorovitch se mit sur les rangs, le vieux cessa de rire. « S’il faut choisir entre les deux, lui dit-il une fois sérieusement, prends le père, mais à condition que le vieux coquin t’épouse et te reconnaisse au préalable un certain capital. Ne te lie pas avec le capitaine, tu n’en tirerais aucun profit. » Ainsi parla le vieux libertin, pressentant sa fin prochaine ; il mourut en effet cinq mois plus tard. Soit dit en passant, bien qu’en ville la rivalité absurde et choquante des Karamazov père et fils fût connue de bien des gens, les véritables relations de Grouchegnka avec chacun d’eux demeuraient ignorées de la plupart. Même ses servantes (après le drame dont nous parlerons) témoignèrent en justice qu’Agraféna Alexandrovna recevait Dmitri Fiodorovitch uniquement par crainte, car « il avait menacé de la tuer ». Elle en avait deux, une cuisinière fort âgée, depuis longtemps au service de sa famille, maladive et presque sourde, et sa petite-fille, alerte femme de chambre de vingt ans.
Grouchegnka vivait fort chichement, dans un intérieur des plus modestes, trois pièces meublées en acajou par la propriétaire, dans le style de 1820. À l’arrivée de Rakitine et d’Aliocha, il faisait déjà nuit, mais on n’avait pas encore allumé. La jeune femme était étendue au salon, sur son canapé au dossier d’acajou, recouvert de cuir dur, déjà usé et troué, la tête appuyée sur deux oreillers. Elle reposait sur le dos, immobile, les mains derrière la tête, portant une robe de soie noire, avec une coiffure en dentelle qui lui seyait à merveille ; sur les épaules, un fichu agrafé par une broche en or massif. Elle attendait quelqu’un, inquiète et impatiente, le teint pâle, les lèvres et les yeux brûlants, son petit pied battant la mesure sur le bras du canapé. Au bruit que firent les visiteurs en entrant, elle sauta à terre, criant d’une voix effrayée :
« Qui va là ? »
La femme de chambre s’empressa de rassurer sa maîtresse.
« Ce n’est pas lui, n’ayez crainte. »
« Que peut-elle bien avoir ? » murmura Rakitine en menant par le bras Aliocha au salon.
Grouchegnka restait debout, encore mal remise de sa frayeur. Une grosse mèche de ses cheveux châtains, échappée de sa coiffure, lui tombait sur l’épaule droite, mais elle n’y prit pas garde et ne l’arrangea pas avant d’avoir reconnu ses hôtes.
« Ah ! c’est toi Rakitka ? Tu m’as fait peur ! Avec qui es-tu ? Seigneur, voilà qui tu m’amènes ! s’écria-t-elle en apercevant Aliocha.
— Fais donc donner de la lumière ! dit Rakitine, du ton d’un familier qui a le droit de commander dans la maison.
— Certainement… Fénia|3|, apporte-lui une bougie… Tu as trouvé le bon moment pour l’amener ! »
Elle fit un signe de tête à Aliocha et arrangea ses cheveux devant la glace. Elle paraissait mécontente.
« Je tombe mal ? demanda Rakitine, l’air soudain vexé.
— Tu m’as effrayée, Rakitka, voilà tout. »
Grouchegnka se tourna en souriant vers Aliocha.
« N’aie pas peur de moi, mon cher Aliocha, reprit-elle, je suis charmée de ta visite inattendue. Je croyais que c’était Mitia qui voulait entrer de force. Vois-tu, je l’ai trompé tout à l’heure, il m’a juré qu’il me croyait et je lui ai menti. Je lui ai dit que j’allais chez mon vieux Kouzma|4| Kouzmitch faire les comptes toute la soirée. J’y vais, en effet, une fois par semaine. Nous nous enfermons à clef : il pioche ses comptes et j’écris dans les livres, il ne se fie qu’à moi. Comment Fénia vous a-t-elle laissés entrer ? Fénia, cours à la porte cochère, regarde si le capitaine ne rôde pas aux alentours. Il est peut-être caché et nous épie, j’ai une peur affreuse !
— Il n’y a personne, Agraféna Alexandrovna ; j’ai regardé partout, je vais voir à chaque instant par les fentes, j’ai peur moi aussi.
— Les volets sont-ils fermés ? Fénia, baisse les rideaux, autrement il verrait la lumière. Je crains aujourd’hui ton frère Mitia, Aliocha. »
Grouchegnka parlait très haut, l’air inquiet et surexcité.
« Pourquoi cela ? demanda Rakitine ; il ne t’effraie pas d’ordinaire, tu le fais marcher comme tu veux.
— Je te dis que j’attends une nouvelle, de sorte que je n’ai que faire de Mitia, maintenant. Il n’a pas cru que j’allais chez Kouzma Kouzmitch, je le sens. À présent, il doit monter la garde chez Fiodor Pavlovitch, dans le jardin. S’il est embusqué là-bas, il ne viendra pas ici, tant mieux ! J’y suis allée vraiment, chez le vieux. Mitia m’accompagnait ; je lui ai fait promettre de venir me chercher à minuit. Dix minutes après, je suis ressortie et j’ai couru jusqu’ici ; je tremblais qu’il me rencontrât.
— Pourquoi es-tu en toilette ? Tu as un bonnet fort curieux.
— Tu es toi-même fort curieux, Rakitka ! Je te répète que j’attends une nouvelle. Sitôt reçue, je m’envolerai, vous ne me verrez plus. Voilà pourquoi je me suis parée.
— Et où t’envoleras-tu ?
— Si on te le demande, tu diras que tu n’en sais rien.
— Comme elle est gaie !… Je ne t’ai jamais vue ainsi. Elle est attifée comme pour un bal ! s’exclama Rakitine en l’examinant avec surprise.
— Es-tu au courant des bals ?
— Et toi ?
— J’en ai vu un, moi. Il y a trois ans, lorsque Kouzma Kouzmitch a marié son fils ; je regardais de la tribune. Mais pourquoi causerais-je avec toi quand j’ai un prince pour hôte ? Mon cher Aliocha, je n’en crois pas mes yeux ; comment se peut-il que tu sois venu ? À vrai dire, je ne t’attendais pas, je n’ai jamais cru que tu puisses venir. Le moment est mal choisi, pourtant je suis bien contente. Assieds-toi sur le canapé, ici, mon bel astre ! Vraiment, je n’en reviens pas encore… Rakitka, si tu l’avais amené hier ou avant-hier !… Eh bien, je suis contente comme ça. Mieux vaut peut-être que ce soit maintenant, à une telle minute… »
Elle s’assit vivement à côté d’Aliocha et le regarda avec extase. Elle était vraiment contente et ne mentait pas. Ses yeux brillaient, elle souriait, mais avec bonté. Aliocha ne s’attendait pas à lui voir une expression aussi bienveillante… Il s’était fait d’elle une idée terrifiante ; sa sortie perfide contre Catherine Ivanovna l’avait bouleversé l’avant-veille, maintenant il s’étonnait de la voir toute changée. Si accablé qu’il fût par son propre chagrin, il l’examinait malgré lui avec attention. Ses manières s’étaient améliorées ; les intonations doucereuses, la mollesse des mouvements avaient presque disparu, faisant place à de la bonhomie, à des gestes prompts et sincères ; mais elle était surexcitée.
« Seigneur, quelles choses étranges se passent aujourd’hui, ma parole ! Pourquoi suis-je si heureuse de te voir, Aliocha, je l’ignore.
— Est-ce bien vrai ? dit Rakitine en souriant. Auparavant, tu avais un but en insistant pour que je l’amène.
— Oui, un but qui n’existe plus maintenant, le moment est passé. Et maintenant, je vais vous bien traiter. Je suis devenue meilleure, à présent, Rakitka. Assieds-toi aussi. Mais c’est déjà fait, il ne s’oublie pas. Vois-tu, Aliocha, il est vexé que je ne l’aie pas invité le premier à s’asseoir. Il est susceptible, ce cher ami. Ne te fâche pas, Rakitka, je suis bonne en ce moment. Pourquoi es-tu si triste, Aliocha ? Aurais-tu peur de moi ? »
Grouchegnka sourit malicieusement en le regardant dans les yeux.
« Il a du chagrin. Un refus de grade.
— Quel grade ?
— Son starets sent mauvais.
— Comment cela ? Tu radotes ; encore quelque vilenie, sans doute. Aliocha, laisse-moi m’asseoir sur tes genoux, comme ça. »
Et aussitôt elle s’installa sur ses genoux, telle qu’une chatte caressante, le bras droit tendrement passé autour de son cou.
« Je saurai bien te faire rire, mon gentil dévot ! Vraiment, tu me laisses sur tes genoux, ça ne te fâche pas ? Tu n’as qu’à le dire, je me lève. »
Aliocha se taisait. Il n’osait bouger, ne répondait pas aux paroles entendues, mais il n’éprouvait pas ce que pouvait imaginer Rakitine, qui l’observait d’un air égrillard. Son grand chagrin absorbait les sensations possibles, et s’il avait pu en ce moment s’analyser, il aurait compris qu’il était cuirassé contre les tentations. Néanmoins, malgré l’inconscience de son état et la tristesse qui l’accablait, il s’étonna d’éprouver une sensation étrange : cette femme « terrible » ne lui inspirait plus l’effroi inséparable dans son cœur de l’idée de la femme. Au contraire, installée sur ses genoux et l’enlaçant, elle éveillait en lui un sentiment inattendu, une curiosité candide sans la moindre frayeur. Voilà ce qui le surprenait malgré lui.
« Assez causé pour ne rien dire ! s’écria Rakitine. Fais plutôt servir du champagne, tu sais que j’ai ta parole.
— C’est vrai, Aliocha, je lui ai promis du champagne s’il t’amenait. Fénia, apporte la bouteille que Mitia a laissée, dépêche-toi. Bien que je sois avare, je donnerai une bouteille, pas pour toi, Rakitine, tu n’es qu’un pauvre sire, mais pour lui. Je n’ai pas le cœur à ça ; mais n’importe, je veux boire avec vous.
— Quelle est donc cette « nouvelle » ? peut-on le savoir, est-ce un secret ? insista Rakitine, sans prendre garde en apparence aux brocards qu’on lui lançait.
— Un secret dont tu es au courant, dit Grouchegnka d’un air préoccupé : mon officier arrive.
— Je l’ai entendu dire, mais est-il si proche ?
— Il est maintenant à Mokroïé, d’où il enverra un exprès ; je viens de recevoir une lettre. J’attends.
— Tiens ! Pourquoi à Mokroïé ?
— Ce serait trop long à raconter ; en voilà assez.
— Mais alors, et Mitia, le sait-il ?
— Il n’en sait pas le premier mot. Sinon, il me tuerait. D’ailleurs, je n’ai plus peur de lui, maintenant. Tais-toi, Rakitka, que je n’entende plus parler de lui ; il m’a fait trop de mal. J’aime mieux songer à Aliocha, le regarder… Souris donc, mon chéri, déride-toi tu me feras plaisir… Mais il a souri ! Vois comme il me regarde d’un air caressant. Sais-tu, Aliocha, je croyais que tu m’en voulais à cause de la scène d’hier, chez cette demoiselle. J’ai été rosse… Pourtant, c’était réussi, en bien et en mal, dit Grouchegnka pensivement, avec un sourire mauvais, Mitia m’a dit qu’elle criait : « Il faut la fouetter ! » Je l’ai gravement offensée. Elle m’a attirée, elle a voulu me séduire avec son chocolat… Non, ça s’est bien passé comme ça. » Elle sourit de nouveau. « Seulement, je crains que tu ne sois fâché…
— En vérité, Aliocha, elle te craint, toi, le petit poussin, intervint Rakitine avec une réelle surprise.
— C’est pour toi, Rakitine, qu’il est un petit poussin, car tu n’as pas de conscience. Moi, je l’aime. Le crois-tu, Aliocha, je t’aime de toute mon âme.
— Ah ! l’effrontée ! Elle te fait une déclaration, Aliocha.
— Eh bien quoi, je l’aime.
— Et l’officier ? Et l’heureuse nouvelle de Mokroïé ?
— Ce n’est pas la même chose.
— Voilà la logique des femmes !
— Ne me fâche pas, Rakitine. Je te dis que ce n’est pas la même chose. J’aime Aliocha autrement. À vrai dire, Aliocha, j’ai eu de mauvais desseins à ton égard. Je suis vile, je suis violente ; mais à certains moments je te regardais comme ma conscience. Je me disais : « Comme il doit me mépriser, maintenant ! » J’y pensais avant-hier en me sauvant de chez cette demoiselle. Depuis longtemps je t’ai remarqué, Aliocha ; Mitia le sait, il me comprend. Le croiras-tu, parfois je suis saisie de honte en te regardant. Comment suis-je venue à penser à toi, et depuis quand ? je l’ignore. »
Fénia entra, posa sur la table un plateau avec une bouteille débouchée et trois verres pleins.
« Voilà le champagne ! s’écria Rakitine. Tu es excitée, Agraféna Alexandrovna. Après avoir bu, tu te mettras à danser. Quelle maladresse ! ajouta-t-il : il est déjà versé et tiède, et il n’y a pas de bouchon. »
Il n’en vida pas moins son verre d’un trait et le remplit à nouveau.
« On a rarement l’occasion, déclara-t-il en s’essuyant les lèvres ; allons, Aliocha, prends ton verre, et sois brave. Mais, à quoi boirons-nous ? Prends le tien, Groucha, et buvons aux portes du paradis.
— Qu’entends-tu par là ? »
Elle prit un verre, Aliocha but une gorgée du sien et le reposa.
« Non, j’aime mieux m’abstenir, dit-il avec un doux sourire.
— Ah ! tu te vantais ! cria Rakitine.
— Moi aussi, alors, fit Grouchegnka. Achève la bouteille, Rakitka. Si Aliocha boit, je boirai.
— Voilà les effusions qui commencent ! goguenarda Rakitine. Et elle est assise sur ses genoux ! Lui a du chagrin, j’en conviens, mais toi, qu’as-tu ? Il est en révolte contre son Dieu, il allait manger du saucisson !
— Comment cela ?
— Son starets est mort aujourd’hui, le vieux Zosime, le saint.
— Ah ! il est mort. Je n’en savais rien, dit-elle en se signant. Seigneur, et moi qui suis sur ses genoux ! »
Elle se leva vivement et s’assit sur le canapé. Aliocha la considéra avec surprise et son visage s’éclaira.
« Rakitine, proféra-t-il d’un ton ferme, ne m’irrite pas en disant que je me suis révolté contre mon Dieu. Je n’ai pas d’animosité contre toi ; sois donc meilleur, toi aussi. J’ai fait une perte inestimable, et tu ne peux me juger en ce moment. Regarde-la, elle ; tu as vu sa mansuétude à mon égard ? J’étais venu ici trouver une âme méchante, poussé par mes mauvais sentiments : j’ai rencontré une véritable sœur, une âme aimante, un trésor… Agraféna Alexandrovna, c’est de toi que je parle. Tu as régénéré mon âme. »
Aliocha oppressé se tut, les lèvres tremblantes.
« On dirait qu’elle t’a sauvé ! railla Rakitine. Mais sais-tu qu’elle voulait te manger ?
— Assez, Rakitine ! Taisez-vous tous les deux. Toi, Aliocha, parce que tes paroles me font honte : tu me crois bonne, je suis mauvaise. Toi, Rakitka, parce que tu mens. Je m’étais proposé de le manger, mais c’est du passé, cela. Que je ne t’entende plus parler ainsi, Rakitka ! »
Grouchegnka s’était exprimée avec une vive émotion.
« Ils sont enragés ! murmura Rakitine en les considérant avec surprise, on se croirait dans une maison de santé. Tout à l’heure ils vont pleurer, pour sûr !
— Oui, je pleurerai, oui, je pleurerai ! affirma Grouchegnka ; il m’a appelée sa sœur, je ne l’oublierai jamais ! Si mauvaise que je sois, Rakitka, j’ai pourtant donné un oignon.
— Quel oignon ? Diable, ils sont toqués pour de bon ! »
Leur exaltation étonnait Rakitine, qui aurait dû comprendre que tout concourait à les bouleverser d’une façon exceptionnelle. Mais Rakitine, subtil quand il s’agissait de lui, démêlait mal les sentiments et les sensations de ses proches, autant par égoïsme que par inexpérience juvénile.
« Vois-tu, Aliocha, reprit Grouchegnka avec un rire nerveux, je me suis vantée à Rakitine d’avoir donné un oignon. Je vais t’expliquer la chose en toute humilité. Ce n’est qu’une légende : Matrone, la cuisinière, me la racontait quand j’étais enfant : « Il y avait une mégère qui mourut sans laisser derrière elle une seule vertu. Les diables s’en saisirent et la jetèrent dans le lac de feu. Son ange gardien se creusait la tête pour lui découvrir une vertu et en parler à Dieu. Il se rappela et dit au Seigneur : « Elle a arraché un oignon au potager pour le donner à une mendiante. » Dieu lui répondit : « Prends cet oignon, tends-le à cette femme dans le lac, qu’elle s’y cramponne. Si tu parviens à la retirer, elle ira en paradis : si l’oignon se rompt, elle restera où elle est. » L’ange courut à la femme, lui tendit l’oignon. « Prends, dit-il, tiens bon. » Il se mit à la tirer avec précaution, elle était déjà dehors. Les autres pécheurs, voyant qu’on la retirait du lac, s’agrippèrent à elle, voulant profiter de l’aubaine. Mais la femme, qui était fort méchante, leur donnait des coups de pied : « C’est moi qu’on tire et non pas vous ; c’est mon oignon, non le vôtre. » À ces mots, l’oignon se rompit. La femme retomba dans le lac où elle brûle encore. L’ange partit en pleurant. « Voilà cette légende, Aliocha ; ne me crois pas bonne, c’est tout le contraire ; tes éloges me feraient honte. Je désirais tellement ta venue, que j’ai promis vingt-cinq roubles à Rakitka s’il t’amenait. Un instant. »
Elle alla ouvrir un tiroir, prit son porte-monnaie et en sortit un billet de vingt-cinq roubles.
« C’est absurde ! s’écria Rakitine embarrassé.
— Tiens, Rakitka, je m’acquitte envers toi ; tu ne refuseras pas, tu l’as demandé toi-même. »
Elle lui jeta le billet.
« Comment donc, répliqua-t-il, s’efforçant de cacher sa confusion, c’est tout profit, les sots existent dans l’intérêt des gens d’esprit.