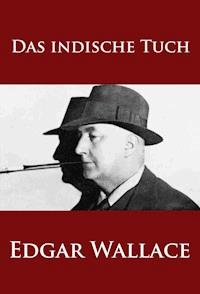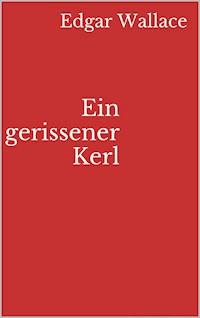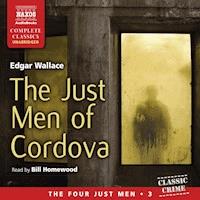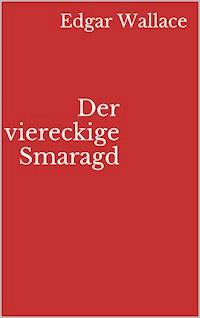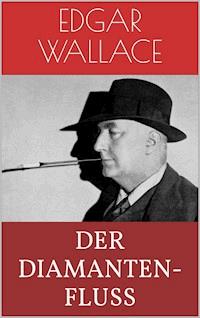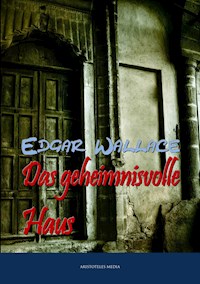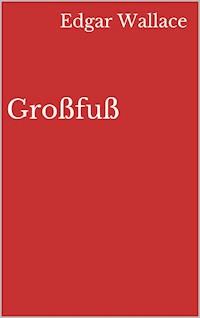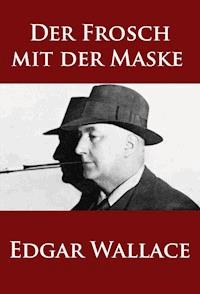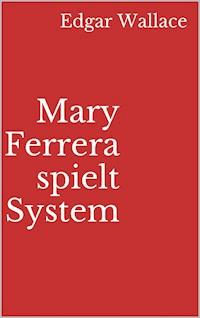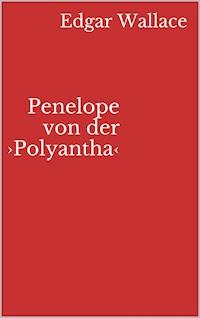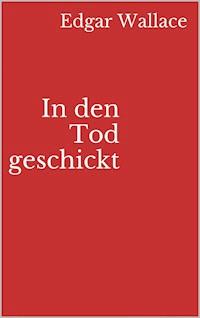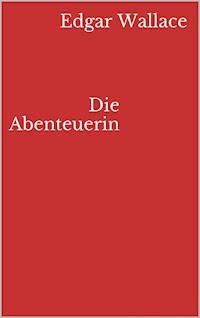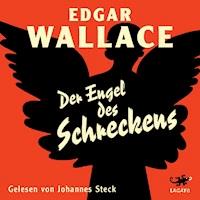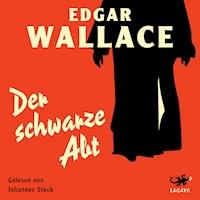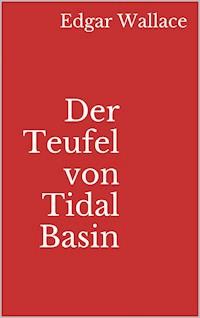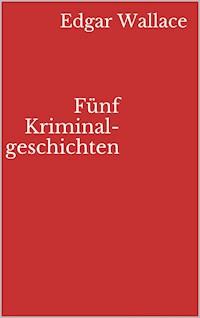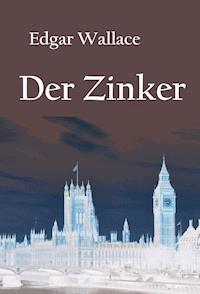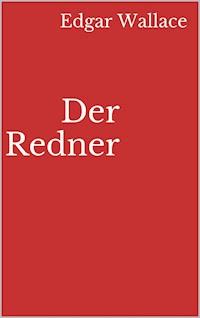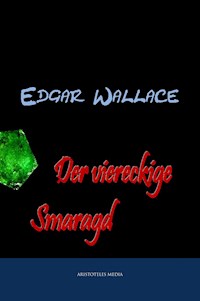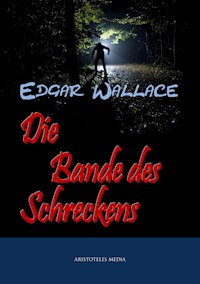3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Né en Virginie, Edward Tatham est confié à l'âge de 12 ans, après le décès de ses deux parents, à une branche irlandaise de sa famille. Très vite il les quitte pour aller à Londres où il exerce une multitude d'emplois. Doué d'un esprit extraordinairement alerte et d'une imagination prodigieuse il obtient un prix de chimie après avoir suivi des cours du soir. Engagé dans l'armée anglaise, nous retrouvons le capitaine Tatham lors de la guerre des Boërs où à la tête de ses hommes qui le vénèrent comme un dieu, il a un comportement héroïque. C'est pendant ces évènements qu'il a connaissance de l'existence de «l'Île de la Désolation», rocher de l'Atlantique sud complètement inaccessible, se composant à l'intérieur d'une profonde vallée où se distinguent des cours d'eau, une végétation abondante, une abondante vie animale et paraissant prodigieusement riche en minéraux dont certainement de l'or. Nous suivons alors les extraordinaires péripéties qui vont amener Tatham à l'exploiter et à se l'approprier avec l'aide de ses hommes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
L'Ile d'Eve
L'Ile d'EveGENÈSE DE CETTE HISTOIREI. DÉPOSITION DU PREMIER TÉMOIN : CAPITAINE WALTER FORD, R. N., C. M. G.II. DÉPOSITION DU DEUXIÈME TÉMOIN : ERNEST GEORGE STUCKEYIII. RÉCIT DU TROISIÈME TÉMOIN : WILLIAM C. HACKITTIV. RÉCIT DU TROISIÈME TÉMOIN : WILLIAM C. HACKITT (suite)V. RÉCIT DU QUATRIÈME TÉMOIN : RICHARD CALLUSVI. RÉCIT DU QUATRIÈME TÉMOIN : RICHARD CALLUS (suite)VII. RÉCIT DU QUATRIÈME TÉMOIN : RICHARD CALLUS (suite)VIII. RÉCIT DU QUATRIÈME TÉMOIN : RICHARD CALLUS (suite)IX. RÉCIT DU QUATRIÈME TÉMOIN : RICHARD CALLUS (suite)X. RÉCIT DU QUATRIÈME TÉMOIN : RICHARD CALLUS (suite)XI. RÉCIT DU QUATRIÈME TÉMOIN : RICHARD CALLUS (suite)XII. RÉCIT DU QUATRIÈME TÉMOIN : RICHARD CALLUS (suite)XIII. RÉCIT DU QUATRIÈME TÉMOIN : RICHARD CALLUS (suite)XIV. RÉCIT DU CINQUIÈME TÉMOIN : SIR GEORGE CALLIPERXV. FIN DU RÉCIT DU QUATRIÈME TÉMOIN : RICHARD CALLUSPage de copyrightL'Ile d'Eve
Edgar Wallace
GENÈSE DE CETTE HISTOIRE
Edward G. Tatham naquit en Virginie, aux États-Unis. C’est là un fait aujourd’hui connu du monde entier. On trouve encore des gens à Springville (Virginie) pour affirmer qu’ils se souviennent de l’avoir vu, tout enfant, assis devant la boutique du vieux Crubbs, traînant ses pieds nus dans la poussière. Ils le décrivent, d’après leurs souvenirs, comme un enfant aux cheveux filasse, au mince visage sérieux, avec des yeux bleus qui vous examinaient comme si vous aviez été un spécimen d’une variété inconnue d’insectes, ou un phénomène inédit de la nature. Ils disent aussi que, dès cette époque, il était doué d’une grande facilité d’élocution, qu’il récitait des fables, qu’il avait une mémoire qui ne laissait rien échapper, et qu’il était admis, sur un pied d’égalité, aux graves réunions qui s’assemblaient chaque jour chez Crubbs.
Ce dernier point m’a été certifié par M. Crubbs l’aîné, lui-même, mais j’ai averti mon gouvernement qu’il y avait lieu de faire quelques réserves sur cette assertion, ayant été avisé que Crubbs est un intarissable conteur d’anecdotes, et qu’en le poussant un peu, on obtiendrait de lui des souvenirs personnels de ses rapports avec Abraham Lincoln ou même avec Washington.
Les pauvres registres de l’état civil de Springville nous enseignent que Edward Garfield Tatham est né le 1er avril 1873, de Clark Thomas Tatham, et de Georgina Mary Daly, son épouse. Le couple, qui venait d’un État de l’Est, s’installa à Springville juste assez longtemps pour qu’y naquît l’enfant qui devait plus tard occasionner presque un casus belli européen, avant de retourner ensuite dans l’Est.
Le père, marchand de chevaux, mourut à Baltimore en 1881, la mère à Troy (N.-Y.) en 1883, et Edward G. Tatham, à ce que j’ai pu savoir, fut recueilli par un certain Michaël Joseph Daly, son oncle, qui tenait une salle de billard dans un quartier de l’Est, à New York. Daly devint alderman, puis il mourut, encore jeune ; c’était probablement un honnête homme et ce qu’il advint de son neveu fut plutôt le résultat d’un concours de circonstances que celui de ses conseils.
À l’âge de douze ans, le jeune Tatham traversa l’Atlantique et alla s’installer chez des parents, de fort médiocre réputation, à qui l’oncle Michaël, sur son lit de mort, avait fait recommander l’enfant. Celui-ci vécut donc, dès lors, dans une rue étroite, tout près de la Rotonde, à Dublin.
J’ai découvert qu’il avait été condamné à la prison et à une amende de deux shillings et six pence pour avoir vendu des journaux dans la rue. Ceci ne constitue évidemment pas un délit, mais le procès-verbal précise qu’il « occasionna un encombrement, le 8 octobre, dans Sackville Street, et que, sommé de circuler par le constable Patrick O’Leary, il usa d’un langage grossier et insultant, propre à troubler l’ordre, après avoir assailli et malmené le nommé Patrick Moriaty, marchand de journaux ambulant, âgé de quatorze ans, en le frappant d’un coup de poing au visage ».
J’ai retrouvé, dans un journal de l’époque, un compte rendu de l’incident qui résulta de la première immixtion du jeune Tatham dans les intérêts d’autrui, car Patrick Moriaty s’était adjugé le monopole de la vente du Freeman’s Journal dans ce secteur, et avait manifesté son déplaisir de l’apparition d’un concurrent.
La vente des journaux dans les rues de Dublin n’était décidément pas la vocation du jeune Tatham. Trois mois plus tard, il était à Londres. Il avait rompu les relations avec ses parents – il est d’ailleurs possible et même vraisemblable que ceux-ci aient pris l’initiative de cette rupture.
On sait peu de chose de sa vie à Londres, à cette période. Il est certain du moins qu’il travailla, mais sans jamais conserver plus de deux ou trois mois le même genre d’occupation. J’ai retrouvé ses traces comme apprenti imprimeur, petit commis et garçon laitier. Il semble avoir été en proie à un goût certain pour le vagabondage qui lui rendait insupportable la monotonie d’un emploi stable. « Il lâchait son boulot pour en essayer un autre, et ainsi de suite », a dit un témoignage authentique. Il est certain, en tout cas, qu’il suivit assidûment les cours du soir qu’un conseil municipal généreux a institué au bénéfice des jeunes gens des classes laborieuses. Là, pour quelques sous par semaine, son instruction fut perfectionnée. Il remporta un prix de chimie, en argent, dont le montant surpassait de beaucoup celui de ses études. L’une de ses dissertations historiques fut imprimée dans la revue du conseil municipal. Il apprenait facilement, car il était doué d’un esprit extraordinairement alerte, et, a dit un de ses professeurs qui se souvenait de lui, « d’une imagination prodigieuse ». Il possédait encore d’autres qualités, qui devaient s’épanouir plus tard.
Je pourrais le dépeindre tel qu’il était alors, ce garçon maigre et fruste, courbé sur son pupitre de sapin, et toujours affamé, car son salaire, à ce que j’ai pu savoir, ne dépassait jamais beaucoup deux shillings et demi, desquels il lui fallait consacrer la moitié à son logement.
« Il était encore plus affamé de science, nous a dit son maître. Il était avide de connaissances nouvelles comme un ours est friand de miel, dévorait voracement toutes les bribes de savoir qu’il recueillait, et si la pâture intellectuelle lui était distribuée trop chichement à son gré, il tendait une main mendiante, toute pleine de notes, de résumés et de demandes d’explications. »
En 1889, Tatham disparaît, et je ne puis retrouver aucune trace de ses faits et gestes à ce moment. À mon avis, il dut s’engager dans l’armée britannique, mais aucune preuve ne confirme cette hypothèse. Tatham lui-même n’en dit rien et, considérant cette période comme d’une importance secondaire en l’occurrence, je n’ai pas poursuivi plus loin mon enquête sur ce point.
C’est après les événements qui déterminèrent le rassemblement de notre flotte dans l’Atlantique Sud, alors que le nom de Edward G. Tatham était sur les lèvres de tous les habitants du monde civilisé, que je fus invité à me rendre à Washington où le Président de notre grande République désirait avoir un entretien avec moi. Déjà, précédemment, j’avais eu l’honneur d’être félicité par le Président au sujet de mon Histoire de la Guerre hispano-américaine, histoire qui, je dois l’avouer en toute modestie, offrait le maximum d’objectivité possible sur des faits encore si récents.
Je fus introduit dans le bureau particulier du chef de l’État qui me serra chaleureusement la main.
« Je suis heureux que vous soyez venu, me dit-il, avec son habituel sourire expansif. Je désirais vous voir non seulement à titre personnel, mais aussi pour des raisons officielles. »
Tout en parlant, il s’était mis à arpenter la pièce à grands pas, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon.
« Vous connaissez les événements de l’Atlantique Sud ? me dit-il. Et bien entendu, vous avez eu l’écho des incidents qui se sont élevés au sujet du président Tatham, incidents qui sont aujourd’hui heureusement clos. Vous connaissez sans doute aussi quelques-unes des causes de ces incidents ? »
Je hochai la tête affirmativement ; l’histoire était déjà dans le domaine public.
« Le gouvernement britannique a désigné une commission secrète qui a siégé pendant trois semaines pour établir les tenants et les aboutissants de l’affaire, et ses conclusions doivent rester strictement secrètes… »
J’acquiesçai de nouveau de la tête. « Il y a peu de chose à apprendre, dis-je. Nous savons que Tatham… »
Le Président leva la main pour m’arrêter et sourit.
« Vous ne savez rien du tout, dit-il. Connaissez-vous Ève Smith ? Connaissez-vous le correspondant Callus ? Connaissez-vous l’ingénieur Hackitt ? »
Il frappa sur la table et reprit :
« Connaissez-vous l’Éclaireur ? »
Je le regardai avec surprise.
« L’Éclaireur ?
– C’est un cheval de course, dit le Président, visiblement amusé de mon ahurissement ; et c’est la clef de voûte de toute l’affaire, bien que peu de gens s’en doutent. »
Il ouvrit un tiroir et y prit une large enveloppe d’où il sortit quelques feuillets.
« Voici le squelette de l’affaire, reprit-il. Je l’ai eu par… hum… par voie diplomatique. Je désire que vous vous rendiez en Europe pour mettre de la chair sur cette charpente. Vous trouverez ici une liste d’individus qui vous fourniront des indications. Le gouvernement britannique n’élèvera aucune objection, dès qu’il comprendra que vous savez quels sont ces témoins. Tatham a été un citoyen de notre pays. Il le serait encore s’il n’avait pas édifié ses propres lois ; il est entré en conflit avec l’Europe et a gagné la partie. Allez, et dites-moi comment il s’y est pris. Adieu, et bon voyage ! »
*
* *
C’est ainsi que j’ai été amené à écrire le livre le plus étrange qui ait jamais été publié, un livre qui pourrait, me semble-t-il, fournir la matière d’un bon roman si un écrivain plus expérimenté que je ne le suis y mettait la main.
J’ajoute que les divers fragments de ce récit, présenté aujourd’hui au public pour la première fois, ont été recueillis en des endroits variés et parfois surprenants. En effet, lorsque j’arrivai en Angleterre, la plupart des acteurs de cette histoire s’étaient éparpillés aux quatre coins du monde. Je dus me rendre à la prison de Wormwood Scrubs pour interviewer Stuckey. Je rencontrai le correspondant de guerre dans un petit café de Cadix. Sir James Calliper se trouvait en Écosse quand je parvins à le joindre, mais fort heureusement, il était en possession des Livres Bleus nécessaires pour élucider la fin de l’histoire. Pour trouver le capitaine Ford, il me fallut traverser la Sibérie, son navire croisant dans les mers de Chine, et enfin, je trouvai Hackitt, en dernier lieu, à Rio de Janeiro.
Chacun de ces témoignages m’était nécessaire. L’ensemble des récits de ces personnages constitue l’histoire de la plus extraordinaire aventure dans laquelle homme se soit jamais trouvé entraîné.
Je n’ai pas donné la version du gouvernement du Congo, trop visiblement partiale. Bruxelles considère Tatham comme un vulgaire escroc, bien qu’il ait fait réparation.
En assemblant tous ces morceaux divers, j’ai cru devoir disposer ces témoignages non dans l’ordre où je les ai recueillis, mais selon le déroulement chronologique des faits, afin de reconstituer le développement logique des événements.
I. DÉPOSITION DU PREMIER TÉMOIN : CAPITAINE WALTER FORD, R. N., C. M. G.
Le capitaine Walter Ford, de la Marine Royale, chevalier de l’ordre de Saint-Michel et de Saint-George, commandant le croiseur de première classe Ontario. Le capitaine Ford est un homme de cinquante ans, légèrement grisonnant, de haute taille. Il me reçut à bord de son navire, au large de Hong-Kong, et manifesta une certaine répugnance à me communiquer les informations que je venais chercher. Fort heureusement, la lettre de l’Amirauté britannique que m’avait procurée notre ambassadeur à Londres leva tous ses scrupules quant à la discrétion exigée par l’Acte secret, et il me fit part de tout ce qu’il savait, en phrases brèves et concises, tout en dégageant admirablement les points essentiels de son récit.
J’ai commandé pendant quelques années le garde-côte Charter, dit le capitaine Ford, et c’est alors que j’ai fait connaissance avec l’île que l’on désigne maintenant sous le nom d’île de Tatham. Sa position exacte doit être 20° 5’ 5” latitude Ouest et 37° 5’ 4” longitude Sud. La dernière fois que je me suis trouvé dans ces parages, c’était en octobre 1897, pour relever les fonds, du côté septentrional de l’île. Celle-ci, selon toute apparence, était inhabitée, et à vrai dire, ne semblait guère autre chose qu’un gigantesque rocher s’élevant perpendiculairement au-dessus des eaux, semblable à un énorme iceberg de granit. Son aspect était si rébarbatif que je me fis longtemps prier avant d’autoriser mon premier lieutenant à tenter une exploration à l’intérieur de l’île qui, par ailleurs, je le dis en passant, est d’environ 30 kilomètres de long et de 24 kilomètres dans sa plus grande largeur.
Ce qui me détermina à entreprendre cette expédition, ce fut la découverte, par le lieutenant A. S. W. Sanders, d’une rivière souterraine dont l’embouchure se trouvait, sur la face Sud de l’île, sous le pic auquel nous donnâmes le nom de « Pic du Signal ». La présence d’eau potable n’avait jamais été découverte par les navires qui, de loin en loin, saluaient l’île, et c’est sans doute pour cette raison que l’Empire avait négligé de faire valoir ses droits sur ce rocher.
Il y a deux ans encore, la possession de l’île restait indéterminée. Elle était revendiquée parfois par la Grande-Bretagne, en application du traité de Tsai-Lang ; par le Portugal, en raison d’une soi-disant « occupation » ; et aussi par la Hollande. Par ailleurs, elle est portée sur tous les atlas allemands comme possession germanique.
Je disais donc que la découverte de la rivière souterraine me décida à organiser une expédition à l’intérieur de l’île. En conséquence, le 28 octobre 1897, j’envoyai le lieutenant Granger, en canot, opérer une reconnaissance autour d’elle afin de relever les points d’atterrissage.
À son retour, il m’apprit qu’en dépit de recherches consciencieuses, il n’avait pu découvrir la plus étroite faille dans la muraille verticale qui surplombait cette côte véritablement inhospitalière. Son canot n’avait pu atterrir que sur une étroite bande de sable, entièrement recouverte d’ailleurs à marée haute, au Nord-Est de l’île. Mais là encore, mordant sur le sable, le roc s’élevait à cinq cents pieds de hauteur, sans offrir la moindre brèche. Ces renseignements me parurent si surprenants que, sans mettre en doute la parole du lieutenant Granger, j’entrepris moi-même une nouvelle exploration, pour aboutir aux mêmes résultats que l’officier.
Nous serions repartis sans que j’eusse poussé plus loin des recherches qui semblaient devoir rester vaines, si le lieutenant Granger n’avait eu l’ingénieuse idée de tenter d’obtenir une photographie de l’intérieur de l’île, au moyen d’un cerf-volant.
L’appareil fut construit avec soin par le sergent Doyle et, dès le premier essai, nos efforts furent couronnés de succès : la camera avait fonctionné au moyen du système d’horlogerie agencé par Doyle sur le cerf-volant. Avant de développer la plaque, je fis repartir le cerf-volant, mais malheureusement, un vent contraire le fit dériver.
Nos troisième et quatrième essais furent satisfaisants et les photographies ainsi obtenues, parfaitement nettes. D’après leur témoignage, l’île se composait à l’intérieur d’une profonde vallée où se distinguaient des cours d’eau et une végétation abondante. Aucune trace, bien entendu, d’habitations humaines, mais, en revanche, abondance de vie animale, si j’en juge par des animaux qui me parurent analogues, autant que j’en pus juger, aux quaggas du Sud de l’Afrique.
Nous avions employé des plaques isochromatiques qui m’aidèrent à discerner approximativement la formation géologique du sol, particulièrement en ce qui concerne les collines déclives de la muraille occidentale, à propos desquelles je notai :
« Paraissent prodigieusement riches en minéraux. »
Mes relevés de fonds furent terminés en décembre et, peu après, je transmis mon rapport à l’Amirauté.
J’ignorais absolument à cette époque l’existence du capitaine Tatham. L’île avait le nom d’« Île de la Désolation » ou Woortz Island. Je n’ai entendu parler du capitaine Tatham qu’en même temps que le reste du monde, et d’une façon tout accidentelle.
Mon rapport à l’Amirauté était un document de nature confidentielle et je ne pourrais dire si le capitaine Tatham eût jamais la possibilité d’en prendre connaissance.
II. DÉPOSITION DU DEUXIÈME TÉMOIN : ERNEST GEORGE STUCKEY
L’autorisation de rendre visite à Ernest George Stuckey me fut fournie par le ministère de l’Intérieur. Cette entrevue eut lieu dans la vaste prison de la banlieue de Londres qui se nomme Wormwood Scrubs. Là, en présence de deux gardiens, Stuckey me fit le récit de ce qu’il savait. C’était un homme de belle apparence, distingué même, en dépit du hideux costume kaki des détenus, et qui conservait quelque chose de militaire dans l’attitude. Il était assis à un bout d’une longue table, moi à l’autre extrémité, les deux gardiens entre nous, un de chaque côté de la table.
Il fut un temps où j’étais attaché à l’Amirauté, mais je purge aujourd’hui une peine de douze mois de prison pour divulgation de documents secrets, dit Stuckey. Avant mon entrée au service de l’Amirauté, j’étais sergent dans l’artillerie. Je connais la salle des archives, dans les vieux bâtiments de l’Amirauté, et j’y avais accès. Les documents qui y sont enfermés sont « confidentiels », formule qui n’a d’ailleurs qu’une valeur relative pour la plupart de ces dossiers.
Je m’étais souvent amusé à compulser les notes, sans jamais y avoir rien trouvé de sensationnel, et je puis vous assurer que je n’avais guère en vue, en agissant ainsi, que de passer le temps.
Je tombai, un jour, sur le rapport du capitaine Ford au sujet de l’île Tatham, sous la cote Ch. 7743, 1897. Je suppose que Ch. était mis pour Charter, nom du navire commandé par Ford. Ce rapport me passionna, et comme j’ai l’imagination assez romanesque, je passai bien des heures à inventer toutes sortes d’histoires à propos de l’île, et à rêver de richesses improbables, détenues en ce coin de terre si bien défendu par la nature. J’en arrivai à connaître le rapport de Ford par cœur, et aujourd’hui encore, je pourrais dessiner le plan de l’île, les yeux fermés. Ceci se passait en 1899 ; vers la fin de l’année, la guerre des Boërs éclata, je fus mobilisé avec la réserve, et je partis pour l’Afrique du Sud, à bord du Drayton Grange.
Je restai sous les ordres du général French pendant la plus grande partie de la campagne, mais vers la fin, lorsque la situation devint critique, du côté du Cap, je fus envoyé, avec la moitié d’un bataillon sous les ordres du capitaine Powell, pour rejoindre la colonne de Henniker.
Henniker ne badinait pas et nous tenait debout jour et nuit. Il avait avec nous sous ses ordres la moitié d’un corps de volontaires, des durs à cuire, je vous prie de le croire, et qui se battaient bien. C’est là que je rencontrai pour la première fois le capitaine Tatham.
C’était un grand garçon, toujours le rire aux lèvres, avec des yeux qui vous fixaient d’un air amusé, comme si vous aviez été une chenille bossue. Par exemple, il se battait comme pas un, et je me demande s’il savait ce que c’est que d’avoir peur.
Il m’avait plu au premier coup d’œil, et malgré la différence de nos grades, puisqu’il était officier et moi tout juste sorti du rang, nous étions vite devenus copains. Cela peut vous paraître étrange, mais n’oubliez pas qu’en temps de guerre le côté cérémonieux de la discipline se relâche plus ou moins, sans compter qu’un gradé d’un corps irrégulier n’est jamais aussi à cheval sur l’étiquette qu’un officier de l’armée active.
Un soir, de fil en aiguille, j’en arrivai à faire allusion au rapport de Ford, et il parut tout de suite très intéressé. Il me le fit réciter au moins douze fois, et je finis par lui en dresser la carte et lui expliquer les vues obtenues au moyen du cerf-volant. Le passage sur les collines « prodigieusement riches en minéraux » le fit longuement rêver, et le lendemain soir, dans son calepin il copia sous ma dictée tout ce que j’avais retenu du rapport.
Son accent m’avait fait supposer qu’il était Américain, et j’en fus convaincu lorsqu’il me dit qu’il était « d’origine cosmopolite », car c’est le titre que se donnent les Américains lorsqu’ils ont peu connu leur propre pays. Il me confia une autre fois qu’il avait souvent fait de la prospection, et qu’il « avait le flair » pour trouver de l’or. Il commandait, je crois bien, le deuxième escadron de volontaires, et ses hommes, qu’il appelait presque tous par leurs noms de baptême, l’adoraient.
Ce qui m’étonnait chez lui, c’était son extraordinaire puissance de concentration. Je l’ai vu rester assis devant le feu pendant des heures, les yeux fixés sur les flammes, sans plus bouger qu’une idole de pierre. Quand il était sorti de ses méditations, vous vous aperceviez que, pendant ces heures où il avait paru presque endormi, il avait dressé tout un plan et, qu’il s’agît d’une reconnaissance hasardeuse, d’un raid sur une ferme, ou d’une escarmouche, il avait passé en revue toutes les éventualités, toutes les combinaisons imaginables de circonstances, et pourvu à toutes les possibilités.
Finalement, sa formation fut envoyée dans le district de Pietersburg, au Nord de Prétoria, et je ne le revis plus jusqu’à la fin de la guerre.
J’appris par quelques-uns de ses hommes que je retrouvai à l’hôpital (j’avais été blessé dans la bataille contre De Wet) qu’il était en querelle avec le gouvernement au sujet de la prime qui lui revenait. Autant que je le connais, il devait moins se soucier de sa propre part que de voir ses hommes injustement traités. En tout cas, le gouvernement se montra récalcitrant, et il sortit de l’affaire plus pauvre encore qu’il n’y était entré.
C’est en juin 1902 que je le retrouvai. Après la démobilisation, j’avais repris mon service à l’Amirauté ; un beau jour, je reçus un mot de lui, me demandant de le rejoindre le soir même au restaurant Fregiloni.
Il était toujours le même ; mais je fus dérouté de le voir en vêtements civils. Tatham appartenait à ce genre d’hommes qu’on ne peut se représenter qu’en bottes de cheval, sous un casque colonial. Il paraissait fort démuni ; ses souliers étaient éculés, son col éraillé, et de toute évidence, son complet était sorti, longtemps auparavant, d’un magasin de confection. Après un modeste dîner qu’il tint à régler en allongeant un pourboire magnifique au garçon, il m’apprit qu’il se trouvait à Londres, avec l’un de ses hommes, pour essayer de réunir des fonds en vue d’une « expédition ». Le reste de sa compagnie était resté au Cap, à attendre de ses nouvelles. Comme je lui demandais le montant de la somme qu’il souhaitait réunir, il me répondit négligemment : « Oh ! environ 150 000 francs. »
Visiblement, il ne connaissait pas âme qui vive à Londres, et jusqu’ici, il n’avait trouvé aucun capitaliste disposé à lui prêter cette somme, pas plus que toute autre, du reste.
Il m’apprit aussi, en passant, qu’on lui avait proposé un « drôle de travail » dans une société hispano-américaine de la Cité, mais garda le silence sur ce qu’était ce « drôle de travail ». J’ai cru comprendre qu’il s’était présenté là dans l’espoir de trouver de l’argent, et qu’on lui avait offert une aventure risquée et assez louche. Il avait d’ailleurs étudié la proposition et presque accepté, puis il s’était rétracté, après une discussion, et une promesse solennelle de silence avait été échangée. Tout cela paraissait très mystérieux, et je pensai un moment qu’il « romançait » pour le moins la vérité. Il me dit enfin qu’il allait repartir pour le Cap dans une semaine, mais qu’il lui restait une ou deux choses à régler auparavant.
Je lui dis spontanément que je possédais quelques économies, 3 000 francs en tout, et que je les mettais à sa disposition. À ma grande consternation, je dois l’avouer, Tatham accepta avec empressement, « Toute aide m’est précieuse », me dit-il. Le lendemain, je lui envoyai donc l’argent à l’adresse qu’il m’avait indiquée et, par retour du courrier, je recevais une reconnaissance de dette pour le même montant.
Je ne devais plus le revoir. Deux jours plus tard, je lus dans un journal du soir un article intitulé « Un vol peu banal ». Il s’agissait d’un ballon commandé à la fameuse firme Stence et Cie par le comte Castini, le fameux aéronaute. L’appareil, emballé dans une caisse, avait été volé au cours de son acheminement vers son légitime propriétaire. À la description qui était donnée d’un homme que l’on soupçonnait être l’un des voleurs, je n’eus pas de peine à reconnaître Tatham.
Une semaine plus tard, il s’embarquait, et je recevais un mot de lui, timbré de Southampton, dans lequel il me disait : « En dépit de quelques difficultés, nous rassemblons lentement l’équipement nécessaire à l’heureuse issue de notre expédition. »
Le 28 octobre 1906, quelques jours après la sensationnelle victoire d’Éclaireur dans le prix du Cesarevitch, je recevais un paquet chargé, constellé de cachets. Je l’ouvris, et trouvai un second emballage fait d’un épais papier ciré, sur lequel étaient écrits ces mots : « Le bien que tu as fait te sera rendu au centuple, Ned Tatham. » Ouvrant le papier, je trouvai 300 000 francs en billets de mille, répartis en deux paquets de 150 coupures chacun.
En décembre de l’année dernière, après que l’attention publique se fut portée sur l’île Tatham, une enquête officieuse fut effectuée, au terme de laquelle je fus condamné à douze mois de prison, selon l’article 3 du Service des Documents secrets : « Avoir reçu en dépôt, ou administré, ou eu connaissance de tout document ou information relatifs aux intérêts militaires ou navals de Sa Majesté, et avoir délibérément trahi la confiance ainsi accordée en les communiquant, contrairement aux intérêts de l’État. »
Je n’ai plus jamais eu de nouvelles de Tatham, et n’ai jamais entendu parler de M. Hackitt ni de Mlle Ève Smith.
L’argent que Tatham m’avait envoyé d’une manière si imprévue se trouve, aujourd’hui encore, à ma banque, la Cour ayant estimé que cette somme constituait le remboursement de mon prêt à Tatham, augmenté d’un intérêt dont il était seul juge, et non pas une rémunération pour l’information fournie par moi.