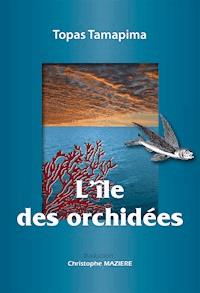
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ipagine
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
L’île des Orchidées, le nom seul fait rêver…
Est-ce ce qui a conduit un jeune médecin-écrivain, Topas Tamapima, à y vivre pendant 3 ans et huit mois (de1987 à 1991) ?
Dans ses
Souvenirs d’un médecin sur l’île des Orchidées, consignés au jour le jour, on y découvre :
- l’écume qui reste après la rencontre de deux cultures (autre ethnie, autre langage, autres traditions…) : c’est un merveilleux guide pour apprendre à écouter et soigner « l’autre »
- le poids de la médecine moderne qui veut contraindre et négliger l’esprit de la tradition
- les manoeuvres des politiques qui veulent anéantir toute liberté sous les déchets nucléaires, entre autres…
Un grand livre de tolérance et de sagesse et une histoire vraie et actuelle !
EXTRAIT
Quant à l’île des Orchidées, je n’arrivais pas à me l’imaginer, et ce bien qu’ayant longuement étudié la géographie de la République de Chine. Quand j’étais en troisième année à l’université, j’avais vu par hasard une présentation de l’île dans le journal. Je me souvenais juste qu’il y avait aussi des compatriotes montagnards d’outre-mer qui vivaient librement sur une petite île.
Quant aux raisons pour lesquelles je voulais y exercer, il fallait remonter à une singulière rencontre quatre ans plus tôt. Cette année-là, j’avais malheureusement eu un accident de la route en allant participer à une grande réunion commémorative de réhabilitation de feu Lai He ; j’avais été admis en salle de soins intensifs à l’hôpital Mackay de Taipei, car j’étais dans le coma. Lorsque j’avais peu à peu retrouvé mes esprits au neuvième jour, les premières paroles qui m’étaient parvenues aux oreilles avaient été que «
le médecin de l’île des Orchidées était mort ». En fait, le médecin et moi occupions la même salle de soins et en avions été sortis de la même façon, mais pas dans la même direction.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Topas Tamapima est un médecin-écrivain de Taïwan. Il a déjà remporté les prix Wu Zhuoliu et Lai He à la fin des années 80, soit les plus importants de toute la littérature taïwanaise, notamment pour son premier recueil intitulé
Le dernier chasseur publié en 1987.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Le plus grand plaisir dans ma vie, c’est de voir l’écume des vagues soulevée lorsque les cultures de deux ethnies différentes se rencontrent ! »
Lévi-Strauss
Préface
Un dialogueentre les monts et les mers
À la fin du 18ème siècle, alors qu’ils étaient à bord de leurs navires, des explorateurs occidentaux vinrent jusqu’à la côte est de Taiwan et aperçurent des falaises qui, à pic depuis la surface plane de la mer, s’enfonçaient directement dans le ciel et atteignaient plus de deux mille pouces de haut. Ils en restèrent aussitôt bouche bée, comme si tout s’était arrêté entre ciel et terre. Ils ne purent qu’écouter avec silence et respect le bruit des vagues qui frappaient contre le rivage. C’était la première fois que des Occidentaux entendaient le dialogue entre les monts et les mers de Formose.
En fait, ce dialogue se faisait sur l’île des Orchidées1 depuis déjà des milliers d’années. Hélas, personne ne comprenait leur langue.
On ne sait pas non plus pour quelle raison, appartenant à une « ethnie des monts », le médecin-écrivain Topas de l’ethnie des Bunun est venu exercer sur l’île des Orchidées, encerclée des quatre côtés par la mer, pour engager avec les Tao2, appartenant à « une ethnie des mers », un dialogue de trois ans et huit mois. Toutes les notes prises au cours de ce dialogue de presque quatre années, Topas les a réunies dans le livre Souvenirs d’un médecin sur l’île des Orchidées.
L’île des Orchidées, c’est là où la « réflexion des monts » de Topas a rencontré la « réflexion des mers » des Tao. Adopter le point de vue des « monts » pour aller comprendre la réflexion des « mers » n’était évidemment pas chose facile, mais Topas se fia à sa sollicitude, à sa chaleur et à son indulgence pour « l’homme » pour trouver le lien entre les « monts » et les « mers ».
Depuis qu’on a changé d’appellation le nom des « Aborigènes », nombre de Taiwanais sont tombés dans une confusion encore plus grande. Ils s’imaginaient qu’il n’existait à Taiwan qu’une seule ethnie appelée « Aborigènes ». C’était une méprise grande comme le ciel. Les « Aborigènes » de Taiwan sont en fait plus d’une seule ethnie, avec chacune une langue, une culture, une histoire et des préceptes entre lesquels les différences sont énormes. Prenons « l’ethnie des Bunun » à laquelle appartient Topas, je crains bien qu’elle ne soit encore plus distante des Tao que ne le sont les Taiwanais des Japonais !
Exercer la médecine sur l’île des Orchidées, comme le fit Topas, équivaut pratiquement à se rendre à l’étranger, en termes d’écart culturel. Les différences conceptuelles, de même que les coups de toutes sortes portés par ces divergences lui ont sans doute laissé de profondes et inoubliables impressions dans le cœur !
Dans ce livre semblable à un « essai au fil de la plume », Topas y apparait davantage comme un anthropologue culturel que comme un simple auteur, sans y perdre la finesse et l’humour d’écrivain bunun dont il est coutumier !
Prenons par exemple sa façon de traiter de l’indifférence des touristes pour la « dignité » des Tao : pour dix yuans, les touristes qui viennent de Taiwan voudraient que les vieux tao qui portent une culotte en forme de T prennent la pose pour les laisser photographier un instant d’embarras. Il se saisit à son tour d’un appareil et se rend sur la plage en quête de touristes féminines à la taille gracieuse, afin qu’elles le laissent aussi prendre une photo.
« J’en prends juste une ? C’est possible ? Je paie quel que soit le prix ! » Topas présente sa requête avec sang froid, mais il n’obtient que des reproches en retour !
« Nous ne sommes pas aussi viles. Ne compte pas sur ton argent pour acheter notre dignité. »
Pourquoi les Taiwanais n’ont-ils pas un comportement « avilissant » lorsqu’ils recourent à l’argent pour photographier les Tao en culotte ? Et pourquoi un Aborigène l’est-il lorsqu’il demande à ces deux touristes de lui accorder une photo contre de l’argent ? Topas n’en dit pas plus et use habilement de moyens de comparaison pour rendre compte de la nature des choses. Il intitule ce manuscrit Triste samedi.
Lévi-Strauss aime voir « l’écume des vagues » soulevée lorsque les cultures d’ethnies différentes se rencontrent, car nombre de choses profondes, au sens métaphorique, s’y cachent, même si elles nous entraînent souvent dans une sphère de réflexion totalement différente du passé.
Dans les notes d’un essai intitulé Une nuit après le typhon et l’averse, Topas se sert du point de vue du spectateur pour relater pareille histoire : aux environs de minuit, il est appelé pour une chèvre qui a été mordue à mort par un chien, « la blessure est examinée par l’autorité juridique compétente », afin de confirmer que la chèvre élevée par les Tao a bien été mordue par un « chien militaire » élevé par « l’armée nationale ». L’unique « médecin » à faire autorité sur l’île fait son expertise et « l’armée nationale » finit par « reconnaître sa culpabilité » en dédommageant les Tao pour leur chèvre.
Le développement qui suit est d’autant plus intéressant : les militaires s’obstinent à vouloir ramener la chèvre pour la faire cuire après les avoir indemnisés, au motif que cela revient à l’avoir achetée et que sa viande doit nécessairement leur revenir.
Mais la logique des Tao est d’un autre genre : ils considèrent que lorsqu’on heurte le véhicule de quelqu’un à Taiwan, celui-ci appartient encore à son propriétaire après que l’autre partie a payé les réparations. Emporter l’indemnité et la chèvre défunte participe du même bon sens pour les Tao.
Topas nous fait voir « l’écume des vagues » soulevée lorsque les cultures de deux groupes ethniques se rencontrent !
Dans Souvenirs d’un médecin sur l’île des Orchidées, il en va toujours de pareilles histoires qui surprennent, puis font rire aux éclats et finissent par faire sombrer dans une profonde réflexion.
Et qui donc s’imagine parvenir à une telle réflexion ? Les Tao estiment que les avions de l’île des Orchidées heurtent mortellement les petits porcs. La compagnie aérienne leur reproche vertement de « leur laisser trop de liberté ». C’est inexact et la faute incombe aux avions, pas aux porcs. Qu’on entoure donc « les avions de murs d’enceinte et ils ne fauteront plus en allant heurter les petits porcs ! »
L’île des Orchidées a toujours été considérée par les Taiwanais comme faisant naturellement partie de leur « territoire national ». Mais que savons-nous au final des Tao qui y vivent ? Et qu’en est-il de leur point de vue sur la « politique » et le « territoire national » ?
Et en quoi cela préoccupe t-il Topas ? Une histoire qui lui est arrivée peut sans doute nous éclairer davantage.
À ce qui se disait, de hauts fonctionnaires de l’unité sanitaire de la circonscription avaient voulu prendre connaissance de la « situation médicale » de l’île et avaient envoyé un écrit officiel, pour demander à Topas de leur faire un bref rapport.
Dans la salle de rapport officielle, Topas avait projeté et commenté des diapositives à ces « hauts fonctionnaires » qui étaient assis dans une pièce climatisée. Tout en leur montrant « le balbuzard à cornes3 de l’île des Orchidées », « le Papilio xuthus3 à jupe jaune et aux perles éclatantes » qui y apparaissaient, ainsi que d’autres films sur la faune et la flore, il avait expliqué avec volubilité : « Cet oiseau est un trésor national, ce papillon est un trésor national, le gouvernement les classe comme des sujets à préserver, un gros budget est alloué pour les protéger… »
Topas avait bien parlé dix minutes et pendant qu’il avait joué les commentateurs, il s’était arrangé pour que ces messieurs fonctionnaires se regardassent consternés. À la fin, un membre subalterne du service public n’avait pu s’empêcher de venir lui faire remarquer :
« Docteur, il s’agit aujourd’hui de rendre compte de la situation médicale de l’île, pas de… »
« Ah… » Topas avait fait mine de comprendre et avait lancé l’ultime diapositive.
« Cette espèce d’animaux s’appelle les Tao, ils sont la seule espèce à ne pas recevoir la protection du gouvernement. Leur sort ne vaut pas celui d’un petit porc de l’île des Orchidées ! »
À la fin du rapport, la lumière s’était allumée et Topas avait vu les visages livides de ces hauts fonctionnaires.
C’est tout Topas, et c’est bien parce qu’il a ce genre de tempérament qu’il a écrit un livre comme Souvenirs d’un médecin sur l’île des Orchidées. Pareille littérature ne fait que nous amener en bord de mer, pour nous montrer cette espèce « d’écume des vagues » qui se soulève contre les rochers et nous dire tout haut : « Regardez ! De si hautes vagues ! Un typhon va bientôt dévaster l’île des Orchidées ! »
WU Jinfa4
1 Située dans le pacifique à 83 km de la côte orientale de Taiwan, avec 45,74 km2 de superficie pour une circonférence de 38,45 km. Cette île volcanique, recouverte de forêts et de montagnes avec une profusion d’orchidées, est entourée de magnifiques formations coralliennes.
2 Tao, veut dire « homme ». Au nombre de 3 776 et présents sur l’île depuis plus de huit cents ans.Organisé au sein d’une société patriarcale, le mode de vie originel des Tao est intimement lié à l’océan : ils sont traditionnellement pêcheurs et agriculteurs. Leur animal sacré est le poisson-volant et leurs principaux objets d’artisanat sont les bateaux de bois qu’ils fabriquent et décorent.
3 Le balbuzard à cornes, qui est un rapace diurne, et le Papilio xuthus, insecte lépidoptère de la famille des papilionidés, font tous deux partie de la dizaine d’animaux classés par les autorités locales sur l’île des Orchidées.
4 WU Jinfa, né en 1954, diplômé de sociologie, est un des principaux écrivains taiwanais initiateurs de la littérature écrite des Aborigènes de Taiwan.
Premier chapitre
Je veux êtrele médecin de l’île des Orchidées
Je m’éloignai de mon pays natal dans les montagnes pour venir à Kaohsiung. Je passai presque une journée de travail à faire le trajet en voiture et maltraitai les deux gros muscles de mes fesses grassouillettes. Quand j’atteignis l’esplanade de la municipalité de Kaohsiung, la sensation douloureuse d’engourdissement de mon postérieur s’amoindrit tout doucement. J’étendis vigoureusement les gros muscles de ma poitrine, pour laisser l’ardente lumière du soleil estival de l’après-midi tomber d’aplomb sur chaque partie de mon corps. Mon humeur s’égaya du fait de m’y exposer, comme le vent du sud de Taiwan qui vagabondait librement sur la vaste esplanade dénudée. Depuis que j’avais officiellement retiré l’uniforme militaire le mois dernier, c’était la première fois que j’éprouvais le plaisir d’échapper à une entrave invisible. Le soleil s’inclina peu à peu vers l’ouest, mon cuir chevelu commençait à me démanger à force d’y être exposé. Je soulevai mon gros sac à dos militaire, et me hâtai de passer à la maison de l’art du thé pour retrouver des amis de Kaohsiung.
Dès que j’en ouvris la porte, je regardai droit devant moi et fis face au grand écrivain Wu Jinfa et à des amis journalistes. Ils occupaient déjà la plus grande table de la maison qui se trouvait juste à l’angle du mur, face au sud, un bon emplacement à l’écart des importuns, très commode pour bavarder gaiement avec de vieilles retrouvailles. Je leur fis signe en marchant dans leur direction. Celui qui était le plus proche de moi, et que j’avais l’impression d’avoir déjà croisé, me demanda si j’étais en train de déménager. Je trouvai cela quelque peu amusant. Je voulus tout de suite leur dire ma destination mais ne sus pas comment prendre la parole. Il ne me resta plus qu’à agiter la main gauche face à eux et sourire légèrement.
Les journalistes, dont la capacité d’observation était toujours plus affûtée que celle du commun des mortels, semblèrent deviner mes hésitations et m’assaillirent de questions avec curiosité. Je ne pris probablement garde qu’au lourd bagage que j’avais sur les épaules et trouvai une place vide. Je me débarrassai aussitôt de mon sac à dos et pus enfin leur dire à voix basse que je m’apprêtais à partir pour l’île des Orchidées le lendemain.
Celui qui semblait le plus jeune eut une réaction particulièrement vive, il me demanda si j’allais y faire mon service militaire comme médecin.
Je me saisis à temps du sujet qu’ils avaient pressenti et leur expliquai doucement que je voulais y aller en tant que médecin. J’avais sans doute vraiment l’air d’un médecin militaire qui se rendait sur une île, sauf que c’était sur l’île des Orchidées.
Les amis écoutèrent attentivement et lorsque je fis allusion à « l’île des Orchidées » pour la seconde fois, ils se mirent à remuer subitement et dirent en même temps un tas de paroles agitées. Ils affirmèrent que cette information méritait un reportage sur-le-champ. En fait, je compris qu’ils avaient trouvé là un matériau pour l’ébauche d’un sujet d’information, voilà tout.
Après m’être assis, je les suppliai en toute hâte de déposer leur plume acérée. On ne pouvait pas faire une information de mon intention d’aller sur l’île des Orchidées, car mes pieds étaient encore posés à Taiwan. Celle-ci m’était en réalité totalement inconnue, et même si cela pouvait susciter en moi l’idée d’en faire l’expérience, je ferais demi-tour pour rentrer à Taiwan si jamais je me rétractais en chemin ; et même si je parvenais à y prendre mes fonctions, ne deviendrais-je pas un sujet de plaisanterie si je n’étais pas à la hauteur de la charge ?
D’une même voix, ils prirent conscience de mon appréhension et n’insistèrent plus pour faire de moi un sujet d’information. Mais ils demeurèrent surpris par ma décision qu’absolument rien ne présageait et me demandèrent d’en faire un compte-rendu, afin de combler leur ambition inachevée.
Quant à l’île des Orchidées, je n’arrivais pas à me l’imaginer, et ce bien qu’ayant longuement étudié la géographie de la République de Chine. Quand j’étais en troisième année à l’université, j’avais vu par hasard une présentation de l’île dans le journal. Je me souvenais juste qu’il y avait aussi des compatriotes montagnards d’outre-mer qui vivaient librement sur une petite île.
Quant aux raisons pour lesquelles je voulais y exercer, il fallait remonter à une singulière rencontre quatre ans plus tôt. Cette année-là, j’avais malheureusement eu un accident de la route en allant participer à une grande réunion commémorative de réhabilitation de feu Lai He ; j’avais été admis en salle de soins intensifs à l’hôpital Mackay de Taipei, car j’étais dans le coma. Lorsque j’avais peu à peu retrouvé mes esprits au neuvième jour, les premières paroles qui m’étaient parvenues aux oreilles avaient été que « le médecin de l’île des Orchidées était mort ». En fait, le médecin et moi occupions la même salle de soins et en avions été sortis de la même façon, mais pas dans la même direction. Je m’étais alors rendu compte de sa situation sur l’île de la bouche même de sa famille, ce qui m’en avait donné une très nette impression – le peuple de l’île des Orchidées manquait considérablement de soins médicaux modernes.
Aussitôt après la fac de médecine, j’avais été confronté aux choix des affectations, lorsque j’avais noté les sites auxquels j’aspirais, je m’étais aperçu que les médecins évitaient délibérément l’île des Orchidées. J’avais trouvé cela très curieux. Cette île était sans doute un endroit particulier. Mais il m’avait fallu terminer mon service militaire et j’avais provisoirement remisé au fond de moi l’idée d’aller y exercer.
Pendant mon service, j’étais malheureusement tombé dans la délicate position d’être surveillé, convoqué et questionné. J’étais coincé comme un rat et en éprouvais une étouffante peur bleue. Il m’avait suffi d’escorter un soldat blessé, je m’étais porté volontaire, pour ensuite me faufiler dans la bibliothèque de l’université Tunghai aux environs de la ville. J’avais la certitude que ceux qui avaient de grands yeux pour épier n’aimaient pas les bibliothèques, je pouvais y lire sans crainte. Dans les rayons aux nombreux étages, j’avais découvert par hasard des reportages sur l’île. J’avais parcouru de la documentation sur les Tao et au fur et à mesure de ma lecture, j’avais pris goût à la mystérieuse île. J’étais convaincu qu’il y avait encore de l’air libre sur cette île du Pacifique et alors que j’avais commencé à compter les jours, mon projet de partir loin de Taiwan s’était fait de plus en plus intense. Quand la douloureuse attente de quitter l’armée avait commencé à me ronger, j’avais pris la décision de me rendre sur l’île des Orchidées au service des plus nécessiteux.
La fin de ma vie de soldat avait été comme l’achèvement d’une grande entreprise. Bien que le bienveillant général Zhou de la police militaire m’eût assuré qu’il ne me protégerait plus, mon degré d’excitation du fait de recevoir l’ordre de quitter l’armée avait dépassé celui de l’obtention de mon diplôme de médecine. Lorsque je m’étais rendu au bureau sanitaire de la circonscription faire ma demande pour être envoyé au dispensaire de l’île des Orchidées, le chef de l’unité administrative en était resté abasourdi et m’avait invité à attendre la nouvelle à la maison. Il m’avait dit à voix basse et en pointant fébrilement ma tête de son doigt, qu’une enquête d’un mois était nécessaire et que je ne pouvais y servir officiellement qu’après en avoir reçu l’autorisation. Je m’étais inquiété qu’un document rempli par les Renseignements Généraux sur ma personne pût influer sur mes vœux, et m’étais donné une limite d’une semaine, faute de quoi je n’aurais plus songé à m’y rendre.
L’île des Orchidées avait vraiment un besoin urgent de médecins. J’avais reçu l’ordre de déplacement à la date prévue et le même jour, je m’étais hâté de descendre vers le sud pour Kaohsiung. Je quittais officiellement Taiwan le lendemain pour aller prendre mes fonctions sur l’île.
Après leur avoir longuement expliqué les tenants et les aboutissants de ma démarche, un journaliste chevronné me demanda d’un ton dubitatif : « Et c’est pour y servir combien d’années ?
J’avais beau envisager d’y servir pendant dix ans, j’étais pareil à une amibe protozoaire qui n’appréciait pas d’être catégorisée. Si jamais je n’étais pas capable de tenir la promesse que je m’étais faite, je deviendrais à coup sûr matière à plaisanterie lors des apéritifs de mes amis. Je me contentai de hocher la tête, sans oser dire un mot.
Un vieil ami vit la situation et les interrompit juste à temps. Il leur dit tout haut qu’il n’y avait pas lieu de mesurer le dévouement d’autrui avec des chiffres. Perdre ou non espoir après y avoir servi faisait aussi partie des fruits que chacun pouvait en retirer, et le fait d’avoir le courage d’aller sur l’île des Orchidées méritait justement d’être salué. Il suggéra alors d’aller à un petit étal en bord de route, pour boire et fêter leurs respectueuses bénédictions à mon égard.
La dernière nuit avant de quitter l’île de Taiwan, je tombai d’ivresse chez l’enthousiaste ami de Kaohsiung.
Arriver sain et saufsur l’île des Orchidées
Après cinq à six heures à bord du véhicule, nous traversâmes la gare de Fenggang. Le bus commença à circuler sur une route de montagne qui n’arrêtait pas de serpenter, et entra comme par hasard dans une petite ville de campagne dont nous n’avions jamais entendu parler. Nous aperçûmes sur la route un individu à la peau légèrement sombre, au faciès lumineux et calme. Très accueillant, bien que nous fussions étrangers.
Sans savoir combien de temps avait duré le trajet, j’entendis soudainement que nous étions arrivés à Taitung. J’ouvris des yeux las et eus des doutes au fond de moi. Les maisons et les rues qui étaient sous mes yeux étaient-elles vraiment celles d’une grande ville ?
Je suivis les passagers qui descendaient du véhicule et aperçus au premier regard les trois gros caractères « Gare de Taitung ». Je demandai vite ma route pour trouver le bureau sanitaire avec l’espoir de pouvoir gagner, avant la tombée de la nuit, l’île des Orchidées à laquelle je songeais depuis tant d’années.
J’arrivai au bureau sanitaire. Les personnes à l’intérieur semblèrent ne pas croire que j’étais le médecin qui avait été envoyé pour travailler sur l’île. Les vêtements ordinaires avec lesquels j’étais habillé n’étaient peut-être pas assortis au rang d’un médecin ! Ce ne fut qu’après que l’administration locale leur eut communiqué ma nomination, qu’ils revinrent peu à peu sur les doutes qu’ils avaient eus un instant plus tôt.
Après m’être acquitté de cela, je sortis du bureau et suivis un panneau indicateur pour aller prendre l’avion.
Depuis que j’étais né, j’avais toujours vu des avions faire des allers-retours au-dessus de ma tête. La base où j’avais fait mon service militaire se trouvait juste à proximité de l’aérodrome de l’armée de l’air. Le bruit du décollage des avions, de leurs vols d’essai et de leur atterrissage m’était déjà familier, et j’avais souvent rêvé d’avoir la chance de monter un jour dans les airs. Mais quand l’avion fut sur le point de quitter le sol, je ressentis de la peur et ne pus plus me contenir en l’espace d’un instant. Lorsque les hommes et les choses se rapetissèrent peu à peu sous l’avion, j’eus soudain une révélation : j’avais vraiment quitté ma terre bien-aimée et de chers amis. Je m’éloignais…
Une étendue bleu foncé sous le fuselage de l’avion, une distance impossible à évaluer à vue d’œil. Les palpitations de mon cœur s’accélérèrent et le sang me monta violemment à la tête, j’eus un moment de confusion et priai en silence. Mes yeux fixèrent par intervalle l’espace qui m’angoissait.
Même pas vingt minutes après, les passagers des places avant poussèrent des cris. L’île des Orchidées était en vue !
Je me penchai pour regarder loin devant une petite île, où il était difficile d’imaginer que des humains pussent vivre : l’eau l’encerclait étroitement, comme si c’était un gros rocher sur la mer.
Elle s’agrandit peu à peu sous mes yeux. Pas une plaine sur l’île n’était aussi grandiose et vaste que le large. Je me demandais où se trouvaient les villages de ses habitants quand l’avion heurta un courant atmosphérique et chuta subitement de quelques dizaines de mètres. Mon cœur me monta à la gorge, comme pour glisser hors de ma bouche que je m’empressai de fermer.
L’avion atterrit rapidement, ses roues touchèrent le sol avec la même sensation de perte de poids que quand elles l’avaient quitté. Je ne me sentis en sécurité et n’eus l’esprit tranquille qu’après qu’il fut immobilisé et eut coupé son moteur.
J’inspirai une grande goulée d’air frais, des vagues d’excitation ne cessèrent de m’envahir. Tout comme je l’avais espéré, j’étais finalement arrivé sain et sauf sur l’île des Orchidées.
Premier lever du jour
J’ouvris les yeux et aperçus mon premier lever du jour sur l’île des Orchidées. Mon nez recouvra peu à peu ses sensations et inspira un profond bol d’air. Son odeur n’était pas moins bonne que celle de mon pays natal, elle avait juste un goût de médicaments en plus. En fait, je dormais dans l’infirmerie.
Je n’avais pas encore pris mon service ce jour-là. Il me fallait d’abord régler mon problème de logement, mais j’étais impatient de voir la situation de l’île toute entière et de rendre visite à son peuple. Je pris une motocyclette du service public et partis en suivant la direction qu’un collègue m’avait indiquée.
En moins d’une demi-journée, j’avais fait tout le tour de l’île. J’étais allé dans six tribus, et avais rencontré nombre de vieillards affables avec lesquels j’avais conversé à l’aide de gestes, de la langue nationale et de quelques phrases de japonais. La synthèse des impressions des insulaires au sujet du dispensaire pouvait se faire en trois points :
Le médecin du dispensaire n’est pas souvent là, il n’est pas du tout facile de réunir de l’argent et de prendre le bus pour s’y rendre, et on gaspille cet argent si on n’arrive pas à le voir.
Le médecin du dispensaire traite les maladies n’importe comment, il n’ouvre pas la bouche et ne se sert pas de ses yeux, il prend un crayon et donne des médicaments après avoir écrit dans le carnet de
santé. Les insulaires n’osent pas les prendre tant ils ont peur.
Les médicaments du dispensaire sont de piètre qualité, certaines personnes vont consulter de célèbres médecins à Taiwan qui n’ont jamais vu ces médicaments.
Je rapportai de nombreuses récriminations au dispensaire, et m’encourageai en mon for intérieur : je réduirai peu à peu les mauvaises impressions des patients, leur donnerai des consultations attentives et ne cesserai d’améliorer mes connaissances pour leur faire face.
Chambre commune avec le cafard
Le vieillard qui empruntait la chambre du médecin avait fini par déménager malgré lui. J’étais très content d’obtenir enfin un espace à moi. Je n’avais plus besoin de dormir sur un lit de malade saturé d’odeurs de médicaments.
J’ouvris la porte de la chambre d’où sortit un vent bizarre. Je crus d’abord que c’étaient les relents corporels qu’avait laissés le vieillard. Après être entré dans la chambre, je découvris des objets sales jonchés sur le sol, une planche dégoûtante à l’extérieur. Hormis le lit, la pièce était complètement vide. J’entrouvris une autre porte. C’était une fosse d’aisances qui n’avait pas de siège de cabinet, et dont l’odeur fétide me jaillit en plein nez. Je refermai la porte sans la moindre considération.
Une fois la porte fermée à clef, l’odeur bizarre continua à imprégner l’air.
Je m’introduisis dans la salle de bain : il y avait un grand trou dans le mur. Au savon par terre, je devinai que le vieillard avait sans doute pris une douche avant de partir. Je ressentis de la honte pour lui en regardant le trou.
Tout à coup, un cafard vola jusque sur mon pantalon. Il me fit si peur que je frappai violemment le sol du pied. Il me lança un regard fixe, fonça aussitôt jusqu’à la bordure des jambes de mon pantalon puis tourna pour remonter. Je le sentis courir à l’intérieur. Je me tapai les jambes des deux mains et finis, avec difficultés, par le faire partir.
Je retournai à côté de la porte en courant et haletai tout doucement. C’était considéré comme une chambre, ça ? hurlai-je au fond de moi. C’étaient ça, les honneurs avec lesquels la préfecture traitait le médecin d’une île lointaine ?
Dans la soirée, j’hésitai à rentrer de bonne heure dans la « chambre au cafard », et m’assis en tailleur sur le terrain vague qui se trouvait en face, à contempler la surface brillante de la mer et à songer à mon foyer à Taiwan. Ce n’était peut-être pas une demeure somptueuse, mais il n’y avait pas trace d’un cafard. Je pouvais me confier à mes amis lorsque je rencontrais des difficultés. À présent, je ne pouvais que m’abandonner à la rêverie face à la mer.
Dès lors, je m’attendis non seulement à ne pouvoir obtenir le moindre réconfort, mais aussi au fait de devoir faire chambre commune avec le cafard que j’avais le plus haï de toute ma vie.
Brusquement j’ai été tenté de partir. Mais je me souvins de l’indigence des soins que j’avais vue sur l’île au cours des deux derniers jours. Je n’avais pas encore le cœur à la quitter de cette façon.
Je priai en silence pendant un long moment, et poussai la porte de la chambre. J’entrai dans la pièce, et accrochai au mur une dent de porc des montagnes sur laquelle une sorcière bunun avait appliqué sa magie. Je l’implorai de me protéger et de m’accorder une nuit sûre.
Être un bon médecin au réveil
Une population d’un peu moins de dix personnes était venue consulter au dispensaire dans la matinée. Je profitai d’un moment libre où aucun patient ne vînt, pour transporter la peinture du dépôt dans ma chambre. Je commençai à peindre sur les vieux murs en oubliant de me débarrasser de mes vêtements. On m’avait obligé à jouer les peintres en bâtiment pendant mon service militaire. Mon habileté à peindre les murs était forcément passable, je ne perdis donc pas beaucoup de temps à peindre la pièce, soit à peine celui d’examiner une dizaine de grippés. Les quatre murs de la chambre étaient flambant neufs, de différentes nuances de rose, à la fois douces et ensorcelantes.
À midi, l’air fut si chaud que je n’avais pas envie de manger. Je continuai à travailler.
Je fus occupé une après-midi à poser de la tapisserie aux murs, à coller du parquet en plastique sur un sol noir de crasse. L’odeur bizarre qui était à l’intérieur se dissipa progressivement. C’était enfin devenu une chambre habitable.
Je fus épuisé dans la soirée. Je me mis au lit plus tôt que prévu et avant de fermer les paupières, je ne pus m’empêcher de sourire intérieurement. J’avais découvert quelque chose de nouveau ce jour-là : je pouvais être peintre en bâtiment, cimentier, mais aussi préparateur en revêtement et poseur de parquet.
Avant de m’endormir, je priai pour être un bon médecin le lendemain au réveil.
Jour saint
Quand le ciel, la terre et tous les êtres furent achevés, Dieu cessa son travail de création au septième jour et décida d’en faire un jour saint.
J’étais venu jusque sur cette terre inconnue qu’était l’île des Orchidées. Je m’étais fatigué quelques jours et avais bien aménagé logement et travail. Mais j’étais angoissé et dénué de ressources comme un enfant de sept jours.
Ce jour-là, je fis une visite jusque dans la tribu Yayo et en chemin, je traversai une petite église qui était construite d’innombrables petites pierres. Des chants sacrés qui m’étaient familiers se diffusèrent de l’intérieur et attirèrent mes pas.
Un missionnaire aux pieds nus qui portait une chasuble noir foncé vint m’accueillir à l’entrée. Je trouvai rapidement une place pour m’asseoir. L’assistance fit de gros yeux et accompagna le déplacement de mes pas. Je baissai la tête et fermai les yeux pour prier en toute quiétude.
Je relevai la tête peu de temps après. Un frère tao qui était à côté de moi me passa un livre de cantiques. Je l’acceptai des deux mains et le remerciai à voix basse pour son geste amical.
Le missionnaire et l’assistance ne furent absolument pas affectés par ma présence, et la messe se déroula dans l’ordre.
À la fin du prêche, un vieillard se mit soudain à chanter en solo et l’assistance lui répondit en chœur. Je fis l’effort de trouver la mesure, qui était à la fois belle et émouvante. Mon cœur enthousiaste ne se rasséréna que bien après que le chant fut terminé. Un vieillard qui était aux places de devant se tourna et me dit avec satisfaction : « C’était un chant originel des Tao. »
Le missionnaire exposa en tao le sujet du jour. Je ne compris pas un mot du début à la fin, mais pus me faire une idée de tout ce qu’il avait dit. Tout cela me réconfortait, toutes les difficultés et les injustices que j’avais subies depuis sept jours se dissolvaient totalement dans l’atmosphère de l’église. J’avais un soutien dans mon cœur.
Je survolai librement l’édition en langue nationale de la Bible, et en récitai un passage à voix basse : « Vous devez agir, pas simplement écouter et vous mentir à vous-mêmes. »
Je me sentis plus affirmé après avoir lu ce passage, et m’écriai avec satisfaction au fond de moi : « Je ne me suis pas menti à moi-même, je l’ai fait ! »
La messe terminée, je repris vite mon humeur d’origine pour aller soigner les malades.
Ne surtout pas laisserles causes de sa maladie se déroberà mes oreilles et à ma vue
Quelles maladies contagieuses y avait-il sur l’île ? Et pourquoi le nombre de malades se multipliait-il avec la montée de la température ? En plus, la majorité était de petits enfants.
Je m’assis sur le confortable siège de consultation, et écoutai tranquillement les parents du malade m’informer de son état. Ils firent tout leur possible pour aggraver ses symptômes, et espérèrent vivement que je pusse me concentrer pour l’ausculter. Je ne pouvais surtout pas laisser les causes de sa maladie se dérober à mes oreilles et à ma vue. Je l’examinai prudemment des pieds à la tête, mais tombai sur quelque chose d’étrange ce jour-là. Hormis le fait d’avoir environ trente-huit degrés de fièvre, le petit patient n’avait nul autre symptôme.
Je me triturai la cervelle à réfléchir aux causes de sa fièvre. Quelle maladie bizarre était-ce à la fin ? Une épidémie circulait-elle ? À moins que ce ne fût une maladie contagieuse de la région ?
La lumière se fit peu après dans mon esprit. Son corps était sans doute incapable de réguler sa température interne, on appelait cette maladie la fièvre d’été infantile, et ses symptômes disparaissaient dès lors qu’on plaçait le malade sans discontinuer dans un environnement frais et aéré.
L’île des Orchidées était d’une température et d’un degré d’humidité élevés. Non seulement les réfrigérateurs y étaient rares, mais il était encore moins question d’y installer des climatiseurs. Les enfants contractaient inéluctablement cette maladie.
Je m’assis sur le siège de consultation et ressentis peu à peu l’étouffante chaleur. Tout comme moi, les malades semblaient ne pouvoir supporter le climat chaud et humide.
Naïvement, je songeais que cela serait bien mieux si on installait un climatiseur en salle de consultation ! Ces petits malades resteraient alors pour se reposer, il n’y aurait pas lieu de dépenser d’argent pour les médicaments et les piqûres. Leur état s’améliorerait à coup sûr.
L’après-midi, je pris le temps d’appeler les fonctionnaires de la préfecture pour leur faire part des difficultés médicales que connaissait l’île. J’en suppliai le supérieur d’y affecter un climatiseur qui ferait du bien au peuple. Le haut fonctionnaire prétexta que le dispensaire était de la compétence du bureau sanitaire et ne s’en chargea donc pas.
Avis fut alors demandé au bureau sanitaire qui, de la même façon, n’y prêta pas attention du fait qu’il n’y avait pas de budget.
Je m’aperçus subitement qu’il n’était nullement dans les intentions des fonctionnaires de l’État de veiller sur le peuple d’une île lointaine. C’était juste du boniment de politiques, voilà tout.
Il savait rienqu’en regardant mes pieds
J’entrai dans le dispensaire, et aperçus une dizaine de personnes assises sur les chaises de la salle d’attente. Je les saluai cordialement ; certaines sourirent à pleines dents, tandis que d’autres me rendirent la politesse avec nervosité. Je marchai tout en jetant un œil sur l’horloge qui était accrochée au mur. Il était huit heures vingt.
Je m’arrêtai devant la salle d’inscription pendant un instant. J’approchai mon oreille gauche de sa petite fenêtre, et tournai les yeux face aux patients qui y attendaient. Je ne perçus pas le moindre bruit de respiration à l’intérieur. Gêné, je baissai subitement les yeux pour fuir leur regard, et tournai rapidement pour entrer dans la salle afin de les inscrire.
À huit heures trente-cinq, les infirmières déboulèrent l’une après l’autre pour prendre leur service. Je donnai les consultations délibérément sans dire un mot. Les malades entrèrent chacun leur tour, puis prirent leur ordonnance pour recevoir des médicaments.
« Monsieur Shi ? »
J’appelai à plusieurs reprises et de plus en plus fort, mais ne vis plus l’ombre de quiconque. Je me levai avec curiosité et me penchai pour regarder. Un vieillard qui baissait la tête était assis sur une chaise de la salle d’attente. Il était le dernier à attendre d’être reçu. Je demandai alors à un collègue d’ethnie tao de m’aider à traduire pour l’inviter à entrer, ce qu’il fit en faisant des pas en forme de O.
Il marcha en criant d’une voie aigüe, sa figure se serra et prit un aspect colérique. La fois dernière, j’avais mal exprimé mes sentiments car j’avais présumé à tort de la mine d’un Yami. Je n’eus donc pas l’audace d’affirmer que le vieillard était en colère.
« Il ne se sent pas bien ? » demandai-je au collègue qui traduisait.
« Il me demande si vous êtes bien le médecin envoyé par le gouvernement. Il demande aussi pourquoi vous êtes si lent à le soigner, et si vous être capable de le faire. » Je ne sus pas comment lui répondre. Avais-je tort de l’examiner avec attention ? Je venais à peine de trouver l’origine de la maladie d’un patient grâce à ma méticulosité, et m’en étais justement senti très fier !
« Euh… Manidasuyingying ? » l’interrogeai-je avec la langue tao que je venais d’apprendre pour faire les diagnostics.
« Ah ! Tu sais parler tao, j’ai mal ici. » Il me montra son genou avec les mains.
« Vous avez fait une chute ou bien vous vous êtes déjà cogné ? » Je tendis la main pour sentir l’articulation de son genou droit.
« L’ordonnance que le médecin a faite dans le passé vous a-t-elle aidé contre la douleur ? »
« Pourquoi t’es si bavard ? Le médecin d’avant savait rien qu’en regardant mes pieds. » Le collègue tao traduisit les paroles du vieillard en langue nationale.
Une fois l’ordonnance délivrée et juste avant de partir, le malade n’exprima pas un air très joyeux.
Le collègue qui m’avait aidé à traduire s’avança pour me réconforter : « Tu ne le croiras peut-être pas, mais certains médecins sont envoyés malgré eux par le gouvernement et parfois, on ne les voit pas de tout le mois. Ils ne comprennent pas la langue tao, mais leurs mains ne tremblent pas lorsqu’ils rédigent une ordonnance. Une fois, la demoiselle de la pharmacie a couru au dortoir en pleurant parce qu’elle n’avait pas osé donner de médicaments à un malade. »





























