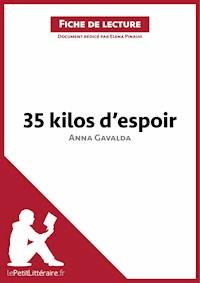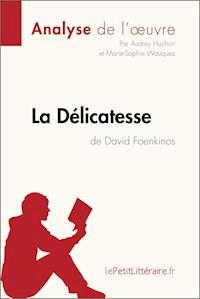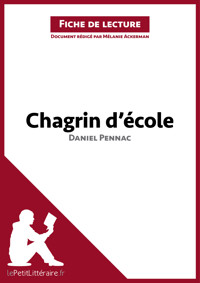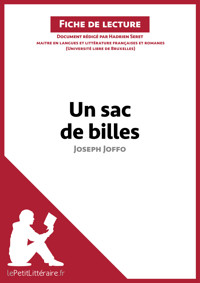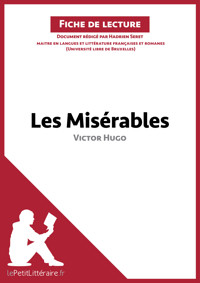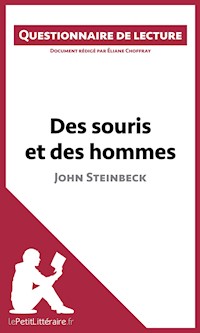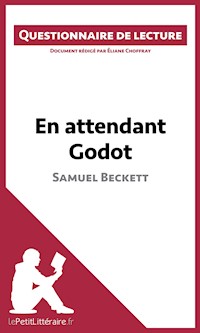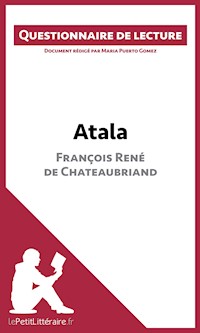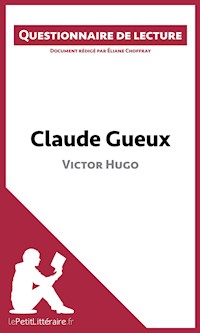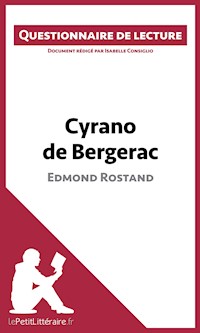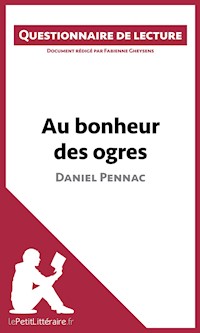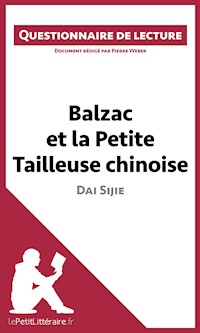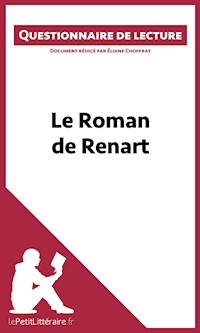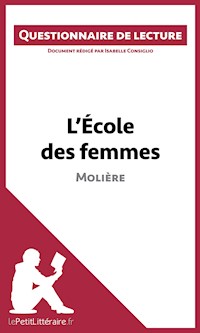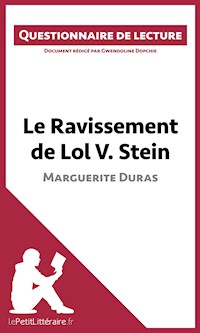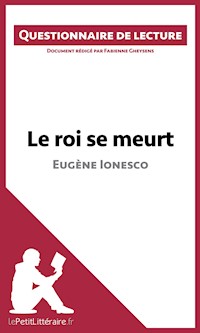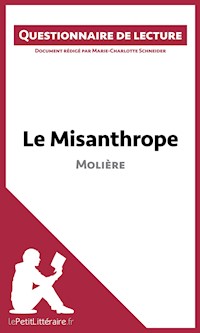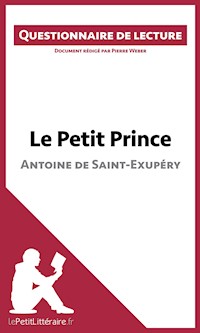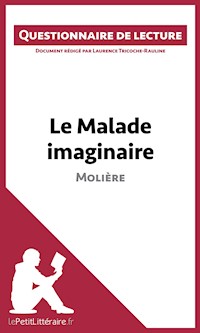9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: lePetitLitteraire.fr
- Kategorie: Bildung
- Serie: Fiche de lecture
- Sprache: Französisch
Décryptez L'Illusion comique de Pierre Corneille avec l'analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir de
L'Illusion comique, la pièce incontournable qui montre que Corneille maitrise tous les genres théâtraux ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une analyse complète et détaillée.
Vous trouverez notamment dans cette fiche :
• Un résumé complet
• Une présentation des personnages principaux tels que Alcandre, Pridamant, Clindor, Isabelle et Matamore
• Une analyse des spécificités de l'œuvre : un contexte historique et artistique riche et mouvementé, entre dramaturgie classique et esthétique baroque, le théâtre dans le théâtre, une apologie du théâtre et le comique et l'illusion
Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l'œuvre.
LE MOT DE L’ÉDITEUR :
« Dans cette nouvelle édition de notre analyse de
L'Illusion comique (2017), avec Marie-Charlotte Schneider et Tina Van Roeyen, nous fournissons des pistes pour décoder cette comédie qui entremêle avec brio la dramaturgie classique et le procédé baroque. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l'œuvre et d'aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN
À propos de la collection LePetitLitteraire.fr :
Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d'analyse d'œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation. Plus d'informations sur lepetitlitteraire.fr
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 31
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Pierre Corneille
Dramaturge français
Né en 1606 à Rouen (Seine-Maritime)Décédé en 1684 à ParisQuelques-unes de ses œuvres :Le Cid (1637), tragicomédieHorace (1640), tragédieCinna (1642), tragédiePierre Corneille est, avec Molière (1622-1673) et Racine (1639-1699), l’un des trois grands auteurs de théâtre du XVIIe siècle en France. Issu d’une famille aisée, diplômé en droit, avocat du roi, maitre des Eaux et Forêts, Corneille se jette corps et âme dans l’aventure dramatique. Il est repéré par le cardinal de Richelieu (prélat et homme d’État français, créateur de l’Académie française, 1585-1642) et pensionné à 29 ans par ce dernier (c’est-à-dire qu’il reçoit périodiquement une rente de sa part). Il peut ainsi se consacrer à l’écriture, mettant en scène « des héros tourmentés par le doute, faillibles, chez qui la passion vient buter contre l’ordre établi » (DE BOECK D., Programme – Cahier pédagogique 30, Bruxelles, Théâtre National, 1996, p. 2).
Son œuvre est abondante et variée, puisque Corneille s’est illustré tant dans la comédie que dans la tragédie. Auteur baroque (L’Illusion comique, 1636), Corneille donne aussi au classicisme français quelques-unes de ses plus grandes œuvres (Horace, Cinna,ou Polyeucte en 1643). Sa pièce la plus connue reste néanmoins Le Cid, une œuvre qui suscite en son temps une grande controverse, en raison des libertés prises par l’auteur avec les règles strictes de la tragédie classique.
L’Illusion comique
Une comédie protéiforme
Genre : pièce de théâtreÉdition de référence : L’Illusion comique, Paris, Librairie Larousse, 1937, 95 p.1re édition : 1636Thématiques : magie, amour, rivalité, vengeance, réconciliation, apologie du théâtreL’Illusion comique est une comédie en cinq actes et en vers, représentée pour la première fois en 1636. Dans cette pièce, le magicien Alcandre permet à Pridamant de voir la vie de son fils Clindor, qui l’a quitté dix ans plus tôt. Il le découvre alors valet de Matamore ; il est témoin de ses complexes relations amoureuses et assiste à sa mort lors d’un duel. Mais bientôt, le rideau se lève et révèle que Clindor est en réalité bien vivant : devenu comédien, il jouait ici son propre rôle dans une tragédie.
Cette pièce constitue un cas particulier dans l’œuvre de Corneille, dans la mesure où il s’agit d’une comédie protéiforme qui mélange les genres et les tons. De plus, la composition de la pièce est régie par le procédé baroque du théâtre dans le théâtre, alors que Corneille est le grand précurseur du classicisme, mouvement contemporain dominant la première moitié du XVIIe siècle. On distingue ainsi plusieurs niveaux qui s’entremêlent : celui de Pridamant et Alcandre observant la vie présente de Clindor, celui de la vie passée de Clindor et celui de la tragédie jouée par des comédiens (Clindor lui-même et Isabelle). Il n’est donc pas étonnant que, dans son examen de la pièce, l’auteur la qualifie lui-même de « galanterie extravagante » (p. 85), reniant par là même son importance.
Résumé
Il existe deux versions de L’Illusion comique : l’originale publiée en 1636, et une deuxième, remaniée par Corneille en 1660. Le résumé ci-dessous est celui de la version de 1660, dans laquelle Corneille avait supprimé la scène IV de l’acte V et le personnage de Rosine, tronquant la pièce d’une péripétie. L’acte V de la version initiale comprenait donc six scènes au lieu de cinq dans la version de 1660.