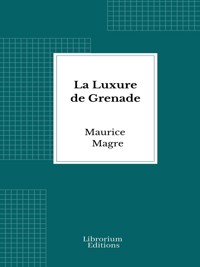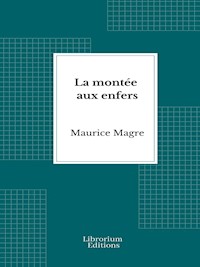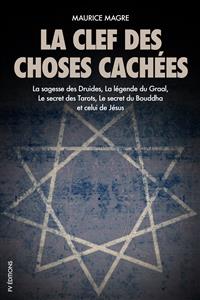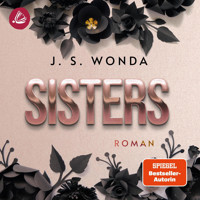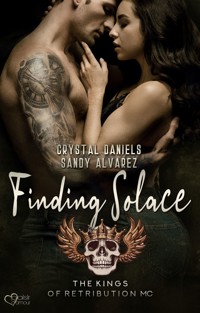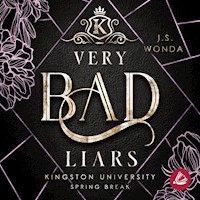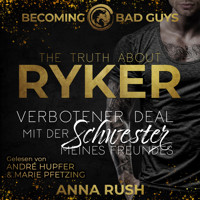Épigraphe
Ne pousse pas la grille en fer de ce domaine
Où sont morts le jet d’eau, le lavoir et la cloche.
Vois, l’herbe a recouvert le sentier qui t’y mène
Et nul chien sur le seuil n’aboie à ton approche.
On nomme ce logis la maison des tristesses…
Jamais les contrevents ne battent les murailles.
Nulle lampe aux carreaux n’allume sa caresse
Et le perron est obstrué par les broussailles.
Ne te penche qu’un peu pour regarder et passe…
Le colombier muet n’a plus de tourterelles.
Mille oiseaux autrefois volaient sur la terrasse
Et des roses croissaient ici, mais où sont-elles ?…
Le maître de l’endroit est un homme bizarre.
Il eut jadis un grand chagrin. De quelle sorte,
Nul ne le sait… Il est de paroles avare…
Le vent dans les sapins chante sa douleur morte.
Il aimait tant bêcher un peu, soigner les roses,
Arracher l’herbe folle aux coins des avenues :
Mais les petits bonheurs de ces petites choses
Sont partis pour jamais quand la peine est venue.
Si tu le vois avec une étrange démarche,
Des habits mal soignés, dire des mots sans suite,
Ou compter au hasard les arbres ou les marches,
Ne lui fais pas de signe, éloigne-toi très vite.
Car ses vieux compagnons, le tilleul et le hêtre,
À ce pauvre homme-là savent ce qu’il faut dire.
Tout d’un coup à ta vue il pleurerait peut-être…
Ce serait plus affreux s’il se mettait à rire…
– Ô lecteur, c’est ici la maison des tristesses.
Voici le beau parc mort où l’oubli fait sa trame.
Le maître du logis y passe… Le jour baisse…
Voici le puits sans roue et l’ortie et mon âme…
Une visite
Nous étions arrivés dans ma ville natale.
Près du chemin de fer finit le cimetière.
C’était le dernier soir des dernières cigales…
Elle voulut aller au tombeau de ma mère.
Les trains avaient noirci les cyprès de fumée
Et nous montions, parmi les marchands de couronnes,
Une mélancolique et longue et blanche allée…
Et tout était désert, sur tout planait l’automne…
Elle avait un bouquet d’œillets à son corsage.
Ses yeux étaient plus bleus dans l’oblique lumière.
Elle passait avec son manteau de voyage
Dans le marbre et le fer des fastes mortuaires.
La tombe se cachait sous d’anciens chrysanthèmes.
Nous ne priâmes pas, n’ayant pas de croyance…
J’ai dit du fond du cœur : « Voilà celle que j’aime ! »
Elle a mis son bouquet sur la pierre, en silence…
Et nous sommes partis, timides, tout de suite…
Le soir versait aux morts son ombre accoutumée…
Alors ma mère a dit : « Douce est cette visite !
Enfant, comme j’aurais aimé ta bien-aimée… »
Ces mots ont-ils atteint son âme trop humaine ?
Elle ne pressa pas ma main dans la pénombre…
Pour la première fois je la sentis lointaine,
L’ombre de ces cyprès fut notre première ombre…
La lettre
Je l’ai vue, à quoi bon la froisser, cette lettre ?
Pourquoi la caches-tu ?… Je ne la prendrai pas.
Pourquoi te demander si j’en souffre peut-être ?
Elle devait venir, je l’attendais, lis-la.
Lis-la, tu me fais mal, mais lis-la. Je t’envie.
Je vois les mots affreux sur le papier flamber,
Doux comme des aveux, et chauds comme la vie…
Savoure ce bonheur que tu m’as dérobé.
Car jamais plus mon cœur ne connaîtra l’attente
De l’enveloppe bleue où je lisais mon nom
Tracé dans une grande écriture charmante,
De la lettre qu’on ouvre avec un grand frisson.
Et pourtant si j’allais l’arracher tout de même !
Si je cédais soudain à mon brusque désir !
Si je voulais savoir la façon dont il t’aime,
La crudité des mots évoquant vos plaisirs ?
Mais tu vois ton bonheur en danger, tu te dresses.
Te voilà prête à le défendre jusqu’au bout.
Le passé n’est plus rien, tu n’es plus ma maîtresse,
Comme deux ennemis nous sommes là, debout.
Va, cette lettre-là, je la connais de reste.
Dans ton mauvais regard, je la lis à loisir.
Toi que j’aimais si fort, comme tu me détestes !
Pour ce papier froissé tu me ferais mourir…
On s’éveille en sursaut…
On s’éveille en sursaut avec le cœur qui bat.
On sait bien qu’un malheur vous est venu la veille.
Mais lequel ? On le cherche, on ne se souvient pas…
À quelque oiseau traqué l’âme est alors pareille.
Cela dure quelques secondes… Brusquement
Le souvenir s’abat, net, clair, impitoyable,
Ah ! comme il fait du mal ! il va falloir pourtant
Vivre avec lui cette journée inexorable.
Il va falloir, pourtant, se lever, s’habiller,
Sortir, dire des mots qui parlent d’autre chose.
Comme elle fait souffrir l’ombre des chambres closes,
Quand avec sa douleur on vient de s’éveiller !…
On demeure, les yeux sur un point dans l’espace.
Déjà le matin jaune a coulé sur les draps…
Un clairon sonne au loin… Une voiture passe…
On voudrait bien se rendormir… on ne peut pas…
Elle pleurait si fort…
Elle pleurait si fort ce soir-là dans la chambre
Que je poussai la porte afin de l’apaiser.
Elle était dans un coin, tremblant de tous ses membres,
Et si petite ! ainsi qu’un pauvre objet brisé.
Et je lui dis : « Tais-toi ! J’oublierai tout, peut-être.
Je t’apporte un pardon qui vient du fond du cœur. »
Et la nuit solennelle entrait par la fenêtre,
L’orgueil de ma bonté remplaçait ma douleur…
Et je disais encor, tant j’avais pitié d’elle :
« Va nous retrouverons tous les bonheurs d’avant… »
Et ces mots en effet séchèrent ses prunelles,
Elle me regarda, hostile, fixement…
Et je lus dans ses yeux sa terrible pensée…
Ce qu’elle désirait surtout, c’était partir,
Elle voulait rejoindre l’autre, être chassée,
La douceur du pardon allait la retenir.
Elle aurait préféré l’injure et le reproche
À ce pardon que j’apportais comme un trésor.
Elle l’avait senti sur la porte, tout proche,
Et c’était pour cela qu’elle pleurait si fort.
Tous les trois
Elle disait : « Mais non, c’est à cause de toi
Que je suis triste. Va, ce chagrin est le nôtre.
Tu tiens mon cœur léger, méchant, entre tes doigts… »
– Mais moi je savais bien qu’il battait pour un autre.
Car je le devinais à son baiser plus froid,
Au poignet frémissant, au goût de solitude,
À des arrière-goûts de sanglots dans sa voix,
Au regard fixe et doux que fait l’inquiétude.
Je souffrais de la voir plus pâle chaque jour
Et même dans mes bras étrangère et lointaine.
J’aurais voulu la réchauffer de mon amour…
J’avais plus de pitié que je n’avais de peine.
Oh ! non, je ne veux pas que pleurent les chers yeux,
Je ne veux pas qu’il soit meurtri, le beau visage…
Du cœur où j’ai dormi dans l’ombre des cheveux
J’écarterai le vol des soucis en voyage.
Ce que tu ne dis pas, moi je le lui dirai :
« Elle est aimante, elle est sensible, elle est nerveuse…
Son cœur est un trésor que vous découvrirez…
Il faut que vous l’aimiez pour qu’elle soit heureuse. »
Et je te conduirai ton bonheur par la main…
Je trouverai plus doux les parfums de ta chambre,
Plus intime le soir, plus profonds les coussins,
Assis tous trois muets près du feu de décembre…
Mon pas dans l’escalier sera sonore et lourd…
Comme je serai seul sur le boulevard vide !
Je me retournerai comme le premier jour :
Que ta fenêtre alors m’apparaîtra splendide !
Si mon cœur s’est brisé, tu ne le sauras pas.
Je serai sur la liste où sont ceux que l’on aime.
Et quand vous parlerez de moi tu lui diras :
« Ce n’était qu’un ami, qu’un vieil ami, pas même ! »
Le baiser d’adieu
Elle devait partir pour toujours, à l’aurore
Et pour me dire adieu m’éveiller d’un baiser.
Ah ! ce dernier baiser serait plus doux encore
Que tous les vieux baisers sur nos lèvres posés.
Nous l’avions convenu, c’était irrévocable.
Nous devions nous quitter sans pleurs, sans désespoir,
En grands amis loyaux et de haine incapables,
Comme si nous devions nous retrouver le soir.
Aussi, lorsque trembla près de nous la veilleuse,
Tandis qu’elle dormait déjà, je m’accoudai
Pour voir le sein parfait, l’épaule merveilleuse
Mettre un luxe charnel parmi les draps brodés…
Et j’écoutais, auprès de sa forme drapée
À peine, que le bleu de l’électricité
Faisait plus longue, ainsi qu’une lame d’épée,
Le poème du lit et de la nudité…
Je me disais : Demain, parmi les demi-teintes
De l’aube, elle sera petite entre mes bras.
Je mettrai tant d’amour dans ma dernière étreinte
Que même en la quittant je ne la perdrai pas.
« Et qui sait ? La chaleur de mon baiser, peut-être,
Aura tant de pouvoir qu’elle demeurera…
L’aube derrière les rideaux pourra paraître,
Nous garderons la nuit contre nous sous les draps. »
Je me suis éveillé tout seul dans le jour pâle.
Légère, elle avait fui pendant que je dormais.
L’oreiller, tiède encore, dessinait son ovale.
Le parfum de son corps dans la chambre embaumait.
Or, son baiser d’adieu flottait sur mon visage
En partant elle l’avait mis à mon insu,
Triste comme l’adieu, long comme le voyage
Et ce fut le meilleur que j’ai jamais reçu.
Le départ oublié
Nous pleurions contre la valise… Ah ! quelle peine !
Je m’en souviens… La gare était dans un faubourg…
Pourtant nous nous quittions pour quelques jours à peine.
Nous n’avons pas pleuré quand ce fut pour toujours.
La voiture nous secouait et des lumières
Éclairaient par instants ton visage mouillé.
Cette nuit de départ nous semblait la dernière…
Je portais ta voilette et ton manteau rayé…
Nous nous dîmes adieu dans la cour de la gare.
Trop triste est le quai noir où le train va partir.
Ta voix prit un accent enfantin et bizarre…
Il pleuvait… Tu cherchais ton petit sac de cuir…
Cette grande douleur avait un certain charme :
« Écris-moi tous les jours… Pense à moi… Prends bien soin
Du chien… » Et le cocher riait et dans tes larmes
Tu m’as souri… Mon dieu que tout cela est loin…
La réunion
Ils étaient tous venus ainsi qu’à l’ordinaire
Et sous la lampe bleue et dans le bruit du thé
Ils causaient avec moi des choses coutumières…
Mais je n’avais pas dit qu’elle m’avait quitté…
Mon salon conservait l’odeur de sa jeunesse
Et tous à chaque instant croyaient la voir venir.
Je savourais tout seul cette espèce d’ivresse
Qui font des amitiés avec les souvenirs.
Lorsque quelqu’un sonnait je m’écriais : « C’est elle ! »
Sachant que jamais plus elle ne sonnerait…
Le cœur de mes amis lui demeurait fidèle
Et pour elle un concert de louanges montait.
Ah ! pourquoi le cacher ! Je voulais bien leur dire,
Mais pas encor ! Il me semblait qu’en le disant
Je perdais un peu plus ses yeux et son sourire,
Que l’on me retirait les doux et chers présents…
Elle ne peut tarder, c’est son heure, disais-je…
Mais ma voix tout à coup sonna si faussement
Qu’un silence pesant et qu’aucun mot n’allège
Tomba comme une pluie amère tristement.
Alors un des amis, plus subtil ou plus tendre,
Devinant tout au battement de mon regard,
Dit : « Je l’ai rencontrée, il ne faut pas l’attendre,
Elle est très occupée et doit venir très tard… »
– Ô toi qui m’as sauvé de la pitié banale
Que je craignais autant que mon propre souci,
Cette simple parole aucune ne l’égale !
Elle viendra très tard, en effet… Va, merci…
Sur la porte
Lorsque le beau visage eut souri de la sorte
Offrant toute sa joie à cet homme étranger
J’étais déjà très loin bien qu’encor sur la porte,
J’allais partir avec un cœur presque léger.
Et voilà qu’il suffit d’une seule seconde
Pour faire s’envoler tous mes renoncements.
J’avais vu se pencher trop près la tête blonde
Et j’avais respiré mon malheur trop longtemps.
Je n’acceptais plus rien, je voulais la reprendre ;
Je retirais les mots anciens qui pardonnaient.
Je l’avais si longtemps, d’une façon si tendre,
Dorlotée et chérie ! elle m’appartenait !
Ce que j’avais souffert j’allais enfin le dire.
Ils sauraient que j’étais malheureux, isolé
Et que c’était ma beauté propre, ce sourire,
Que c’étaient mes bonheurs que l’on m’avait volés.
Le désespoir qui m’agitait fut-il sensible ?
Je vis ses yeux sans amitié fixés sur moi…
On chuchotait un peu, j’ai salué, je crois,
Et je m’en suis allé pourtant, est-ce possible ?…
Les deux Pierrots
Ils ne comprendront pas pourquoi j’ai voulu mettre
Ce chapeau, ce pourpoint et ce manteau croisé
Puisqu’à ce bal, ce soir, elle aussi devait être…
C’est bien moins douloureux lorsqu’on est déguisé…
Ils m’ont dit : « C’est se faire à plaisir de la peine… »
Mais je vais doucement dans les rires, les bruits.
Je sais qu’elle est tout près, vraiment, je souffre à peine…
Comment aurais-je mieux passé la longue nuit ?
Une espagnole danse avec un tambour basque…
Un clown ivre poursuit une chauve-souris…
Ah ! qui dira jamais la tristesse des masques ?…
Ô souvenirs ! dominos bleus, dominos gris !…
Elle m’a rencontré, mais me reconnaît-elle ?
Elle a pressé plus fort le bras qu’elle tenait.
Aucune flamme n’a passé dans ses prunelles…
C’est que ce manteau-là me transforme en effet.
Il vaut mieux, tout va bien ainsi…
L’orchestre lutte
Avec le petit jour qui se traîne là-bas.
Et je ne pense à rien jusqu’à cette minute
Où les deux pierrots noirs me prennent par le bras.
Et voilà qu’ils m’ont dit maintes choses sur elle
Venant du fond mauvais de l’âme, qu’ils m’ont dit
Sur ses amours, sur ses secrets, des choses telles
Qu’en courant j’ai quitté ce bal trois fois maudit.
J’ai fui dans un matin gris comme un crépuscule…
Des cochers qui passaient à travers le brouillard
Se montraient en riant mon ombre ridicule…
Je crois bien m’être assis sur un banc, quelque part…
J’étais comme égaré dans un pays de cendres…
Ah ! ce n’était donc rien que de ne plus l’avoir !
Comment n’y pas penser, comment ne pas entendre
Ce qui fut dit tout bas par les deux pierrots noirs ?…
Mon père et elle
Elle avait su gagner l’amitié de mon père
Sans le connaître ou lui parler, rien qu’en passant
Et c’était comme une parenté de lumière
Entre ses cheveux blonds et les doux cheveux blancs.
Certes, presque jamais il ne me parlait d’elle,
Mais quelquefois il me disait : « Comment va-t-on ? »
Je sentais qu’il voulait que je lui sois fidèle
Et qu’il m’encourageait à l’aimer pour de bon.
Et quand il souriait avec son bon sourire
Je voyais la charmante image dans ses yeux
Et j’avais alors bien du mal à ne pas dire
Combien nous nous aimions et que j’étais heureux.
Le silence est meilleur si la peine est cruelle…
Quand mon père à présent dira : Comment va-t-on ?
Je répondrai : Très bien ! Ce soir, nous nous voyons…
En me disant tout bas : Mon Dieu ! Comment va-t-elle ?…
La meilleure part
C’était par un jour clair d’odeurs, de couples joints,
De feuillages et de premières robes claires…
Le soleil déclinait… Paris chantait au loin…
Une poussière d’or s’élevait de la terre.
C’était par un jour chaud, lumineux, printanier.
Je marchais seul, me souvenant de leurs paroles :
« Soyez heureux ! La solitude et l’amitié
Sont la meilleure part, que cela vous console ! »
Sans doute ils ont raison, mais que ce soir est lourd !
Qu’il mêle étrangement la chair et la nature !
Chaque ombrelle en passant agitait de l’amour…
Je sentis près de moi glisser une voiture…
C’était eux ! ah ! la paix profonde de leurs yeux !
Ils ne s’étreignaient pas mais c’était plus terrible
De les voir côte à côte ainsi silencieux
Regarder longuement le ciel irrésistible.
Or, ils m’apparaissaient plus jeunes et plus beaux,
Ils étaient une élite entre les créatures,
Ils s’en allaient vers du soleil… Ils m’aperçurent
Et machinalement j’ai levé mon chapeau.
J’étais un promeneur bien seul, bien misérable.
Penchés tous deux à la portière, ils me faisaient
Des signes d’amitié trop nombreux, trop aimables…
Mais la voiture au loin s’en allait, s’en allait…
Puis le soleil couchant jeta toutes ses flammes.
J’entendis vaguement quelqu’un dire : il est tard !
Je mis mon pardessus… Le vent me glaçait l’âme…
Allons, décidément, c’est la meilleure part…
Le chien noir
Le chien noir qu’elle aimait s’est perdu dans Paris.
Furtif, il s’est glissé par une porte ouverte.
Ce n’était qu’un ingrat ; il erre sans abri.
Il fait nuit, il fait froid et la rue est déserte…
Il était tout le jour bercé, soigné, choyé,
Dans le berceau des mains, la chaleur d’une robe.
Il ne se lassait pas cependant d’aboyer
Vers le bel au-delà que les portes dérobent.
Sa place était marquée en le creux des coussins.
La voix qui commandait était toujours câline.
Il pouvait endormir son plus petit chagrin
Sur la plus pure et la plus blanche des poitrines…
J’étais jaloux de ce rival toujours heureux
Et m’enorgueillissais pourtant de ses caresses.
Un peu d’elle flottait sur son corps ténébreux,
Je retrouvais sur lui le parfum de ses tresses.
Je lui disais : « Ses yeux sont moins doux aujourd’hui.
T’a-t-elle dit pourquoi elle fut si méchante !… »
J’avais son souvenir plus vivant près de lui.
Je la regrettais mieux lorsqu’elle était absente.
Il est parti, l’ami gai, léger, puéril,
Qu’émerveillait le vol d’un insecte qui passe,
Dont la laideur avait une charmante grâce,
Pour qui tout petit bruit était un grand péril.
Où donc est-il, lui l’ignorant, lui le timide ?
Comme il doit se blottir sous les portails obscurs !
Comme il doit avoir peur de l’ombre, des grands murs
Et de la flaque où luit un bec de gaz livide.
Comme il doit regretter les draps frais, l’édredon
Où, discret, il venait chaque matin s’étendre,
Comme il doit regretter le sucre, les soins tendres,
Le chaud appartement où sont les maîtres bons…
Pauvre être noir errant dans une ville immense,
Cher petit compagnon égaré, gémissant,
Qui pleure le bonheur perdu par ta démence.
Nous sommes tous les deux semblables à présent…
Car, j’habitais aussi le palais de son âme.
Il était magnifique, exquis, profond, sculpté,
Ruisselant de satins, de velours et de flammes…
C’est lorsque j’en sortis que j’ai su sa beauté…
Je cherche comme toi des splendeurs disparues,
Le sucre des baisers, la chaleur des coussins…
Je passe, en appelant, par d’innombrables rues…
Mais je ne trouverai jamais plus le chemin…
L’ami dont je vous parle
L’ami dont je vous parle aimait tant sa maîtresse
Que lorsqu’il en parlait sa voix tremblait un peu,
Comme ma voix, ce soir, tremble de la tristesse
De penser à l’amour, de penser à l’adieu.
Mais il voulait aller toujours au fond de l’âme.
Par la peur du mensonge il était tourmenté.
Malheur à qui voit trop dans les yeux d’une femme
Et qui traque son cœur jusqu’à la vérité !
« Je ne vous aime plus ! » La terrible parole !
La pitié le défend, on ne la dit jamais.
Cet ami pour l’entendre a su jouer un rôle
Et l’arracher enfin à celle qu’il aimait.
« Tu fus toujours, lui disait-il, loyale et bonne,
Les mensonges consolateurs sont superflus.
Dis-moi que tu ne m’aimes plus, je te pardonne… »
Elle dit simplement : « Je ne vous aime plus. »
Ah ! l’on ne peut savoir alors, l’horreur immense
De ces affreux mots secs qui tombent comme un glas.
Mon ami me l’a dit, du moins… Quand il pense
Il pleure encor… Guérira-t-il ? Je ne sais pas…
L’étrange ressemblance
Comment je les suivis cette nuit-là ? Qu’importe !
On cherche la douleur quand on est sans espoir.
Je riais avec eux lorsqu’on ouvrit la porte
De la maison des seins pendants et des miroirs…
Et ce qui fut écrit, cette nuit, pour mon âme
Fut étrange et je sais à peine l’exprimer…
Je vis en peignoir bleu dans le groupe des femmes
Le visage et le corps que j’avais tant aimés.
Pas le même visage absolument, mais presque,
Une peau plus ternie et des yeux moins changeants.
Presque le même corps, mais fané, mais burlesque,
Et l’être souriait d’un sourire engageant.
Et j’ai voulu presser cette caricature
Mal maquillée avec un carmin bon marché,
J’ai voulu me prêter au jeu de la nature,
Revoir le long de moi l’ancien bonheur couché.
Chaque geste diminuait la ressemblance,
Les doigts étaient épais, il manquait une dent.
Une fade bonté faite de complaisance
Me déchirait le cœur à chaque mouvement.
Et je fermais les yeux afin de mieux entendre
Chanter dans mon esprit la merveilleuse voix.
Mais une voix criarde odieusement tendre
M’arrachait sans repos au songe d’autrefois.
Non, le peignoir déteint n’est pas la robe unique !
La chair ne trompe pas la chair par le dégoût !
On voit trop le malheur sous les becs électriques.
Et ce soir-là, la mort assiste au rendez-vous…
Où donc est-elle…
Où donc est-elle sur la terre en ce moment ?
Pour qui s’ouvre la fleur de sa bouche charmante ?
Elle est blottie au fond de quel appartement,
Les cheveux répandus et la chair frémissante ?
Résiste-t-elle avec un geste qui faiblit
Au charme tout puissant d’une première étreinte ?
Défait-elle sa robe, assise sur son lit ?
Se donne-t-elle dans les draps avec des plaintes ?
Ne rien savoir c’est ce qui fait le plus de mal…
Avec l’horreur que j’imagine, me débattre !
Est-elle dans la rue, auprès d’amis, au bal ?
Fait-elle rayonner la loge d’un théâtre ?
Peut-être est-elle triste et lasse du baiser
Et je ne suis pas là ce soir pour la reprendre ?
Elle est seule, elle souffre et pour la consoler
Peut-être il suffirait d’une parole tendre ?
À cette heure, elle va, je sais, dormir bientôt.
Peut-être a-t-elle froid dans un train qui l’emporte
Et je ne suis pas là pour croiser son manteau ?
Où donc est-elle en ce moment ? Mon Dieu, qu’importe…
Les distractions du soir
Ils me diront : « Venez avec nous respirer
La chaude nuit d’été sur Paris répandue
Et le parfum d’amour des plaisirs rencontrés… »
Mais moi j’aimerai mieux aller seul par les rues.
Si je vois un ami, sans voir je passerai
Et même je courrai si j’entends qu’il m’appelle.
Si j’ai des rendez-vous, exprès je l’oublierai.
La vie au promeneur en somme est riche et belle.
Quand on porte un chagrin, il faut le porter loin
Pour le laisser un peu s’égrener sur la route.
Ce soir-là je fuirai ma pensée avec soin :
Le souvenir se tait quand personne n’écoute.
On me verra debout devant les magasins.
Je les regarderai longtemps de mes yeux vides.
Un autre, puis un autre et l’on suit son chemin…
Les vitrines pour moi seront toutes splendides.
L’orchestre des cafés me fera grand plaisir.
Mais quels airs ? ah ! cela je ne saurais le dire…
Peut-être de m’asseoir aurais-je le loisir ?
Peut-être un menu fait me fera-t-il sourire ?
Ce sera long, très long, je marcherai très tard…
Nuit de Paris ! de la poussière, des figures,
De la musique, un infini de boulevards
Et tous les désespoirs errants dans les voitures…
Et quand enfin j’arriverai devant mon seuil,
Je me dirai : « J’ai bien passé cette soirée… »
Mais alors sur la porte étroite et sans accueil,
J’aurai subitement l’âme désespérée.
J’aurai l’effroi de l’escalier mal éclairé
De la chambre et du lit où dort mon habitude
Et brisé par la nuit qui meurt, je m’assiérai
Peut-être là, pour sangloter de solitude…
La porte oublieuse
Ce sera par un soir d’hiver plein de lumières,
Après que quelques mois se seront écoulés,
Un soir si froid qu’il met des larmes aux paupières
Et mon pas sonnera sur le trottoir gelé.
La maison qui jadis m’était si merveilleuse
Entre d’autres maisons pareilles sera là.
La fenêtre ordinaire et la porte oublieuse
Avec un air joyeux ne m’accueilleront pas.
Je gravirai à chaque étage plus timide
L’escalier qu’autrefois je montais en courant
Et je le trouverai plus solennel, plus vide,
Interminable avec ses seuils indifférents.
Je sonnerai ; soudain des fentes de la porte
Viendra le cher parfum de son appartement
Et durant un instant les bouquets de fleurs mortes
Auront ressuscité miraculeusement.
La porte s’ouvrira comme aux jours magnifiques
Et sous cet angle étroit laissant voir le salon
Et l’antichambre avec ses plantes exotiques,
Le cadre du bonheur semblera plus profond.
Les meubles familiers seront aux mêmes places :
Je verrai l’abat-jour, les bibelots connus,
Je verrai la banquette et la petite glace,
Mais le chien que j’aimais ne me connaîtra plus.
Il aboiera pour me chasser, lui que naguère
Je comblais d’amitié, de caresses, de soins,
Qui léchait près de moi les mains qui m’étaient chères
Et qui dormait la nuit couché sur nos pieds joints.
Je sentirai tout près, la présence légère,
À d’invisibles frôlements, à presque rien,
Au souffle parfumé d’une intime atmosphère.
« Madame n’est pas là », dira-t-on. « Merci bien. »
Il fera beau dehors. J’irai d’un pas tranquille…
Je me rappellerai les premiers rendez-vous…
La rue au loin sera longue, infinie, hostile…
Et je dirai : « C’est bien… Voilà… » Ce sera tout.