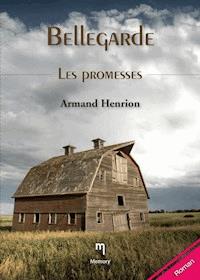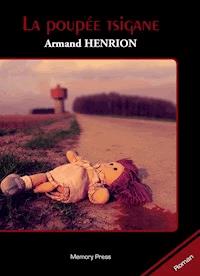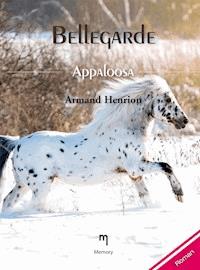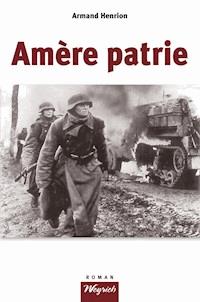Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Memory
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Après deux années d’enquêtes peu spectaculaires, trafics de voiture, cambriolages, quelques meurtres passionnels dont il ne faut même pas chercher l’auteur, l’inspecteur Juste se trouve confronté à un, puis deux assassinats sauvages dans les bois de l’Ardenne profonde.
La chasse réglementée et le braconnage organisé constituent deux mondes qui ne poursuivent pas toujours le même gibier, ni par les mêmes moyens. Les tireurs sont parfois les mêmes et la discrétion des Ardennais n’aide pas la police. Quand un tueur mystérieux se met à la chasse à l’homme avec une arme de gros calibre, la peur augmente et le chasseur peut devenir gibier.
Au travers des indices, l’inspecteur Juste recherchera l’assassin…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHAPITRE 1 DIMANCHE
Raymond Tigne a eu cinquante ans hier matin, à sept heures quinze exactement. Voilà pourquoi il marche aujourd’hui le long de l’Ourthe vêtu d’une superbe veste kaki offerte par sa maman pour son anniversaire.
Tout s’est passé hier exactement comme les autres années : un bon repas, la sœur, le beau-frère et les trois enfants avec la mère autour de la table, une cravate (la sœur), un Bourgogne dix ans d’âge (le beau-frère), rien (les enfants), et un vêtement pour l’hiver (la maman). Et le gâteau avec autant de bougies que d’années, que Raymond souffle toujours méthodiquement, en deux ou trois fois, ce qui donne à la crème fraîche du dernier quartier l’allure si appétissante de la neige carbonique parsemée de cristaux de suie, comme dans les meilleurs incendies. Il y a deux ans, c’était un pull-over de grosse laine, l’an dernier un imperméable réversible, et cette année … un vrai body-warmer avec de chaque côté sur l’avant deux poches à bouton pression et deux autres à fermeture éclair, où Raymond Tigne a déjà placé les objets indispensables à ses longues marches en forêt : le téléphone portable, les galettes de sésame, le canif à manche d’ivoire. La quatrième poche n’a pas encore trouvé d’usage. Elle restera peut-être vide. Dans les trois autres, l’ordre des choses est désormais immuable.
Etonnant que la maman ait offert cette fois-ci un cadeau sans manches, elle qui lutte depuis un demi-siècle pour que jamais son petit ne prenne froid. Elle a probablement cédé à l’effet de mode, étudié les folders de réclames et de soldes comme d’autres lisent des romans. Elle a dû céder au charme de ces mannequins masculins qui posent sur un fond de forêt urbaine, le pied chaussé de neuf posé avec aplomb sur une bûche trop propre, tenant d’une main un merlin brillant d’inutilité, avec sur le côté le coffre savamment entrouvert d’un 4x4 aux roues étincelantes.
Raymond Tigne a cinquante ans, mais il ne les fait pas. Enfin, pas partout. Il est de taille moyenne. Un certain embonpoint bien caché sous des chandails assez amples, un crâne de plus en plus dégarni que la casquette dissimule, tout cela témoigne de l’homme mûr. Mais ce qui ne change pas, c’est ce visage tout rond, à la peau rose à peine tachée de poils de barbe épars, ces joues dodues et ce regard perpétuellement apeuré d’un adulte qui n’a jamais vraiment quitté l’enfance.
Raymond Tigne est un forcené de la marche en forêt. Et il habite au milieu de sa passion. Valogne est un village d’à peine six cents âmes, posé en plein milieu des bois de l’Ardenne, dont les habitants ont parcimonieusement colonisé juste assez de terres de culture pour faire survivre les quelques fermes qui y subsistent encore. Quand il monte au grenier dans la maison paternelle, il ouvre la barbacane de l’est et ne voit à l’horizon que des arbres, à perte de vue. A la fenêtre de l’ouest, c’est le même paysage de frondaisons, de chênes et de sapins, de bouleaux et de hêtres qui alternent sur la ligne du ciel leurs murs de vert et de brun.
Raymond a toujours vécu dans la maison paternelle, il a toujours vécu à Valogne, et il y mourra. Bien sûr, il y a les journées de travail à Rochelle, les fastidieux horaires du guichet de la poste, mais il faut bien gagner sa vie, entretenir la mère et la maison. Cependant, le temps selon Raymond s’articule autour des promenades du dimanche, comme d’autres vivent les semaines en parlant du jeudi au samedi du match du dimanche à venir, et du lundi au mercredi de ce même match et de ce qu’il a rapporté de bonheur ou de tristesse, selon le score. Raymond mitonne ses balades comme un orfèvre : analyse de cartes, étude de la météo, préparation du matériel. Dès le dimanche soir, il note dans un cahier qui fait office de journal de bord l’itinéraire qu’il a parcouru, les heures de départ et de retour, les fleurs, animaux, arbres et autres faits saillants découverts au hasard des kilomètres. A raison d’ une moyenne de trente kilomètres par sortie, Raymond a récemment calculé — non sans fierté – qu’en vingt-cinq ans de marche solitaire, il avait déjà presque accompli un tour de la terre, sans s’être jamais éloigné de son lit plus loin que le périmètre de ses quatre cartes d’état-major.
Il a cependant aujourd’hui un autre élément à gérer : depuis deux semaines, la chasse est ouverte, et il faudra patienter, ruser, calculer les itinéraires pendant deux longs mois encore avant d’être débarrassé de ces gêneurs. Raymond n’aime pas la chasse. Il n’irait pas jusqu’à dire qu’il n’aime pas les chasseurs, car ce serait prendre des risques, surtout à voix haute : ses trois voisins immédiats sont des passionnés du fusil, une frénésie qu’ils ont transmise à leurs enfants, et qui mesure le temps comme le football ou la marche, en ce qui précède l’automne, ces longs mois d’impatience où il est interdit de faire feu, et ce qui suit décembre, cette éternité de jours où l’on ne peut plus tirer.
Raymond marchait le long de l’Ourthe. Il avait laissé sa voiture près du pont, dans la vallée. Son but aujourd’hui était double : de toute façon trente kilomètres qui le mèneraient lentement vers les crêtes, passé la forteresse celtique où les fouilles avaient été abandonnées, passé le pont de fer au dessus du petit barrage à saumons, puis l’ascension du versant opposé, les stations rituelles aux trois points de vue d’où il étudierait les nouvelles coupes de bois, et enfin le retour vers la voiture en redescendant le long des deux ruisseaux qui se jettent dans l’Ourthe au Vieux Pont. Ce parcours lui permettrait aussi de vérifier que ses sapins sont indemnes. Son père lui avait laissé quelques parcelles boisées avant de mourir, il y a déjà vingt ans, d’une maladie infectieuse mal soignée dans un corps chétif. Une des parcelles longeait la rivière sur deux cents mètres au bout de la partie praticable du chemin sur lequel il marchait. Et Raymond était inquiet. Il pleuvait depuis dix jours presque sans discontinuer, les cours d’eau avaient gonflé, le journal télévisé montrait déjà les caves inondées des maisons de Dinant et d’Esneux, comme à chaque fois que les éléments se déchaînent. A sa droite, l’Ourthe charriait des flots boueux, son lit avait déjà doublé de largeur depuis l’été, et l’eau venait clapoter au ras des berges avec un petit bruit sinistre. Après un kilomètre, Raymond dut quitter le chemin et monter dans le versant pour éviter l’eau qui avait envahi l’ancien gué des chariots. Il n’aimait pas marcher avec des bottes en caoutchouc, le pied transpire, il n’a pas d’assise et glisse sur les racines dissimulées sous les feuilles. Mais par un temps pareil, marcher avec des bottines eut été de la pure folie. Il acceptait les bottes comme un moindre mal.
En redescendant sur le chemin, il glissa à nouveau et s’étala dans un roncier qui agrippa sa nouvelle veste au risque de la déchirer. Raymond jura, se remit debout, écarta avec précaution les ronces tentaculaires qui s’accrochaient à la laine de ses manches. Il prit encore quelques minutes pour extraire de sa main gauche trois épines qui s’étaient logées dans la peau.
Il se remit à pleuvoir. Heureusement, il avait sa casquette. Il pensa que son imperméable réversible de l’an dernier aurait été plus adéquat que le body-warmer neuf qui, comme pour mériter son nom, commençait à lui donner chaud sans protéger pour autant ses bras de la pluie. Raymond n’avait pas de bonnes sensations ce jour-là. Il détestait tomber, c’était pour lui comme un manque d’intelligence. De plus, la rivière tumultueuse le remplissait de crainte, la crainte de se noyer chez un homme qui ne sait pas nager.
Vivement la parcelle de sapins, qu’il puisse commencer à monter, à quitter l’inquiétant voisinage du courant. Il se remit en route. Il eut à peine un regard pour le petit camping de caravanes de l’autre côté de l’eau, cette vingtaine de cubes de métal blanc flanqués d’auvents en plastique décolorés par le soleil et les averses. On imaginait mal que ce bivouac désert allait dans quelques mois reprendre vie, rassembler à nouveau des Hollandais bedonnants et d’opulentes Flamandes autour de barbecues sans fin. L’eau venait déjà titiller les roues des caravanes les plus proches de la berge, et s’il pleuvait encore pendant une semaine, ce serait le même cirque qu’il y a cinq ans, quand trois masses de ferraille étaient parties avec les flots s’éventrer contre les rochers un kilomètre plus loin, vomissant dans la rivière des fauteuils pliants, des ballons et des cerceaux qui étaient allés mourir sur les berges au gré des virages suivants, en faisant de la vallée un dépotoir insupportable.
Il allait bientôt atteindre la grande courbe de l’Ourthe, où la rivière depuis des millénaires vient buter sur une muraille rocheuse qui la force à dévier vers la gauche. C’est là que les caravanes s’étaient échouées. On les avait péniblement retirées du courant avec une grue qui avait abîmé la rive du côté de Valogne. Il y avait à cet endroit un constant fatras de troncs d’arbres empilés, d’où pendaient des restes de paille et de foin qui témoignaient de la hauteur impressionnante des crues de printemps.
Son regard s’arrêta sur une étrange forme accrochée dans les arbres, juste à hauteur de l’eau. Il fit un effort pour mieux voir, mais l’humidité perlait ses lunettes de petites gouttes de vapeur, et sa vue n’était plus aussi bonne qu’avant. Et il avait choisi de ne pas prendre ses jumelles. Le temps ne s’y prêtait pas. Sur une centaine de mètres, un rideau de jeunes saules masquait le rocher. Il accéléra le pas. Puis, dès que la vue se libéra, il s’arrêta net, pétrifié. Là, devant lui, une forme disloquée émergeait à peine de l’eau brune, mais Raymond ne pouvait pas refuser de la reconnaître pour ce qu’elle était : un corps humain. Il voyait clairement un bras soulevé à hauteur des arbres échoués, une tête tournée de côté et regardant vers le bas, et les carreaux rouges et noirs d’une veste qui se gonflait d’eau à chaque vague projetée par la rivière.
Pendant une minute, Raymond resta immobile. Une angoisse inconnue l’étranglait. Il sentait son cœur battre à toute vitesse dans sa poitrine… Puis il se lâcha :
– Nom de Dieu ! Merde ! Qu’est-ce que c’est que ça ?
Les jambes tremblantes, il se remit en marche. Le chemin devenait à cet endroit un tout petit sentier à peine plus large que les pas d’un homme, qui donnait un passage étroit à deux mètres au dessus de l’eau en longeant la roche luisante de pluie. Raymond s’arrêta à hauteur du cadavre qui dansait doucement dans l’eau noire. C’était un homme de forte corpulence. On devinait sous l’eau le reste du corps qui devait être coincé dans les branches ou dans une cavité de la roche. A intervalles réguliers, un pied chaussé d’une bottine brune remontait à la surface pour ensuite replonger, comme si le cadavre avait encore une vie propre. Un inconnu, se dit Raymond, en espérant ne pas se tromper. Il descendit prudemment la paroi rocheuse dix mètres derrière la vision macabre. Au moment où il allait poser le pied sur un des troncs échoués, il hésita. Et si l’arbre se détachait de son ancrage et se mettait à flotter, poussé par le poids de son corps à lui ? Il y aurait deux cadavres pour le prix d’un seul. Il pensa un instant rebrousser chemin. Appeler des secours. Ridicule ! Le type est mort. Il n’y a plus d’urgence.
Raymond ne savait pas ce qui le fit quand même avancer sur le tronc. Le bois lisse était comme enduit de savon. Et ses bottes qui n’offraient pas de prise. Il testa la stabilité du tronc en fléchissant deux fois les genoux. Ça avait l’air solide. Il fit quatre pas prudents de côté, en se tenant aux grosses branches nues des sapins couchés dans l’eau, et c’est ainsi qu’il parvint juste au dessus du corps du noyé. Son cœur battait la chamade. Et maintenant, que faire ? A quoi cela servait-il d’être ici, au dessus d’un bonhomme qui avait cessé de respirer depuis belle lurette et que rien ne ramènerait à la vie ?
Il s’accroupit sur le tronc tout en tenant une branche de sa main gauche. Le bras du mort était à portée maintenant, sa tête aux cheveux noirs plaqués sur le crâne à un demi-mètre de lui. Il n’aurait pas le courage de le toucher. Pourtant, il devrait bien lui soulever la tête pour voir de quoi il avait l’air. Il avisa un petit bâton flottant sur place le long de l’arbre mort, il recula avec précaution, saisit le bâton et le dirigea vers le menton du cadavre. La résistance était surprenante. Il faillit glisser, se reprit à une branche et recommença l’opération. En reculant encore de quelques centimètres, il put viser mieux. Le menton se releva, imprimant un mouvement de balancier au corps qui se remit à bouger dans l’eau. Tigne tenait le bâton de toute la force de son bras droit. Le visage du mort se tourna lentement vers le ciel : inconnu. Ouf. Inconnu. Nez fin, moustache noire, la quarantaine. Mais cette nouvelle rassurante fut de courte durée : avant que ses forces l’abandonnent, Tigne eut le temps de voir au milieu du front du noyé un trou qui ne saignait plus, aux contours parfaitement circulaires de peau bleue et rose lavée par le courant : le trou que laisse sans aucun doute possible une balle de fusil.
CHAPITRE 2 DIMANCHE
François Juste était assis à son bureau depuis plus d’une heure, et il avait l’impression de n’avoir encore rien fait. La pile de documents à sa gauche avait certes diminué de hauteur, mais il n’aurait pas pu dire si le traitement qu’il lui avait réservée était pertinent. Certaines feuilles avaient rejoint des classeurs sans être lues, d’autres étaient passées sans raison de son coude gauche à son coude droit, et le bac à papier avait aussi reçu sa part.
Juste laissa errer son regard sur les quelques sapins qui remuaient au vent de novembre. C’étaient les seuls arbres qui étaient restés debout quand on avait décidé de construire sur ce terrain un nouvel immeuble réunissant la police judiciaire et la gendarmerie fraîchement mariés par la politique sous le nom bizarre de « police intégrée ». Une opération chimique assez peu réussie aux yeux de Juste et de ses collègues, qui n’y voyaient aucun avantage et certainement beaucoup d’inconvénients, à commencer par une diminution de moyens. On aurait dit que tout l’argent disponible était allé au bâtiment neuf. Juste aurait été ingrat de nier qu’il avait maintenant enfin un bureau digne de ce nom, au mobilier fonctionnel, avec des portes qui ferment et des armoires stables, et même, le nec plus ultra, une cuisine-réfectoire où trônait une machine à café qui faisait du bon café, et que Juste fréquentait entre deux dossiers, entre deux interrogatoires. Il devait boire ses deux litres par jour. C’était une des nombreuses choses qui n’étaient pas bonnes pour sa santé et qu’il feignait d’ignorer.
Il avait fait le compte : ils disposaient d’un nouveau commissariat, chacun avait son ordinateur, la climatisation était prévue – dans une région où le mercure ne monte que rarement au dessus de vingt-cinq degrés. Mais au passif, il y avait une voiture et une camionnette en moins, deux agents avaient été mutés à Bruxelles contre leur gré, et on parlait de fusionner Rochelle avec la brigade voisine, ce qui reposerait la question de la destination de leurs beaux bureaux. Tout cela concordait selon Juste. La police était une affaire assise, une question de dossiers que l’on traite à distance, sur des écrans, et de moins en moins un travail debout, fait de proximité et de terrain. Exactement le contraire du discours politique. Juste n’avait plus envie de s’élever contre ce qui lui apparaissait comme une perversion du système. Il ne voulait plus se battre. Depuis deux ans, quelque chose en lui s’était brisé. Maintenant, il fonctionnait.
Il alluma une pipe. Un autre problème de santé qu’il dribblait chaque jour. Il n’y avait plus personne chez lui pour protester contre l’odeur de tabac froid, les trous dans les chemises neuves et les cendriers qui débordent. Voilà presque trois ans que Gisèle était morte, et pendant une longue période Juste ne fut pas beaucoup plus vivant qu’elle. Après cette journée terrible où elle s’était jetée dans la mort, tout s’était arrêté.
* * *
Quand Bultot lui avait téléphoné que deux chalets venaient de brûler alors que le pyromane était mort, Juste était parti d’un immense éclat de rire en raccrochant sans répondre. Des pleurs aussi déchirants qu’incontrôlés avaient suivi, puis Juste était entré en léthargie. C’est un mort-vivant qui avait suivi le cercueil, serré des mains sans visage, embrassé la belle-famille honteuse dans un ballet de perdants et de condamnés. Il avait obtenu sans le demander deux mois de congé de maladie, et tout le monde doutait avec lui qu’il puisse survivre à cette horreur.
Les premières semaines furent rythmées par les visites du médecin, la prise de tranquillisants et d’anti-dépresseurs, de cachets de toutes sortes qui lui ravageaient l’estomac. Il confondait le jour et la nuit, se nourrissait comme un sauvage, ne voulait voir personne. Même sa mère, qui achevait à Liège une vie de veuve sage. Elle lui proposa de venir vivre avec lui. Il accepta dans un premier temps, comme un naufragé qui saisit la bouée qu’on lui tend. Puis il refusa le jour avant qu’elle ne vienne. Il ne donna pas d’explication. Sa mère en fut bouleversée. En fait, il sentait qu’elle se sacrifiait pour lui. Elle n’aimait pas la campagne, elle allait se couper de ses amis du club de bridge, de sa chorale dominicale, de ses habitudes citadines, pour venir soulager la décrépitude de quelqu’un qui ne supporterait pas sa présence.
Ce refus s’avéra être le premier acte délibéré qu’il posait depuis la mort de Gisèle, le premier mouvement d’opposition par rapport à la pente où il se laissait glisser. Dire non à sa mère, c’était cesser de régresser, commencer à se reconstruire, ou du moins à ne plus se détruire. Il se mit à écrire sur des bouts de papier des résolutions à tenir : faire son lit, se raser le matin, faire la vaisselle, entretenir le linge, lire un livre par semaine.
Etonnamment, il tint la distance. On aurait dit que le corps et l’âme venaient de toucher le fond, et que c’était maintenant le moment de décider entre la balle dans la tête – on lui avait bizarrement laissé son arme de service – ou la reprise en main. Il était a posteriori surpris de n’avoir jamais vraiment pensé au suicide. Peut-être était-ce depuis le début un faux dilemme, peut-être avait-il tout simplement fallu qu’il se repose en se laissant aller, avec toute la négligence et le délabrement que cette sorte de vide exige ?
Au début de son congé, Bultot vint le voir une ou deux fois par semaine. Il apportait une bouteille de vin ou de purnalet, qu’ils éclusaient ensemble, un tiers pour le visiteur, deux tiers pour Juste. A la fin de la visite, et sous l’effet de l’alcool, l’inspecteur devenait grossier, il jurait, cherchait querelle, et Bultot partait chaque fois un peu plus perplexe quant aux chances de récupération de son patron. Le lendemain, Juste était effondré, il appelait Bultot au bureau pour s’excuser, pour renouveler l’invitation. Celui-ci hésitait, car il avait aussi remarqué la lente déchéance de la maison : la vaisselle qui s’amoncelait, le sol jamais lavé, des vêtements sur toutes les chaises, et des bouteilles vides qui n’étaient pas celles qu’il avait apportées. Il n’osait pas intervenir ou proposer son aide : il était certain de se faire rabrouer avec des mots grommelés dans une bouche empâtée par le bourgogne. Il laissa passer quinze jours avant de tenter un dernier essai. Il acheta un paquet de tabac de la Semois et une nouvelle pipe. C’était plus cher que le vin, mais cela ferait moins de dégâts.
Le spectacle qui l’attendait chez Juste le stupéfia. L’inspecteur était rasé de frais, l’œil clair, la cuisine était pimpante, les sièges débarrassés de tous leurs pulls, chemises et pantalons. Plus une seule bouteille en vue.
– J’ai décidé de réagir, Bultot. Je reprends le travail dans dix jours. Il le fallait. J’ai une femme d’ouvrage qui vient tous les trois jours. Et je ne touche plus à la gnôle. Juré ! Un café ?
– Volontiers. Euh … j’ai pensé que ceci vous ferait plaisir, dit-il en tendant timidement le petit sachet avec la pipe et le tabac.
– Oh, Bultot, il ne fallait pas. C’est trop gentil. La prochaine fois, n’apportez plus rien. C’est vous qui êtes un cadeau.
Ils échangèrent des sourires gauches comme savent en arborer deux hommes gênés par la pudeur des sentiments.
– Je suis allé au cimetière dimanche dernier. C’est toujours difficile. Mais cette fois-ci, c’est comme si Gisèle m’avait dit qu’une mort suffisait, que me détruire ne servirait à rien. C’est drôle. On aurait vraiment dit qu’elle me parlait. Ce n’est qu’un monticule de terre avec une croix. Ils n’ont pas encore placé la dalle de grès. J’en suis à regretter cette idée. J’ai peur que ce couvercle de pierre ne me coupe vraiment d’elle. Je sais, c’est ridicule. Mais on devient un peu barge quand on est veuf et misérable, vous savez.
Bultot faisait oui de la tête, en tournant sa cuiller dans sa tasse de café noir où il n’y avait même pas de sucre à mélanger. Il ne disait rien. Il ne voulait pas interrompre ce flot de paroles calmes si nouvelles dans la bouche de Juste.
– Et je me suis dit, avec elle, que je ferais mieux de me montrer digne d’elle en réagissant, plutôt que de venir chialer tous les deux jours sur mon sort au cimetière sans chercher de solution. Depuis, ça va mieux. Ce n’est pas encore parfait, mais ça avance. Vous comprenez ? Un vrai électrochoc !
Bultot acquiesça. Puis, pour la première fois depuis longtemps, ils se mirent à parler boulot. Cela signifiait que le patron était prêt à reprendre le collier. Bultot évoqua l’ambiance au commissariat. Et les affaires en cours. Ils avaient assez vite coffré les deux ados qui avaient bouté le feu aux autres chalets le jour de la mort de Gisèle. Ces petits connards avaient tout simplement voulu profiter de l’effet d’entraînement provoqué par la vague d’incendies pour y ajouter les leurs. L’enquête, au lieu de se corser, s’était décantée au point qu’il suffit de deux témoignages pour coincer les gamins et les confondre.
* * *
Deux bonnes années s’étaient écoulées, avec des enquêtes plutôt faciles et peu spectaculaires. Des trafics de voitures, des cambriolages, quelques meurtres passionnels où il ne fallait même pas chercher l’auteur qui s’était rendu parce qu’il n’avait pas le courage de rejoindre l’autre dans l’au-delà. Et de plus en plus de cas de pédophilie, avérés ou imaginaires, des enquêtes plus complexes celles-là, où on entrait souvent dans l’enveloppe obscure et nauséabonde des secrets de famille.
Un des papiers qu’il venait de classer concernait l’épilogue d’une affaire qui avait tenu un village voisin en émoi pendant plusieurs semaines. Un instituteur accusé d’actes pédophiles par les parents d’un élève, la petite communauté divisée sur le sujet, l’éloignement de l’enseignant par l’ordre d’une loi contestée et, finalement, grâce à la qualité de l’enquête de Juste et de ses collègues, des parents qui se rétractent et avouent une cabale contre l’enseignant à cause d’un vieux différend familial. C’était maintenant au tour de l’instituteur de se pourvoir contre les parents pour diffamation. Mais cela ne concernait plus Juste.
Il avait de plus en plus l’impression que la maladie du tout-àla-justice gagnait les régions rurales après avoir conquis les villes. On consulte un avocat pour un mètre de mur mitoyen, un échec sur le bulletin ou un tapage nocturne. Pour un rien, on monte au tribunal. Et au bout du compte, cela fait surtout l’affaire sonnante et trébuchante des hommes de loi, sans rien solutionner au fond des choses.
La pipe s’éteignit pendant la rêverie de Juste. Sans doute du tabac trop humide. Il avait dû laisser trop d’épluchures de mandarine dans la tabatière. Il se pourrait bien que sa pipe se bouche assez vite. Pourtant, elle était sans reproche. Et de plus, c’était celle que Bultot lui avait offerte. Il cherchait la boîte d’allumettes sur le bureau quand le téléphone sonna. Un dimanche aprèsmidi ! C’était rare, et injuste pour les dévoués qui assuraient la permanence.
– Allo oui !
– Inspecteur, j’ai un appel en ligne pour vous. Quelqu’un qui veut vous parler. Il a l’air très énervé. Je vous le passe ?
CHAPITRE 3 DIMANCHE
Quand Raymond Tigne réalisa qu’il avait affaire à un meurtre, la peur se mua en panique. Il lâcha la branche qui avait permis de soulever le visage du mort. Ce mouvement brusque lui fit perdre l’équilibre, il glissa le long du tronc de sapin, ses deux jambes plongèrent dans l’eau glacée qui s’engouffra dans ses bottes. Il ne dut son salut qu’à sa prise d’une branche basse et solide. En jurant comme un païen, il se hissa sur la surface visqueuse du tronc et reflua prudemment vers la rive. Dès qu’il atteignit le sol ferme, il ne put que constater les dégâts : son pantalon était trempé jusqu’en haut des cuisses, et les premiers pas qu’il fit sur le sentier résonnèrent comme autant de clapotis d’eau prisonnière autour de ses pieds. L’impression de froid le gagnait. Quand il se retrouva sur la partie large du chemin, il enleva ses bottes pour au moins en évacuer l’eau. Il n’eut pas un regard en arrière pour le noyé. Il aurait voulu qu’il disparaisse, qu’il n’ait jamais existé, que le courant l’emporte plus loin, que quelqu’un d’autre le trouve. Il y avait en lui l’épouvante de ce qu’il venait de découvrir, la rage d’être stupidement tombé à l’eau, la crainte d’un gros refroidissement, et, par dessus tout cela, et bien plus prosaïquement, la contrariété de ne pas pouvoir accomplir la promenade qu’il avait si bien préparée. C’était la réaction typique d’un célibataire peu enclin aux concessions.
Raymond se mit à marcher vite pour vaincre le froid qui coupait son corps en deux par le milieu. Le pantalon collait à ses jambes, et le vent de face augmentait encore l’impression d’humidité. Il pressait le pas aussi parce qu’il voulait le plus rapidement possible prévenir la police de ce qu’il avait découvert. La voiture était garée près du seul bâtiment à cet endroit de la vallée. C’était un hôtel où il pourrait téléphoner et se réchauffer un peu avant de rentrer à Valogne. Après cinq bonnes minutes de marche forcée, il s’arrêta net, enfin conscient de sa bêtise. Il avait sur lui son portable. Il pouvait appeler de n’importe où. Décidément, cette macabre surprise lui avait enlevé tout bon sens ! Il chercha fébrilement dans quelle poche du body-warmer il l’avait glissé. Pas encore habitué à toutes ces poches ! Quand il eut dégagé l’appareil, il lui fallut tout un temps pour composer le numéro de ses doigts engourdis. Ses mains tremblaient. Il se remit à marcher tout en attendant la sonorité. Rien. Seulement un tut tut ridicule. Et sur l’écran, le message fatidique : « Appel rejeté ». Merde, il n’y avait pas de réseau au fond de cette vallée, de ce lieu de cons oublié des hommes, de ce bordel de chemin de boue où il était en train d’attraper la mort après l’avoir vue en face.
Il hésita. Aller jusqu’à l’hôtel ? Monter dans le bois jusqu’à ce que ces foutues barres de réseau s’impriment à l’écran ? Il opta pour la deuxième solution. Il choisit une diagonale entre les rochers, dans une sapinière dont il s’aperçut après un instant que c’était la sienne. Il aurait dû s’arrêter là, seulement pour vérifier l’état de ses conifères. Il n’en serait pas à mourir de froid pour un cadavre. Raymond gagna une plate-forme rocheuse. Le souffle commençait à lui manquer. Ah, j’ai deux barres. Cela devrait suffire. En effet, après une seule sonnerie, une voix répondit :
– Poste de police de Rochelle. J’écoute.
Raymond n’était pas prêt. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n’en sortit.
– Allo. Poste de police de Rochelle. J’écoute.
– Allo. Oui. Ah oui. Bonjour monsieur. Je suis bien au poste de police ?
– Oui. J’écoute.
– Voilà. Je suis au bord de l’Ourthe. Et je viens de découvrir un … un … un cadavre dans l’eau. Qu’est-ce que je dois faire ?
– Je vous passe l’inspecteur Juste. Ne quittez pas.
Suivit un air de musique classique préfabriquée, qui rappela à Raymond les génériques des matches de foot à la télé, du temps du noir et blanc. Il fut lui-même étonné du type d’association qu’il pouvait faire à un tel moment. Le froid revenait l’assaillir quand il ne bougeait plus. Il se mit à marcher deux pas à gauche, deux à droite, en cognant du pied dans le tapis d’aiguilles. Mais qu’est-ce qu’ils foutent ? Je vais attraper la misère !
– Allo. Inspecteur Juste. Je vous écoute.
– Ah, inspecteur. Bonjour. Je suis sur le bord de l’Ourthe, près de l’hôtel du Vieux Pont, sur la route de Rochelle. Je viens de trouver un cadavre dans l’eau, un peu plus loin que le camping. Vous voyez où c’est ?
– Oui, à peu près. Puis-je vous demander votre identité ? Raymond ne répondit pas. Il ne s’était pas attendu à cette question. Il ne voulait rien avoir à faire avec toute cette histoire. Ce coup de fil était une énorme erreur, le début des emmerdes !
– Allo. Vos nom et adresse, s’il vous plaît !
– Allo. Oui … la communication n’est pas bonne. Je vous avais perdu. Voilà. Euh … Raymond Tigne, j’habite Valogne, au numéro 96 de la grand-rue.
– Et votre numéro de portable est bien le 0496 55 53 97 ?
– Euh … oui … comment … ?
– Nous arrivons. Pouvez-vous nous attendre à la route, près du pont ?
– C’est que … je suis trempé, je suis tombé à l’eau. Je vais attraper une maladie. Si ce n’est déjà fait.
– Désolé, mais vous devez rester sur les lieux pour nous indiquer le chemin. C’est d’une importance capitale. Et surtout, ne touchez à rien.
– Là, il n’y a pas de danger ! C’est assez horrible comme ça ! Il …
L’inspecteur avait déjà raccroché. Quel goujat !
Tigne fixa le petit cadran d’un air incrédule. Puis il bloqua le clavier, glissa le téléphone dans la bonne poche et se mit à courir en coupant dans la descente. Il savait que ceci rendrait toute nouvelle communication impossible. Il s’en foutait. Il lui fallait absolument gagner au plus vite sa voiture pour échapper à ce maudit vent qui lui glaçait les jambes. Voilà comment on le remerciait d’avoir donné l’alerte le plus vite possible : il allait devoir rester dans sa bagnole à se geler les guiboles en attendant que les flics arrivent, à deux cents mètres d’une salle bien chauffée où on lui aurait offert un café brûlant et une bonne goutte. Dieu sait si la patronne ne lui aurait pas proposé de sécher son pantalon ?
Près de la voiture, il mit un temps infernal à trouver ses clés. Le body-warmer – quel nom ridicule – avait décidément trop de poches. Il saisit une couverture dans le coffre, la déposa sur le siège et s’engouffra dans l’habitacle. Il mit aussitôt le moteur en marche, le chauffage à fond et la ventilation au maximum. Erreur. C’est de l’air froid qui lui fouettait le visage. Ventilation sur deux, direction les pieds, et s’emmailloter au maximum dans la couverture. Il resta quelques minutes à regarder devant lui, avec un œil régulier sur l’aiguille de température qui ne voulait pas bouger. Puis ce qui devait arriver arriva : le premier éternuement, suivi d’un frisson dans le dos. Nom de Dieu, ça y est, j’ai la crève ! Devait-il enlever ses bottes ? Cela sécherait plus vite … Non, jamais il ne parviendrait à rentrer ses pieds humides dans des bottes refroidies. Ce serait encore pire.