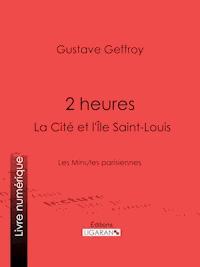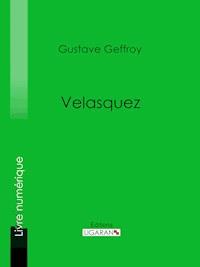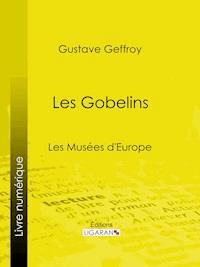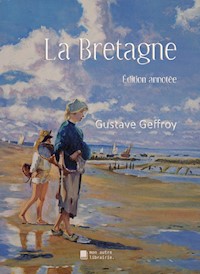
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une présentation bienveillante et singulièrement fouillée de la Bretagne sous tous ses aspects : géographique, toponymique, économique, historique, gastronomique, artistique, politique, sans oublier folklorique, voire magique ! De Rennes à Brest, de Lorient à Saint-Brieuc, en chemin de fer, en bateau, en charrette ou à pied, l'auteur a exploré les villes et les campagnes bretonnes, dans les années 1900, et nous en restitue avec sincérité l'image la plus exacte et la plus objective qu'a pu lui permettre son coeur de Breton. Une Bible. (Édition annotée)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Bretagne
Gustave Geffroy
Édition annotée
Fait par Mon Autre Librairie
À partir des livraisons de 1902, 1903 et 1904 du Tour du Monde.
Les illustrations n’ont pas été reprises.
Toutes les notes ont été ajoutées pour la présente édition.
Couverture d’après John Singer Sergent.
Illust. intérieure : Bretonne de Guimiliau
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2022, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-38371-009-7
Table des matières
I. – La Bretagne du Nord
1. Le pays de Rennes
2. – Le pays de Dol et de Saint-Malo
3. – Le pays de Saint-Brieuc
4. – Le pays de Tréguier
5. – Le pays de Léon
II. – La Bretagne du Centre
1. Le pays de Ploërmel
2. – Le pays de Pontivy
3. – Les Montagnes Noires
4. – Le pays de Douarnenez
5. – La presqu’île de Crozon et la pointe de Plougastel
6. – Les Montagnes d’Arrée
7. – Le pays de Carhaix et le pays de Belle-Île-en-Terre
III. – la Bretagne du Sud
1. Le pays de Nantes
2. Le pays de Vannes
3. Le pays d’Auray
4. Le pays de Lorient
5. Le pays de Quimperlé
6. Le pays de Quimper
7. Le pays d’Audierne
I. – La Bretagne du Nord
1. Le pays de Rennes
1. --- Vitré. – Le château. – Le fouillis du musée. – Le faubourg du Rachapt. – Les tricoteuses. – Les vieilles maisons. – Notre-Dame. – Une femme de Barbe-Bleue. – Le château des Rochers. – Madame de Sévigné est toujours là. – La chambre de la marquise. – Le jardin de la marquise. – Soucis d’argent. – Économie et faste. – La société des Rochers. – Le Bien-Bon. – Mademoiselle de Kerlouche. – Les lectures. – Fougères. – Les remparts et les vieilles maisons. – Les ruelles. – Le rôti du dimanche. – Saint-Sulpice. – Le château. – Le verger dans la ruine. – La vue sur la forêt. – La forêt de Fougères.
La première ville bretonne où je pénètre par l’Est est bâtie sur une ondulation de terrain de 110 mètres d’altitude qui domine la rive gauche de la Vilaine. C’est Vitré. Autour de la gare s’organise le monde moderne de la province : une place encadrée de grands arbres, ornée de boulingrins et de parterres de fleurs, une promenade de petite ville, une profusion d’enseignes aux maisons, l’hôtel tout enguirlandé de plantes grimpantes, la grande table recouverte d’une nappe blanche qui attend le voyageur. Mais que l’on quitte la place, que l’on s’engage sur les pavés de la rue Baudrairie ou de la rue Garengeot, on a presque immédiatement la vision du passé. On commence à remonter les siècles, à trouver l’histoire. Tout de suite, c’est le château, l’ancien château-fort de la Trémoille, aux vieux remparts crénelés, aux tours massives, formidable bastille achevée vers la fin du XIVe siècle, legs de l’architecture militaire du Moyen-âge, avec son châtelet à l’entrée, flanqué de deux tours à mâchicoulis, précédé d’un pont-levis et d’une poterne. On entre dans la cour : au milieu, un vieux puits entouré d’un mur surmonté d’un toit ; en face, accrochée au pignon d’une tour, la tribune en pierre sculptée d’où la princesse de la Trémoille suivait les offices de l’Église réformée, absidiole gracieusement fleurie, avec cette inscription : Post tenebras spero lucem.
L’antique forteresse sert en partie de prison, mais elle est devenue aussi le pacifique asile du musée, de la bibliothèque, de tout ce cocasse et agréable fouillis qui fait songer à une cellule de sorcier, à un laboratoire d’alchimiste, à un cabinet de cousin Pons : cailloux, animaux empaillés, vieilles faïences, vieux bouquins, vieux parchemins, vieilles gravures, outils de silex, instruments de torture, tromblons, rapières, cela dans un décor de murailles épaisses, de poutres apparentes, de cheminées à vastes auvents. Tout semble groupé au hasard, les objets subissent l’éclairage de clair-obscur des étroites fenêtres profondément encaissées. Çà et là, un portrait de Madame de Sévigné. Une belle cheminée provient d’une maison de la rue de la Poterie ayant appartenu à Lucas Royer et à Françoise Gouverneur, son épouse.
Je sors de cet encombrement d’objets où l’on pourrait passer son existence si l’on voulait tout voir, tout déchiffrer, tout lire. Je débouche, par un étroit escalier et une petite porte, sur le chemin de ronde. La ville et ses environs se déploient. La Vilaine se déroule à travers une campagne remplie de soleil doré et d’ombre bleue, de verdures et de fleurs. Dans les champs, les alignements des gerbes empourprées du sarrasin, les sacs de pommes de terre sur le champ remué, les betteraves aux feuilles grasses, le paysage ombragé de sombres châtaigniers et de pommiers aux fruits rouges. De l’autre côté se ramassent les quartiers de la ville dominés par les flèches de Notre-Dame et de Saint-Martin, par le clocher et la terrasse de Sainte-Croix : la rue du Rachapt, qui rampe et s’élève à flanc de vallée ; la rue de Chateaubriand, qui coupe le chemin de fer sur un pont pour aboutir au Jardin des Plantes ; le parc de la Baratière ; la route d’Argentré, qui conduit chez Madame de Sévigné ; la promenade du Val, qui longe les remparts édifiés au XIIIe siècle par le baron André III, seigneur du lieu, tué aux côtés de Louis IX à la bataille de la Massoure.
Je descends l’escalier en colimaçon pour aller voir ces aspects de plus près ; mais avant de sortir, je plonge aux oubliettes, je suis le chemin couvert qui mène à une ancienne poterne. L’enceinte longée, une petite rampe descendue, j’atteints le faubourg du Rachapt où se trouve l’hôpital Saint-Nicolas, anciennement Maison-Dieu, fondé en 1205 par André II et déplacé par le chanoine Robert de Gramesnil, dont les cendres reposent dévotement dans la chapelle. Le faubourg du Rachapt est habité par des tricoteuses. Les femmes, des vieilles et des jeunes, sont assises, par groupes ou isolées, au seuil des portes, devant les humbles maisons. Leurs doigts agiles manient les aiguilles avec une dextérité prodigieuse. L’une d’elles me regarde par-dessus ses lunettes, sans perdre une maille de son tricot, puis s’interrompt et parle :
– Voyez, dit-elle, je fais des bas. Il faut cinq aiguilles. Trois tiennent les mailles faites, deux font de nouvelles mailles. Pour avoir une jambe bien régulière, il faut mettre les aiguilles en carré, le même nombre de mailles de chaque côté. On fait le compte lorsque l’un des côtés est achevé, l’aiguille qui noue les mailles vient se croiser avec la suivante, et ainsi de suite. On rétrécit ou on élargit le tricot pour former le dessin de la jambe, en diminuant ou en augmentant les mailles.
– Et le talon, le cou-de-pied ? dis-je.
– Le talon se fait en tricot plat, sur deux aiguilles. On donne le pli du cou-de-pied en élargissant ou en rétrécissant suivant le cas, et l’on raccorde les deux parties par un point tourné qui simule une couture : c’est ce qu’on appelle le fini.
– Mais, dis-je encore, je vois en haut de la jambe que l’ouverture est plus resserrée et que les mailles ne sont pas unies comme dans le reste du tricot ?
– Ce sont des mailles à côtes : on les fait au point double, ou point tourné, dans la proportion de deux points tournés pour un ou deux points unis. C’est plus élastique, et cela peut dispenser d’employer des jarretières.
– Merci bien, Madame.
– À votre service, Monsieur.
Dans toutes les rues des anciens quartiers où je déambule ensuite – mais tous les quartiers, sauf celui de la gare, ne sont-ils pas anciens, à Vitré ? – rue Baudrairie, rue Saint-Louis, rue Notre-Dame, rue de la Poterie, rue d’Embas, le regard est arrêté à tout instant par les vieilles maisons aux étages surplombants, aux pignons anguleux et avancés qui obstruent la clarté du jour. C’est une succession d’encorbellements d’une étrange variété, de tourelles en pointe, de lucarnes protégées d’auvents, de toits à épis, de niches où les Vierges, les Jésus, les Saints, méditent, sourient ou se renfrognent, parmi les fleurs desséchées et les rubans fanés. Sous les arcades à solives s’ouvrent des portes basses et étroites, des porches obscurs qui conduisent à des cours humides. D’autres portes, en bois plein ou à vitres, largement ouvertes celles-là, laissent voir des logis garnis de vieux meubles cirés, de lits clos, d’armoires aux ferrures luisantes, de pétrins qui fabriquent le pain depuis plus d’un siècle peut-être. La vaisselle garnit les rayons des crédences, les cuivres et les étains brillent. Les rideaux des croisées aux carreaux étroits et clairs sont blancs et empesés. Tout dit l’ordre et le soin. C’est la vétusté et c’est la propreté. Les femmes groupées cousent, raccommodent, brodent, tricotent. Celle-ci, repasseuse de coiffes, en tête à tête avec sa « Sidonie », est entourée de blancheurs de linge et de légèretés de dentelles.
Encore et toujours, ce sont des constructions non moins vermoulues. Quelques-unes sont rapiécées de planches ou plaquées d’ardoises pour combattre l’humidité. Architecture torse, dont les bâtis s’étayent les uns les autres, qui semble dater d’une époque où le fil-à-plomb était inconnu. Les montants des portes et des fenêtres s’élèvent et se croisent de travers, les œils-de-bœuf dessinent des ovales de guingois. Les toitures rapprochées ne laissent voir qu’un étroit pan de ciel, comme par un soupirail. À travers cette agglomération de logis branlants sont les charmants vestiges des hôtels de la Renaissance, les façades divisées par des pilastres, les pierres transversales au-dessus des portes, les charpentes affleurant les murs, les meneaux, les linteaux ornés de rinceaux délicatement sculptés, parfois peints, les ouvertes des fenêtres barrées d’appuis, de balustres de pierre, de fers ajourés, les angles des façades arrondis par des tourelles surmontées de poivrières percées de lucarnes. La plupart de ces édifices ont été défigurés par les réparations, des trous ont été comblés à l’aide de briques, des lézardes dissimulées sous le mortier ou le plâtre. Tels sont l’hôtel Limoyne de la Borderie, place du Vieux-Marchix ; l’hôtel du Bourg, rue de la Poterie ; l’hôtel du Langle dans la Mesriais ; l’hôtel Hardy, occupé par un établissement de bienfaisance. L’habitation de la famille de Sévigné, dite Tour de Sévigné, a été démolie, il y a plus d’un siècle, pour donner passage à une rue qui porte le nom de Sévigné. La propriété est décrite dans « l’aveu » de 1688. La marquise a parfois habité cette Tour. Elle y eut un lit, un petit lever, y reçut toute la Bretagne ; elle écrit à propos de l’un de ses séjours : « Dix ou douze hommes soupèrent avec mon fils à la Tour de Sévigné ... Il y eut dans ce repas une jolie querelle sur un rien : un démenti se fit entendre, on se jeta entre deux, on parla beaucoup, on raisonna peu. Le marquis eut l’honneur d’accommoder cette affaire. »
Non loin, Notre-Dame, ancien prieuré de l’abbaye de Saint-Melaine de Rennes, commencée au XVe siècle, achevée au XVIe, amalgame le gothique et la Renaissance. Il n’y a d’intéressant à l’intérieur que le tombeau de la femme de Barbe-Bleue, André de Laval, maréchal de Rais, qui fut jugé et pendu à Nantes pour actes infâmes et meurtres commis sur la personne de jeunes garçons et de jeunes filles. Huysmans, dans Là-bas, a raconté toute cette histoire de son beau style subtil. L’extérieur retient davantage, avec sa chaire sculptée accrochée à l’un des contreforts. Des femmes coiffées de bonnets plats, à brides de tulle, comme j’en ai vu tout à l’heure chez la repasseuse, les épaules recouvertes d’un grand fichu ou d’un petit châle noir frangé posé en losange sur leurs épaules, entrent dans l’église ou en sortent. Il est bien rare qu’une église soit déserte en Bretagne. Il y a toujours quelque bonne femme agenouillée au bord d’une chaise, sur une dalle ou sur une pierre tombale, un prêtre qui circule, un bedeau qui fait le ménage.
Il est à Vitré d’autres églises : Saint-Martin, de construction récente, bâtie sur l’emplacement du château de Rivalon, l’intérieur orné selon l’art du quartier Saint-Sulpice à Paris ; Sainte-Croix, ancien prieuré de l’abbaye de Marmoutier, fondé en 1076 par Robert de Vitré, rebâtie au commencement du XIXe siècle. Tout ceci nous mènerait à l’histoire religieuse de Vitré, si nous avions le loisir de nous arrêter ainsi au début du chemin. Qu’il suffise de dire que les couvents abondent au temps des barons catholiques romains, qu’ils diminuent à l’avènement des La Trémoille, qui sont de la religion réformée, qu’ils reparaissent après la révocation de l’édit de Nantes.
Je m’en vais au château des Rochers, chez Madame de Sévigné. En route, le voiturier causeur me dit que la ville fait gros commerce de beurre, de grains, de fourrages, de bonneterie en laine, de passementerie, de boissellerie, de vannerie, de cuir, de cire, de miel. Nous avons aussi, me dit-il, de belles carrières de pierre à bâtir. Et de mon côté je me remémore une lettre de Madame de Sévigné, lue avant de quitter Paris, informant Madame de Grignan qu’il y a un bon tailleur à Vitré, et de bonne toile. C’est la femme d’un La Trémoille qui avait eu l’idée, en 1522, de faire venir des tisserands de Belgique pour former des apprentis. En peu de temps, chaque fermier eut son métier à tisser ; le chanvre était cultivé partout. L’hiver, à la veillée, assises autour des cheminées, les femmes teillaient tandis que les hommes peignaient les étoupes avec des peignes à dents de fer accrochés, de distance en distance, à hauteur de main, à des traverses assujetties contre le mur. Les toiles exportées en Hollande, en Espagne, en Angleterre, furent une cause de richesse. Il en est, me dit-on, resté quelque chose.
Nous avons traversé le boulevard des Jacobins, nous nous sommes engagés sur le boulevard des Rochers, planté d’érables, de chênes, de quelques châtaigniers. La route est bordée de haies. Le terrain ondule doucement. Il fait un joli soleil d’après-midi. On passe devant une chapelle, on arrive à l’embranchement de deux chemins, l’un qui descend vers Argentré, l’autre qui monte en pente légère et longe le mur du jardin des Rochers. Bientôt c’est une terrasse étendue où se trouvent, à droite les communs du château, et au fond, à gauche, la chapelle et l’habitation de Madame de Sévigné.
Le château, dont les constructions, le jardin et l’ancien parc, aujourd’hui séparé par une grille de l’ensemble de la propriété, s’élèvent au sommet d’une colline, a été bâti du XIe au XIVe siècle. Le corps de logis principal, de style gothique, est flanqué de tours et d’une tourelle en poivrière servant de cage à l’escalier. Une tour séparée, construite en 1671, par les soins de l’abbé de Coulanges,1 dit le Bien-Bon, a été aménagée en chapelle : la première messe y fut dite, quatre ans après son achèvement, en décembre 1675.
L’illusion du séjour de Madame de Sévigné a été conservée, par l’extérieur du château d’abord, par la chapelle, par les jardins, par la chambre de la marquise, ensuite. Une femme de service est le guide des visiteurs ; elle sait la place et la destination de chaque objet, l’emploi de tous les moments de la journée de la châtelaine, l’heure à laquelle elle se levait, selon le jour de la semaine et la saison. Elle indique ses endroits préférés, suit le chemin qu’elle parcourait pour aller s’appuyer à la balustrade de la terrasse d’où elle admirait l’horizon, ou pour conduire ses invités aux pierres sur lesquelles ils se plaçaient pour entendre l’écho des paroles, des chants ou des cris. La préposée s’est tellement identifiée à l’existence du château d’autrefois qu’il lui arrive, me semble-t-il, de mettre au temps présent les petits faits qu’elle relate, disant par exemple :
– Madame la marquise ne « passe » jamais par ici... ne « va » jamais là...
Cette femme, jeune encore, qui vit son existence parmi ces souvenirs, peut s’imaginer qu’elle va voir un jour tourner l’avenue par quelque vieux carrosse, ou par une antique berline chargée de seigneurs et de dames venant faire visite à Mme de Sévigné. En attendant, elle explique comment le château des Rochers est devenu la propriété des Sévigné à la suite du mariage d’Anne de Mathefelon, dame des Rochers, avec Guillaume de Sévigné, chambellan du duc de Bretagne, Jean IV, fils de Jean de Montfort. Le château passa ensuite aux mains de la petite-fille de la marquise, Pauline de Grignan, marquise de Simiane, puis en 1714, il fut acquis par les Nétumières, ses propriétaires actuels. J’entends cela, et je vois les détails de la chapelle, les ornements, les peintures, les cadres aux armes de Bussy-Rabutin, le lustre de cuivre doré en forme de fleur de lis, les fauteuils rangés devant l’autel, qui semblent attendre les fidèles d’il y a deux cents ans. Je vois la chambre où chaque meuble, chaque objet, occupe toujours la place qui lui fut assignée. Voici le lit à baldaquin partagé pendant si peu d’années avec le dissipé et peu fidèle marquis. Voici, devant une croisée, la table-bureau où la marquise aimait à s’installer pour écrire à sa fille. En face de la fenêtre, sous la copie du portrait de Mignard, voici la vitrine des reliques : l’encrier, la tasse, un compte de dépenses dressé par Beaulieu, le maître d’hôtel. Les fauteuils, les chaises, n’ont pas été dérangés. Le coffre à bois, vermoulu, a dû être remplacé. L’architecte a fait copier l’ancien modèle et, tandis que je parcours la pièce, une jeune fille en sarrau s’applique à imiter la décoration du premier meuble. D’autres meubles, prêts à tomber de vétusté, sont réparés sur place par un ouvrier qui bouche les trous, fait les raccords, consolide, à l’aide de brides et d’équerres, les pieds et les dossiers branlants. Auprès du lit, au-dessus d’une petite commode-toilette encore garnie de ses accessoires, sourit une miniature de la marquise, très jeune, la chevelure ébouriffée, les yeux grand ouverts, les joues roses, comme si elle revenait d’une randonnée à travers le parc.
Au jardin, tracé par Le Nôtre, les allées sont ombragées par des cèdres plantés au commencement du siècle dernier. Les caisses d’orangers s’alignent le long de l’avenue centrale qui conduit à la grille du parc, et à la muraille basse qui renvoie en échos les ondes sonores de la voix humaine. Deux pierres marquent l’endroit où ce phénomène, « petit rediseur de mots jusque dans l’oreille », est le plus sensible. À droite du château, c’est le parc dont il est tant de fois parlé dans les Lettres, ce « bois de décoration, garni de grands et anciens bois de haute futaie, dans lequel il y a plusieurs bocages, de belles et grandes allées, un jeu de mail, un labyrinthe, des garennes et refuges à lapins, vergers, champs et semis. » Ce labyrinthe, qui occupait la place du potager actuel, a beaucoup tracassé Mme de Sévigné : elle a mis dix-huit ans, de 1667 à 1695, pour l’amener au point qu’elle voulait. Elle avait donné des noms aux différentes allées de son parc : elles se nomment, dit-elle, « la Solitaire, si belle et si bien plantée, qui contient douze cents pas, la plus belle de mes allées ; l’Infinie, allée courbe dont on n’aperçoit aucune extrémité ; la Sainte Horreur ; l’Humeur de ma mère ; l’Humeur de ma fille, appelée aussi le Mail, encore plus beau que tout le reste, où règne un silence, une tranquillité, une solitude que je ne crois pas qu’il soit donné de retrouver ailleurs. »
Ce parc faisait l’admiration de tous les hôtes et visiteurs. Monsieur de Coulanges, le bon oncle, a même écrit : « On ne peut assez louer les allées des Rochers, elles auraient leur mérite à Versailles. » Malgré les transformations, on ne peut se défendre de revoir la jeune veuve qui fit ici des séjours prolongés, qui trouva la consolation, le repos, la gaieté, l’inspiration, au parcours de ces allées, qui apprit dans ce pays à connaître des hommes simples, vivant loin du bruit des cités et du faste des cours. Mme de Sévigné venait là pour faire des économies, pour suspendre le désordre, pour faire payer ses fermages : « Poi*nt d’argent qu’à la pointe de l’épée, écrit-elle ; des petits créanciers dont je suis étranglée ; des chevaux de carrosse à racheter ; en sorte que j’ignore comme j’aurais pu faire. Au lieu qu’en passant l’hiver en ce pays, j’aurai le temps de respirer ; je m’amuserai à payer mes dettes et à manger mes provisions. » Pour payer des dettes, il faut faire rentrer des créances, et la chose, paraît-il, n’était pas toujours commode : « Pour me faire payer, je ne veux entendre ni rime ni raison. C’est une chose étrange que la quantité d’argent qu’on me doit. Je dirai toujours comme l’avare : de l’argent, de l’argent. » Relisez la lettre où Mme de Sévigné met sa fille au courant de ses ennuis :
« Aux Rochers, samedi 15 juin 1680
« Je mandais l’autre jour à Madame de Vins que je lui donnais à deviner quelle sorte de vertu je mettais ici le plus souvent en pratique, et je lui disais que c’était la libéralité. Il est vrai que j’ai donné d’assez grosses sommes depuis mon arrivée : un matin, 800 francs ; l’autre, 1000 francs ; l’autre, 5 ; un autre, 300 écus ; il semble que ce soit pour rire, ce n’est que trop une vérité. Je trouve des métayers et des meuniers qui me doivent toutes ces sommes, et qui n’ont pas un unique sou pour les payer : que fait-on ? Il faut bien leur donner. Vous voyez bien que je n’en prétends pas un grand mérite, puisque c’est par force ; mais j’étais toute prise de cette pensée en écrivant à Madame de Vins et je lui dis cette folie. Je me venge de ces banqueroutes sur les lods et ventes. Je n’ai pas encore touché ces 6000 francs de Nantes : dès qu’il y a quelque affaire à finir, cela ne va pas si vite.
« Je vis arriver l’autre jour une belle petite fermière de Bodégat, avec de beaux yeux brillants, une belle taille, une robe de drap de Hollande, découpée sur du tabis,2 les manches tailladées. Ah ! Seigneur, quand je la vis, je me crus bien ruinée ; elle me doit 8000 francs. Ce matin, il est entré un paysan avec des sacs de tous les côtés : il en avait sous ses bras, dans ses poches, dans ses chausses, car en ce pays, c’est la première chose qu’ils font que de les délier ; ceux qui ne le font pas sont habillés d’une étrange façon : la mode de boutonner le justaucorps par en bas n’y est point encore établie ; l’économie est grande sur l’étoffe des chausses, de sorte que depuis le bel air de Vitré jusqu’à mon homme, tout est dans la dernière négligence. Le bon abbé, qui va droit au fait, crut que nous étions riches à jamais. ‘Ah ! Mon ami, vous voilà bien chargé ! Combien apportez-vous ?
« – Monsieur, dit-il, en respirant à peine, je crois qu’il y a bien ici trente francs.’ C’étaient tous les doubles3 de France, qui se sont réfugiés dans cette province avec les chapeaux pointus,4 et qui abusent ainsi de notre patience. »
Mme de Sévigné est ainsi occupée de questions d’argent. Ses lettres et les souvenirs contemporains décèlent parfois chez elle un état de gêne. Cependant, le jour où Marie de Rabutin-Chantal épousa, à l’âge de dix-huit ans, le marquis Henri de Sévigné, seigneur de Sévigné, de Coatquen, de Bodégat, d’Étrelles, de Lestremeur, de Launay, maréchal de camp et gouverneur de Fougères, ce jour-là, le 1er août 1644, elle apporta en dot 100.000 écus, ce qui constituait à l’époque un joli denier. Mais le marquis, dont la vertu conjugale n’avait rien d’exemplaire, ne se piquait pas non plus d’être un modèle d’ordre et d’économie. Sa mort violente, survenue sept ans après son mariage, dans un duel avec le chevalier d’Albret, n’empêcha pas, d’ailleurs, la marquise de continuer le train de maison établi. Puis, il lui fallut placer son fils et doter sa fille. On acheta au jeune marquis Charles de Sévigné une charge de lieutenant aux Gendarmes-Dauphin.5 Le jeune officier parut plus occupé de galanteries que d’études de stratégie et de tactique. La liste de ses conquêtes serait longue à dresser, depuis la Champmeslé jusqu’à Ninon de Lenclos, qui le considérait comme « une âme de bouillie, un corps de papier mouillé, une vraie citrouille fricassée dans de la neige. »
Donc, aux Rochers, le train est fastueux au temps de la marquise. Il y a un nombreux personnel domestique : le régisseur et sénéchal Vaillant ; le concierge Rahuel ; le maître d’hôtel Beaulieu et son épouse Hélène Delan, première femme de chambre ; Marie, fille du jardinier, qui n’a point de fonction attitrée, mais qui sait se rendre utile ; Hébert, un autre maître d’hôtel, qui abandonnera sa place pour une meilleure à l’hôtel de Condé ; Lamerchin, valet de chambre du jeune marquis ; Pilois, le jardinier qui conduisait les travaux du parc sous la direction de la châtelaine ; d’autres laquais, La Beauce, qui faisait le service de la poste à Vitré, La Brie, Rencontre, Picard ; les cochers et palefreniers Lombard, Langevin, Laporte ; les femmes, Jacquine, La Turquesine. On pense bien que tous ces gens n’avaient pas seulement à s’occuper du service de la châtelaine. Il y a toujours aux Rochers de nombreux invités, en dehors du fils prodigue et de l’abbé de Coulanges, dit le Bien-Bon, homme d’ordre qui a la manie de bâtir et le goût de la table et des vins, et qui a tant bu et bâti qu’il finit par mourir. Il est remplacé par l’abbé de la Mousse, qui a toujours mal aux dents, et qui égaye Mme de Sévigné de sa naïveté. Puis un cousin de la famille, Monsieur de Coulanges, convive gai, rond comme une boule ; Messieurs de Chésières, de Saint-Aubin, frères du Bien-Bon ; le comte des Chapelles qui aide à faire les honneurs et complète des bouts-rimés. Les voisins aussi fréquentent assidûment ; ils trouvent le logis hospitalier et la table à leur goût. C’est la princesse de Tarente, veuve du duc de la Trémoille, qui habite un manoir du voisinage, le Château-Madame. C’est Monsieur du Plessis et sa sœur, qui louche, et qui excite singulièrement la verve de Mme de Sévigné : « J’appelle la Plessis Mademoiselle de Kerlouche, la Biglesse. Cette dernière a quelque chose de si étrangement beau et de si furieusement agréable qu’elle peut aller de pair avec l’aimable Tisiphone.6 Une lèpre qui lui couvre la bouche est jointe à cette prunelle qui fait souhaiter un parasol au milieu des brouillards ; elle a une manière de peste sur les bras ... elle salue avec sa roupie ordinaire. » Avec tous ces agréments, la pauvre demoiselle du Plessis a la manie d’embrasser : « Elle me plante ce baiser que vous connaissez tous les quarts d’heure ... Son goût pour moi me déshonore ; je lui dis des rudesses abominables ... Vous savez que par l’autre bout, ma lunette éloigne ; je la tourne sur Mademoiselle du Plessis et je la trouve tout d’un coup à deux lieues de moi. » La visiteuse a d’autres défauts : « Elle est justement et à point toute fausse. Je lui fais trop d’honneur de daigner seulement en dire du mal. Elle joue toutes sortes de choses ; elle joue la dévote, la capable, la peureuse, la petite poitrine, la meilleure fille du monde ; mais surtout elle me contrefait ; de sorte qu’elle me fait toujours le même plaisir que si je me voyais dans un miroir qui me fît ridicule, ou que si je parlais à un écho qui me répondît des sottises. » Voilà un portrait. Il y en a d’autres, celui de Madame de la Hamelinière, par exemple, qui vient de vingt-huit lieues et « tombe au château comme une bombe, à l’heure où j’y pense le moins. Cette espèce de beauté a un amant à bride abattue, à qui elle emprunte son carrosse, ses chevaux, ses laquais. »
Avec ce perpétuel va-et-vient, on comprend que l’existence menée aux Rochers soit dispendieuse. Il y a toujours une nuée d’ouvriers qui bâtissent, qui plantent, qui arrachent, qui taillent, qui coupent. C’est ce que Mme de Sévigné appelle une vie réglée. L’esprit, toutefois, garde ses droits. Durant l’intervalle des visites, la lecture occupe les heures. C’est Monsieur de Sévigné fils qui lit, et qui lit cinq heures de suite, et qui « joue comme Molière ». On ne lit aux Rochers que des ouvrages graves, profonds. Les romans de La Calprenède, de Mademoiselle de Scudéry, de Madame de Lafayette, « ont gagné les petites armoires. » On commente Saint Augustin, Bourdaloue, Bossuet. La logique de Port-Royal est familière. Pascal est goûté pour son style « incisif et piquant ». La philosophie de Descartes est invoquée : « Elle me paraît d’autant plus belle qu’elle est facile et qu’elle n’admet dans le monde que des corps et du mouvement, ne pouvant souffrir tout ce dont on ne peut avoir une idée claire et nette ... elle détrompe d’un million d’erreurs où est tout le monde, et apprend à raisonner juste. » La Rochefoucauld est un ami de la maison, ses Maximes sont divines. Montaigne est prisé, mais Pauline, la petite fille, ne doit pas encore mettre son petit nez dans ses livres : « Il est trop malin pour elle. » On aime Rabelais, Corneille, Boileau, La Fontaine, on est injuste pour Racine.
Mais il me faut quitter ces souvenirs et ce séjour. De la terrasse, on voit pointer le clocher d’Étrelles, où Mme de Sévigné allait chercher la messe avant que sa chapelle fût consacrée. Non loin, sur la jolie route qui mène à Argentré, c’est le château du Plessis où habitait la demoiselle si maltraitée aux Rochers : il est aujourd’hui recrépit, blanchi, aimable, dans son décor de pelouses et de bosquets.
Je reviens à Vitré et je pars pour Fougères. En route Dampierre, où sont deux blocs de quartzite appelés le Saut-Roland, entre lesquels coule la Cantache. La tradition raconte que le chevalier Roland, après avoir franchi plusieurs fois, à cheval, l’espace qui sépare les deux rochers, aurait fini par tomber dans le gouffre : l’empreinte du sabot du cheval est, dit-on, visible sur le roc. Non loin de là, une autre roche nommée la Pierre-Dégouttante, d’où jaillit une source : ce sont les larmes de la « dame » du paladin qui creusent le roc depuis des siècles. J’oublie ces légendes devant la réalité de Fougères. Fougères est une jolie ville de vingt mille habitants. Elle était jadis le titre d’une baronnie fondée au XIe siècle par Méen, fils de Juhel Bérenger, comte de Rennes. Méen fit bâtir un château au fond de la vallée où passe aujourd’hui le chemin de fer. Des maisons s’élevèrent ensuite sur la hauteur voisine, à distance respectueuse. D’habitude, aux temps féodaux, c’était le contraire : les maisons dans la vallée, le château sur la hauteur. Est-ce ce vice de construction qui fit prendre la ville et raser le château, un siècle et demi plus tard, par la faute d’un successeur de Méen qui eut l’imprudence de déclarer la guerre à l’Angleterre ? Fougères, relevée de ses ruines, fut assiégée à plusieurs reprises : en 1230, par Pierre de Dreux ; en 1372, par Du Gueslin ; en 1448, par un aventurier à la solde de l’Angleterre, François de Surienne. La baronnie étant passée aux ducs de Bretagne, François II dut assiéger la ville pendant cinq mois pour l’arracher à Surienne. À la suite d’une insurrection, Charles VIII envoya en Bretagne une armée qui s’empara de Fougères après dix jours de siège. Pendant toute la durée de la Ligue, la ville fut occupée par le duc de Mercœur. Au XVIIIe siècle, Fougères était une agglomération de maisons presque toutes bâties en bois : elles furent à six reprises la proie des flammes. En 1792, à la suite de la conspiration de la Rouërie, treize Fougerais furent exécutés sur une place de la ville. Le 19 mars 1793 la garde nationale battit et repoussa une bande de huit mille Chouans. La même année, le 4 novembre, les Vendéens prenaient la ville d’assaut, l’abandonnaient, la reprenaient, la perdaient : elle resta en état de siège jusqu’à la fin de la Chouannerie, c’est-à-dire jusqu’au Consulat.
C’est donc tout d’abord comme un champ de bataille qu’apparaît la vallée de Fougères, avec son amas de maisons au sommet de la colline, ses murs, ses fossés, ses remparts, au bas desquels achève de se désagréger la ruine, réparée çà et là, de son château-fort. La vie, pourtant, lutte doucement contre les souvenirs de mort. Les maisons ont rompu l’enceinte, descendent tranquillement la pente, s’arrêtent gentiment au pied de la colline où coule le Nançon : on dirait qu’elles se sont enhardies à sortir de leur prison, à courir la campagne. Si l’on va au château par la droite, en prenant le boulevard qui traverse la ligne du chemin de fer, et que l’on s’arrête sur l’emplacement des fossés comblés, on peut se rendre compte de ce qu’était l’ancienne ville. Les fondations des vieilles maisons s’appuient sur les murailles prêtes, croirait-on, à s’écrouler, tant elles sont lézardées, trouées de toutes parts, comme s’il y avait partout traces de boulets et de mitraille. Parmi ces constructions, dont les pignons surplombent le gouffre, s’élèvent encore de vieilles tours, aux meurtrières desquelles pendent des linges ou des hardes qui sèchent, reliées à des maisons aux toits pointus. Dans les crevasses des remparts verdissent et fleurissent des jardins en terrasses, des tonnelles ombragées d’arbres fruitiers et de plantes grimpantes. Plus haut, des balcons, des fenêtres étroites, des toits en ardoise s’enchevêtrent en fouillis capricieux tracé par une géométrie de hasard. Tout cela vu à travers les ramures de grands arbres qui encadrent ce tableau de ruines, et lui donnent, au jour où je l’aperçois, une étrange splendeur d’automne.
Du boulevard de Rennes, le même panorama se présente sous une autre face. On devine les artifices à l’aide desquels une science architecturale rudimentaire a pu étayer tout un quartier sur des ruines, en appuyant des constructions sur des murs crénelés, d’une épaisseur extraordinaire, défiant les secousses des ouragans et la désagrégation des pluies. Des ruelles étroites, escarpées, des marches de pierre que l’on s’essouffle à gravir, conduisent à des cassines, misérables à l’extérieur, très propres à l’intérieur. Tous ces faubourgs sont peuplés d’un monde de travailleurs exerçant l’industrie des tissus, la tannerie, la cordonnerie, exploitant des carrières de granit, s’employant à la verrerie de Laignelet.
Je suis là un dimanche ; un fumet de rôti embaume ces quartiers. Il est midi, on rencontre à chaque pas des ménagères qui, à l’issue de la messe, rapportent au logis, à plat découvert, le gigot ou la volaille rôtis chez le boulanger. C’est la bombance hebdomadaire, le festin dominical. Un tel jour, il faut bien passer sa matinée dans les rues : les offices empêchent la visite des églises, le château est fermé jusqu’à midi, on ne peut que se promener à travers les boyaux étroits des vieux quartiers ou dans les rues larges que bordent les constructions modernes. On respire bien un peu trop les mauvaises odeurs des rues du Marché, des Vallées, du Nançon, des Tanneurs, mais les aspects qu’on y aperçoit offrent une compensation. Les enseignes y deviennent une distraction, on y apprend que « Benoit, sonneur » est « au fond de la ruelle ». À chaque pas, on est arrêté par une vieillerie, une relique encastrée dans une muraille et respectée par la truelle des maçons et le balai à chaux des badigeonneurs.
On parvient ainsi, par la rue du Fos-Querally, aux limites des anciennes murailles et à la porte Saint-Sulpice, flanquée de tours, qui a échappé à la destruction. Presque tout de suite, c’est la flèche penchée de Saint-Sulpice, ancienne chapelle transformée en église au XIe siècle, et dont l’ensemble n’a été achevé qu’à la fin du XVIIIe siècle. Les murs extérieurs sont ornés de gargouilles, de têtes de chiens aux gueules grimaçantes. À l’intérieur, le retable d’un des autels, sculpté dans le granit, représente les instruments de la passion du Christ et les trois croix du Calvaire, le tout encadré de pampres garnis de fruits mûrs naïvement coloriés. Sous le tabernacle, dans une vitrine, une petite idole en cire : sainte Viviane. Auprès d’un autre autel, dans une niche, un saint Roch assis sur une pierre, et devant lui une pénitente à genoux. On marche sur des pierres tombales aux inscriptions à demi effacées. Aux murailles, des peintures du XVIIe siècle, un Sacrifice d’Abraham, une Assomption ; dans une chapelle, une Descente de croix, de Deveria.
Il faut repasser la porte Saint-Sulpice pour arriver à l’entrée du château, dont la silhouette ruinée se dresse en face d’une colline dans laquelle il semble vouloir enfoncer l’éperon audacieux d’un angle avancé. On répare, on refait, on arrivera peut-être à remettre en état la forteresse féodale. Je crains pourtant que l’on n’aboutisse qu’à un décor neuf et banal. Telle qu’elle est, cette ruine garde au contraire son caractère et sa majesté et donne suffisamment à voir comment les lignes, les angles, la direction des créneaux, des meurtrières, la perspective des chemins de ronde, les trappes des mâchicoulis, avaient été combinés pour résister aux attaques et aux coups de mains des troupes les plus hardies. Les corps de logis ont été rasés en partie et remplacés, à côté de l’ancien puits, par une construction en planches qui servait, il y a peu de temps, d’écurie aux chevaux d’un officier supérieur, logé au pavillon d’entrée. La cour est devenue un jardin d’herbes folles, un verger de hasard où des pommiers et des poiriers croissent parmi les gazons, les orties, les fleurs. On peut être tenté d’envier le militaire qui eut l’idée de louer à la municipalité de Fougères cette retraite, où, tout en voisinant avec la civilisation d’une ville, il pouvait se croire détaché dans quelque lointain poste avancé, garnisaire d’un pays abandonné par ses habitants. Quand, dans une vingtaine d’années, un jardin anglais aura remplacé ce Paradou, que les murailles seront relevées, les tours recrépies, on ne pourra guère s’imaginer ces débris d’aujourd’hui, où se résume l’histoire de Fougères.
Lorsque, par la faute de Raoul II, le château bâti par Méen eut été rasé, on entreprit, en 1173, de réédifier la forteresse actuelle. Les conquérants y ont tous laissé des traces de leur passage. Le baron Raoul y a sa tour. Une autre tour est désignée du nom de l’aventurier Surienne. Ces trois autres barons ont marqué la date de leurs règnes : Geoffroy, Hugues et Guy de Lusignan, descendants de la fée Mélusine. Plus tard, les ducs de Bretagne, devenus maîtres de la baronnie de Fougères, modifient, consolident la forteresse, notamment le duc Pierre, mari de Françoise d’Amboise. L’entrée est protégée par trois tours, dont les toitures ont été réparées ; cinq autres tours protégeaient la place proprement dite. L’une d’elles, la tour de Coigny, couvrait la chapelle. Une autre a été abattue. Les trois suivantes font face à l’église Saint-Sulpice : la tour du Cadran, la tour Raoul, la tour Surienne. Le donjon n’existe plus. Sur d’autres points s’élèvent les tours Guibé, du Gobelin, du Hallay, de Pléguen et d’Amboise. L’une de ces tours, celle du Gobelin, abrite un musée fermé pour l’instant et mis sous scellés. Du haut du chemin de ronde rempli de gravats, on a une vue sur la ville, les environs, la colline avoisinante. En bas, vers Saint-Sulpice, des jeunes gens jouent paisiblement aux boules dans les fossés où fut versé tant de sang. Tout au loin, la barre sombre de la forêt de Fougères.
La ville regagnée, c’est Saint-Léonard au portail gothique flamboyant, à la balustrade renaissance ; c’est l’ancien couvent des Ursulines qui abrite le collège et la bibliothèque ; c’est l’abbaye de Rillé où logent les sourds-muets ; c’est la tour du Beffroi de l’Auditoire, où le timbre de l’horloge date de 1304 ; c’est, auprès de la gare, une construction entourée d’un vaste terrain, allées et pelouse, semblable à une piste de vélodrome, et qui est le château de la Chinardière. Hors la ville, c’est la verrerie de Laignelet, à trois kilomètres, et c’est la forêt.
Ses 1700 hectares appartiennent au domaine public. Tous les arbres y croissent, surtout le chêne. La route qui conduit à Louvigné-du-Désert la traverse. Non loin de cette route subsiste un chapelet de quatre-vingt blocs de quartz peu élevés, le « Cordon des Druides ». Les prêtres du culte ancien enseignaient là que « la matière et l’esprit sont éternels ; que l’univers, bien que soumis à de perpétuelles variations de forme, reste inaltérable et indestructible dans sa substance ; que l’eau et le feu sont les agents tout-puissants de ces variations, et par l’effet de leur prédominance successive, opèrent les grandes révolutions de la nature ; qu’enfin, l’âme humaine, au sortir du corps, va donner la vie et le mouvement à d’autres êtres. » Au VIIIe siècle, après les dernières conquêtes du christianisme, les Cordeliers bâtirent une chapelle dont on voit encore les ruines à proximité du Cordon des Druides. Et tout près, en suivant l’allée des Hauts-Vents, est la Pierre du Trésor, dolmen à demi renversé par la chute d’un arbre. Pierres druidiques et ruines de chapelles font bon ménage. En somme, les premiers prêtres catholiques se sont bornés à s’installer auprès de ces monuments, qu’ils ont respectés comme s’il y avait eu en eux – qui sait ? – un mélange de croyances, une crainte de profaner le culte d’hier. Ce sentiment devait être, après tout, celui des populations à gagner. Les transitions peuvent être presque invisibles, dans les phénomènes du monde moral, comme dans les phénomènes du monde physique. Il y a des états intermédiaires entre les idées comme entre les époques et les saisons. C’est ainsi que le premier christianisme a pu être mélangé de druidisme. On a pu accoler l’oratoire au dolmen, ou fixer une croix au sommet du menhir, et la vie religieuse n’a pas eu, peut-être, de solution de continuité.
Si l’on ne prend pas le chemin de fer pour aller de Fougères à Louvigné-du-Désert, si l’on continue à suivre la route nationale qui traverse la forêt, on laisse, sur la gauche, Parigué et son menhir renversé, l’Épaulée du Diable, une croix ancienne dans le voisinage du château de la Villegontier, l’étang de la Lande Morel, puis Villamée, sur la droite, La Bazouges-du-Désert, bourg assez important avec ses deux châteaux, La Bignette et La Boizardière.
2. --- Antrain. – La route de Combourg. – Combourg. – Les « sensures ». – Le château de Combourg. – L’enfance de Chateaubriand. – Sa chambre. – Le marché aux cochons. – L’étang. – L’hôtesse-cuisinière et l’hôtelier-ébéniste. – Rennes. – Impression de Versailles. – Le grand incendie de 1720. – La ville reconstruite. – Les monuments et les maisons historiques. – Les églises. – La vie ouvrière d’autrefois. – La forêt.
De Fougères à Antrain, par le chemin de fer, on touche Saint-Germain-en-Coglès, où sont les galeries couvertes du rocher Jacault ; la chapelle de Saint-Eustache, où les femmes stériles viennent demander la fécondité ; Saint-Brice-en-Coglès, avec ses deux châteaux, celui de la Tourche-Limousinière, qui date du Moyen-âge, celui de Rocher-Portail, construit sous Henri IV ; Tremblay et son église du XIe siècle. À Antrain, où je m’arrête, il y a une diligence pour Combourg.
Le postillon est un Combourgeois, très causant, très aimable. Le cheval est vicieux, entêté, cornu, réformé de l’armée, et gâté par plusieurs générations de conscrits inexpérimentés. Ce coursier, assez docile sur la grande route, est intraitable dans les rues du bourg d’Antrain. Sitôt attelé, il veut courir, et c’est au petit bonheur, pendant qu’il essaie son trot et son galop, qu’il faut sauter dans la voiture. Enfin, on part. Avant de partir, j’ai vu les vieilles maisons à sculptures de bois, j’ai admiré les grasses prairies arrosées par l’Oysance et le Couesnon, j’ai goûté les truites dont le renom est mérité, j’ai appris que l’église ne renferme rien de curieux, et que le château de Bonne-Fontaine, situé à un kilomètre et remontant au XVIe siècle, n’est pas ouvert aux étrangers.
Le trajet d’Antrain à Combourg est d’environ 25 kilomètres. La voiture traverse un plateau d’où l’on a vue sur tout le pays : au nord, la forêt de Villequartier, dans la direction de Pleine-Fougères, et à l’opposé, vers Saint-André-du-Cormier, les bourgs de Rimaux et de Romazy, bâtis sur des sommets qui dominent la vallée du Couesnon. La vue s’étend sur ce vaste panorama moutonné où se développent, d’une part, une chaîne de hauteurs qui, dans la direction du Sud, vient finir à la forêt de Rennes, à quelques kilomètres de Liffré, et d’autre part, les terrains plus abaissés qui se heurtent aux vallonnements dominant Pontorson, Pleine-Fougères et le marais de Dol. La route suit la direction Ouest, et l’on arrive à Bazouges-la-Pérouse où le courrier prend à la poste les sacs de dépêches. Je profite de l’arrêt pour visiter l’église qui conserve des morceaux du XIVe siècle : chapelle, bénitier, vitrail. La diligence se remet en route. À six kilomètres, arrêt à Noyal-sous-Bazouges, où se voit un menhir de cinq mètres de hauteur dont la base a une circonférence de près de huit mètres. Le conducteur a pris les lettres, on repart. C’est d’ailleurs, tout le long du chemin, un échelonnement de gens qui font voir de loin le carré blanc d’une lettre que le voiturier saisit au vol. Cela ressemble beaucoup au jeu des anneaux où s’exercent les cavaliers des chevaux de bois. Les physionomies des gens, leurs recommandations naïves, les nouvelles échangées, les renseignements fournis d’un mot coupé par le vent, éveillent la curiosité et l’incitent à se satisfaire. Le messager s’explique bien et posément, sur les gens, sur son métier, et enfin sur lui-même, sur le souci qu’il a de son service militaire. Il voudrait servir au train des équipages, s’y perfectionner dans la conduite des attelages et le maniement des chevaux, et revenir au pays et à sa profession, mais sa taille l’inquiète ; il craint l’infanterie, où peut-être il ne serait même pas muletier. Je ne puis, en descendant à la gare de Combourg, limite du trajet, que lui souhaiter bonne chance.
La gare de Combourg n’est pas Combourg. Encore 1500 mètres à faire. Je les fais à pied par une large route bordée de maisons. Dès les premières habitations du bourg, l’attention est mise en éveil par l’aspect pittoresque de cet amas de constructions qui ont conservé, en grand nombre, le caractère du XVIe siècle. L’« abominable rue de Combourg », selon l’expression de Chateaubriand, a été améliorée, on y a mis des trottoirs, la chaussée a été pavée, on a dressé, au cœur de la petite cité, une halle qui abrite le marché aux grains et les vendeurs qui viennent s’y installer chaque lundi et les jours de foire. Précisément, demain lundi sera un de ces jours où les cultivateurs et les éleveurs des environs viendront avec leur récolte et leur bétail. J’aurai le spectacle de cette animation hebdomadaire, mais par contre, on me dit qu’il me sera probablement impossible de pénétrer au Château, où les étrangers ne sont admis que le mercredi. Heureusement, Madame de Chateaubriand, petite nièce de l’illustre écrivain, est présente à Combourg. Elle veut bien, sur le désir que je lui fais transmettre, m’autoriser à visiter le domaine demain, après le déjeuner.
Je dispose donc aujourd’hui de toute la matinée pour parcourir les rues, faire le tour de l’étang, des murailles du château – hier soir déjà, j’ai vu se dresser dans la nuit sa masse rébarbative trouée de quelques lumières. C’est au cours de ma promenade circulaire du matin que je lis, à la porte d’une chaumière, dans un chemin en contre-bas du château, cette enseigne tracée sur une planche :
Ici on vend des sensures en toutes saisons
Vve trufaud a l’abaye
Pendant que je lis cette inscription, dont je respecte la forme et les caractères, et que je cherche à deviner ce que sont ces « sensures », la veuve Trufaud, qui m’a aperçu, va prendre un bocal sur une planche, dans sa petite maison basse composée de deux pièces au rez-de-chaussée. On parvient à l’entrée après avoir franchi un pont étroit fait de quelques planches de sapin d’un pouce d’épaisseur, réunies par deux traverses et jetées en travers du fossé. La bonne femme élève le bocal dans le soleil. Les « sensures » sont des sangsues.
– Voyez, me dit-elle, comme elles sont gentiles quand elles se dégourdissent à la lumière et à la chaleur. J’en ai dans toutes les saisons, et dame ! il y a des moments où c’est pas commode d’en attraper... Elles ont trois mâchoires, vous voyez bien, et c’est avec ça qu’elles percent la peau des malades. Ça avale jusqu’à trois fois son poids de sang. Ah ! les gourmandes.
– Et dans votre bocal, que mangent-elles ?
– Oh ! rien, je change l’eau, voilà tout. Ça jeûne pendant des années, cette engeance-là ! Tenez, regardez si elles se remuent. (Le fait est que les petites bêtes serpentent, s’agitent dans tous les sens.) On dit que ça ne voit pas clair, mais je crois bien que ces points noirâtres, qui brillent au soleil, ce sont leurs yeux.
– Où faites-vous votre pêche ?
– Dans l’étang de Combourg. Ah ! c’est pas commode de les prendre, allez !
– Vraiment ! Comment faites-vous donc ?
– Ah ! c’est un moyen que je peux pas dire, dame ! sauf le respect que je vous dois. Si tout le monde le savait !... Ça se vend assez bien dans des saisons. C’est pas pour dire, mais il n’y en a pas beaucoup dans le pays d’aussi bonnes. Tous les pharmaciens des environs m’en demandent. Dans l’étang, ça mange de tout, des limaces, des limnées, et puis quand les gamins vont se baigner, elles leur piquent les jambes... quand je suis là, je leur-z-y enlève. En voulez-vous quelques-unes, monsieur ?
– Non madame, merci ; au revoir.7
Je ne quitte pas pourtant la veuve Trufaud sans qu’elle m’ait montré son jardin, derrière sa maison, un jardin si petit que l’on ne peut pas y entrer deux : il y a trois choux, un puits, et un pied de vigne qui grimpe au mur.
Après avoir fait volte-face, la silhouette du château reparaît, puis disparaît dans l’épais feuillage des hauts arbres du parc. Il faut marcher jusqu’au tournant de la rue de l’Abbaye, près de la route de Dinan, dans le voisinage de l’étang, pour distinguer nettement les détails de cette forteresse que Chateaubriand a comparée à un « char à quatre roues ». L’ensemble est imposant et sévère. Les tours cylindriques, couronnées de créneaux, paraissent énormes au regard des constructions qui les réunissent. Les fenêtres grillées semblent des trous noirs comme des embrasures de canons, et les croisées étroites des tours sont pareilles à des meurtrières. Au pied des murs du château, la foule est occupée de la vente et de l’achat des porcs qui hurlent dans des cages. Tout ce monde bruyant est agité par les soucis du négoce au pied de ce grand château silencieux, et l’ensemble fait un décor de féerie étrange et folle.
Après le déjeuner, lorsqu’après avoir franchi la grille, je pénètre dans le parc qui précède le château à l’est et au nord, c’est d’abord une vaste clairière. Il faut tourner une allée avant de découvrir la masse de l’édifice flanqué de ses quatre tours. Les hôtes actuels sont assis sur le perron, comme autrefois. Je m’aperçois de Mme de Chateaubriand, assise dans une guérite d’osier, qu’une robe noire et deux mains qui tricotent. La châtelaine a mis à ma disposition une servante pour me guider dans ma visite.
J’entre dans un vestibule orné de peintures murales. La grande salle où se promenait le père de Chateaubriand, et qui servait de salon et de salle à manger, a été divisée en deux par une cloison. La grande cheminée a été conservée. Tout le mobilier est moderne à la façon des meubles luxueux de Paris. Dans une pièce voisine, c’est le bureau de Chateaubriand et une partie de sa bibliothèque. Au pied de l’escalier, le buste sculpté par David d’Angers, et tout en haut, la chambre où l’écrivain du Génie du Christianisme passa sa jeunesse. On l’a convertie en musée, on y garde le petit lit de fer où le vieillard est mort, le squelette du chat boiteux que l’on entend gravir l’escalier dans les Mémoires d’outre-tombe, une table chargée de livres, un encrier, quelques meubles d’une extrême simplicité. Ce qui donne l’émotion de la présence ancienne, ce sont les parois de cette petite chambre, c’est l’escalier par lequel on est monté, c’est la porte, c’est la fenêtre étroite, c’est la galerie sur laquelle on sort et d’où l’on aperçoit le vaste horizon. C’est là, dans ce réduit, c’est devant ces campagnes sévères et ce grand ciel chagrin, que s’est formée la sensibilité de l’homme et la tristesse du génie de l’écrivain. C’est cette tristesse qui a mis sa marque sur toutes choses, jusqu’à sembler une tradition perpétuée à travers les générations. Le parc, ses prairies, ses vergers, ses grands arbres, qui sont pourtant de belles choses vivantes, tout est triste ici depuis qu’une grande pensée triste s’est imposée à nous. Le château, qui fut tour à tour la propriété de Junken, évêque de Dol, des Tinténiac, de la famille Du Guesclin, de Geoffroy de Châteaugiron, des Coëtquen, du maréchal de Duras,8 semble avoir servi de réceptacle à l’humeur chagrine de toutes ces familles illustres, mais n’en croyez rien, c’est la tristesse de Chateaubriand qui remonte les temps et qui s’impose au passé.
L’existence menée là devait avoir une action profonde sur cet adolescent, son imagination ne pouvait que s’exalter dans cette atmosphère de silence forcé. Ce fut sa sœur Lucile qui lui donna le secret de faire de la vie avec cette mort. Comme elle l’entendait parler avec ravissement de la solitude : « Tu devrais peindre tout cela », dit-elle. « Ce mot, écrit Chateaubriand, me révéla la Muse ; un souffle divin passa sur moi. Je me mis à bégayer des vers, comme si ç’eût été ma langue maternelle ; jour et nuit, je chantai mes plaisirs, c’est-à-dire mes bois et mes vallons ... C’est dans les bois de Combourg que je suis devenu ce que je suis, que j’ai commencé à sentir la première atteinte de cet ennui que j’ai traîné toute ma vie, de cette tristesse qui a fait mon tourment et ma félicité. »
Tout le temps qu’a duré ma visite à Combourg, à chaque fenêtre ouverte, à chaque sortie sur un mur de ronde, j’aperçois le marché, j’entends sa rumeur qui monte vers les tours, avec l’aigre concert des cris des porcs. Ce n’est plus la tristesse de René, c’est la mêlée humaine et la bataille des intérêts. Ma foi ! cette vie qui continue malgré la mélancolie des poètes fait tout de même plaisir à voir, et je suis bien sûr que Chateaubriand, vieilli et morose, dut se rappeler plus d’une fois les gaietés à pleine rue qui assaillaient les auberges de Combourg. Lui aussi, en son intelligence et en son cœur, savait le prix du rire, et la figure du jeune homme amer et hautain qui hante cet étang, ce parc et ces hautes tours, n’est pas diminuée parce que le vieillard, revenu de tout, s’en allait dîner dans un cabaret du Jardin des Plantes et écouter les chansons de sa bonne amie.
Une dernière allée et venue au bord de l’étang, où il y a toujours les joncs et les nénufars, où il n’y a plus la barque légère de René et de Lucile. La nuit me surprend à quelques centaines de mètres de Combourg. Lorsque je rentre en ville, on arrime les dernières voitures autour du marché. L’hôtel Gentil est envahi par la foule. Les hommes sont en blouses, en vestes, mais il y a les costumes noirs et les coiffes des femmes de Bécherel, Hédé, Tinténiac, Miniac, la coiffe de Miniac en forme de mitre ailée.
Peu à peu, tout ce monde file par les routes, et je suis bientôt seul, libre de regarder à mon aise les boiseries sculptées qui couvrent les murs, de la cimaise au plafond. C’est le travail de l’hôtelier, et un bon travail, car les plateaux de châtaignier qui ont servi à la confection de ces boiseries ont été choisis dans de beaux bois refendus dans le sens du fil, ajustés et joints à merveille. Tout l’hôtel est d’ailleurs fait pour plaire. C’est la vieille auberge, la vieille cour et la vieille cuisine, des perdrix et des lièvres pendus dans la cage de l’escalier, des meubles massifs et cirés dans la salle obscure où l’âtre rougeoie. Et Madame Gentil n’est pas moins habile en art culinaire que Monsieur Gentil dans l’art du bois. Elle dirige avec autorité plusieurs aides, surveille une armée de casseroles et de coquilles qui mijotent sur le vaste fourneau. Elle est secondée, d’ailleurs fort bien, par une petite bonne toute menue qui n’a qu’un soupçon de nez au milieu de son petit visage rond, et qu’un commis voyageur facétieux désigne sous le nom de « Nez en moins ». La petite bonne nous sert, malgré cette plaisanterie inférieure, un repas délicieux, et elle s’en va, tout enorgueillie de plaisir, lorsqu’elle est chargée de compliments pour sa patronne. Le vin, surtout, est délicieux, et ce n’est pas la seule fois que j’aurai à remarquer la qualité des crus que possède la Bretagne. Si le raisin, chez elle, ne mûrit guère, le vin s’y bonifie.
Rennes, c’est la capitale. Un grand Versailles sans Versailles, c’est-à-dire sans le Château et le Parc, mais il y a les vastes avenues, les rues droites, l’herbe entre les pavés, et cette couleur grise de temps passé qui revêt toutes choses de sa mélancolie solennelle. Oui, quand on entre à Rennes après avoir traversé les campagnes resplendissantes des environs, c’est la même sensation qu’on éprouve en pénétrant à Versailles par les bois de Chaville et de Viroflay. À Rennes, comme à Versailles, les rues sont larges, les passants rares. C’est à peine si la vie s’anime sur les quais de la Vilaine, qui traverse la ville de l’est à l’ouest, endiguée par les murailles des quais surmontées de balustrades de fer. Ces murs se continuent, vers la droite, le long du canal d’Ille-et-Rance, et vers la gauche en suivant le cours de la Vilaine jusqu’au delà du coude des Abattoirs. De belles constructions s’étendent de chaque côté de l’eau, mais la ville est surtout bâtie sur la rive droite. C’est là que se trouvent les sièges de tous les organismes sociaux : la Préfecture, le Palais de Justice, l’Archevêché, le Théâtre, l’École d’Artillerie, l’Hôtel-Dieu, la cathédrale et la plupart des autres églises. La rive gauche est, comme à Paris, un quartier latin, le quartier des Écoles, et l’on y trouve, avec le lycée et le Musée, l’Hôtel des Postes et Télégraphes, l’Arsenal, le Champ de Mars, les Casernes. Des quartiers neufs se développent du côté du Jardin des Plantes. Dans sa plus grande largeur, du bout de la rue de Nantes à l’extrémité de la rue de Saint-Malo, la traversée de Rennes est de deux kilomètres environ.
Les deux rives de la Vilaine se joignent par quatre ponts. Le quartier de la rive droite s’appelle la Ville-Haute. Le caractère de l’architecture de Rennes est de la seconde moitié du XVIIIe