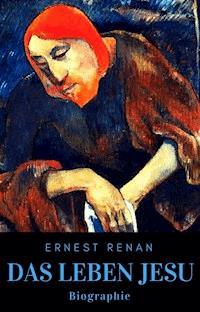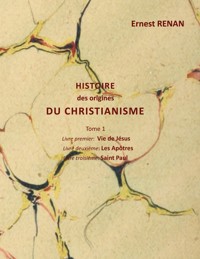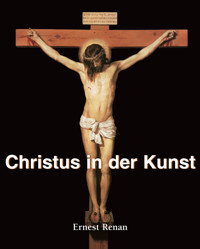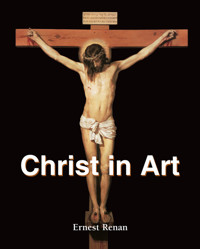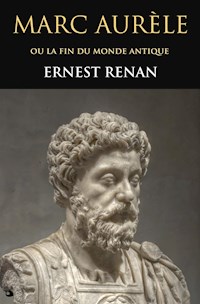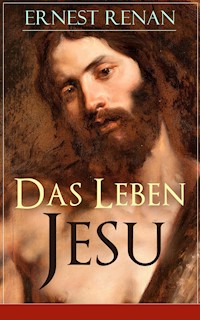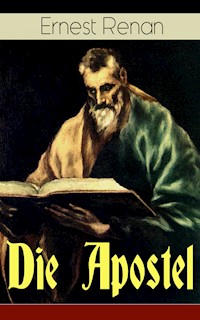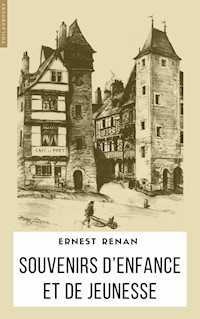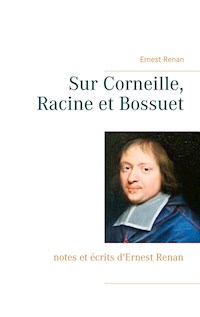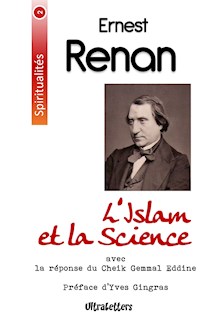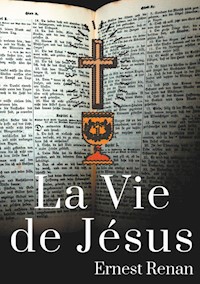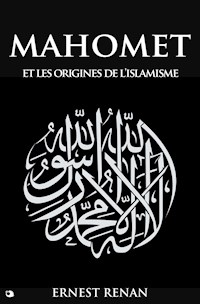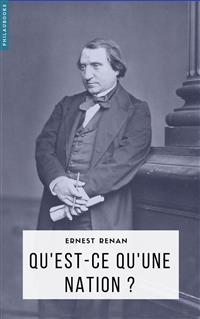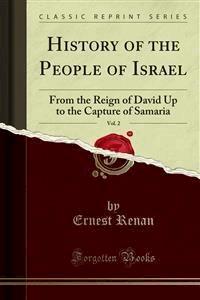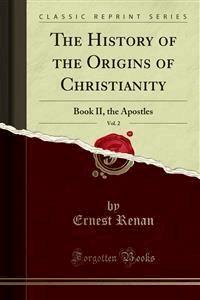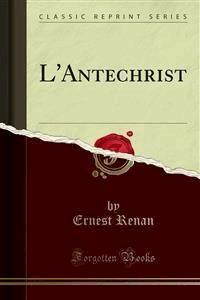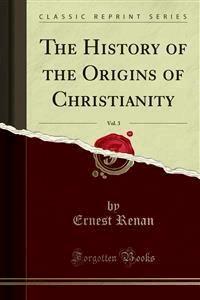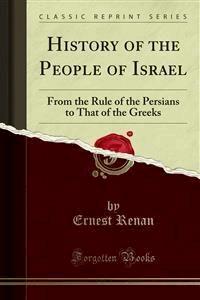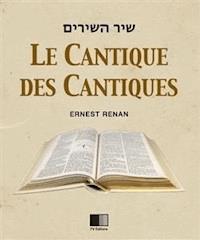
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FV Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Traduit directement de l'hébreu par Ernest Renan, cette version du Cantique des Cantiques reste l'unes des plus belles à ce jour.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Contenu
copyright
LE CANTIQUE
À M. LE BARON DE BUNSEN
PRÉFACE
ÉTUDE
I
II
III
IV
LE CANTIQUE DES CANTIQUES
TRADUCTION
LE CANTIQUE DES CANTIQUES
ACTE II.
ACTE III.
ACTE IV.
ACTE V.
ÉPILOGUE
Également Disponible
Notes de bas de page
copyright
Copyright © 2016 par FV Éditions
ISBN 979-10-299-0301-4
Tous droits réservés
LE CANTIQUEDES CANTIQUES
TRADUIT DE L’HÉBREU
AVEC UNE ÉTUDE
SUR LE PLAN, L’ÂGE ET LE CARACTÈRE DU POËME
PAR
ERNEST RENAN
MEMBRE DE L’INSTITUT
— 1884 —
À M. LE BARON DE BUNSEN
Quand je vous vis, il y a cinq mois, j’hésitais encore à donner au public ce livre, sur lequel la frivolité pourra facilement se méprendre. Vos exhortations et l’accord que je remarquai entre vos vues et les miennes me portèrent à ne pas m’interdire pour le malentendu des uns ce qui pouvait n’être pas sans fruit pour quelques autres. Vous m’apprîtes que le Cantique fait partie de votre Bible et que vous le relisez chaque année. Vous me fîtes comprendre que dans l’église que nous édifions tout sert au but de l’éternité, et vos entretiens me révélèrent de combien de joie (je ne dis pas de vulgaire gaieté) la vie serait pleine si on savait retrouver l’art de la passionner pour ce qui est beau et vrai. Lisez, ce printemps, la pastorale de Sulem sous vos orangers de Cannes, et venez bientôt nous redire que la science est une chose jeune, qu’elle suppose la fraîcheur de l’âme, et que, quand elle remplit la vie, elle empêche de vieillir.
6 avril 1860
PRÉFACE
Israël se laissait quelquefois distraire de sa haute destinée, et durant des siècles on vit ce peuple oublier la mission religieuse qu’il était appelé à remplir. Devenue la Terre Sainte pour l’humanité civilisée, la Judée ne nous apparaît maintenant que comme un pays de prêtres et de prophètes ; tous les monuments de la littérature hébraïque sont, au premier coup d’œil, des livres saints. Mais c’est là une illusion résultant du préjugé qui ne nous permet de voir dans les grandes choses que le principe même qui en a fait la grandeur. Une étude attentive de ces écrits donnés tous pour religieux nous révèle de nombreuses traces d’une vie profane, qui, n’ayant pas été le côté le plus brillant du peuple juif, a été naturellement rejetée dans l’ombre. Par un miracle étrange, et grâce à une méprise pour laquelle la critique ne saurait se montrer bien sévère, puisqu’elle nous a conservé le plus curieux peut-être des monuments de l’antiquité, un livre entier, œuvre de ces moments d’oubli où le peuple de Dieu laissait reposer ses espérances infinies, est venu jusqu’à nous. Le Cantique des Cantiques n’est pas la seule page profane que renferme la Bible, mais c’est de beaucoup celle pour laquelle les scribes qui ont décidé du sort des écrits hébreux ont le plus élargi leurs règles d’admission. J’ai donc cru faire un travail utile en étudiant, après le Livre de Job, cet autre livre, bien moins important sous le rapport de la philosophie et de la religion, mais essentiel aussi pour qui veut connaître exactement l’histoire du développement de l’esprit hébreu.
La nature particulière des difficultés du Cantique des Cantiques m’a obligé dans cet essai à suivre un plan un peu différent de celui que j’avais adopté pour le Livre de Job. Ni dans l’une ni dans l’autre de ces deux études, je ne me suis proposé de faire un commentaire perpétuel où le sens de tous les passages difficiles soit discuté ; rarement, j’ai été amené à proposer dans le détail des interprétations entièrement neuves ; la justification de ma traduction se trouve, par conséquent, dans les nombreux ouvrages où chaque ligne de ces antiques écrits a été examinée avec des développements auxquels j’aurais peu de chose à ajouter. Mais en ce qui concerne le Cantique des Cantiques quelques explications de plus étaient nécessaires. Le plan de l’ouvrage, qui dans le livre de Job est évident, offre, dans le poëme qui cette fois nous occupe, les plus sérieuses difficultés ; c’est là, à vrai dire, le grand problème de l’exégèse du Cantique. J’ai donc proposé au lecteur, sans jamais reculer devant la nécessité des déductions les plus compliquées, toute la série des raisonnements qui m’ont conduit à mon hypothèse sur la nature du poëme. C’est l’objet du premier paragraphe de l’Étude préliminaire. Sans ces détails, l’arrangement que j’ai prêté au poëme eût semblé une construction artificielle, et plusieurs endroits eussent offert une apparence de subtilité.
La même considération m’a forcé d’adopter pour l’arrangement de la traduction un parti qui d’abord surprendra peut-être, mais dont on reconnaîtra, j’espère, l’utilité. La traduction se trouve en ce volume imprimée deux fois, une première fois sans aucune addition explicative et sous une forme qui ne laisse rien préjuger quant au plan du poëme, les seules coupes qu’on y trouve étant celles qui frappent au premier coup d’œil un lecteur attentif, et ces coupes d’ailleurs n’ayant qu’un caractère provisoire1 ; une seconde fois avec les coupes et les explications qui résultent de la discussion à laquelle je me suis livré, dans l’étude préliminaire sur le plan du poëme. Si je m’étais borné à la première forme, j’aurais manqué au devoir le plus essentiel du traducteur, qui est de donner au lecteur un texte qui s’explique de lui-même. Si je n’eusse donné que la seconde forme, on m’eût reproché avec raison d’imposer mon hypothèse avec ma traduction ; il eût été difficile de faire abstraction des coupes et des indications scéniques ; le texte nu ne se fût pas suffisamment dégagé. Au contraire, dans le parti que j’ai adopté, la liberté du lecteur est pleinement respectée ; il peut, si bon lui semble, en ne lisant que la première version, chercher à bâtir une hypothèse meilleure que celle que j’ai proposée. J’avertis pourtant ceux qui voudront tenter cette épreuve que le plan auquel je me suis arrêté est celui qui résulte du travail de plusieurs générations de laborieux interprètes. Il sera facile au premier coup d’œil d’y trouver des parties faibles ; mais si l’on veut tout peser et ne pas s’en tenir à la considération exclusive de certains passages, on arrivera, je crois, à reconnaître qu’il est impossible de proposer une autre construction. Ceci ne s’applique, bien entendu, qu’à l’ensemble du poëme. Une foule de nuances, dans l’interprétation d’un livre de cette nature, sont laissées à l’appréciation de chacun, et il est même probable que l’auteur n’avait pas sur tous les points des partis pris aussi strictement arrêtés que l’exigent nos habitudes d’esprit. Deux passages surtout (vi, 11 et suiv., viii, 8 et suiv.) sont d’une extrême difficulté. J’ai donné l’explication qui m’a paru la plus vraisemblable ; maïs on serait présomptueux à parler de certitude quand il s’agit de morceaux aussi obscurs.
Je ne dissimulerai pas un système qui m’a d’abord préoccupé et auquel je n’ai renoncé qu’en faisant subir à mon travail la dernière révision. J’ai longtemps pensé que le seul moyen de porter remède aux troubles que semble offrir le plan du Cantique était de transposer quelques scènes. Il est certain que, dans l’état actuel du poëme, l’ordre chronologique de l’action est tout à fait renversé. Ainsi, au chapitre ier nous voyons la jeune fille faire son entrée dans le sérail ; au chapitre iii, elle entre pour la première fois dans Jérusalem ; au chapitre vi, elle est surprise à Sulem par les gens de Salomon ; au chapitre viii, ses frères semblent former ensemble un complot dont le développement constituerait le nœud du poëme. C’est surtout pour ces deux derniers morceaux que la tentation était forte, et j’avoue que parfois je suis encore porté à croire que le poëme a subi des désordres graves. Mais au moment de réaliser l’entreprise hardie de toucher à un texte aussi anciennement établi, la main m’a tremblé. Le poëme tel qu’il est pouvant strictement être ramené, non certes à la forme qu’exigeraient nos idées sur l’art dramatique, mais à un système suivi, je me suis interdit l’emploi d’un moyen extrême, auquel il ne faut recourir que dans les cas d’une absolue nécessité.
Je sais que plusieurs passages de la traduction paraîtront un peu choquants à deux classes de personnes, d’abord à celles qui n’admirent de l’antiquité que ce qui ressemble plus ou moins aux formes du goût français ; en second lieu, à celles qui n’ont connu le Cantique qu’à travers le voile mystique dont la conscience religieuse des siècles l’a entouré. Ces dernières sont naturellement celles dont il me coûte le plus de froisser les habitudes. Ce n’est jamais sans crainte que l’on porte la main sur ces textes sacrés qui ont fondé ou soutenu les espérances de l’éternité, ni que l’on rectifie, au nom de la science critique, ces contre-sens séculaires qui ont consolé l’humanité, l’ont aidée à traverser tant d’arides déserts et lui ont fait conquérir des vérités fort supérieures à celles de la philologie. Il vaut mieux que l’humanité ait espéré le Messie que bien entendu tel endroit d’Isaïe où elle a cru le voir annoncé ; il vaut mieux qu’elle ait cru à la résurrection que bien lu et bien compris tel passage obscur du Livre de Job, sur la foi duquel elle a affirmé sa délivrance future. Où en serions-nous si les contemporains du Christ et les fondateurs du christianisme eussent été d’aussi bons philologues que Gesenius ? La foi à la résurrection et la foi au Messie ont fait faire plus de grandes choses que la science exacte du grammairien. Mais c’est la grandeur de l’esprit moderne de ne point sacrifier l’un à l’autre les besoins légitimes de la nature humaine ; nos espérances ne dépendent plus d’un texte bien ou mal entendu. Chacun, d’ailleurs, impose sa foi aux textes bien plus qu’il ne l’y puise. Ceux qui ont besoin de l’autorité de Job pour espérer en l’avenir ne croiront pas l’hébraïsant, qui leur exposera ses doutes et ses objections ; sans s’inquiéter d’une variante, ils diront hardiment avec l’humanité : De terra surrecturus sum. De même le Cantique cher à tant d’âmes pieuses subsistera malgré nos démonstrations. Comme une statue antique que la piété du moyen âge aurait habillée en madone, il conservera ses respects, même quand l’archéologue aura prouvé son origine profane. Pour moi, mon but n’a pas été de soustraire à la vénération l’image devenue sainte, mais de la dépouiller un moment de ses voiles pour la montrer aux amateurs de l’art antique dans sa chaste nudité.
ÉTUDESUR LE PLAN, L’AGE ET LE CARACTÈRE DU POËME
I
Le Cantique des Cantiques est un des livres hébreux qui offrent, sous le rapport de la langue, le moins de difficultés ; mais de tous les monuments littéraires du peuple juif, c’est sans contredit celui dont le plan, la nature et le sens général sont le plus obscurs. Sans parler des innombrables explications mystiques et allégoriques proposées par les théologiens, et dont aucune (comme nous le démontrerons plus tard) n’a de fondement dans l’original, deux systèmes opposés se partagent encore les exégètes en ce qui concerne ce livre singulier. Selon les uns, une action suivie relie toutes les parties du poëme et en fait une composition régulière, ayant son unité. Selon d’autres, le n’est qu’une série de chants d’amour, n’ayant d’autre lien que l’analogie du sujet, et ne supposant pas derrière eux une action dramatique. Bien que ce second système nous paraisse insoutenable, et soit aujourd’hui à peu près abandonné, on conçoit quelles difficultés doit offrir l’ensemble du poëme, pour avoir réduit des hommes comme Herder, Paulus, Eichhorn. W. Jones, de Wette, à admettre une hypothèse aussi désespérée. Un coup d’œil rapide jeté sur le justifie du reste les hésitations de tant d’éminents critiques. Nous croyons que si le lecteur veut bien parcourir la première de nos traductions, il sera évident pour lui que divers morceaux, tels que le deuxième, le troisième, le huitième, le douzième, le quatorzième, le quinzième, le seizième renferment des allusions précises et indubitables à une action dramatique dont on entrevoit sans peine la contexture générale. Plusieurs traits de ces morceaux, en effet, n’offrent aucun sens si on envisage les pièces où ils se trouvent comme de simples romances détachées. D’un autre côté, quand on cherche dans le poëme un développement régulier analogue à celui de nos drames, on rencontre d’insolubles difficultés, et on est tenté de croire que l’ordre des scènes a été interverti ou que quelques morceaux ont été égarés. Un examen minutieux de tout le poëme, fait verset par verset, peut seul nous donner la clef de ce problème singulier.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!