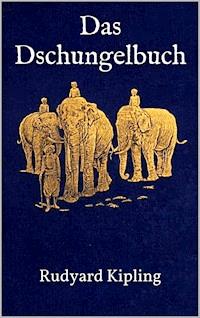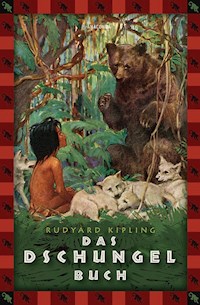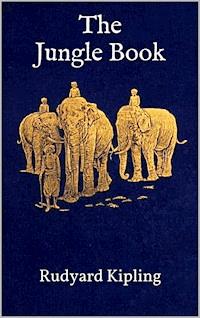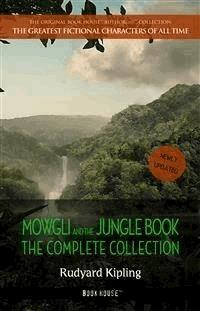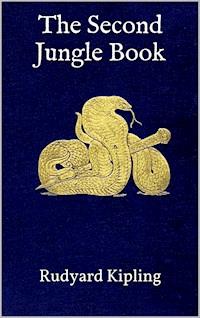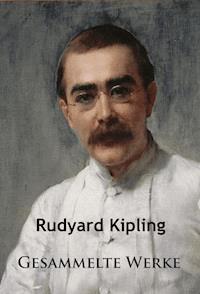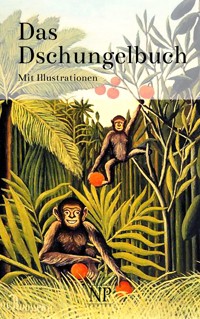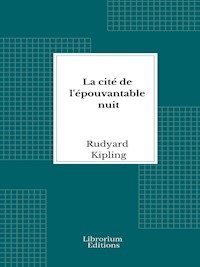
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Nous sommes, tous tant que nous sommes, des pionniers, des Barbares, nous autres qui habitons au delà du Fossé, dans les ténèbres extérieures du Mofussil.
Il n’y a ici rien qui ressemble à des commissaires, à des chefs d’administration et il n’existe dans l’Inde qu’une Cité.
Bombay est trop vert, trop joli, a des détours trop compliqués et il y a si longtemps que Madras est défunt.
Tirons notre chapeau devant Calcutta, la ville aux multiples facettes, enfumée, magnifique, lorsque nous passons en voiture sur le pont de l’Hughli, à l’aube d’une calme matinée de février.
Nous avons laissé l’Inde derrière nous à la gare d’Howrah, et maintenant nous entrons en territoire étranger.
Non, pas tout à fait étranger.
Disons plutôt trop familier.
Tous les hommes d’un certain âge connaissent l’irritation que cause le sentiment qu’on est en cage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE COSMOPOLITE
LA CITÉ DE l’épouvantable NUIT
PARRUDYARD KIPLING
Traduction de ALBERT SAVINE
1922
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383837763
Kipling voyageur
Rudyard Kipling, au temps où il prenait ses congés de journaliste, fut un grand voyageur devant l’Éternel.
Le présent volume se compose du récit de deux de ses promenades de globe-trotter.
Dans la première, il visite Calcutta, la cité de l’épouvantable nuit, et en décrit les bouges.
La seconde nous conduit jusqu’à Hong-Kong.
Ces souvenirs anecdotiques et pleins d’humour seront certainement goûtés du public français, car ils tranchent sur le ton pudibond et abusivement moralisateur des voyageurs anglais.
A. S.
LA CITÉ DE L’ÉPOUVANTABLE NUIT
(Janvier-février 1888)
I UNE CITÉ DE LA VIE RÉELLE
Nous sommes, tous tant que nous sommes, des pionniers, des Barbares, nous autres qui habitons au delà du Fossé, dans les ténèbres extérieures du Mofussil.
Il n’y a ici rien qui ressemble à des commissaires, à des chefs d’administration et il n’existe dans l’Inde qu’une Cité.
Bombay est trop vert, trop joli, a des détours trop compliqués et il y a si longtemps que Madras est défunt.
Tirons notre chapeau devant Calcutta, la ville aux multiples facettes, enfumée, magnifique, lorsque nous passons en voiture sur le pont de l’Hughli, à l’aube d’une calme matinée de février.
Nous avons laissé l’Inde derrière nous à la gare d’Howrah, et maintenant nous entrons en territoire étranger.
Non, pas tout à fait étranger.
Disons plutôt trop familier.
Tous les hommes d’un certain âge connaissent l’irritation que cause le sentiment qu’on est en cage.
Une illustration du Graphic — une portée de musique ou les propos légers d’un ami qui arrive du pays, peuvent la faire flamboyer — cette sensation qui a sa source dans ce que nous savons de notre paradis perdu de Londres.
Au pays, eux, les autres, nos égaux, ont sous la main tout ce que la ville peut donner, le bruit sourd de la rue, les lumières, la musique, les endroits charmants, des millions de leurs semblables, une immensité peuplée de jolies Anglaises aux fraîches couleurs, des théâtres, des restaurants.
Ils sont dans leur droit.
Ils considèrent qu’il en est ainsi et ils se donnent même des airs de n’en pas faire grand cas.
Et nous… nous n’avons rien que les quelques distractions que nous nous organisons à grand-peine, les douloureux divertissements de gymkhanas où tout le monde, de part et d’autre, se connaît, où les antécédents d’un chacun sont aussi notoires que sa façon, à lui ou à elle, de valser.
Nous avons été dépouillés de notre héritage.
Ce sont les gens du pays de là-bas qui en jouissent en totalité, sans se douter combien il est beau et riche, et nous, tout ce que nous pouvons faire, se réduit à gagner l’Occident pour quelques mois et à nous gaver de ce qui, en des circonstances convenables, représenterait sept, huit, dix années de liesse.
Voilà ce qu’est notre héritage londonien perdu et la conscience de cette perte, volontaire ou forcée, hante en certains temps, en certaines saisons, la plupart d’entre nous et nous rend de mauvaise humeur.
Calcutta offre des espérances trompeuses de quelque compensation.
La fumée dense forme un nuage bas, dans la fraîcheur glaciale des matins, sur un océan de toits, et à mesure que la cité s’éveille, il monte vers cette fumée un ronflement grave, sonore de vie, de mouvement, de masse humaine.
Aussi, quiconque voit Calcutta pour la première fois, met joyeusement le nez hors du tikka-gharri[1], flaire la fumée et tourne la figure vers la cohue.
[1] Fiacre de place.
Il se dit :
— Voilà enfin une parcelle de mon héritage qui me rentre. Voilà une Cité : il y a de la vie ici et, le fleuve passé, sous la fumée il y aura mille choses agréables à posséder.
Cette litanie dit bien des choses et décrit exactement les premières émotions d’un sauvage vagabond, échoué à Calcutta.
L’œil a perdu son instinct des proportions. Le foyer est raccourci par l’effet d’une résidence trop prolongée dans les stations du haut pays — vingt minutes de trot pour aller de l’hôpital au terrain de manœuvres, — et l’esprit a subi le même rétrécissement que le champ visuel.
Tous deux disent ensemble en prenant mesure du mouvement naval, au dessus et au dessous du pont de l’Hughli :
— Tiens ! mais c’est Londres ! Voici les Docks. Voici qui est impérial ! Voici un coup d’œil qui méritait bien le voyage de l’Inde.
Alors une idée nettement canaille s’empare de l’esprit :
— Quel endroit divin ! Quel endroit céleste pour razzier !
Et elle cède la place à un démon bien pire encore, celui du conservatisme.
On en vient à se figurer que c’est non seulement une faute, mais un crime d’accorder aux indigènes le moindre accès à l’administration d’une Cité pareille, qui doit son embellissement, ses docks, ses quais, ses façades, son hygiène à des Anglais, qui n’existe que parce que l’Angleterre existe et dont l’existence dépend de l’Angleterre.
Toute l’Inde connaît la Municipalité de Calcutta.
Mais est-il un homme qui ait étudié à fond la Grande Puanteur de Calcutta ?
Elle est unique.
Bénarès est plus infect au point de vue de l’odeur concentrée, renfermée.
Il y a à Peshawar des puanteurs plus fortes que la grande Puanteur de Calcutta, mais au point de vue de la diffusion, de la faculté à faire pénétrer partout l’écœurement, la puanteur de Calcutta laisse bien loin et Bénarès et Peshawar.
Bombay masque ses infections sous un vernis d’assa fœtida et de tabac : Calcutta est au-dessus de toute ostentation.
Il est impossible d’assigner une source quelconque au fléau de Calcutta : c’est ténu, c’est écœurant, cela ne peut se décrire, mais les Américains qui habitent le Grand Hôtel d’Orient disent que cela rappelle l’odeur du Quartier Chinois à San Francisco.
Ce n’est certainement pas une odeur indienne.
On dirait de l’essence de pourriture qui aurait subi une seconde pourriture, — l’odeur gluante de la colle de pâte tournée au bleu.
Et nul moyen de la fuir !
Elle souffle à travers le Maidân ; elle pénètre par rafales dans les corridors du grand Hôtel d’Orient.
Ce qu’on se plaît à appeler « les Palais de Chowringhi », la promène.
Elle tournoie autour du Club du Bengale.
Les ruelles la déversent avec une intensité qui vous donne la nausée et la brise matinale en est chargée.
On la trouve, cette odeur, en dépit de la fumée des machines, à la Gare de Howrah.
Elle semble empirer dans les petites ruelles de derrière Lal-Bazar, où se trouvent les boutiques à saouler, mais elle est presque aussi accentuée en face du palais du Gouvernement et dans les administrations publiques.
Cette puanteur est intermittente.
On peut avaler sans inconvénient six gorgées d’un air relativement pur. Puis à la septième vague l’estomac, qui n’a pas subi d’entraînement, se soulève.
Quand on habite Calcutta assez longtemps, on finit par s’y habituer.
Les résidents réguliers avouent bien l’existence du fléau, mais voici leur réponse.
— Attendez que le vent ait desséché les marais salés où aboutit le système d’égouts, et alors vous m’en parlerez.
Voilà comment ils se défendent ! Rien d’étonnant à ce qu’ils regardent Calcutta comme un séjour qui convient parfaitement à un vice-Roi permanent.
Des Anglais, qui sont capables d’atténuer une honte par une autre, sont gens à demander n’importe quoi et à compter qu’ils l’obtiendront.
Si une station des montagnes contenant trois mille hommes de troupes et une vingtaine de fonctionnaires civils possédait une propriété analogue à celle que possède Calcutta, le sous-commissaire ou le magistrat du cantonnement chasserait du bureau administratif tous les indigènes, ou les jetterait décemment d’un coup de pelle à l’arrière-plan, jusqu’à ce que l’inconvénient eût été supprimé.
Alors on leur permettrait de se remettre en avant, de parler tant qu’ils voudraient « d’oppression, d’arbitraire ».
Cette puanteur, pour un nez dépourvu de préjugés, ôte à Calcutta tout droit d’être une Cité des Rois.
Et en dépit de cette puanteur, on admet, on encourage même, les indigènes à se mêler des affaires locales !
Le sol moite, saturé par le drainage, est empoisonné par le foisonnement de la vie depuis cent ans, et la liste de la municipalité est encombrée de noms indigènes, — gens nés, élevés, grandis aux dépens de cet amas de débris accumulés ! Ils figurent comme propriétaires, ces charmants Aryas, dans le conseil municipal, dans le conseil législatif du Bengale.
Lancez une proposition de les taxer comme tels et tout naturellement ils se mettent à hurler.
On hurle aussi dans le haut pays, mais les locaux pour des meetings monstres sont rares, et avec un secrétaire et un Président énergiques dont la faveur est chose précieuse, et dont la colère n’est point chose désirable, on maintient les gens dans la propreté, bon gré mal gré, pour qu’ils ne puissent pas empoisonner leurs voisins.
— Alors, demande un sauvage, pourquoi leur accorder un vote quelconque ?
Ils sont capables de s’accommoder de cette saleté. Ils sont incapables d’aucun sentiment qui vaille un fétu.
Qu’on les laisse vivre tranquilles, et sous notre protection, faire leur bas de laine !
D’autre part, nous les taxerons jusqu’à ce que l’état de leur bourse leur donne la mesure de leur négligence passée.
Puis, quand l’odeur aura un peu diminué, nous les laisserons reparaître et bavarder, et attribuer le progrès à leurs lumières.
Les classes supérieures ont leurs broughams et leurs barouches ; les basses sont capables de jeter d’un coup d’épaule un Anglais dans le chenil et de lui parler comme s’il était un cuisinier.
Ils peuvent s’exprimer sur une dame anglaise en la qualifiant d’aurat.
On leur permet une liberté — pour ne pas employer un terme trop gros — une liberté de langage qui ne tarderait pas à amener des bagarres sérieuses, si un Anglais en usait de même avec un autre Anglais.
Ils sont entourés de barrières protectrices. On les rend inviolables.
Assurément, ils devraient se contenter de toutes ces choses, sans se mêler d’affaires auxquelles ils ne peuvent rien comprendre, étant donné leur origine.
On se demandera si cette diatribe pleine de feu est le produit d’un esprit indépendant, le résultat premier de la nausée que donne cette féroce puanteur ou le résultat fécond de la migraine contractée à force de fumer tout le jour pour combattre l’odeur.
En tout cas, Calcutta est un endroit redoutable pour quiconque n’y a pas été élevé.
Un bon conseil à d’autres barbares.
N’amenez pas à Calcutta un domestique originaire du haut pays.
Il aura certainement des désagréments parce qu’il ne pourra comprendre les usages de la Cité.
Un Punjabi, qui arrive pour la première fois ici, se croit tenu en conscience d’aller à l’Ajaibghar, le Museum.
Plus d’un y est allé, et en est revenu de très mauvaise humeur, et l’esprit troublé.
— Je suis allé au Museum, dit-il, et personne ne m’a dit d’injures. Je suis allé acheter mes provisions au marché, et je me suis assis. Alors est venu un homme en uniforme qui m’a dit : « Ote-toi de là que je m’y mette ». J’ai répondu : « J’y étais le premier ». Il a dit : « Je suis un chaprassi. Va-t’en », et il m’a frappé. Or, comme cet endroit pour s’asseoir était public, je l’ai battu jusqu’à le faire pleurer. Il a couru chercher la police, et je me suis sauvé aussi, car ici tous les gens de la police sont des Sahibs. Puis-je avoir congé, à partir de deux heures, pour me mettre à la recherche de cet homme et le battre encore ?
Voyez-vous la situation ?
Une Cité inconnue, pleine d’une senteur qui vous fait rechercher le repos et la retraite, et un domestique qui ronge son frein, qui n’est pas encore depuis six heures dans le four, et qui s’est engagé dans une querelle à mort avec un Chaprassi inconnu et réclame à grands cris la permission d’aller poursuivre la dispute.
Hélas ! Où est l’illusion de l’héritage qu’on allait reprendre ?
Dormons, dormons, et prions pour que Calcutta se porte mieux demain.
Pour le moment, ce sommeil-là ressemble étonnamment au sommeil en compagnie d’un cadavre.
II LES RÉFLEXIONS D’UN SAUVAGE
La nuit porte conseil.
Après tout, Calcutta exhale-t-il une odeur aussi empestée ?
Il a beaucoup plu pendant la nuit. La Cité est lavée de frais et la clarté du soleil la montre sous son jour le plus avantageux.
Où donc, où donc un homme irait-il dans ce désert de vie ?
Le Grand Hôtel d’Orient bourdonne de vie dans toutes ses cent chambres.
Des portes battent gaîment et toutes les nations de la terre montent et descendent les escaliers en courant.
Cela suffit pour vous remonter, parce que les passants vous heurtent et vous prient de vous écarter.
Figurez-vous, en dehors de la salle de réception de la Reine, un endroit où il y ait un tel entassement d’Anglais ?
Figurez-vous soixante-dix personnes à la table d’hôte, et ce bruit assourdissant de couteaux et de fourchettes ?
Figurez-vous que vous trouvez un véritable bar où l’on puisse faire servir à boire, et, joie suprême, figurez-vous qu’en mettant les pieds hors de l’hôtel, vous tombez dans les bras d’un Bobby[2] tout vivant, habillé de blanc, casqué, boutonné, armé de sa massue ?
[2] Agent de police.
Qu’arriverait-il si l’on adressait la parole à ce Bobby ? Se fâcherait-il ?
Il ne se fâche point ! Il est affable.
Il est chargé d’inspecter le pavé devant le Grand Hôtel d’Orient et d’empêcher les encombrements inextricables de voitures.
Quand il a affaire à un blanc qui paraît respectable, il se conduit en homme, en frère.
Il n’y a en lui aucune trace d’arrogance.
Toutefois, en l’examinant de plus près, on reconnaît que ce n’est point un Bobby authentique.
C’est un je ne sais quoi de la Police municipale, et son uniforme n’est pas correct, si toutefois là-bas, au pays, on n’a rien changé à la tenue des hommes.
Mais peu importe !
Plus tard nous nous informerons au sujet du Bobby de Calcutta, parce que c’est un blanc, et qu’il doit se mesurer avec certains des types les plus redoutables que leur malice ait jamais portés à peindre en vermillon la cité de Job Charnock.
Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas traverser Old Court House Street sans regarder attentivement si vous ne courez aucun risque d’être écrasé par un véhicule.
Voilà qui est beau.
Il y a un grondement continu de trafic, interrompu de deux en deux minutes par le roulement sourd des tramways.
La façon de conduire est excentrique, je ne dis pas mauvaise, mais enfin il y a le trafic, il y en a plus que n’en ont vu pendant un certain nombre d’années des regards sans préjugés.
Cela signifie que les affaires marchent, qu’on gagne de l’argent. Cela évoque la vie qui s’entasse, qui se hâte. Cela vous entre dans le sang et le fait circuler.
Voici de vastes magasins aux devantures formées par des glaces, et qui tous vous présentent les noms de maisons bien connues avec lesquelles nous autres, sauvages, ne correspondons que par l’intermédiaire des Colis postaux.
Les voici tous ici, de grandeur naturelle, prêts à fournir tout ce dont vous avez besoin, et vous n’avez rien à faire qu’à signer.
C’est bien tentant que de pouvoir se faire donner une chose séance tenante sans être obligé d’écrire pour une semaine déterminée, puis d’attendre pendant un mois, et alors de voir arriver une chose tout autre.
Rien d’étonnant à ce que les jolies dames, qui habitent à une distance raisonnable, viennent elles-mêmes faire leurs emplettes.
— Voyez-vous ? Si vous tenez à être considéré, il ne faut pas fumer dans la rue. Personne ne le fait.
Cet avis vous est donné avec bienveillance par un ami en habit noir.
Il n’y a pas de réception, non plus que de Lieutenant-Général en vue, mais il porte l’habit noir, parce qu’il fait grand jour et qu’il peut être vu.
C’est pour le même motif qu’il s’abstient de fumer.
Il admet que la Providence a fait le grand air pour qu’on puisse y fumer, mais il dit que « ce n’est pas à faire ».
Cet homme a un brougham, une jolie petite boîte à bonbons, dont le roulement a un bizarre mouvement de tangage.
Il monte dans le brougham, et se coiffe d’un chapeau haut de forme, un huit-reflets bien luisant.
Il y avait une fois, dans le haut pays, un individu qui possédait un haut de forme.
Il le loua à des sociétés d’acteurs amateurs, jusqu’à ce que le bord en eût disparu, au bout de quelques saisons.
Alors il le jeta dans un arbre et des abeilles sauvages vinrent y essaimer.
Il arrivait de temps à autre que l’on venait contempler le chapeau, dans ses jours de prospérité, dans le but de se donner le mal des pays.
Toute la station s’y intéressait, et il mourut avec deux seers[3] de miel de fleur de babul dans son intérieur.
[3] Cinq livres.
Mais les chapeaux hauts de forme ne sont point faits pour être portés dans l’Inde. Ils sont aussi sacrés que les lettres du pays et les vieux boutons de roses.
L’ami ne peut pas comprendre cela.
Il reconnaît que s’il descendait de son brougham et se promenait en plein soleil pendant dix minutes, il attraperait un fort mal de tête, et, au bout d’une demi-heure, probablement une insolation mortelle.
Il convient de tout cela ; mais il persiste à porter son chapeau et ne peut concevoir pourquoi cette vue plonge un barbare dans un accès de rire inextinguible.
Tous ceux qui possèdent un brougham et bon nombre de ceux qui n’usent que des tikka-gharris, portent le chapeau haut de forme et l’habit noir.
L’effet est curieux et frappe de surprise celui qui le voit pour la première fois.
Et maintenant :
— Allons voir les belles demeures où habitent les opulents Nobles.
Au nord s’étend la grande jungle humaine qu’est la ville indigène, et qui va du bazar Burra jusqu’à Chitpore.
Dans la direction du sud se trouvent le Maidân et Chowringhi.
Si vous vous placez au centre du Maidân, vous comprendrez pourquoi Calcutta est appelée la Ville des Palais.
Ainsi avait parlé l’Américain du Grand Hôtel d’Orient, homme qui avait vu du pays.
Il y a une tour peu élevée, improprement qualifiée de monument commémoratif, qui se dresse sur un désert de gazon mou, d’un vert cru.
Il vaut autant se rendre à ce point-là qu’à un autre.
Les dimensions du Maidân sont propres à décourager tous ceux qui sont accoutumés aux « jardins » du haut pays, tout comme on dit que la lande de Newmarket impressionne un cheval habitué à un champ de courses mieux clos.
L’immense plaine est parsemée de statues de bronze représentant des gentlemen montés sur des chevaux capricieux et hissés sur des piédestaux aux lignes d’une sévérité excessive.
L’immensité donne à ces statues des proportions de nains ; elle donne d’ailleurs des proportions minuscules à toutes choses, excepté aux façades lointaines de la route de Chowringhi.
C’est énorme, c’est impressionnant.
C’est un fait auquel il est impossible de se soustraire.
On bâtissait des maisons à l’époque où la roupie valait deux shillings et un penny.
Ces maisons ont trois étages. Elles sont ornées d’escaliers de service pareils à des maisons dans la montagne.
Elles sont très rapprochées et ont leurs jardins clos de murs en maçonnerie, percés d’une seule porte cochère.
Elles sont bien anglaises avec leur air chez soi. Elles sont orientales par leurs vastes proportions, mais ces escaliers de service ne donnent pas l’idée de la santé.
Nous allons former une commission hygiénique d’amateurs et nous rendrons une visite à Chowringhi.
Ce n’est pas une chose fort agréable que d’être présenté pour la première fois à un durwân, ou portier de Calcutta.
Lorsqu’il est en train de chiquer du pân, il ne se donne pas la peine d’enlever sa chique.
S’il est assis sur sa couchette et occupé à mâcher de la canne à sucre, il ne croit pas devoir se lever.
Ce sont là des choses qu’il faut lui enseigner, et il n’arrive pas à comprendre pourquoi on le blâme.
Évidemment il est le survivant d’un système qui a fait son temps.
La Providence n’a jamais voulu faire de l’indigène un concierge plus insolent qu’aucun de ceux de la variété française.
A Calcutta, on installe un homme dans une logette près de la porte de sa demeure afin de détourner les rôdeurs et de protéger sa maison contre le vol.
Il en résulte que le durwân traite comme rôdeurs tous ceux qu’il ne connaît pas, qu’il a une connaissance approfondie et véritable de tout ce qui concerne le dehors et le dedans de la maison et qu’il a une influence assez considérable sur le choix des domestiques.
On dit qu’un membre de cette estimable classe est maintenant en procès avec une banque au sujet de trois lakhs de roupies.
Dans le haut pays, le domestique d’un lieutenant-gouverneur est obligé de travailler trente ans avant de pouvoir se retirer avec soixante mille roupies d’économies.
Le Durwân de Calcutta est une grande institution.
Ce qui constitue le principal, le plus visible de ses défauts, c’est qu’il s’obstine à vouloir parler anglais.
Comment il défend les maisons, Calcutta seul le sait. Il suffit de lui parler avec rudesse pour lui faire perdre la tête, et généralement aux heures des visites, il dort.
Si l’on fait un circuit quelque peu régulier de visites, trois fois sur sept, il pue la boisson.
Voilà pour le Durwân. Maintenant parlons de la maison qu’il garde.
C’est une sensation fort agréable que d’être introduit dans un salon empesté d’un relent d’écurie.
— Est-ce que c’est toujours comme cela ?
— Non, non, à moins que vous ne teniez la chambre fermée pendant quelque temps, mais si vous ouvrez les volets, alors ce sont d’autres odeurs. Comme vous le voyez, les écuries et les logements des domestiques sont tout près.
On paie cinq cents roupies par mois pour une demi-douzaine de pièces remplies de ces odeurs-là.
On ne se plaint pas.
Quand on croit que l’honneur de la Cité est en jeu, on dit d’un air de défi :
— Oui, mais vous devez vous rappeler que nous sommes une capitale. Nous sommes très serrés ici. La place nous manque. Nous ne sommes pas comme dans vos petites fractions.
Chowringhi est une localité imposante, pleine de maisons somptueuses, mais ce qu’il y a de mieux à faire, c’est de la visiter à la hâte.
Arrêtez-vous un instant à considérer à quoi correspondent ces logements rétrécis, ce sol noir et détrempé, les réseaux compliqués des escaliers de services, les écuries bondées, le bouillonnement de vie humaine tout autour des loges des Durwâns, et le curieux arrangement des canaux de décharge à découvert et vous qualifierez le tout de sépulcre blanchi.
Des gens, qui habitent des logis vastes, souffrent d’angine chronique et vous diront d’un air réjoui :
— Nous avons maintenant la fièvre typhoïde à Calcutta.
La peste la quitte-t-elle jamais ?
Tout paraît disposé pour l’entretenir confortablement. Elle peut s’installer à son aise sur les toits, grimper le long du chéneau jusque sur la terrasse, monter de l’évier à la vérandah et de là jusqu’à l’étage le plus élevé.
Mais Calcutta dit que tout est pour le mieux, et invoque des chiffres pour le prouver.
En même temps, elle convient qu’une coupure dans la chair saine ne s’y guérit pas facilement.
On peut se dispenser de chercher d’autres preuves.
Voici qu’arrive à travers Park Street, et en route pour le Maidân, un flot de broughams, de bogheys proprets, de gigs les plus légers possible, de brownberries, de victorias étincelantes, et une pincée de vrais hansom-cabs.
Dans les broughams se trouvent des hommes en chapeau haut de forme. Dans les autres véhicules, des jeunes gens, tous presque pareils, tous en tenue absolument irréprochable.
Un nouveau flot, venu de Chowringhi, se joint au détachement de Park-Street et tous deux roulent ensemble à travers le Maidân, vers le quartier des affaires.
C’est ainsi qu’à Calcutta on se rend à son bureau, les fonctionnaires civils dans les bâtiments du Gouvernement, les jeunes gens à leurs maisons de commerce, à leurs magasins, à leurs quais.
C’est là qu’on voit que Calcutta a la meilleure voie d’évitement qu’il y ait dans l’Empire.
Chevaux et voitures sont également propres à exciter l’envie par leur perfection, et remarquez ce détail : c’est la pierre de touche de la civilisation, les lanternes sont dans leurs montures.
Ici le cheval du pays est un animal rare. Sa place est prise par le gallois, et le gallois, quoique canaille au fond de l’âme, peut être dressé de façon à avoir l’air d’un gentleman.
Il paraît inconvenant de remarquer trop élogieusement le brillant des harnais, le vernis irréprochable des panneaux et les livrées des saïs.
Tout cela fait bonne figure sur les routes de belle apparence extérieure dans l’ombre des Palais.
Combien de catégories de la société complexe de cette contrée trouve-t-on dans les voitures ?
En premier lieu, le fonctionnaire civil du Bengale qui se rend aux Bureaux des Scribes, travaille dans un bureau absolument irréprochable, et parle d’un ton détaché, « d’envoyer les choses aux Indes », ce qui signifie simplement qu’il en réfère sur les affaires au Gouvernement Suprême.
C’est un grand personnage, et il a la bouche pleine de propos de sa boutique : « avancement, nomination ».
Généralement, quand on parle de lui, c’est en disant : « Un homme qui s’élève. » On dirait que Calcutta est plein d’hommes qui s’élèvent.
En second lieu, c’est l’homme du Gouvernement de l’Inde qui, figure bien connue à Simla, loue un rez-de-chaussée quand il n’est pas dans les Collines, et se montre raisonnable sur le sujet des inconvénients de Calcutta.
En troisième lieu, c’est l’homme des maisons de commerce, le personnage franchement non-officiel qui se bat sous le drapeau d’une des grandes maisons de la ville, ou bien pour son propre compte dans un bureau bien tenu, ou parcourt à toute la vitesse de son brougham Clive-Street pour jouer « sa partie d’associé » ou quelque chose de ce genre.
Il ne redoute point « le Bengale » et « l’Inde » ne lui inspire pas grand respect.
Il peste impartialement après l’un ou l’autre quand leurs actes troublent ses opérations.
Son jargon de boutique est tout à fait inintelligible.
Il ressemble au marchand de la Cité qu’on aurait dépouillé de son air glacial.
Il vit largement et reçoit d’une façon hospitalière.
Au temps jadis, il tenait plus de place qu’aujourd’hui, mais il n’en est pas moins assez volumineux.
Il se montre raisonnable jusqu’au point de faire écho lorsqu’on injurie la Municipalité, mais il devient femme, par son insistance à parler des supériorités de Calcutta.
Bien au-dessus de tous ces gens qui courent à leur besogne, sont les diverses brigades, escadrons, détachements des autres classes. Mais ce sont des coteries et non des sections, et cela tourne autour du Belvédère, du Palais du Gouvernement, du Fort William.
Simla les réclame dans la saison chaude.
Qu’ils y aillent !
Ils portent le haut de forme et l’habit noir.