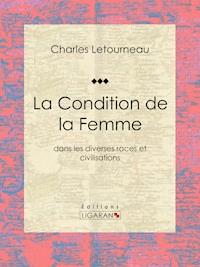
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Le mot sociologie, néologisme assez récent, puisqu'il a été créé par A. Comte, n'a eu longtemps, n'a même pas encore, du moins pour le grand public, un sens bien précis. [...] Grâce aux moyens de pénétration et d'investigation que l'industrie moderne a mis en notre pouvoir, les peuples primitifs sont chaque jour mieux connus..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 734
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335031096
©Ligaran 2015
Ces quelques lignes n’ont pour but que d’expliquer comment la Bibliothèque Sociologique Internationale se trouve publier en ce moment un livre posthume du Dr Charles Letourneau. Tous les amis de la sociologie savent que cet infatigable travailleur a, dans sa chaire de l’École d’Anthropologie, étudié successivement les principaux phénomènes de la vie sociale : mariage et famille, propriété, morale, droit, religion, politique, éducation, littérature, guerre, esclavage, commerce, et qu’il en a fait l’objet d’autant de livres documentés et instructifs. L’un de ses derniers cours avait pour objet l’étude de la condition de la femme. Fidèle à sa méthode habituelle, il l’envisageait dans les diverses races et civilisations, à l’aide surtout des données ethnographiques. C’est ce cours qu’il avait bien voulu nous promettre pour la Bibliothèque, et il en avait relu le manuscrit dans cette intention. Une mort que nous ne pouvons pas ne point trouver prématurée – bien qu’elle ne soit venue qu’au terme d’une longue existence et qu’il l’ait acceptée avec la sérénité du sage – l’a empêché sans doute d’en faire une seconde révision. Mais, tel qu’il était, son texte exprimait certainement sa pensée d’une façon assez complète et assez exacte pour qu’on n’eût pas à craindre de déformer celle-ci en le publiant. Grâce aux soins de MM. les Drs Manouvrier et Papillault, les dévoués et savants collègues de M. Letournoau à l’École d’Anthropologie et au bureau de la Société d’Anthropologie de Paris, ce travail voit le jour avant l’expiration de l’année où son auteur nous fut ravi. Le second a bien voulu y joindre une notice informée et touchante sur la vie de son maître et sur les influences qui ont présidé à la formation de son esprit. Nous sommes heureux, pour notre part, d’avoir pu contribuer à la publication d’une étude doublement honorable pour la mémoire de M. Letourneau – comme œuvre de science et, à l’égard d’une moitié du genre humain, comme œuvre de réparatrice équité.
RENÉ WORMS.
Sur Charles LETOURNEAU
J’ai été chargé par les enfants de Charles Letourneau de présenter au public cette œuvre posthume de mon regretté maître. Je sens bien que je ne dois cet honneur qu’à l’affection profonde que j’avais pour lui et à ma reconnaissance pour l’action que volontairement il avait exercée sur ma pensée, non seulement par son enseignement, mais encore et surtout dans les longs entretiens que nous eûmes si souvent ensemble, soit à Paris, soit pendant nos voyages en Tunisie, en Algérie et en Italie. J’ai pu de la sorte, dans un abandon plein de charme et de profit pour moi, pénétrer plus avant que beaucoup de ses amis dans l’intimité de sa pensée et de sa personnalité d’ordinaire un peu fermée, un peu repliée sur elle-même, par une sorte de timidité ombrageuse et par une répulsion très vive pour toute vanité personnelle.
C’est pourtant l’histoire de sa pensée que je voudrais esquisser dans ces quelques pages, bien plus qu’une biographie méthodique et complète ; mais je ne crois pas, en publiant ces quelques notes, faire violence à ses volontés. Je ne viens pas conter des anecdotes pour complaire à une banale curiosité, mais je désire montrer l’unité, l’harmonie saisissante, qui existait entre son œuvre, ses convictions et sa vie. Le haut exemple de probité intellectuelle et morale qu’il nous laisse est trop rare et trop précieux pour rester ignoré.
Faire l’histoire de sa vie c’est donc expliquer son œuvre. La valeur de celle-ci légitime l’attention que nous accorderons à celle-là. Tel fait de la vie courante, humble et sans intérêt, grandit immédiatement s’il nous apparaît comme un des facteurs de la puissante mentalité que nous avons tous admirée.
L’origine et l’enfance de Charles Letourneau ont une grande importance à nos yeux. Les premiers sentiments imprimés dans l’esprit par le milieu et l’éducation ne périssent jamais. Ils poursuivent, au contraire, leur croissance logique à travers les acquisitions nouvelles, imposent leur orientation aux faits et aux idées, et, dans la pleine maturité de l’esprit, se retrouvent toujours vivaces dans les théories générales et les systèmes. Toutes ces conceptions semblent la pure expression des faits qu’elles coordonnent ; mais ce n’est vrai qu’en partie ; creusez davantage, descendez dans les profondeurs de la conscience, et vous trouverez les impressions d’enfance, racines vigoureuses nourrissant de leur sève la riche floraison qui aura mis un demi-siècle à s’épanouir.
Mais parlons d’abord du physique ; biologiste très renseigné et matérialiste convaincu, il ne me pardonnerait pas de l’oublier.
Sa famille était bretonne. Dans les notes que son fils M. Gustave Letourneau a eu l’obligeance de me donner, je lis que « ses ascendants maternels occupaient vers la fin du XVIIIe siècle une assez brillante situation. Son grand-père, le baron Cosson de Kervodiès, était magistrat à Lorient. Plus tard, des revers de fortune obligèrent toute la famille, après un séjour de plusieurs années à Paris, à se fixer dans le Morbihan, dans la petite ville d’Auray ». C’est là qu’il naquit le 23 septembre 1831.
Il aimait à poursuivre beaucoup plus loin sa généalogie. Très brun, la barbe ondulée et très noire autrefois, le nez fort et busqué, le front large et haut, la face robuste et fortement charpentée, la courbe crânienne régulière avec un indice céphalique de 80,4, il pensait appartenir à la vieille race quaternaire, forte, courageuse, libérale et pacifique, et qui a laissé tant de traces dans le midi de l’Europe et le nord de l’Afrique. Quoiqu’il en soit, sa robustesse était indéniable, et ses habitudes de jeunesse avaient tout réuni pour favoriser les prédispositions ethniques. Enfant, il vagabondait en toute liberté dans les landes bretonnes, ou bien, avec des marins de son âge, allait d’île en île dans la mer douce et bienveillante du Morbihan. Envoyé à Vannes pour suivre les cours du collège, il n’interrompit point ses courses aventureuses. Aussi garda-t-il toujours envers ses vieux maîtres une reconnaissance spéciale : ils ne lui avaient presque rien appris et l’avaient laissé libre, lui épargnant ainsi la double déformation physique et mentale qui frappe ordinairement la jeunesse française.
Il resta toute sa vie le Breton solide, trapu et musclé que l’air des grèves avait développé. À 40 ans, il étonnait les marins Italiens en traversant à la nage l’immense baie de la Spezzia ; à 70 ans, il restait un redoutable compagnon de route, conservant après 8 ou 10 heures de marche toute l’aisance de ses mouvements et toute la lucidité d’une mémoire merveilleuse. De tempérament solide et d’esprit pondéré (mens sana in corpore sano), il ne cachait pas son mépris pour la délicatesse maladive des civilisés et ce qu’il appelait l’affolement de leurs réflexes.
N’exagérons rien cependant : si son cerveau, nettement supérieur à la moyenne d’après mes pesées et remarquablement riche en circonvolutions, commandait en maître à son organisme, s’il pouvait exercer sur les réflexes et sur l’expression des sentiments une action inhibitrice à peu près toute puissante, il ne faudrait pas en conclure que cette souveraineté s’exerçât sans résistance. Une dose très minime de café ou de tabac produisait chez lui une excitation à laquelle il s’exposait rarement. Toutes ses impressions étaient extrêmement vives ; mais il fallait le connaître très intimement pour s’en apercevoir. Très artiste, très sensible à la beauté des formes, à l’harmonie du verbe, il présentait dans le domaine moral la même délicatesse de sentiment, et nous allons voir quelles émotions soulevaient dans son âme d’enfant les pratiques religieuses du catholicisme.
Cette acuité de toutes les impressions ne doit pas, à mon sens, nous étonner ; elle prouve simplement l’activité et la tonicité de sa substance nerveuse, et constitue une condition indispensable à la finesse et à la pénétration de la pensée.
Examinons maintenant comment le milieu façonna cette intelligence et lui donna son orientation définitive, Auray, l’humble et poétique petite ville où s’écoula son enfance, est sœur de Tréguier, la patrie de Renan, « C’est par ce que j’ai vu de ces excellents marins, dit ce dernier, que j’ai formé mes idées sur la vertu innée de nos races, quand elles sont organisées selon le type du clan primitif. On ne comprendra jamais ce qu’il y avait débouté dans ces vieux Celtes, et même de politesse et de douceur de mœurs, » J’ai souligné le passage qui fait allusion à l’organisation du clan, car l’observation est très juste, et elle est d’une importance capitale pour comprendre la mentalité de Letourneau.
Constatons d’abord, que son avis concorde en tous points avec celui de Renan sur les rapports du clan avec la moralité : « Le premier type social réalisé par les hommes, dit-il, a été à la fois familial et communautaire, c’est celui du clan, c’est-à-dire d’une petite agglomération républicaine, cimentée par une solidarité des plus étroites… Ses membres étaient encore de pauvres êtres bien mal armés, bien dépourvus, mais, entre eux, l’aide mutuelle était plus qu’un devoir, c’était une nécessité… Il est clair que ces conditions sont éminemment favorables à la constitution, dans la mentalité des primitifs, de certaines vertus sociales qui, avec le temps, peuvent et doivent devenir héréditaires. » Or la Bretagne a conservé jusqu’à nos jours la tradition et l’empreinte morale de cette organisation : absence de mercantilisme et division du travail peu accentué, solidarité étroite entre les membres d’un même village, bienveillance réciproque, services en nature rendus aux faibles, aux veuves, aux orphelins, aux malades, persistance même du totem dans le culte d’un saint local, dont l’image veille aux destinées du clan. Le jeune cerveau de Letourneau subit profondément l’empreinte de ce milieu, et la conserva toute sa vie. Longtemps après, quand il avait déjà dépassé la cinquantaine, il reprochait avec amertume à la civilisation moderne d’être « de plus en plus une civilisation mercantile, où position sociale, droit à une profession, genre de vie, mariage, même la durée de l’existence, tout en un mot est question d’argent ». On comprend qu’il n’était pas fait pour y réussir. Sans fortune, marié à une cousine pauvre comme lui, il essaya, avec son titre de médecin, de gagner sa vie à Paris, mais il exerçait son art en solidariste, portant d’abord ses soins aux déshérités, aux malheureux, comme il aurait fait dans son clan breton. Ici, il risquait de mourir de faim, « Pour les délicats, retenus par une foule de points d’honneur, la concurrence est impossible avec de prosaïques lutteurs bien décidés à ne se priver d’aucun avantage dans la bataille de la vie. » Ce sont encore des paroles de Renan qui s’appliquent admirablement à son compatriote d’Auray.
Mais la providence, auraient dit ses pieux ancêtres, veillait sur lui ; un héritage inespéré vint le tirer d’embarras, sans le réconcilier, d’ailleurs, avec le régime individualiste. Son rêve est toujours d’établir un régime de solidarité qui, tout en respectant la liberté individuelle et même la concurrence, « offrirait à tous ses membres des chances égales à leur entrée dans la vie, et mettrait un appui à la portée de tous les faibles. » Enfin ajoute-t-il, « la république utopique dont je viens de parler exclut nécessairement toute centralisation à outrance. Pour qu’il existe une sérieuse solidarité, il faut que l’unité sociale ne soit pas trop grande, que tout le monde y puisse sentir et maintenir la communauté des intérêts. » Qui oserait, devant ces paroles si suggestives, nier l’influence persistante de ses premières impressions d’enfance ? Le savant sociologue, après avoir pesé tous les systèmes, scruté les mœurs de tous les pays, revenait au clan breton dont les mœurs pures et bienveillantes avaient façonné sa conscience, et c’est bien cette organisation qu’il offrait comme idéal à l’humanité, après l’avoir, il est vrai, rationalisée et débarrassée de sa gangue superstitieuse.
Au fond, il en eut la nostalgie toute sa vie, et c’est bien encore à cet instinct qu’il obéissait quand il se mit membre d’un familistère fouriériste, où il allait se reposer de ses travaux, dans le calme de la forêt de Rambouillet, au milieu d’une société organisée suivant les principes qui lui étaient chers. Si nous ajoutons enfin que son dernier cours à l’École d’anthropologie fut consacré à l’histoire du clan, ou peut vraiment dire que le cycle de sa vie était accompli, que son œuvre, étrangement une et harmonieuse, était terminée.
L’influence spéciale que j’ai essayé d’analyser put se développer tout à l’aise chez lui ; elle ne rencontra aucun obstacle sérieux dans ses études, et le spectacle que la centralisation étatiste et l’individualisme effréné de notre société offraient à ses yeux n’était pas fait pour le rallier et lui faire oublier les mœurs de son enfance ; il n’en fut pas de même des idées religieuses qu’on lui avait inculquées.
« L’état moral et mental de la petite ville ou je suis né, raconte-t-il, en était resté au XVe ou au XVIe siècle ; la population vivait en plein catholicisme, fanatique, borné et fervent. Toute la population était en état de crédulité. Le surnaturel était chose tout à fait naturelle, nul prodige n’étonnait. » Avec le sens affiné que nous lui connaissons, Letourneau fut profondément impressionné, pénétré par cette atmosphère religieuse qui l’enveloppait, « Le début de l’adolescence, dit-il, généralement marqué par un élan des facultés imaginatives, se fit chez moi dans un sens tout à fait religieux, presque mystique. De temps en temps on nous faisait communier, c’était pour moi chaque fois une sorte de crise mentale. J’avais beau faire, toujours je me croyais en état de péché. »
On devine bien qu’il ne s’échappa pas de la tutelle ecclésiastique à la manière des esprits vulgaires, par suite de l’entraînement général, ou par indifférence, ou simplement par libertinage. Ce n’est pas, non plus, l’incohérence des légendes, l’absurdité des miracles qui le choqua. Il y a souvent dans ces légendes, dans ces croyances catholiques une poésie très fine, un sentiment moral très délicat, qui exercent sur des esprits affinés un charme captivant. Il dut sa libération au sentiment de justice que l’enseignement religieux avait sûrement contribué à développer dans sa conscience et qui se retourna contre ses dogmes.
Le catholicisme, autoritaire et soupçonneux, écarte les individus des associations actives où les intelligences se groupent pour étudier et discuter en commun, où les volontés unissent leurs efforts vers un but librement accepté ; mais il leur laisse en pâture un idéal de justice absolue dont la réalisation ne dépend nullement de leur activité, mais dont l’attente respectueuse, dans une âme pénétrée de vertus passives, est regardée comme une beauté morale. Ce sentiment reste très vif chez les libérés ; c’est lui qui fait l’honneur et peut-être aussi la faiblesse des peuples latins ; c’est lui qui souleva l’indignation de Letourneau contre son aumônier, assez injuste pour condamner aux flammes éternelles tous les non-baptisés.
La rupture fut complète et définitive. L’étude des sciences naturelles « ramena son esprit sur la terre, » suivant sa propre expression. Il fit en 1858 une thèse de doctorat en médecine intitulée : Quelques observations sur les nouveau-nés. On y trouve déjà quelques données anthropométriques intéressantes. Puis « la facilité logique que l’on trouve à remplacer un Dieu immatériel, parfaitement inintelligible, par une substance matérielle, étoffe éternelle de l’univers et matrice de toutes choses, » fit de lui un à matérialiste convaincu ; il le resta toute sa vie. Plus tard il devait être un des fondateurs de la Loge « Le matérialisme scientifique » et, dans ses dernières années, je le vois encore répondre avec une vivacité tout à fait exceptionnelle aux objections que je lui faisais au nom du phénoménisme. C’était sûrement, à ses yeux, une perversion de mon esprit, peut-être même y flairait-il une dernière concession au Dieu immatériel. Et sur ce point, il était Intransigeant.
Au point où nous sommes parvenus, la mentalité de Letourneau a acquis son orientation définitive. Les circonstances ne feront que mettre en œuvre ses aptitudes innées ou acquises, et donner occasion de se manifester aux principes directeurs de sa pensée, principe de solidarité et principe de justice, dont il en tendait donner la démonstration par une science rigoureuse et purement matérialiste.
Pendant la période relativement calme qui précéda la guerre de 1870, il lutta surtout pour l’émancipation des esprits. Il écrivit assidûment dans une courageuse publication, La Pensée Nouvelle où collaboraient également Asseline, Coudreau, Paul Lacombe, André Lefèvre, Thulié, Issaurat, Yves Guyot. Ce dernier a bien voulu noter ses souvenirs et me les adresser. Je ne puis mieux faire que de les transcrire : « Nous nous réunissions une fois par semaine, vers 4 heures. Chaque collaborateur lisait son article. On le discutait, on le critiquait, mais avec une grande largeur de vues. On pensait aux difficultés qu’il y avait de faire un journal très surveillé sans tomber sous les risques de la police correctionnelle et de la suppression, La Pensée Nouvelle se déclarait nettement matérialiste, elle citait les auteurs et les savants prudents qui faisaient du matérialisme sans le savoir, entre autres Claude Bernard et Taine. Elle montrait souvent par des extraits l’inconséquence des positivistes. »
« L’influence de la Pensée Nouvelle a été considérable. C’était un journal qui faisait penser et osait appeler les choses par leur nom. On ne subordonnait pus la vérité aux conséquences qu’elle pouvait avoir pour ses rédacteurs, »
Plusieurs des articles de Letourneau ont paru plus tard dans Science et matérialisme, publié en 1801, et dans son premier livre philosophique, La Physiologie des Passions, paru en 1868. Cette œuvre de jeunesse a peu vieilli ; bien écrite, fortement pensée, elle contient en substance la plus grande parties des idées qui serrent développées plus tard.
La guerre vint l’arracher brutalement à ses travaux. Il resta à Paris pendant le siège et remplit les fonctions de médecin-major dans un régiment. Quand la Commune fut proclamée, il continua à donner ses soins aux blessés, comme il l’avait fait pendant la guerre ; mais la solidarité n’est pas toujours bonne à pratiquer ; elle était une vertu pendant le siège, elle devint un crime pendant la guerre civile. Il fut noté comme un homme dangereux, et par suite surveillé et tracassé par la police ; quelques amis bien informés lui conseillèrent de quitter la France. Il partit et alla avec sa famille s’installer à Florence d’où il ne revint qu’en 1878.
Ces évènements donnèrent à sa vie sa direction définitive. Le drame épouvantable auquel il assista l’impressionna profondément. « La secousse de 1871 fit virer de bord mon esprit, dit-il lui-même. Certainement que je n’abandonnai pas mes convictions de libre-penseur ; elles reposaient sur le granit de la vérité scientifique et étaient inébranlables. Mais je compris que, si importantes que soient les grandes questions philosophiques, elles sont loin d’être tout. Plus épineux, plus difficiles à résoudre, plus capitaux encore sont les problèmes sociaux. De ce côté, la vérité ne s’appelle plus matérialisme, elle s’appelle justice »
C’est alors qu’il arrête définitivement le projet de travailler à une sociologie scientifique, « dont les solutions s’imposeront ».
L’exil, loin d’apporter des obstacles à sa tâche, lui fournit les moyens de la réaliser. À Paris, il eût peut-être dispersé ses forces : on eût fait appel à son dévouement pour lutter contre la réaction de 1872, et il n’aurait sûrement pas refusé. À Florence, au contraire, la société italienne est très fermée. Il ne fréquenta qu’un petit groupe cosmopolite d’esprits très éclaires, très ouverts, parmi lesquels il faut mettre en première ligne le Professeur Mantegazza avec lequel il resta très lié. On y remuait beaucoup d’idées mais on était condamné à l’inaction. Letourneau travailla. Chaque jour, m’a-t-il dit, il consacra un nombre d’heures déterminé à la lecture et aux recherches sociologiques. Il prenait de nombreuses notes et des citations avec références précises, qui s’accumulaient entas sur sa table de travail. À la fin de la semaine il en faisait le classement méthodique. Son esprit, déjà mûri par des travaux, précédents en biologie et en psychologie, était admirablement préparé pour cette vaste enquête, d’où devaient sortir plus tard ses cours à l’École d’anthropologie et les quatorze volumes qu’il consacra à la sociologie.
Avec les goûts que nous lui connaissons, il ne pouvait rester indifférent aux merveilles artistiques qui l’entouraient. La langue et la littérature italiennes lui devinrent également familières » mais c’était Le Dante qui était son auteur favori. Que de fois, pendant nos excursions dans la riche Toscane, il m’exprima une impression du moment où un souvenir du passé en citant de mémoire un vers imagé et précis de la Divine Comédie ! Cette fréquentation laissa dans son esprit la dernière empreinte que nous aurons à signaler. Son amour de la forme, son goût pour l’expression élégante, choisie, en furent accrus, et donnèrent à ses ouvrages de science et d’érudition une tournure littéraire qui contribua à leur succès. Souvent même on y rencontre une pointe spirituelle, une ironie légère, une malignité souriante, où l’on peut reconnaître la grâce et l’élégance florentines.
Cette période fut peut-être la plus heureuse de sa vie. Sa famille s’était accrue. Il avait maintenant un fils et deux filles qui vivent encore. Il s’était créé dans le monde où l’on pense des amitiés que sa parfaite loyauté lui conservera toute sa vie. Une fortune suffisante le mettait à l’abri de tous les soucis, et laissait à sa pensée toute sa liberté. Pendant les mots d’été il quittait Florance avec plusieurs de ses amis, et allait se reposer dans un petit port donnant sur la baie de la Spezzia, à San Terenzo. Des bois d’oliviers et d’orangers dévalent des hauteurs vers la mer. Deux vieux châteaux forts ajoutent un caractère romantique à ce site merveilleux qui sut retenir quelque temps l’esprit aventureux de Shelley et de Byron. Le soir, on se réunissait, tantôt dans sa villa, tantôt dans celle, toute voisine, de son ami Mantegazza, où un quart de siècle après nous étions reçus avec la même cordialité. Le malin il n’oubliait pas cependant, dans ces délices de Capoue, son travail et son apostolat scientifiques. Il traduisait les œuvres de Büchner et de Hœckel ; c’étaient ses devoirs de vacances.
À l’époque où nous sommes parvenus, la personnalité de Letourneau a acquis son développement complet. L’enfant, né dans les brumes du Morbihan, pénétré tout d’abord de l’esprit de solidarité qui régnait encore dans son petit clan breton, épris ensuite de justice et de vérité, mûri par les évènements tragiques de 1871, riche du trésor acquis pendant six années de recueillement, rapporte d’Italie un rayon de soleil qui illuminera toute son œuvre.
Rentré en France, il retrouva à l’École d’anthropologie plusieurs de ses anciens amis ; c’était bien le milieu libéral et travailleur qui convenait à son enseignement. Il y professa depuis 1883 jusqu’à sa mort, et l’œuvre posthume qui paraît aujourd’hui est le texte de son avant-dernier cours.
La Société d’anthropologie l’élut comme président en 1880 et l’année suivante lui confia la direction de ses travaux en le nommant secrétaire général. Il sut, dans ces délicates fondions, se faire aimer et respecter de tous ceux qui pensent et qui travaillent.
Je n’ai nullement l’intention de porter sur son œuvre un jugement scientifique qui serait anticipé. Je me suis contenté de suivre le plus fidèlement possible la genèse des idées et des qualités qui donnent à cette vaste encyclopédie sociale son unité et son attrait. Je me suis plu à montrer le côté subjectif de ses principes, parce qu’il expliquait l’homme ; mais leur solidité et leur portée objective n’en sont nullement atteintes. Les preuves qu’il a accumulées patiemment pour les étayer constituent des arguments solides dont la masse imposante résistera longtemps à la critique.
Grâce aux moyens de pénétration et d’investigation que l’industrie moderne a mis en notre pouvoir, les peuples primitifs sont chaque jour mieux connus. Progressivement, on saura élucider plus complètement le problème de leurs origines et le développement de leurs idées et de leurs habitudes sociales ; on pourra, par des statistiques longuement poursuivies, apprécier la valeur pratique de leur mœurs en tant que facteurs du progrès humain. Dès lors il est à prévoir qu’on complétera sur beaucoup de points, et qu’on redressera sur quelques autres les conclusions qu’il a posées. Mais on devra reconnaître qu’il était difficile de faire mieux avec les documents qu’il avait à sa disposition. À une époque de lutte ardente contre des dogmes vieillis et une organisation sociale encore autoritaire, dans une science qui touche forcément aux questions les plus brûlantes de l’actualité, il fit un effort méritoire pour rester impartial dans ses jugements, comme il avait été consciencieux et loyal dans ses recherches : son œuvre est honnête et de bonne foi, comme sa vie.
Paris, le 10 novembre 1902.
G. PAPILLAULT.
Le mot « sociologie », néologisme assez récent, puisqu’il a été créé par A. Comte, n’a eu longtemps, n’a même pas encore, du moins pour le grand public, un sens bien précis. Nombre d’écrivains n’ont vu dans la sociologie qu’une nouvelle branche littéraire, que l’on pouvait aborder sans préparation spéciale. Des systèmes improvisés, des vues théoriques sur l’organisation des sociétés, presque toujours des sociétés civilisées seulement, ont, jusqu’à une date très récente, constitué le fond de la plupart des écrits dits sociologiques, même des plus ingénieux. Aujourd’hui enfin la sociologie est en voie de devenir une science : elle a trouvé la méthode qui la peut conduire au but, – L’histoire du développement intellectuel dans le monde nous montre que, partout et toujours, les premiers esprits investigateurs, les fondateurs des sciences et de la philosophie, au lieu d’étudier patiemment les phénomènes, ont commencé par se perdre dans des conceptions imaginaires et nécessairement fausses ; car les vues générales ne peuvent être que le couronnement de longues observations ; elles ne sauraient leur servir de point de départ, car les fondations doivent préexister à l’édifice. La sociologie, comme les autres sciences dites naturelles, doit reposer sur des observations, sur un matériel considérable de laits sociaux, empruntés à toute l’histoire évolutive du genre humain, en y comprenant son enfance, c’est-à-dire les Âges qui n’ont point d’annales écrites, mais qui n’en ont pas moins précédé et préparé les civilisations les plus avancées, comme notre enfance individuelle devance et prépare notre Âge adulte. La période historique, au sens ordinaire du mot, n’est, qu’une floraison dernière, très courte relativement aux cycles de barbarie, de sauvagerie, même d’inconscience, qui se sont écoulés avant son éclosion. Or, c’est dans cette nuit préhistorique qu’il faut, de toute nécessité, aller chercher les origines des institutions historiques. Mais, pour se guider dans les ténèbres de la préhistoire, il fallait un flambeau qui a manqué à nos devanciers.
Aussi jusqu’à nos jours, le problème de ces origines ne se posait même pas et il semblait défier à jamais toute investigation scientifique ; mais la grande doctrine de l’évolution, enfin triomphante, nous a frayé des routes nouvelles : elle a suscité la méthode comparative et, dès lors, les études sociologiques ont pu s’appuyer sur une base solide. On s’est aperçu que les peuples civilisés de race blanche, si fiers de leur civilisation qu’ils en voient à peine les côtés faibles, ne constituaient qu’une minorité dans le genre humain ; qu’en dehors de ces races, de nombreuses sociétés, éparses sur le globe terrestre, avaient cheminé, même cheminent encore, avec des vitesses très inégales sur la route du progrès et nous peuvent représenter, réelles et vivantes, toutes les étapes successives, lentement parcourues jadis par les races aujourd’hui supérieures. Nous n’avons donc plus à imaginer, comme on l’a fait tant de fois, à grand renfort d’hypothèses, les phases premières de l’évolution sociale. Pour les contempler, dans leur simplicité première, il suffit de ranger en série graduée les races humaines actuelles et de comparer leurs institutions partout similaires ou à tout le moins très analogues, si l’on veut bien les confronter aux mêmes périodes de développement.
La sociologie comparative repose donc sur deux propositions générales, deux postulats, si l’on veut : 1° toutes les civilisations passées ou présentes ont eu leur enfance barbare et sauvage, à partir de laquelle lentement, péniblement, elles ont évolué et, pas plus que l’homme, dont elles sont l’aurore, elles ne sont nées par genèse miraculeuse ; 2° les races incultes contemporaines, dont les plus inférieures confinent encore à l’animalité, nous représentent, d’une manière générale, les phases lentement progressives, par lesquelles ont passé les ancêtres des peuples civilisés. De ces deux propositions, on n’ose plus guère contester la première. Quant à la seconde, elle est suffisamment établie par la préhistoire, par les antiques traditions, par la linguistique, et enfin elle est confirmée par les survivances qui persistent encore au sein des civilisations les plus avancées.
Guidés par ces vues nouvelles, les sociologistes de tous les pays se sont mis à l’œuvre et aujourd’hui les grandes lignes de l’histoire positive du genre humain sont tracées sûrement et pour toujours. Sans doute quelques écrivains attardés ou englués dans de vieilles doctrines s’acharnent encore à tirer de l’histoire seule une sociologie scientifique. Autant vaudrait prétendre reconstituer un livre avec son dernier chapitre. Non pas que l’histoire proprement dite ne puisse être de quelque secours aux sociologistes ; mais, pour en tirer un profit sérieux, pour la souder aux phases antérieures, on doit au préalable interroger la préhistoire, la mythologie comparée, la linguistique, la psychologie du genre humain tout entier, et spécialement la sociologie ethnographique.
C’est surtout à cette dernière source de renseignements, à la sociologie ethnographique, qu’en veulent les sociologistes vieux style qui, de parti pris, s’enferment dans l’histoire seule où la sociologie ne doit pourtant puiser qu’avec prudence. À peine est-il besoin de rappeler que la plupart des historiens, des annalistes, s’attachent aux évènements bien plus qu’aux institutions, aux individus bien plus qu’aux faits sociaux ; qu’avant tout ils sont des chroniqueurs et non des sociologistes ; que souvent même les simples récits qu’ils nous donnent d’évènements dont bien rarement ils ont été témoins, fourmillent d’inexactitudes et, presque toujours, le cèdent de beaucoup en authenticité aux renseignements ethnographiques. Ceux-ci, dont parfois on affecte de faire fis nous sont fournis par une armée d’observateurs, voyageurs, explorateurs, missionnaires, marchands, militaires, savants, résidents, fonctionnaires, etc., témoignant de ce qu’ils ont vu de leurs yeux et dont les relations écrites et publiées a des dates diverses, en des langues différentes, par des gens qui, le plus souvent, s’ignoraient les uns les autres, se contrôlent mutuellement et acquièrent ainsi un caractère tout particulier d’exactitude.
Telles sont les vues qui m’ont guidé dans une série d’ouvrages antérieurs. Sans dédaigner aucune source de renseignements, j’en ai surtout demandé à l’ethnographie comparative. L’un après l’autre, les principales institutions, les modes principaux de l’activité sociale ont été étudiés. Je me suis efforcé, non d’en faire l’histoire complète, la tentative eût dépassé les forces d’un seul homme, mais d’on retracer successivement l’évolution en citant et coordonnant les faits les plus typiques. Dans ce volume encore, je resterai fidèle à cette méthode, en décrivant, d’après les faits observés, la condition sociale des femmes dans la série des races et des sociétés humaines, depuis les plus sauvages jusqu’aux plus civilisées. Comme à l’ordinaire, je serai sobre de dissertations abstraites et, autant qu’il me sera possible, abondant en informations précises. Les faits parleront d’eux-mêmes : en sociologie, c’est la seule éloquence sérieuse. Peut-être quelques-uns de mes lecteurs se demandent-ils si ces faits auront une portée féministe ou anti-féministe ? Mais c’est là une considération dont je n’ai pas à me préoccuper. Le seul devoir que nous impose la méthode scientifique, c’est de chercher honnêtement la vérité et de la dire avec une entière sincérité.
Les prémisses une fois posées, je puis aborder, dès à présent, le vaste sujet de ce livre, c’est-à-dire, l’étude du sort fait à la femme dans toutes les races humaines, en commençant par les plus humbles. Mais toutes les races et variétés de notre espèce se peuvent ramoner à trois types principaux : l’homme noir, l’homme jaune, l’homme blanc. À leur tour, chacune de ces grandes divisions comprend des effigies diverses, des sous-races inégalement développées. Nous débuterons donc dans notre enquête par lus races noires, et naturellement par la plus inférieure d’entre elles, le noir d’Australie. Mais l’homme d’Australie est encore si voisin de l’animalité qu’il ne sera pas inopportun, avant de commencer par lui notre revue du genre humain, de jeter un très rapide coup d’œil sur le monde des animaux et d’y relever quelques laits intéressants pour le chapitre sociologique qui va nous occuper.
Dans les sociétés humaines, la position de la femme est, comme on le sait et comme nous le verrons, habituellement subordonnée, quoique à des degrés divers ! S’il en ôtait de même dans le monde animal partout et toujours, on pourrait être tenté d’attribuer ce fait général à une loi universelle, fatale, essentielle à la différence même des sexes. Mais il n’en est rien ; dans nombre d’espèces, les femelles l’emportent sur leurs mules par la taille et la force ; certaines même leur sont redoutables. Non toujours, mais souvent, cette prépotence du sexe femelle se voit de préférence chez les invertébrés, particulièrement chez les arthropodes et surtout chez les arachnides et les insectes. Ainsi, chez quelques espèces d’araignées, le mâle ne peut féconder sa femelle sans risquer d’être dévoré par elle. Ailleurs, dans les curieuses républiques des fourmis et des abeilles, on sait que le gouvernement, plus généralement toute l’activité sociale, est le fait des ouvrières, c’est-à-dire de femelles stériles ou stérilisées, qui, traitant de très haut les mâles et les femelles fécondables, réglementent la reproduction strictement au point de vue de l’utilité publique, sans le moindre égard pour leurs compagnons sexués, jugés inutiles au nid ou à la ruche en dehors de leur office générateur. Il s’en faut donc que la sexualité mêle confère nécessairement la suprématie chez les arthropodes.
Mais l’embranchement des vertébrés n’est pas sans fournir aussi bon nombre d’exemples du même genre. Ainsi, dans la presque totalité des espèces de poissons, la femelle est plus grande que le mâle. Parfois, chez les cyprinodontes, par exemple, le mâle n’atteint même pas la moitié de la grosseur de la femelle et il est sans cosse exposé à être dévore par celle-ci, quand elle est de mœurs carnassières.
De même, chez nombre d’espèces d’oiseaux, les femelles sont plus grandes que les mâles. Le cas opposé est cependant le plus fréquent ; mais, même alors, la femelle est rarement asservie par son compagnon. Très souvent, au contraire, le mâle courtise la femelle et c’est à la sélection esthétique exercée par celle-ci qu’il faut attribuer la lente production, chez les oiseaux mâles, des moyens de séduction dont ils usent, c’est-à-dire de la beauté de leur plu mage et de celle de leur chant. Chez certaines espèces, particulièrement chez les oiseaux à berceau australien, chez l’Amblyornis inornata de la Nouvelle-Guinée, entre autres, le sens esthétique des mâles et de la femelle est tellement développé qu’ils construisent en commun, pour leurs parades d’amour, des abris ornés d’objets de couleur vive : plumes, coquillages, cailloux agréablement teintés, et dont ils changent constamment la disposition afin de se donner des sensations nouvelles. Le mâle et la femelle de ces espèces artistiques travaillent ensemble à leurs maisons d’amour sans songer à s’asservir mutuellement. Pourtant il existe des espèces d’oiseaux à mœurs grossières, brutales ; ce sont d’habitude les moins intelligentes. Ainsi le dindon mâle dévore fréquemment les œufs de sa femelle, quand celle-ci néglige de les lui cacher. Les asturides semblent souvent dépourvus de tout sentiment familial ; la femelle va parfois jusqu’à manger son mâle ou bien d’un commun accord tous deux dévorent leurs petits. Par un juste retour, ces derniers, s’ils ont été épargnés, mangent assez volontiers leurs parents : ce sont les sauvages du monde des oiseaux. La masse des autres espèces est plus civilisée. Chez la plupart, la monogamie est de règle et le initie est bon père et bon époux ; il travaille à la construction du nid ; il nourrit la femelle quand elle couve ; il couve comme elle ; il aide à alimenter les petits et quitte rarement la famille. L’appariage de ces oiseaux dure au moins une saison.
La plupart des espèces d’oiseaux donnent donc aux mammifères des exemples de bonne conduite familiale mais ceux-ci les suivent assez rarement. Leurs unions sont souvent polygamiques et ils obtiennent leurs femelles plus fréquemment par le combat que par des séductions esthétiques. Pourtant la monogamie est loin d’être rare chez les mammifères. Elle est de règle, par exemple, dans les ordres des chéiroptères, des édentés, des insectivores, des rongeurs. Les grands carnassiers aussi sont habituellement monogames, sauf le lion de l’Afrique australe qui groupe autour de lui jusqu’à quatre ou cinq femelles. En outre, chez les mammifères, la polygamie du mâle s’accompagne souvent du vilain sentiment de la jalousie. Le père expulse ses rejetons mâles, dès qu’ils lui donnent de l’ombrage. Ainsi procède, par exemple, le lama guanaco mâle, qui domine, protège et confisque son petit troupeau de femelles. Sans le perdre de vue, il paît à l’écart et donne au besoin l’alarme à son sérail et aux jeunes. Dans ces familles polygames de lamas, les femelles, quoique subordonnées, semblent très attachées à leur mâle commun. Est-il blessé ou tué ? Elles accourent près de lui, en sifflant, et partagent son triste sort.
Chez beaucoup de mammifères, la famille, quand elle existe pendant un certain temps, est purement maternelle ; car d’ordinaire le mâle s’éloigne aussitôt après l’accouplement, qui n’est qu’une rencontre de hasard. – Les singes, notamment les anthropoïdes, sont polygames et forment de petites familles, plus ou moins durables, gouvernées par un seul mâle adulte. Par suite de la régulière expulsion des jeunes mâles, ces petites sociétés polygames des grands singes ne sauraient se développer. Au contraire, certaines espèces de mammifères (canidés, bovidés, équidés, etc.), vivent en troupes non appariées, en hordes nombreuses ; mais, dans le monde animal, la famille et la peuplade sont antagoniques. Ainsi les grandes meutes de chions sauvages se composent de couples, qui ne s’apparient que momentanément et dont les jeunes sont soignés par les mères seules. Les singes polygames forment aussi des hordes nombreuses ; au contraire, les chimpanzés monogames vivent tout au plus ou petits groupes de dix à douze couples. Mais je ne veux plus prolonger davantage cette courte incursion dans le règne animal. Seulement je signalerai les quelques faits généraux qui en ressortent et sont utiles à connaître, puisque l’homme, quoi qu’il ait pu prétendre, n’est que le premier des animaux ; l° La sexualité femelle n’entraîne point nécessairement, et en vertu d’une loi organique, la faiblesse relative et, par suite, la subordination de la femelle au mâle plus robuste. 2° Les unions monogamiques, au moins pour une saison, sont beaucoup moins communes chez les mammifères que chez les oiseaux, qui leur sont pourtant inférieurs dans la hiérarchie taxinomique. 3° Chez les mammifères, la famille rudimentaire reposa surtout sur la femelle. Quand cette famille est monogamique, ce qui est assez rare, elle s’oppose à la formation de sociétés nombreuses. Quand, au contraire, elle est polygamique, elle résulte principalement de la jalouse sensualité du mâle, qui accapare les femelles et expulse les jeunes de son sexe. 4° Dans les unions sexuelles, plus ou moins durables, entre animaux vertébrés supérieurs, par exemple chez les oiseaux et les mammifères, que ces unions soient polygamiques ou monogamiques, les femelles, quoique habituellement les plus faibles, ne sont point opprimées ni maltraitées systématiquement par leurs mâles, comme il arrive si souvent dans les sociétés humaines. Au contraire, le plus souvent, le mâle donne à sa compagne aide et protection. On observe même, chez certaines espèces d’oiseaux, par exemple les perruches illinoises (psittacus pertinax), des cas de tendresse conjugale si vive, que les individus appariés ne se survivent pas l’un à l’autre et que, pour eux, veuvage et mort sont synonymes.
Après cette petite excursion dans la sociologie zoologique, nous pouvons maintenant passer, sans transitions trop heurtées, à l’examen du sort fait à la femme chez les Mélanésiens d’Australie ou de Tasmanie, c’est-à-dire chez la plus inférieure des races noires du genre humain.
Dans les sociétés humaines plus civilisées, la famille, on le sait, se distingue nettement de la grande société, dont elle fait partie. En Australie, il n’en est rien encore ; le clan est l’unité politique, primordiale, et la famille, telle que nous la comprenons, ne s’en est pas encore différenciée. Le clan d’Australie est un petit groupe solidaire, dont tous les membres se regardent comme parents. Tous les hommes de ce clan sont égaux entre eux, sauf la prééminence des membres du Conseil, ordinairement les plus âgés. Tous sont ou doivent être étroitement unis ; en principe, chacun d’eux a droit à l’aide des autres et réciproquement, dès qu’il y a danger. Entre membres de ce clan on ne se remercie pas pour un service rendu ; car le secours mutuel est simplement un devoir. Il n’existe pas non plus de propriété individuelle sérieuse ; car le clan possède un droit éminent sur tout : sur les armes, les filets, les canots, etc. Chaque clan a son nom particulier et son symbole, son totem. Tous les membres du clan, ai-je dit, se regardent comme parents, mais d’une parenté, pour nous, confuse ; car elle se rattache à la primitive conception de la famille utérine, particulièrement au système connu, ou sociologie, sous le nom de « système Tamil ». Ainsi les enfants du frère d’un homme, pour nous ses neveux, sont ses enfants ; inversement tous les frères du père d’un homme, pour nous ses oncles, sont ses pères ; tous les frères de sa mère, au contraire, sont ses oncles. C’est que la première consanguinité constatée à l’origine a été colle qu’il était difficile de ne pas voir : la parenté utérine ; longtemps, bien longtemps on n’en a point connu d’autre dans le clan australien, où, récemment encore, le pore, quand on aurait pu le désigner, n’était point réputé parent de son fils.
Dans ces clans d’Australie, les unions sexuelles ont d’abord été une promiscuité restreinte et réglementée. Aujourd’hui, l’on ne retrouve plus guère de ces clans dans toute la simplicité de leur organisation primaire. Tous ont évolué plus ou moins et pas toujours de même, et il en est résulté, dans certains d’entre eux, la constitution de classes de parents non consanguins, de parents fictifs. Par exemple, un vieillard appellera gravement un enfant son « grand-père » ou bien il donnera le nom de « frère » à un enfant de quelques semaines. Chez les Kurnai, une belle-sœur est appelée « femme » par son beau-frère et elle l’appelle son « mari », survivance d’un temps par trop primitif où des groupes de sœurs épousaient des groupes de frères. Enfin les simples amis se donnent mutuellement des noms exprimant telle ou telle parenté. Au total, on attache beaucoup moins d’importance à la consanguinité réelle qu’aux classes plus ou moins conventionnelles de parenté, à celle qui résulte simplement de la communauté des totem. Règle générale, l’union sexuelle durable, l’union conjugale, est interdite dans le clan ou même dans la classe du clan à laquelle on appartient. Pour se procurer une femme en propre, il faut qu’un Australien s’adresse à un autre clan ou au moins à une autre classe.
Au contraire, il est des clans et des classes unis par une convention conjugale préexistante aux individus qui les composent. En vertu de cette convention, tous les hommes de l’un de ces groupes naissent « maris » de toutes les femmes de l’autre et réciproquement. En conséquence, tout visiteur, venant de l’un de ces clans dans l’autre, pour un séjour temporaire, est pourvu d’une femme pendant la durée de son séjour. Les clans mariés d’office ont, dû jadis être rigoureusement exogames. Les femmes n’en pouvaient littéralement sortir et les enfants de ces femmes appartenaient à leurs clans. Aujourd’hui encore, en cas de guerre de clan à clan, les fils d’un homme rejoignent le clan de leur mère et combattent celui de leur père. Assez souvent les femmes individuellement sorties de leur clan ont été données ou troquées par leurs frères ou leurs pères ;; mais le plus habituellement elles ont été violemment enlevées par des hommes appartenant à des clans étrangers. Ces rapts exogamiques sont ou étaient très fréquents on Australie. Ils se pratiquaient souvent avec une grande brutalité. Le ravisseur s’embusquait dans un endroit propice, guettait l’occasion en se blottissant dans la brousse et enlevait violemment la femme, ordinairement après l’avoir plus ou moins assommée. Finalement il en abusait, dès qu’il se jugeait hors des atteintes du clan outragé par son attentat. Parfois le ravisseur avait pour complices des amis, des hommes de son clan et, aussitôt après la prise, tous possédaient on commun la femme ou la fille enlevée. Parfois les femmes étaient ainsi ravies même à des clans avec lesquels on avait droit d’union sexuelle ; alors l’attentat consistait seulement à faire violemment sortir une femme du clan auquel elle appartenait pour en faire sa propriété. Ces rapts étaient ou sont encore causes de revendications et de guerres perpétuelles entre les élans ; car ils violent les anciennes coutumes, suivant lesquelles c’est le groupe et non l’individu qui doit se marier. Le rapt n’est pas toujours violent, parfois il s’accomplit après accord préalable avec la femme. Il n’en est pas jugé moins punissable ; mais dans tous les cas, la naissance d’un enfant éteint les revendications du clan offensé.
Une fois devenue de manière ou d’autre la propriété spéciale d’un homme, la femme enlevée ne doit pas lui être infidèle sans autorisation de sa part, autorisation que d’ailleurs il n’est pas très coûteux de lui acheter. Lorsqu’une femme, individuellement possédée, s’enfuit et est reprise par d’autres hommes qui se sont mis à sa poursuite, elle leur appartient et non plus à son premier maître. Il va sans dire que la monogamie n’est pas obligatoire pour l’homme d’Australie. Les gens âgés, influents, pratiquent au contraire et largement la polygamie. Si le propriétaire d’une ou de plusieurs femmes vient à mourir, sa ou ses femmes passent immédiatement, à titre de propriété, à un autre homme, par une sorte de lévirat grossier.
La femme, devenue la propriété conjugale d’un homme, n’est pourtant point sans jouir encore d’une certaine protection. Si le mari la maltraite trop cruellement, le clan de cet homme intervient et lui ôte son souffre-douleur pour le donner à un autre. La femme a-t-elle été infidèle dans des conditions jugées blâmables, ce sont ses parents, les parents de son clan, et non son mari, qui seuls ont le droit de la punir. Une Australienne ayant abandonné son mari, ses parents lui firent tranquillement et juridiquement de larges blessures à la tête, châtiment qu’elle subit avec une parfaite résignation, en disant : « C’est leur droit ».
C’est qu’en effet, selon la primitive organisation des clans australiens, les femmes sont la propriété de leur clan, qui on peut disposer à son gré. Mais d’elles-mêmes, sans autorisation préalable, elles ne sont pas libres d’abandonner leur clan pour s’unir et s’associer à un homme d’un autre groupe. Toutes les femmes d’un clan naissent virtuellement « femmes » de tous les hommes d’un autre clan ; mais sans que cela implique le moins du monde le droit de quitter le clan où elles sont nées. Les seules femmes, sur lesquelles un homme puisse avoir un droit de propriété personnelle, quelque chose d’analogue à la manus romaine, sont colles qui ont été librement cédées, échangées ou violemment ravies soit par un rapt particulier, soit par une razzia guerrière. Les hommes ont des termes différents pour désigner les femmes qui leur appartiennent en propre et celles sur lesquelles ils n’ont qu’un droit général, secondaire et partagé avec d’autres.
La plus ancienne division, celle en deux groupes distincts ayant ensemble droit d’union sexuelle, a encore été trouvée intacte dans l’Australie du sud, au nord de Queensland et dans les îles. Partout ailleurs elle est plus ou moins altérée ; les rapts, les échanges individuels des femmes ont atténué ou fait disparaître les vieilles mœurs. Même la filiation individuelle commence à être constatée et acceptée, sans doute là où elle est admissible, c’est-à-dire dans les unions individuelles et durables. Alors les pères ou les frères font entre eux échange de leurs filles ou de leurs sœurs. Parfois même les femmes tiennent à honneur d’avoir été ainsi échangées par leurs proches. Par exemple, chez les Narrinyeri, il est honteux à une femme d’être possédée par un homme qui n’en a pas au préalable donné une autre en échange. Certains clans dégénérés n’ont même plus de totem. Dans d’autres clans, les enfants appartiennent toujours au clan du père ou bien simplement au clan, quel qu’il soit, dans lequel ils naissent.
Mais d’un ensemble de faits, dont je n’ai cité que des spécimens, on est autorisé à induire qu’il l’origine chaque clan formait un petit groupe égalitaire et communautaire, à parenté très confuse, plutôt fictive que réelle. À l’origine, ces clans ont dû être endogamiques, c’est-à-dire qu’il a dû y régner une promiscuité réglementée ; puis ils sont devenus exogamiques, quand des essaims sortis des clans tout à fait primaires ont constitué d’autres clans parents, consanguins, et par suite mariés avec les clans d’où ils étaient sortis. Il se peut que dans les clans tout à fait primaires, dont nous ne voyons plus que les descendants plus ou moins altérés, la situation de la femme ait été relativement bonne. Dans d’autres pays et races, ou a trouvé encore des restes de ces dans rigoureusement égalitaires, où les intérêts, les passions des individus et des petites familles n’avaient pas miné ou détruit les vieilles mœurs. En Australie, il en est bien rarement ainsi ; aussi le sort de la femme y est ordinairement plus que servile, comme nous allons le voir maintenant en écoutant nombre de témoignages.
En raison des privilèges dont jouissent, dans les clans d’Australie, les hommes âges, ceux-ci pratiquent largement la polygamie. La natalité serait donc très faible, par ce seul fait, si les propriétaires clos femmes n’avaient pas la liberté dont ils usent, de trafiquer de leurs femmes ou de les prêter à leurs amis. De leur côté, les femmes pratiquent sans scrupule l’avortement et l’infanticide, car elles redoutent beaucoup la maternité, qui les flétrit, qui leur donne en outre la lourde charge d’élever des enfants et de les allaiter jusqu’à l’âge de 4 à 5 ans. En Australie, la grossièreté des aliments et de leur préparation, sans parler de leur fréquente insuffisance, s’opposent en effet au sevrage précoce.
L’existence de la femme australienne est d’ailleurs des plus pénibles et on a soin de l’y dresser de bonne heure. Les vieilles femmes du clan montrent aux très jeunes filles comment on construit, presque chaque soir, le paravent d’écorce qui sert de maison aux Australiens ; comment on recueille la gomme adhésive de Xantorrhea, indispensable pour fabriquer les outils ou armes en pierre taillée ; comment on transforme les roseaux en paniers ; avec quelles plantes on tresse des corbeilles ou des filets ; comment, avec du poil d’opossum, on fait des cordes et du fil ; comment, avec ce fil, on coud le sac de cuir, qui ne quitte guère le dos de la femme et où, alors qu’elle suit son homme battant la brousse pour trouver du gibier, elle loge divers objets nécessaires, quelquefois un petit enfant, quand elle en doit porter un plus grand sur ses épaules.
Durant ces marches errantes à travers la brousse, la femme australienne s’appuie d’une main sur un long bâton pointu, de l’autre, elle porte ordinairement un tison embrasé ; car en Australie, on est très peu expert dans l’art d’allumer du feu et la femme est, pour ce motif, astreinte au devoir des vestales. Les matrones ont même soin d’enseigner aux jeunes filles, dans une espèce d’initiation secrète, l’art d’entretenir et d’allumer le fou. Le soir, quand on arrive au campement, les femmes ne se nourrissent que des restes du repas, s’il y en a : « Ce sont les souffre-douleur… et, tandis que leurs soigneurs finissent le repas qu’elles ont préparé pour eux, ces malheureuses créatures sont patiemment assises, à distance, et attrapent les os, les débris que les hommes leur jettent aux épaules, exactement comme nous jetons de la viande à un chien ». La femme grosse sort et travaille jusqu’au moment de sa délivrance. Ce moment venu, elle va accoucher à l’écart, sans presque proférer une plainte. Quelques heures après la parturition, l’Australienne reprend sa vie ordinaire, va même chercher du bois pour alimenter le foyer. Ce sont les femmes, en effet, qui doivent fournir à l’association l’eau, le bois ; elles aussi, qui préparent la nourriture souvent végétale. Tous les fardeaux sont pour les épaules de la femme ; toutes les besognes pénibles constituent son lot. C’est même pour cela qu’on la veut posséder en propre. Les jeunes gens prennent femme, de manière ou d’autre, pour s’éviter la peine de chercher du bois, de l’eau, des aliments et de porter les objets qu’ils possèdent (Eyre, Discoveries, II, 321). Ils n’en sont pas, pour cela, plus aimables. Au moindre accès de mauvaise humeur, l’homme détache à la femme un coup d’assommoir ou lui lance son javelot de bois qui peut lui transpercer un membre.
Les Australiens mènent encore une existence nomade ; ils n’ont point de villages ; pour eux, la maison n’est qu’une sorte de paravent d’écorce dressé près du feu. Ils n’habitent pas ; ils campent. Or, après une journée de chasse ou de guerre, quand on s’arrête le soir, pour passer la nuit, les hommes se reposent, mais les femmes doivent d’abord couper du bois pour entretenir le fou ; en outre, si l’on est près d’un cours d’eau ou d’un lue, elles en explorent les rivages pour y trouver des coquillages, qu’elles font cuire et apportent à leurs hommes. Si cette ressource leur manque, elles vont à la recherche des lézards et des opossums, poursuivant ces derniers jusqu’à la cime des arbres ou les capturant dans leurs trous… Sur le rivage, elles passent les jours et souvent les nuits à recueillir des coquillages ou à pécher au milieu des lames, en plongeant… La contribution alimentaire de l’homme consiste surtout en miel et accidentellement en œufs, gibier, lézards ; mais en général il garde pour lui la nourriture animale. Pour l’homme, la chasse est surtout un sport… Approvisionner la famille n’est pas son affaire ; il vit pour sa satisfaction personnelle. Souvent il chasse tout le jour, mais a soin de dévorer sur place son gibier. Ses devoirs sont légers ; en revanche, ses droits sur sa femme sont considérables ; il peut la battre, la blesser, même la tuer, si bon lui semble. Une fois devenue la propriété d’un homme par rapt, achat, troc, razzia, peu importe, la femme n’a plus guère de protection contre le bon plaisir ou la brutalité de son maître.
Nous avons vu que l’Australienne ne peut être infidèle à son propriétaire sans autorisation, mais l’homme, lui, pratique à son gré le libre amour. De plus, il a le droit de répudier sa femme, quand bon lui semble. Les fournies sont-elles vieilles ou infirmes ? il n’y a plus, pour elles, d’autre lot que l’abandon et la mort. Un explorateur, Oldfield, écrit qu’il n’a jamais vu, en Australie, une tombe de femme. Il pense que les naturels ne prennent pas la peine d’enterrer les femmes et ajoute ensuite : « On les dépêche généralement avant qu’elles ne deviennent vieilles et maigres pour ne pas laisser perdre tant de bonne nourriture… Bref, on y attache tellement peu d’importance, soit avant, soit après la mort, qu’il est permis de se demander si l’homme ne met pas son chien, quand celui-ci est vivant, absolument sur la même ligne que sa femme et s’il pense plus souvent et plus tendrement à l’une qu’à l’autre après qu’il les a mangés tous doux. »
Durant leur jeunesse, les femmes d’Australie passent de main en main, en vertu des coutumes dont j’ai parlé, de ces curieux mariages entre clans ; en vertu aussi des rapts, des échanges, des veuvages ou des prêts qu’en font leurs propriétaires. L’Australien semble peu capable de jalousie sexuelle, comme nous l’entendons ; les infidélités féminines sont blâmées et punies par lui surtout comme des infractions aux coutumes, aux règles traditionnelles. Ainsi, dans certaines fêtes de clan, appelées corrobories, quelques femmes sont, pour la circonstance, déliées de toute restriction sexuelle ; dès lors tous les hommes présents ont la liberté d’avoir commerce avec elles et les femmes de service sont chaque jour remplacées par d’autres, tant que dure la fête. De leur côté, les femmes sont aussi étrangères que les hommes à la jalousie. Elles approuvent même beaucoup leurs maris, quand ceux-ci veulent bien leur adjoindre d’autres femmes plus jeunes, sur lesquelles elles auront de l’autorité et se déchargeront des besognes pénibles. Au contraire, elles ne veulent pas de compagnes plus âgées qu’elles et auxquelles elles seraient, par cela même, soumises. Dans de telles occurrences, on en voit se révolter, s’enfuir, enfin chercher protection dans leur clan d’origine, d’où résultent parfois, entre les clans intéressés, des litiges et des combats juridiques, des retaliations. Dans ces duels juridiques, soigneusement réglés à l’avance, les femmes se tiennent auprès de leurs champions, ramassent les javelots lancés, en fournissent au besoin d’autres. Souvent elles sont l’enjeu même de la rencontre, après laquelle il leur arrive de changer de maris ou plutôt de propriétaires. Celles qui sont réputées jolies, sont d’ailleurs désirées par beaucoup d’hommes à la fois et, la coutume du rapt aidant, elles ont maintes occasions de se familiariser avec les révolutions conjugales.
Le sort de la femme australienne est donc des plus misérables, puisqu’elle est doublement esclave : de son clan d’abord, puis des hommes qui, de manière ou d’autre, acquièrent sur elle un droit de propriété. Même dans les réjouissances, dans les fêtes de clan, les femmes jouent assez rarement un rôle actif, si ce n’est dans quelques danses lubriques, quelles exécutent pour exciter les désirs des hommes. Pourtant, durant leurs loisirs et entre elles, elles s’amusent à des danses mimiques, figurant les principaux incidents de leur vie : par exemple, elles font semblant de grimper dans les arbres pour saisir les opossums, de plonger pour recueillir des coquillages, de fouir le sol pour déterrer des racines comestibles, d’allaiter leurs enfants, de se quereller avec leurs maris. Dans les corvobories où dansent les hommes, les femmes, accroupies en cercle autour du lieu de la fête, chantent et marquent la mesure en frappant avec leurs mains sur leurs manteaux de peau, qu’elles ont tendus entre leurs cuisses ; car le tam-tam africain est encore inconnu des Australiens. Quand les femmes dansent, elles se battent la mesure à elles-mêmes en imprimant des mouvements rythmiques à leurs longues mamelles pendantes.
Pourtant il arrive que ces pauvres créatures si dédaignées, si opprimées, soient chargées d’importantes missions politiques. Par exemple, dans les litiges si fréquents entre dans et tribus, les femmes jouent souvent le rôle d’intermédiaires, d’ambassadrices ; car les hommes ne sauraient alors se mettre en avant sans danger ; au contraire, les tommes peuvent circuler entre les doux partis et négocier un arrangement. Même certaines femmes âgées, et sans doute ayant pour maris des hommes âgés comme elles et influents, assistent aux conseils du clan et y ont voix délibérative dans les affaires importantes. On est tenté de voir dans ces pratiques anormales, qui contrastent si fort avec l’oppression générale pesant ordinairement sur les femmes en Australie, des survivances d’un état ancien, des beaux temps du clan égalitaire, qui, en Australie, comme ailleurs, a dû être la première forme sociale.





























