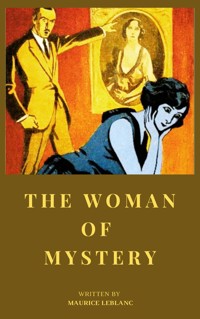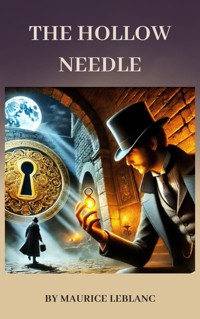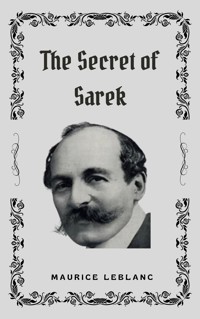3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La femme mystérieuse (traduit)
- Cette édition est unique;
- La traduction est entièrement originale et a été réalisée pour l'Ale. Mar. SAS;
- Tous droits réservés.
La Femme du mystère, également connu sous le nom de L'Éclat de coquillage, est le huitième livre de la série Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Ce livre ne faisait pas partie de la série à l'origine et, dans cette édition de 1916, Lupin n'y figure même pas. C'est dans l'édition de 1923 qu'il a été intégré à l'histoire.
№ 8e de la série Arsène Lupin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Table des matières
Chapitre 1. Le meurtre
Chapitre 2. La pièce fermée
Chapitre 3. L'appel aux armes
Chapitre 4. Une lettre d'Élisabeth
Chapitre 5. La paysanne de Corvigny
Chapitre 6. Ce que Paul a vu à Ornequin
Chapitre 7. H. E. R. M.
Chapitre 8. Le journal d'Élisabeth
Chapitre 9. Un brin d'empire
Chapitre 10. 75 ou 155 ?
Chapitre 11. "Ysery, Misery"
Chapitre 12. Le commandant Hermann
Chapitre 13. La maison du passeur
Chapitre 14. Un chef-d'œuvre de la culture
Chapitre 15. Le prince Conrad se réjouit
Chapitre 16. L'impossible lutte
Chapitre 17. La loi du conquérant
Chapitre 18. Colline 132
Chapitre 19. Les Hohenzollern
Chapitre 20. La peine de mort et une peine capitale
La femme mystérieuse
Maurice Leblanc
Chapitre 1. Le meurtre
"Supposons que je vous dise, dit Paul Delroze, que je me suis trouvé un jour face à lui sur le français. . . ."
Élisabeth lève les yeux vers lui avec l'expression attendrie d'une jeune mariée pour qui la moindre parole de l'homme qu'elle aime est un sujet d'émerveillement :
"Vous avez vu Guillaume II en France ?"
"Je l'ai vu de mes propres yeux et je n'ai jamais oublié un seul des détails qui ont marqué cette rencontre. Et pourtant, cela s'est passé il y a très longtemps."
Il parlait avec une gravité soudaine, comme si le réveil de ce souvenir avait réveillé les pensées les plus douloureuses de son esprit.
"Raconte-moi, Paul, demande Élisabeth.
"Oui, je le ferai", dit-il. "En tout cas, même si je n'étais qu'un enfant à l'époque, l'incident a joué un rôle si tragique dans ma vie que je me dois de vous raconter toute l'histoire".
Le train s'arrêta et ils descendirent à Corvigny, dernière station de l'embranchement local qui, partant du chef-lieu du département, traverse la vallée du Liseron et aboutit, à quinze milles de la frontière, au pied de la petite cité lorraine que Vauban, comme il le raconte dans ses "Mémoires", entoura "des plus parfaites démilunes qu'on puisse imaginer".
La gare présentait une animation inhabituelle. Il y avait de nombreux soldats, dont beaucoup d'officiers. Une foule de voyageurs - commerçants, paysans, ouvriers et visiteurs des stations thermales voisines desservies par Corvigny - se tenait au milieu de piles de bagages sur le quai, attendant le départ du prochain train pour la jonction.
C'était le dernier jeudi de juillet, le jeudi précédant la mobilisation de l'armée française.
Élisabeth se presse contre son mari :
"Oh, Paul", dit-elle, frissonnant d'anxiété, "si seulement nous n'avions pas la guerre !".
"La guerre ! Quelle idée !"
"Mais regardez tous ces gens qui partent, toutes ces familles qui fuient la frontière !
"Cela ne prouve rien".
"Non, mais vous l'avez vu dans le journal à l'instant. Les nouvelles sont très mauvaises. L'Allemagne se prépare à la guerre. Elle a tout planifié. . . Oh, Paul, si nous devions être séparés ! . . . Je ne saurais rien de toi. ... et tu pourrais être blessé... et..."
Il lui a serré la main :
"N'ayez pas peur, Élisabeth. Il ne se passera rien de tel. Il ne peut y avoir de guerre que si quelqu'un la déclare. Et qui serait assez fou, assez criminel, pour faire quelque chose d'aussi abominable ?"
"Je n'ai pas peur, dit-elle, et je suis sûre que je serais très courageuse si tu devais partir. Seulement ... ... seulement ce serait pire pour nous que pour n'importe qui d'autre. Réfléchis, chéri : nous ne nous sommes mariés que ce matin !"
A cette allusion à leur mariage d'il y a quelques heures, qui contenait une si grande promesse de joie profonde et durable, son charmant visage s'éclaira, sous son halo de boucles dorées, d'un sourire de confiance absolue ; et elle murmura :
"Marié ce matin, Paul ! . . . Tu peux donc comprendre que ma charge de bonheur n'est pas encore très lourde."
Il y a eu un mouvement dans la foule. Tout le monde s'est rassemblé autour de la sortie. Un officier général, accompagné de deux aides de camp, sort dans la cour de la gare où l'attend une voiture. Une fanfare militaire se fait entendre ; un bataillon d'infanterie légère descend la route. Vient ensuite un attelage de seize chevaux, conduits par des artilleurs et traînant une énorme pièce de siège qui, malgré le poids de son attelage, paraît légère, à cause de l'extrême longueur du canon. Un troupeau de bœufs suivait.
Paul, qui n'avait pu trouver de porteur, se tenait sur le trottoir, portant les deux sacs de voyage, lorsqu'un homme vêtu de guêtres de cuir, d'une culotte de velours vert et d'un gilet de tir à boutons de corne, s'approcha de lui et souleva sa casquette :
"M. Paul Delroze ?" dit-il. "Je suis le gardien du château."
Il avait un visage puissant et ouvert, une peau durcie par le soleil et le froid, des cheveux qui grisonnaient déjà et cette allure un peu grossière qu'ont souvent les vieux serviteurs à qui leur place permet une certaine indépendance. Depuis dix-sept ans, il vivait dans le grand domaine d'Ornequin, au-dessus de Corvigny, et le gérait pour le père d'Élisabeth, le comte d'Andeville.
"Ah, vous êtes donc Jérôme ? s'écrie Paul. "Bien, bien, bien ! Je vois que vous avez eu la lettre du comte d'Andeville. Nos domestiques sont-ils venus ?"
"Ils sont arrivés ce matin, monsieur, tous les trois, et ils nous ont aidés, ma femme et moi, à mettre de l'ordre dans la maison et à la préparer à recevoir le maître et la maîtresse.
Il reprit sa casquette pour Élisabeth, qui lui dit :
"Alors tu te souviens de moi, Jérôme ? Il y a si longtemps que je ne suis pas venu ici !"
"Mlle Élisabeth avait alors quatre ans. Nous avons eu beaucoup de peine, ma femme et moi, quand nous avons appris que vous ne reviendriez pas à la maison... et Monsieur le Comte non plus, à cause de sa pauvre femme décédée. Monsieur le Comte n'a donc pas l'intention de nous rendre une petite visite cette année ?"
"Non, Jérôme, je ne crois pas. Bien qu'il y ait tant d'années, mon père est encore très malheureux."
Jérôme prend les sacs et les place dans une mouche qu'il a commandée à Corvigny. Le lourd bagage devait suivre dans la charrette de la ferme.
Il fait beau et Paul leur demande de baisser le capot. Ensuite, lui et sa femme ont pris place.
"Le trajet n'est pas très long, dit le gardien. "Moins de dix miles. Mais c'est toujours en montée."
"La maison est-elle plus ou moins habitable ? demande Paul.
"Ce n'est pas comme une maison habitée, mais vous verrez par vous-même, monsieur. Nous avons fait de notre mieux. Ma femme est si heureuse que vous veniez avec la maîtresse ! Vous la trouverez qui l'attend au pied de l'escalier. Je lui ai dit que vous seriez là entre six et sept heures et demie... . ."
La mouche est partie.
"Il a l'air d'un brave homme, dit Paul à Élisabeth, mais il ne doit pas avoir beaucoup d'occasions de parler. Il rattrape le temps perdu."
La rue gravit la pente raide des collines de Corvigny et constitue, entre deux rangées de boutiques, d'hôtels et de bâtiments publics, l'artère principale de la ville, bloquée ce jour-là par une circulation inhabituelle. Puis elle s'incline et longe les anciens bastions de Vauban. Ensuite, une route en lacets traversait une plaine commandée à droite et à gauche par les deux forts connus sous le nom de Petit et Grand Jonas.
En parcourant cette route sinueuse, qui serpentait à travers les champs d'avoine et de blé sous la voûte feuillue formée par les peupliers en rangs serrés, Paul Delroze revint sur l'épisode de son enfance qu'il s'était promis de raconter à Élisabeth :
"Comme je l'ai dit, Élisabeth, l'incident est lié à une terrible tragédie, si étroitement liée que les deux ne forment qu'un seul épisode dans ma mémoire. On a beaucoup parlé de cette tragédie à l'époque, et votre père, qui était un ami de mon père, comme vous le savez, en a entendu parler par les journaux. S'il ne vous en a pas parlé, c'est parce que je lui ai demandé de ne pas le faire, car je voulais être le premier à vous parler d'événements ... si douloureux pour moi".
Leurs mains se rencontrèrent et se serrèrent. Il savait que chacune de ses paroles trouverait un auditeur attentif et, après une brève pause, il poursuivit :
"Mon père était un de ces hommes qui suscitent la sympathie et même l'affection de tous ceux qui les connaissent. Il était d'une nature généreuse, enthousiaste, séduisante et d'une bonne humeur à toute épreuve, s'intéressait passionnément à toutes les belles causes et à tous les beaux spectacles, aimait la vie et en jouissait avec une sorte de précipitation. Il s'engagea en 1870 comme volontaire, gagna son brevet de lieutenant sur le champ de bataille et trouva l'existence héroïque du soldat si bien adaptée à ses goûts qu'il se porta volontaire une seconde fois pour le Tonkin, et une troisième fois pour participer à la conquête de Madagascar. . . . Au retour de cette campagne, au cours de laquelle il est promu capitaine et reçoit la Légion d'honneur, il se marie. Six ans plus tard, il est veuf".
"Tu étais comme moi, Paul, dit Élisabeth. "Tu n'as guère eu le bonheur de connaître ta mère."
"Non, car je n'avais que quatre ans. Mais mon père, qui avait ressenti cruellement la mort de ma mère, m'a donné toute son affection. Il a tenu à me donner personnellement ma première éducation. Il ne négligea rien pour parfaire ma formation physique et faire de moi un garçon fort et courageux. Je l'aimais de tout mon cœur. Aujourd'hui encore, je ne peux penser à lui sans une émotion sincère. . . . A l'âge de onze ans, je l'accompagnai dans un voyage à travers la France, qu'il avait repoussé depuis des années parce qu'il voulait que je l'entreprenne avec lui à un âge où je pourrais en comprendre toute la signification. C'était un pèlerinage sur les lieux identiques et sur les routes où il avait combattu pendant l'année terrible".
"Votre père croyait-il à la possibilité d'une nouvelle guerre ?
"Oui, et il voulait m'y préparer. Paul, dit-il, je ne doute pas qu'un jour tu seras confronté au même ennemi que celui que j'ai combattu. Dès lors, ne prête pas attention aux belles paroles de paix que tu pourras entendre, mais hais cet ennemi de toute la haine dont tu es capable. Quoi qu'on en dise, c'est un barbare, une brute vaniteuse et sanguinaire, une bête de proie. Il nous a écrasés une fois et il ne sera pas satisfait tant qu'il ne nous aura pas écrasés à nouveau et, cette fois, pour de bon. Quand ce jour viendra, Paul, souviens-toi de tous les voyages que nous avons faits ensemble. Ceux que tu feras marqueront autant d'étapes triomphales, j'en suis sûr. Mais n'oublie jamais les noms de ces lieux, Paul, ne laisse jamais ta joie de vaincre effacer leurs noms de douleur et d'humiliation : Froeschwiller, Mars-la-Tour, Saint-Privat et les autres. Pensez-y, Paul, et souvenez-vous ! Et il sourit. Mais pourquoi devrais-je m'inquiéter ? Lui-même, l'ennemi, s'ingéniera à susciter la haine dans le cœur de ceux qui ont oublié et de ceux qui n'ont pas vu. Peut-il changer ? Pas lui ! Tu verras, Paul, tu verras. Rien de ce que je pourrai te dire n'égalera la terrible réalité. Ce sont des monstres.
Paul Delroze a cessé. Sa femme l'interrogea un peu timidement :
"Pensez-vous que votre père avait tout à fait raison ?"
"Il a pu être influencé par des souvenirs cruels, trop récents dans sa mémoire. J'ai beaucoup voyagé en Allemagne, j'y ai même vécu, et je crois que l'état d'esprit des hommes a changé. J'avoue donc que j'ai parfois du mal à comprendre les paroles de mon père. Et pourtant... et pourtant ils me troublent bien souvent. Et puis ce qui s'est passé ensuite est tellement inexplicable".
La voiture a ralenti son allure. La route s'élevait lentement vers les collines qui surplombent la vallée du Liseron. Le soleil se couche en direction de Corvigny. Ils croisèrent une diligence chargée de malles et deux voitures automobiles encombrées de passagers et de bagages. Un piquet de cavalerie galope à travers champs.
"Sortons et marchons", dit Paul Delroze.
Ils ont suivi la voiture à pied, et Paul a continué :
"Le reste de ce que j'ai à te raconter, Élisabeth, me revient en mémoire par des détails très précis, qui semblent émerger d'un épais brouillard dans lequel je ne vois rien. Par exemple, je sais seulement qu'après cette partie de notre voyage, nous devions aller de Strasbourg à la Forêt-Noire. Je ne sais pas pourquoi nos plans ont été modifiés. . . . Je me vois un matin à la gare de Strasbourg, montant dans le train pour les Vosges... oui, pour les Vosges... . . Mon père continuait à lire une lettre qu'il venait de recevoir et qui semblait le réjouir. Cette lettre a peut-être influé sur ses dispositions, je ne sais pas. Nous avons déjeuné dans le train. Il y avait un orage qui se préparait, il faisait très chaud et je me suis endormie, si bien que tout ce dont je me souviens, c'est d'une petite ville allemande où nous avons loué deux bicyclettes et laissé nos sacs dans le vestiaire. Tout cela est très vague dans mon esprit. Nous avons traversé le pays".
"Mais vous ne vous souvenez pas de ce qu'était le pays ?"
Non, tout ce que je sais, c'est que soudain mon père a dit : "Voilà, Paul, nous passons la frontière, nous sommes en France maintenant". Plus tard - je ne saurais dire combien de temps après - il s'arrêta pour demander sa route à un paysan, qui lui indiqua un raccourci à travers les bois. Mais la route et le raccourci ne sont rien d'autre dans mon esprit qu'une obscurité impénétrable dans laquelle mes pensées sont enfouies. ... . . Puis, tout à coup, les ténèbres se déchirent et je vois, avec une étonnante netteté, une clairière dans le bois, de grands arbres, de la mousse veloutée et une vieille chapelle. La pluie tombe à grosses gouttes et mon père me dit : "Mettons-nous à l'abri, Paul". Oh, comme je me souviens du son de sa voix et comme je me représente exactement la petite chapelle, avec ses murs verts d'humidité ! Nous sommes allés mettre nos vélos à l'abri à l'arrière, là où le toit dépassait un peu du chœur. A ce moment-là, le bruit d'une conversation nous parvint de l'intérieur et nous entendîmes le grincement d'une porte qui s'ouvrait au coin de la rue. Quelqu'un est sorti et a dit, en allemand : "Il n'y a personne ici. Dépêchons-nous". A ce moment-là, nous faisions le tour de la chapelle, avec l'intention d'entrer par cette porte latérale ; et il se trouve que mon père, qui ouvrait la marche, se trouva soudain en présence de l'homme qui avait parlé en allemand. Tous deux firent un pas en arrière, l'étranger apparemment très ennuyé et mon père stupéfait de cette rencontre inattendue. Pendant une ou deux secondes, peut-être, ils restèrent à se regarder sans bouger. J'ai entendu mon père dire, à voix basse : "Est-ce possible ? L'empereur ? Et moi-même, tout surpris que je fusse par ces paroles, je n'en doutais pas, car j'avais souvent vu le portrait du Kaiser ; l'homme qui se trouvait devant nous était l'empereur allemand".
"L'empereur d'Allemagne ? reprit Élisabeth. "Tu ne peux pas dire ça !
"Oui, l'empereur en France ! Il baisse rapidement la tête et retourne le col de velours de sa grande cape fluide jusqu'au bord de son chapeau, qui est rabattu sur ses yeux. Il regarde vers la chapelle. Une dame est sortie, suivie d'un homme que j'ai à peine vu, une sorte de serviteur. La dame était grande, jeune encore, brune et plutôt belle. . . . L'empereur lui saisit le bras avec une violence absolue et l'entraîna en prononçant des paroles de colère que nous ne pûmes entendre. Ils prirent la route par laquelle nous étions venus, celle qui mène à la frontière. Le serviteur s'était précipité dans les bois et marchait devant. C'est vraiment une drôle d'aventure, dit mon père en riant. Que diable fait William ici ? Et il s'y risque en plein jour ! Je me demande si la chapelle ne présente pas un intérêt artistique. Viens voir, Paul. . . . Nous sommes entrés. Une faible lumière se frayait un chemin à travers une fenêtre noircie par la poussière et les toiles d'araignée. Mais cette faible lumière suffisait à nous montrer quelques piliers rabougris et des murs nus, et rien qui ne semblât mériter l'honneur d'une visite impériale, comme l'a dit mon père, qui a ajouté : "Il est tout à fait clair que William est venu ici pour s'amuser, au hasard, et qu'il est très fâché d'avoir découvert son escapade. Je suppose que la dame qui l'accompagnait lui a dit qu'il ne courait aucun danger. Cela expliquerait son irritation et ses reproches".
Paul s'interrompt à nouveau. Élisabeth se blottit timidement contre lui. Puis il reprit :
"C'est curieux, n'est-ce pas, Élisabeth, que tous ces petits détails, relativement peu importants pour un garçon de mon âge, soient restés fidèlement gravés dans mon esprit, alors que tant d'autres faits, bien plus essentiels, n'ont laissé aucune trace. Mais je vous raconte tout cela comme si je l'avais encore sous les yeux et comme si les mots résonnaient encore à mes oreilles. Et en ce moment même, je vois, aussi nettement que je l'ai vue au moment où nous avons quitté la chapelle, la compagne de l'Empereur revenir et traverser la clairière d'un pas pressé ; et je l'entends dire à mon père : "Puis-je vous demander un service, monsieur ?" Elle avait couru et était essoufflée, mais elle n'attendit pas qu'il réponde et ajouta aussitôt : "Le monsieur que vous avez vu voudrait vous parler". Le tout dans un français parfait, sans le moindre accent. . . . Mon père hésite. Mais cette hésitation parut la choquer comme une offense inqualifiable à la personne qui l'avait envoyée, et elle reprit d'un ton plus dur : "Vous ne voulez tout de même pas refuser ? Pourquoi pas ? dit mon père avec une impatience évidente. Je ne suis pas ici pour recevoir des ordres. Elle se retint et dit : "Ce n'est pas un ordre, c'est un souhait". Très bien, dit mon père, j'accepte l'entretien. J'attendrai votre amie ici. Elle parut choquée. Non, non, dit-elle, vous devez... Je dois me retirer, n'est-ce pas ? s'écria mon père d'une voix forte. Vous voulez que je traverse la frontière pour aller là où quelqu'un a la condescendance de m'attendre ? Je suis désolé, madame, mais je n'y consentirai pas. Dites à votre ami que s'il craint une indiscrétion de ma part, il peut se rassurer. Venez, Paul". Il ôta son chapeau à la dame et s'inclina. Mais elle lui barra la route : "Non, non, dit-elle, vous devez faire ce que je vous demande. Que vaut une promesse de discrétion ? La chose doit être réglée d'une manière ou d'une autre, et vous l'admettrez vous-même. . . .' Ce furent les derniers mots que j'entendis. Elle se tenait en face de mon père dans une attitude violente et hostile. Son visage était déformé par une expression de férocité qui me terrifiait. Oh, pourquoi n'ai-je pas prévu ce qui allait se passer ? .... Mais j'étais si jeune ! Et tout est arrivé si vite ! . . . Elle s'approcha de mon père et, pour ainsi dire, le força à reculer au pied d'un grand arbre, à droite de la chapelle. Ils ont élevé la voix. Elle a fait un geste menaçant. Il s'est mis à rire. Et soudain, tout de suite, elle a sorti un couteau - je vois la lame maintenant, clignotant dans l'obscurité - et l'a poignardé dans la poitrine, deux fois... deux fois, là, en plein dans la poitrine. Mon père est tombé à terre".
Paul Delroze s'arrête, pâle au souvenir du crime.
"Oh, reprit Élisabeth, votre père a été assassiné ? . . Mon pauvre Paul, mon pauvre chéri !" Et d'une voix angoissée, elle demanda : "Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Paul ? As-tu crié ?"
"J'ai crié, je me suis élancé vers lui, mais une main m'a saisi d'une poigne irrésistible. C'était l'homme, le serviteur, qui avait surgi du bois et m'avait saisi. Je vis son couteau levé au-dessus de ma tête. J'ai senti un coup terrible sur mon épaule. Puis je tombai à mon tour.
Chapitre 2. La pièce fermée
La voiture les attendait un peu plus loin. Ils s'étaient assis au bord de la route en arrivant sur le plateau au sommet de la montée. La vallée verte et vallonnée du Liseron s'ouvrait devant eux, avec sa petite rivière sinueuse escortée par deux routes blanches qui suivaient chacun de ses virages. Derrière eux, sous le soleil couchant, à quelque trois cents pieds de profondeur, s'étendait le massif de Corvigny. A deux milles devant eux s'élevaient les tourelles d'Ornequin et les ruines du vieux château.
Terrifiée par le récit de Paul, Élisabeth reste un moment silencieuse. Puis elle dit :
"Oh, Paul, comme c'est terrible ! As-tu été gravement blessé ?"
"Je ne me souviens de rien jusqu'au jour où je me suis réveillée dans une chambre que je ne connaissais pas et où j'ai vu une religieuse et une vieille dame, cousine de mon père, qui me soignaient. C'était la meilleure chambre d'une auberge quelque part entre Belfort et la frontière. Douze jours auparavant, à une heure très matinale, l'aubergiste avait trouvé deux corps couverts de sang, qui avaient été déposés là pendant la nuit. L'un des corps était très froid. C'était celui de mon pauvre père. Je respirais encore, mais très légèrement... . . J'eus une longue convalescence, interrompue par des rechutes et des accès de délire, au cours desquels j'essayai de m'échapper. Ma vieille cousine, la seule relation qui me restait, me témoigna la plus merveilleuse et la plus dévouée des bontés. Deux mois plus tard, elle m'emmena chez elle. J'étais presque guéri de ma blessure, mais j'étais tellement affecté par la mort de mon père et par les circonstances effrayantes qui l'avaient entourée qu'il m'a fallu plusieurs années avant de recouvrer complètement la santé. Quant à la tragédie elle-même. . . ."
"Alors ? demanda Élisabeth en passant son bras autour du cou de son mari, dans un mouvement de protection empressé.
"Eh bien, ils n'ont jamais réussi à percer le mystère. Pourtant, la police a mené ses investigations avec zèle et scrupule, en essayant de vérifier les seules informations qu'elle a pu utiliser, celles que je lui ai données. Tous leurs efforts ont échoué. Vous savez, mes informations étaient très vagues. En dehors de ce qui s'était passé dans la clairière et devant la chapelle, je ne savais rien. Je ne pouvais pas leur dire où trouver la chapelle, ni où la chercher, ni dans quelle partie du pays la tragédie s'était produite".
Mais vous aviez quand même fait un voyage, vous et votre père, pour atteindre cette partie du pays ; et il me semble qu'en remontant votre route jusqu'à votre départ de Strasbourg...". . . ."
"La police française, non contente d'appeler à l'aide la police allemande, envoya sur place ses détectives les plus avisés. Mais c'est justement ce qui, par la suite, lorsque je fus en âge de réfléchir, me parut si étrange : on ne trouva pas la moindre trace de notre séjour à Strasbourg. Vous comprenez ? Pas la moindre trace. Or, s'il y a une chose dont j'étais absolument certain, c'est que nous avions passé au moins deux jours et deux nuits à Strasbourg. Le magistrat chargé de l'affaire, me considérant comme un enfant malmené et bouleversé, en vint à la conclusion que ma mémoire devait être défaillante. Mais je savais qu'il n'en était rien ; je le savais à l'époque et je le sais encore".
"Et alors, Paul ?"
"Je ne peux m'empêcher de voir un lien entre l'élimination totale de faits indéniables - des faits faciles à vérifier ou à reconstituer, comme la visite d'un Français et de son fils à Strasbourg, leur voyage en train, l'abandon de leurs bagages dans le vestiaire d'une ville d'Alsace, la location de deux bicyclettes - et ce fait principal, que l'Empereur a été directement, oui, directement mêlé à l'affaire."
"Mais ce lien devait être aussi évident pour l'esprit du magistrat que pour le vôtre, Paul."
"Sans doute, mais ni le juge d'instruction, ni aucun de ses collègues, ni les autres fonctionnaires qui ont recueilli mon témoignage n'ont voulu admettre la présence de l'Empereur en Alsace ce jour-là.
"Pourquoi pas ?
"Parce que les journaux allemands ont indiqué qu'il était à Francfort à cette heure précise".
"A Frankfort ?"
"Bien sûr, il est dit qu'il est là où il commande et jamais à un endroit où il ne souhaite pas que sa présence soit connue. En tout cas, sur ce point aussi, on m'a accusé d'être dans l'erreur et l'enquête a été contrariée par un assemblage d'obstacles, d'impossibilités, de mensonges et d'alibis qui, à mon avis, révélaient l'action continue et toute-puissante d'une autorité illimitée. Il n'y a pas d'autre explication. Comment deux sujets français peuvent-ils s'installer dans un hôtel de Strasbourg sans que leur nom soit inscrit sur le livre d'or ? Or, que le livre ait été détruit ou qu'une page ait été arrachée, aucune trace des noms n'a été trouvée. Une preuve et un indice ont donc disparu. Quant au propriétaire de l'hôtel et aux serveurs, aux employés de la gare et aux porteurs, à l'homme qui possédait les bicyclettes, ce sont autant de subalternes, autant de complices, qui ont tous reçu l'ordre de se taire, et aucun d'entre eux n'a désobéi".
"Mais après, Paul, tu as dû faire tes propres recherches ?"
"Je crois bien que oui ! Quatre fois depuis ma majorité, j'ai parcouru toute la frontière de la Suisse au Luxembourg, de Belfort à Longwy, interrogeant les habitants, étudiant le pays. J'ai passé des heures et des heures à me creuser la cervelle dans le vain espoir d'en extraire le moindre souvenir qui m'aurait apporté une lueur. Mais sans résultat. Il n'y avait pas une seule lueur fraîche dans toute cette obscurité. Seules trois images traversaient l'épais brouillard du passé, des images du lieu et des choses qui avaient été témoins du crime : les arbres de la clairière, la vieille chapelle et le sentier qui menait à travers les bois. Et puis il y avait la figure de l'Empereur et... la figure de la femme qui avait tué mon père."
Paul a baissé la voix. Son visage est déformé par le chagrin et le dégoût.
"Quant à elle, poursuivit-il, si je vis jusqu'à cent ans, je la verrai devant mes yeux comme une chose se détachant dans tous ses détails sous la pleine lumière du jour. La forme de ses lèvres, l'expression de ses yeux, la couleur de ses cheveux, le caractère particulier de sa démarche, le rythme de ses mouvements, le contour de son corps : tout cela est enregistré en moi, non pas comme une vision que je convoque à volonté, mais comme quelque chose qui fait partie de mon être même. C'est comme si, pendant mon délire, toutes les puissances mystérieuses de mon cerveau avaient collaboré pour assimiler entièrement ces souvenirs détestables. Il fut un temps où tout cela était une obsession morbide : aujourd'hui, je ne souffre qu'à certaines heures, quand la nuit tombe et que je suis seul. Mon père a été assassiné ; et la femme qui l'a assassiné est vivante, impunie, heureuse, riche, honorée, poursuivant son œuvre de haine et de destruction".
"La reconnaîtrais-tu si tu la voyais, Paul ?"
"Si je la connaissais à nouveau ! Je la reconnaîtrais entre mille. Même défigurée par l'âge, je découvrirais dans les rides de la vieille femme qu'elle est devenue le visage de la jeune femme qui a poignardé mon père ce soir de septembre. La connaître à nouveau ! J'ai remarqué la nuance même de la robe qu'elle portait ! Cela paraît incroyable, mais c'est ainsi. Une robe grise, avec une écharpe de dentelle noire sur les épaules ; et là, dans le corsage, en guise de broche, un lourd camée, serti dans un serpent d'or aux yeux de rubis. Tu vois, Élisabeth, je n'ai pas oublié et je n'oublierai jamais."
Il s'arrête. Élisabeth pleure. Le passé que son mari lui avait révélé la remplissait du même sentiment d'horreur et d'amertume. Il l'attire à lui et l'embrasse sur le front.
"Vous avez raison de ne pas oublier, dit-elle. "Le meurtre sera puni parce qu'il doit être puni. Mais tu ne dois pas laisser ta vie soumise à ces souvenirs de haine. Nous sommes deux maintenant et nous nous aimons. Regardons vers l'avenir.
********************************************************
Le château d'Ornequin est un beau bâtiment du XVIe siècle, de conception simple, avec quatre tourelles à pics, de hautes fenêtres à pinacles denticulés et une légère balustrade en saillie au-dessus du premier étage. L'esplanade est formée de pelouses bien entretenues qui entourent la cour et mènent à droite et à gauche à des jardins, des bois et des vergers. L'un des côtés de ces pelouses se termine par une large terrasse qui domine la vallée du Liseron. Sur cette terrasse, dans l'axe de la maison, se dressent les ruines majestueuses d'un château fort de quatre cases.
L'ensemble a une allure très majestueuse. Le domaine, entouré de fermes et de champs, exige un travail actif et soigné pour son entretien. C'est l'un des plus grands du département.
Dix-sept ans plus tôt, lors de la vente organisée à la mort du dernier baron d'Ornequin, le père d'Élisabeth, le comte d'Andeville, l'avait acheté sur le désir de sa femme. Marié depuis cinq ans, il a démissionné de la cavalerie pour se consacrer entièrement à la femme qu'il aime. Le hasard d'un voyage les conduit à Ornequin au moment où la vente, à peine annoncée dans la presse locale, est sur le point d'avoir lieu. Hermine d'Andeville tombe amoureuse de la maison et du domaine ; et le comte, qui cherche un domaine dont la gestion occuperait ses loisirs, en fait l'acquisition par l'intermédiaire de son avocat, de gré à gré.
Pendant l'hiver qui suivit, il dirigea de Paris les travaux de restauration rendus nécessaires par l'état de délabrement dans lequel l'ancien propriétaire avait laissé la maison. M. d'Andeville souhaitait qu'elle soit non seulement confortable, mais aussi élégante, et, peu à peu, il y envoya toutes les tapisseries, tableaux, objets d'art et bibelots qui ornaient sa maison de Paris.
Ils n'ont pu s'installer qu'au mois d'août. Ils passèrent alors quelques semaines délicieuses avec leur chère Élisabeth, alors âgée de quatre ans, et leur fils Bernard, un garçon vigoureux auquel la comtesse avait donné naissance la même année. Hermine d'Andeville était dévouée à ses enfants et ne dépassait jamais les limites du parc. Le comte s'occupait de ses fermes et tirait sur ses couverts, accompagné de Jérôme, son garde-chasse, un digne Alsacien qui avait été au service du défunt propriétaire et qui connaissait les moindres recoins du domaine.
A la fin du mois d'octobre, la comtesse prit froid ; la maladie qui s'ensuivit fut assez grave ; le comte d'Andeville décida de l'emmener avec les enfants dans le Midi. Quinze jours plus tard, elle fait une rechute et, trois jours plus tard, elle est morte.
Le comte a connu le désespoir qui fait qu'un homme sent que la vie est finie et que, quoi qu'il arrive, il ne connaîtra plus jamais le sentiment de la joie ni même un apaisement quelconque. Il ne vivait pas tant pour ses enfants que pour entretenir en lui le culte de celle qu'il avait perdue et pour perpétuer un souvenir qui devenait désormais l'unique raison de son existence.
Il ne pouvait retourner au château d'Ornequin, où il avait connu un bonheur trop parfait ; d'autre part, il ne voulait pas que des étrangers y habitassent ; et il ordonna à Jérôme de tenir les portes et les volets fermés et de verrouiller le boudoir et la chambre de la comtesse de manière à ce que personne n'y pût jamais pénétrer. Jérôme devait également louer les fermes et percevoir les loyers des fermiers.
Cette rupture avec le passé ne suffit pas à satisfaire le comte. Cela paraît étrange chez un homme qui n'existe que pour le souvenir de sa femme, mais tout ce qui lui rappelle celle-ci - objets familiers, environnement domestique, lieux et paysages - devient pour lui une torture ; et ses enfants mêmes lui inspirent un sentiment de malaise qu'il ne parvient pas à surmonter. Il a une sœur aînée, veuve, qui vit à la campagne, à Chaumont. Il lui confie sa fille Élisabeth et son fils Bernard et part à l'étranger.
Tante Aline était la femme la plus dévouée et la plus désintéressée qui soit. Sous sa tutelle, Élisabeth a vécu une enfance grave, studieuse et affectueuse, où son cœur s'est développé en même temps que son esprit et son caractère. Elle reçut l'éducation d'un garçon ou presque, ainsi qu'une solide discipline morale. À l'âge de vingt ans, elle était devenue une grande fille, capable et intrépide, dont le visage, enclin par nature à la mélancolie, s'éclairait parfois du sourire le plus tendre et le plus innocent. C'était un de ces visages qui révèlent à l'avance les souffrances et les ravissements réservés par le destin. Les larmes n'étaient jamais loin de ses yeux, qui semblaient troublés par le spectacle de la vie. Ses cheveux, aux boucles brillantes, donnaient une certaine gaieté à sa physionomie.
A chaque visite que le comte d'Andeville rendait à sa fille entre ses pérégrinations, il tombait de plus en plus sous son charme. Il l'emmène un hiver en Espagne et le suivant en Italie. C'est ainsi qu'elle fit la connaissance de Paul Delroze à Rome et le retrouva à Naples et à Syracuse, ville à partir de laquelle Paul accompagna les d'Andeville dans une longue excursion à travers la Sicile. L'intimité ainsi créée unit les deux jeunes gens par un lien dont ils ne mesurèrent toute la force qu'au moment de se séparer.
Comme Élisabeth, Paul avait été élevé à la campagne et, comme elle, par une parente aimante qui s'efforçait, à force de soins affectueux, de lui faire oublier la tragédie de son enfance. Si l'oubli ne vint pas, elle réussit en tout cas à poursuivre l'œuvre de son père et à faire de Paul un garçon viril et travailleur, intéressé par les livres, la vie et les activités de l'humanité. Il alla à l'école et, après avoir effectué son service militaire, passa deux ans en Allemagne, où il étudia sur place certaines de ses matières industrielles et mécaniques préférées.
Grand et bien bâti, avec ses cheveux noirs rejetés en arrière de son visage plutôt fin, au menton déterminé, il donnait une impression de force et d'énergie.
Sa rencontre avec Élisabeth lui révèle un monde d'idées et d'émotions qu'il avait jusqu'alors dédaigné. Pour lui comme pour elle, ce fut une sorte d'ivresse mêlée d'étonnement. L'amour créa en eux deux âmes nouvelles, légères et libres comme l'air, dont l'enthousiasme spontané et l'ouverture d'esprit formaient un contraste frappant avec les habitudes que leur imposait la tendance stricte de leur vie. De retour en France, il demande la main d'Élisabeth et obtient son consentement.
Le jour du contrat de mariage, trois jours avant les noces, le comte d'Andeville annonce qu'il ajoute le château d'Ornequin à la dot d'Élisabeth. Le jeune couple décide qu'il y habitera et que Paul cherchera dans les vallées de la région manufacturière voisine des travaux qu'il pourra acheter et gérer.
Ils se sont mariés le jeudi 30 juillet à Chaumont. Ce fut un mariage tranquille, en raison des rumeurs de guerre, bien que le comte d'Andeville, sur la foi d'informations auxquelles il attachait beaucoup de crédit, ait déclaré qu'il n'y aurait pas de guerre. Au petit déjeuner auquel participent les deux familles, Paul fait la connaissance de Bernard d'Andeville, le frère d'Élisabeth, un collégien d'à peine dix-sept ans, dont les vacances viennent de commencer. Paul l'apprécia pour sa franchise et sa bonne humeur, et il fut convenu que Bernard les rejoindrait dans quelques jours à Ornequin. À une heure, Élisabeth et Paul quittèrent Chaumont par le train. Ils allaient, main dans la main, au château où devaient se passer les premières années de leur mariage et peut-être tout cet avenir heureux et paisible qui s'ouvre devant les yeux éblouis des amoureux.
Il était six heures et demie lorsqu'ils aperçurent la femme de Jérôme au pied du perron. Rosalie était un corps robuste et maternel, aux joues rouges et tachetées, au visage joyeux.
Avant de passer à table, ils font un tour précipité dans le jardin et passent en revue la maison. Élisabeth ne peut contenir son émotion. Si aucun souvenir ne l'excitait, elle semblait pourtant retrouver quelque chose de cette mère qu'elle avait connue si peu de temps, dont elle ne se souvenait plus des traits et qui avait passé ici les derniers jours heureux de sa vie. Pour elle, l'ombre de la morte foulait encore les allées du jardin. Les grandes pelouses vertes exhalaient un parfum particulier. Les feuilles des arbres bruissaient dans le vent d'un murmure qu'il lui semblait avoir déjà entendu au même endroit et à la même heure du jour, avec sa mère qui écoutait à côté d'elle.
"Tu as l'air déprimée, Élisabeth", dit Paul.
"Je ne suis pas déprimée, mais troublée. J'ai l'impression que ma mère nous accueille dans ce lieu où elle pensait vivre et où nous sommes venus avec la même intention. Et je me sens en quelque sorte anxieuse. C'est comme si j'étais un étranger, un intrus, qui perturbe le repos et la paix de la maison. Pensez donc ! Ma mère est restée ici toute seule pendant si longtemps ! Mon père ne viendrait jamais ici ; et je me disais que nous n'avions pas le droit de venir ici non plus, avec notre indifférence pour tout ce qui n'est pas nous."
Paul sourit :
"Élisabeth, ma chérie, tu ressens simplement cette impression de malaise que l'on éprouve toujours en arrivant le soir dans un nouvel endroit.
"Je ne sais pas, dit-elle. "J'ose espérer que vous avez raison... . . Mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce malaise, et cela ne me ressemble pas du tout. Croyez-vous aux pressentiments, Paul ?"
"Non, et vous ?"
"Non, moi non plus", dit-elle en riant et en déposant ses lèvres sur les siennes.
Ils furent surpris de constater que les pièces de la maison semblaient avoir été constamment habitées. Par ordre du comte, tout était resté comme au temps lointain d'Hermine d'Andeville. Les bibelots étaient là, à la même place, et chaque broderie, chaque carré de dentelle, chaque miniature, toutes les belles chaises du dix-huitième siècle, toute la tapisserie flamande, tous les meubles que le comte avait rassemblés autrefois pour ajouter à la beauté de sa maison. Ils entraient ainsi d'emblée dans un cadre charmant et familial.
Après le dîner, ils retournèrent dans les jardins, où ils se promenèrent en silence, les bras enlacés autour de la taille de l'autre. De la terrasse, ils contemplaient la vallée sombre, où brillaient çà et là quelques lumières. Le vieux château fort dressait ses ruines massives sur un ciel pâle, dans lequel subsistait encore un reste de vague lumière.
"Paul, dit Élisabeth à voix basse, as-tu remarqué, en passant devant la maison, une porte fermée par un grand cadenas ?
"Au milieu du couloir principal, près de votre chambre, vous voulez dire ?"
"Oui, c'était le boudoir de ma pauvre mère. Mon père a insisté pour qu'il soit fermé à clef, ainsi que la chambre qui en sortait ; Jérôme a mis un cadenas à la porte et lui a envoyé la clef. Personne n'y a mis les pieds depuis. Elle est telle que ma mère l'a laissée. Toutes ses affaires, ses travaux inachevés, ses livres, sont là. Et sur le mur qui fait face à la porte, entre les deux fenêtres qui ont toujours été fermées, il y a son portrait, que mon père avait commandé un an auparavant à un grand peintre de sa connaissance, un portrait en pied qui, paraît-il, est à son image. Son prie-Dieu se trouve à côté. Ce matin, mon père m'a donné la clé du boudoir et je lui ai promis de m'agenouiller sur le prie-Dieu et de faire une prière devant le portrait de cette mère que j'ai à peine connue et dont je ne peux imaginer les traits, car je n'ai même pas eu de photographie d'elle."
"Vraiment ? Comment c'était ?"
"Voyez-vous, mon père aimait tellement ma mère que, obéissant à un sentiment qu'il ne pouvait lui-même expliquer, il souhaitait être seul à se souvenir d'elle. Il voulait que ses souvenirs soient enfouis au plus profond de lui-même, afin que rien ne lui rappelle son existence, si ce n'est sa propre volonté et son chagrin. Il m'en a presque demandé pardon ce matin, il m'a dit qu'il m'avait peut-être fait du tort ; et c'est pourquoi il veut que nous allions ensemble, Paul, ce premier soir, prier devant l'image de ma pauvre mère morte."
"Allons-y maintenant, Élisabeth."
Sa main tremblait dans celle de son mari tandis qu'ils montaient les escaliers menant au premier étage. Des lampes ont été allumées tout au long du passage. Ils s'arrêtent devant une grande et large porte surmontée de sculptures dorées.
"Détache la serrure, Paul, dit Élisabeth.
Sa voix tremble lorsqu'elle parle. Elle lui tend la clé. Il enlève le cadenas et saisit la poignée de la porte. Mais Élisabeth saisit soudain le bras de son mari :
"Un instant, Paul, un instant ! Je me sens si bouleversée. C'est la première fois que je vais voir le visage de ma mère... et toi, ma chérie, tu es à côté de moi... . . J'ai l'impression de redevenir une petite fille."
"Oui, dit-il en lui pressant passionnément la main, une petite fille et une grande femme à la fois.
Réconfortée par l'étreinte de sa main, elle a relâché la sienne et a murmuré :
"Nous allons entrer maintenant, Paul chéri."
Il ouvrit la porte et retourna dans le passage pour prendre une lampe sur un support au mur et la poser sur la table. Pendant ce temps, Élisabeth avait traversé la pièce et se tenait devant le tableau. Le visage de sa mère était dans l'ombre et elle changea la position de la lampe pour l'éclairer pleinement.
"Qu'elle est belle, Paul !"
Il s'approche du tableau et lève la tête. Élisabeth s'agenouille sur le prie-Dieu. Mais, entendant Paul se retourner, elle leva les yeux vers lui et fut stupéfaite de ce qu'elle vit. Il était immobile, le visage livide, les yeux grands ouverts, comme s'il contemplait la plus effroyable des visions.
"Paul, s'écrie-t-elle, que se passe-t-il ?
Il se dirigea vers la porte en reculant, ne pouvant détacher ses yeux du portrait d'Hermine d'Andeville. Il chancelait comme un homme ivre, et ses bras battaient l'air autour de lui.
Il bredouille, à voix basse, "Ça... ça... ça...".
"Paul, supplie Élisabeth, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux dire ?"
"C'est... c'est la femme qui a tué mon père !"
Chapitre 3. L'appel aux armes
L'affreuse accusation est suivie d'un affreux silence. Élisabeth est maintenant debout devant son mari, s'efforçant de comprendre ses paroles, qui n'ont pas encore acquis leur véritable signification pour elle, mais qui lui font mal comme si on lui avait donné un coup de poignard dans le cœur.
Elle s'approcha de lui et, les yeux dans les siens, parla d'une voix si basse qu'il l'entendit à peine :
"Tu ne peux pas penser ce que tu as dit, Paul ? La chose est trop monstrueuse !"
Il lui répond sur le même ton :
"Oui, c'est une chose monstrueuse. Je n'y crois pas encore moi-même. Je refuse d'y croire."
"Alors, c'est une erreur, n'est-ce pas ? Avouez-le, vous avez fait une erreur."
Elle l'implorait avec toute la détresse qui emplissait son être, comme si elle espérait le faire céder. Il fixa à nouveau ses yeux sur le maudit portrait, par-dessus l'épaule de sa femme, et frissonna de la tête aux pieds :
"Oh, c'est elle !" déclara-t-il en serrant les poings. "C'est elle, je la reconnais, c'est la femme qui a tué mon..."
Un choc de protestation traversa son corps et, se frappant la poitrine, elle s'écria :
"Ma mère ! Ma mère, une meurtrière ! Ma mère, que mon père adorait et continuait d'adorer ! Ma mère, qui me tenait sur ses genoux et m'embrassait, j'ai tout oublié d'elle, sauf ses baisers et ses caresses ! Et vous me dites que c'est une meurtrière !".
"C'est vrai."
"Oh, Paul, tu ne dois pas dire des choses aussi horribles ! Comment peux-tu être sûr, si longtemps après ? Tu n'étais qu'un enfant, et tu as vu si peu la femme... à peine quelques minutes...". . ."
"J'ai vu plus d'elle qu'il n'est humainement possible d'en voir", s'exclame Paul à voix haute. "Depuis le moment du meurtre, son image ne m'a jamais quitté. J'ai essayé de m'en débarrasser parfois, comme on essaie de se débarrasser d'un cauchemar, mais je n'y suis pas parvenu. Et l'image est là, accrochée au mur. Aussi sûr que je vis, elle est là ; je la connais comme je devrais connaître ton image après vingt ans. C'est elle... pourquoi, sur sa poitrine, cette broche sertie d'un serpent d'or ! ... un camée, comme je te l'ai dit, et les yeux du serpent... deux rubis ! ... et l'écharpe de dentelle noire autour des épaules ! C'est elle, je vous le dis, c'est la femme que j'ai vue !"
Une rage grandissante l'excite jusqu'à la frénésie, et il brandit son poing sur le portrait d'Hermine d'Andeville.
"Chut ! s'écrie Élisabeth, sous le coup de ses paroles. "Tiens ta langue ! Je ne te permettrai pas de..."
Elle essaya de lui mettre la main sur la bouche pour le contraindre au silence. Mais Paul fit un mouvement de répulsion, comme s'il se dérobait au contact de sa femme, et ce mouvement fut si brusque et si instinctif qu'elle tomba à terre en sanglotant, tandis que lui, courroucé, exaspéré par son chagrin et sa haine, poussé par une sorte d'hallucination terrifiée qui le faisait reculer jusqu'à la porte, criait :