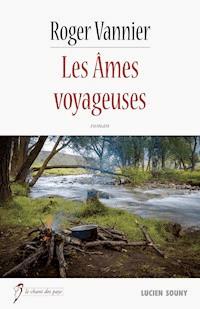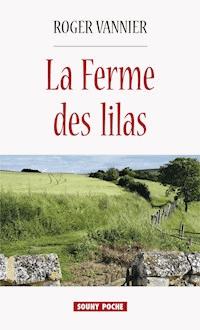
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une troublante intrigue, nourrie par les plaisirs et les drames humains qu’ont connus les paysans dans les années 60.
Les Pactat, sous la houlette de Marguerite, perpétuent une tradition de solidarité familiale et de dévouement à une terre aimée. Mais Jean-Michel, le petit-fils, est avide de savoir. À la suite de la mort accidentelle de son père, il doit mettre fin à ses études pour travailler à la ferme. Sa grand-mère l’exige, brisant ainsi son rêve de devenir instituteur. Sa nouvelle condition l’éloigne aussi de son amie d’enfance, Isabelle, dont il est amoureux. Amer et déçu, il noie sa peine dans le travail, mais il n’arrive pas à oublier la belle rouquine du château. Un jour de printemps, Jean-Michel taille la vigne aux côtés de son oncle Emile et de Pierre Pingeault, un garçon de l’Assistance publique embauché par sa grand-mère. Ce dernier révèle qu’il entretient une relation avec Isabelle. Humilié, Jean-Michel perd son contrôle et une bagarre éclate. Il refuse de croire à la trahison de son amie, d’autant que Pingeault est réputé être un fieffé menteur. Pourtant, lors d’une livraison au château, il entend les pleurs d’un bébé. Le cœur brisé, il s’enferme dans son silence et répugne à l’idée d’aller vers Isabelle et son fils Claude, malgré les pressions et les connivences de son entourage. Réussira-t-il à trouver le chemin qui permettra à ces trois êtres de se retrouver, de s’aimer et de créer une famille ? Un héros tourmenté mais déterminé, écartelé entre le désir de vivre avec son temps et le respect des conventions patriarcales.
Roger Vannier nous livre ici une remarquable fresque sociale au cœur de laquelle se cachent une belle histoire d’amour.
EXTRAIT
Souvent lui était venue à l’esprit l’idée que son voyage n’arriverait pas à son terme. Mais, à chaque fois, il avait su reprendre courage. Il approchait enfin du but. Il n’était plus très loin de chez lui. Il venait de traverser Saint-Christophe-le-Chaudry et, d’un pas régulier, il avançait maintenant vers le moulin du même nom. Sur la route de terre battue, sa silhouette se détachait dans la demi-obscurité d’une nuit qui tirait à sa fin. Il était environ quatre heures en ce début de juillet 1941 et le jour n’allait pas tarder à poindre. Hier, dans la soirée et jusque tard dans la nuit, un orage avait grondé du côté du sud. L’homme avait dépassé Meaulnes alors que le ciel s’illuminait encore au-dessus des premiers contreforts du Massif central. Il avait dû beaucoup pleuvoir, car, à une bonne centaine de mètres du moulin, il entendait déjà la rivière qui s’engouffrait bruyamment sous le deuxième petit pont. L’air matinal était d’ailleurs humide et frais et des taches sombres traînaient dans le gris du ciel.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Roger Vannier est né dans le Cher, à Reigny. Instituteur, il a d’abord enseigné en Algérie, puis il est rentré sur ses terres natales pour terminer sa carrière. Aujourd’hui à la retraite, il mène une activité artistique à laquelle il associe l’écriture. Il vit à Chateaumeillant. Son univers s’enracine dans sa région natale. Il en restitue toute la finesse, l’âme et la beauté.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I
Souvent lui était venue à l’esprit l’idée que son voyage n’arriverait pas à son terme. Mais, à chaque fois, il avait su reprendre courage. Il approchait enfin du but. Il n’était plus très loin de chez lui. Il venait de traverser Saint-Christophe-le-Chaudry et, d’un pas régulier, il avançait maintenant vers le moulin du même nom. Sur la route de terre battue, sa silhouette se détachait dans la demi-obscurité d’une nuit qui tirait à sa fin. Il était environ quatre heures en ce début de juillet 1941 et le jour n’allait pas tarder à poindre. Hier, dans la soirée et jusque tard dans la nuit, un orage avait grondé du côté du sud. L’homme avait dépassé Meaulnes alors que le ciel s’illuminait encore au-dessus des premiers contreforts du Massif central. Il avait dû beaucoup pleuvoir, car, à une bonne centaine de mètres du moulin, il entendait déjà la rivière qui s’engouffrait bruyamment sous le deuxième petit pont. L’air matinal était d’ailleurs humide et frais et des taches sombres traînaient dans le gris du ciel.
Quel périple, mon Dieu ! L’évadé n’en revenait pas. Il serait incapable de dire par où il était passé. Il s’était surtout déplacé la nuit pour éviter les mauvaises rencontres. Le jour, il s’était reposé et, en toute discrétion, avait cherché dans la nature de quoi se nourrir. Il avait toutefois retenu le nom des derniers villages qu’il avait traversés cette nuit : Meaulnes et Saulzais-le-Potier. Il lui restait des allumettes et il en avait gratté quelques-unes pour pouvoir lire sur les pancartes. Il avait même lu le nom d’Épineuil-le-Fleuriel qu’il avait laissé sur sa gauche. Mais, de ces villages, il en avait déjà entendu parler et il avait ainsi compris qu’il avait atteint le département du Cher. Pendant qu’il les traversait, s’était donc installée en lui la conviction qu’il était pratiquement sauvé.
L’homme ne s’était pas évadé seul. Un autre prisonnier s’était fait la belle avec lui. Ils étaient partis un soir, une heure avant la tombée du jour. Pour se lancer dans l’aventure, ils avaient profité d’une surveillance relâchée et d’un début de pleine lune qui leur avait permis de marcher plus vite et de laisser, en une nuit, la plus grande distance possible entre leurs geôliers et eux.
Les deux évadés s’étaient rencontrés dans le stalag de Schwenningen, dans le Württemberg. Au printemps 1941, on les avait placés sous la responsabilité d’un paysan de la région de Schramberg, non loin de la Forêt-Noire. Là, ils avaient dû participer à tous les travaux des champs.
Les deux prisonniers étaient partis peu avant la fenaison, s’étaient enfoncés dans les bois et étaient allés vers le sud, sans se poser de question. Et ils avaient eu raison de ne pas s’en poser, car se trouver si loin de chez soi et partir à l’aveuglette étaient des données tellement négatives qu’elles n’auraient pas tardé à les décourager.
Ils étaient passés au large des villages, avaient coupé à travers bois et champs. Ils avaient contourné Neustad, Lenzkirch, évitant aussi les fermes et les hameaux. Ils avaient traversé des torrents sournois, failli s’écraser au creux des ravins et, au bout de la huitième nuit, atteint la rive du Rhin du côté de Bad Bäckingen. En longeant le fleuve sur plusieurs kilomètres, ils avaient trouvé un pont sur lequel ils n’avaient pas vu de surveillance et, en quelques enjambées, s’étaient retrouvés en Suisse. Cinq jours plus tard, ils avaient mis les pieds en France.
Ils s’étaient habitués à la marche nocturne. Ils avaient avancé calmement, mais prudemment. Puis ils s’étaient séparés dans les environs de Mâcon, chacun devant poursuivre sa route en direction de sa propre région. Ils s’étaient quittés, le vague à l’âme, et s’étaient promis de s’écrire une fois rentrés chez eux.
En cette fin de nuit, René Pactat, accoudé sur le parapet de fer forgé du deuxième petit pont, fixait la masse sombre des flots tumultueux qui s’étendait au pied des pelles du barrage. Il tenait, serré dans ses mains, son bâton sculpté qui lui avait servi, au début, à transporter son maigre baluchon. À Schramberg, en prévision de leur évasion, son camarade et lui avaient rassemblé, jour après jour, sous un roncier, dans un coin de champ, quelques affaires de rechange. Ces quelques effets personnels, ils en avaient fait un paquet qu’ils avaient attaché à une extrémité de leur bâton, bâton qu’ils avaient appuyé, la plupart du temps, sur leur épaule.
Il n’y avait plus de baluchon. Le voyage avait rapidement usé ou déchiré chaque chose et le bâton sculpté était resté un souvenir, le témoin d’une aventure détestable, d’un angoissant et exténuant retour au pays. C’était au stalag de Schwenningen, le soir, à la veillée, durant l’hiver 1940-1941, que René avait travaillé son bâton. Il avait sculpté un serpent qui s’enroulait tout autour, la queue vers le bas, la tête arrêtée à deux doigts de la base de la poignée, laquelle était, elle aussi, soigneusement ciselée. Avec la pointe d’une dent de fourche cassée qu’il avait chauffée au rouge dans le foyer du vieux poêle de la pièce centrale, il avait simulé les écailles et les yeux du serpent. Un V tracé sur la tête de celui-ci complétait le travail d’art. Sur la poignée, René avait pyrogravé ses initiales et, en bas de cette poignée, sur une partie sculptée en forme de bague, il avait difficilement inscrit « Meuse et Ardennes ». La base de la poignée avait été percée pour qu’on pût y passer une ficelle. C’était un bâton de marche. Délesté de son baluchon, il avait servi à effaroucher les chiens errants à l’approche des lieux habités ou dans la traversée de certains villages endormis. René Pactat avait marqué « Meuse et Ardennes » sur son bâton. C’était une façon de matérialiser le souvenir de son temps de guerre. Son temps de guerre ? Il n’avait pas tiré un seul coup de fusil, personne n’avait fait feu autour de lui et les chefs avaient donné l’ordre de se rendre à l’ennemi. René n’avait pas demandé mieux. Ah si ! Il aurait bien demandé qu’on le renvoyât dans son Berry natal, mais il ne fallait pas rêver.
René était donc là, tout près de chez lui, à moins de deux kilomètres de son hameau et de la ferme familiale. Il était arrivé jusqu’ici, sur ce pont, et il s’était immobilisé, donnant l’impression de ne plus vouloir aller au-delà. Il était accoudé au parapet et il réfléchissait. Il se revoyait des semaines en arrière, se lançant, ivre de liberté, sur des terres inconnues. Pour prendre la poudre d’escampette, ils avaient fait les dociles, son camarade et lui, ils avaient modérément joué les idiots et avaient ainsi acquis la confiance du maître des lieux.
À l’est, le ciel étalait sa lumière blanche au-dessus des façades obscures des maisons de Saint-Christophe et nettoyait déjà les ombres installées au creux de la nature. Le grand jour allait bientôt réveiller ce petit coin de France et la vie reprendrait ses droits.
René n’avait pas bougé. Il fixait l’endroit obscur où coulait l’Arnon. Le bruit du courant qui passait sous ses pieds lui fit comprendre que la rivière était effectivement grande : l’effet de l’orage devait se manifester depuis un bon moment déjà. D’ailleurs, les pelles étaient levées en prévision d’une crue ou, du moins, d’un gros afflux d’eau.
L’évadé eut un réflexe de repli en même temps que son regard fut attiré par une lumière qui venait de surgir sur sa gauche. Une lumière jaune pâle suivie par d’autres de même nature. Le moulin s’éclairait. Le meunier était déjà à son poste. Il devait y avoir, sans les pelles abaissées, suffisamment d’eau pour faire tourner la roue à aube du moulin.
Les pelles ! Ces deux grandes portes de bois épais, chargées de barrer le cours d’eau, étaient dotées d’une armature à toute épreuve. Elles reposaient sur un large socle en ciment et une construction de même nature les encadrait. Un système de crémaillère permettait au meunier de les relever ou de les abaisser. En dehors des crues ou de forts débits, ces pelles abaissées faisaient donc barrage et retenaient l’eau qui montait dans un chenal pour aller alimenter le mécanisme du moulin. Mais aussi elles donnaient parfois l’occasion aux pêcheurs du dimanche de faire des pêches miraculeuses. Quand les pelles étaient abaissées, le dimanche matin, c’était que le meunier avait oublié de les relever la veille au soir ou que celui-ci travaillait le dimanche matin. Alors, en amont, l’eau de l’Arnon était haute sur plusieurs centaines de mètres et, devant les endroits les plus propices à la pêche, les endroits les plus profonds, venaient s’installer — au petit jour quand il faisait beau — une multitude de pêcheurs. C’était comme une tradition.
René se revoyait avec son père, en amont du barrage, dans le premier pré qui borde l’Arnon sur trois cents mètres environ. Dans les eaux calmes de la rivière, chaque pêcheur tendait plusieurs lignes fixées chacune à une gaule rudimentaire : une longue perche de noisetier ou, au mieux, une canne en roseau sans moulinet.
Son père, Louis, aimait la pêche, à cette époque. Lui, par contre, n’était pas attiré par ce genre de loisir. Cependant, tout gamin, il avait souvent accompagné son paternel sur les bords de l’Arnon. Mais, dans ce déploiement de pêcheurs amateurs des dimanches ensoleillés, il lui était souvent arrivé de s’ennuyer, surtout quand le poisson dédaignait de mordre à l’hameçon.
De ces parties de pêche, René gardait le souvenir d’un moment particulier. Ce n’était pas celui d’une belle friture que son père avait faite qu’il avait en mémoire. Non ! Quand son père Louis ramenait à la maison une tanche ou un carpeau, c’était déjà exceptionnel. C’était un matin où il y avait eu une dispute au bord de l’eau. Le propriétaire du pré, mécontent de voir tous ces pêcheurs installés chez lui, s’était adressé à ces derniers pour leur intimer l’ordre de quitter les lieux et il les avait menacés de faire appel aux gardes s’ils persistaient à rester à leur poste.
Philippe Baron, un jeune et petit paysan à casquette, était venu vers les pêcheurs d’un pas décidé. À quelques mètres de René et de son père, il s’était arrêté et avait ordonné sur un ton autoritaire :
— Vous aurez intérêt à plier vos cannes à pêche et à déguerpir de mon pré avant que ça aille très mal.
Alors, comme il avait regardé le père de René en disant cela, ce dernier s’était senti autorisé à relever ses propos en lui demandant :
— Qu’est-ce que tu racontes là, mon gars ?
— Tu as très bien compris ce que j’ai dit.
— Tu es bien un peu jeune, gamin, pour me tutoyer !
Philippe Baron avait estimé que le fait d’être chez lui lui donnait tous les droits. Le père de René lui avait fermement conseillé de changer d’attitude, mais il n’avait pas tenu compte de ce conseil et avait persisté à vouloir chasser, sur-le-champ, tous les pêcheurs de sa propriété.
— Nous, on ne partira pas, lui avait opposé Louis Pactat. On pêche. Et puis, ton pré, on ne l’abîme pas, on se met au bord de l’eau.
— Oui, mais, moi, je ne vous ai pas donné le droit de pêche.
— Tu ne nous as peut-être pas donné le droit de pêche, mais, nous, le droit de pêche, on l’a pris sans ta permission. Et puis, si tu veux boire la tasse, tu n’as qu’à continuer à nous agacer comme tu fais. Si tu insistes, tu vas voir comment ça va te faire.
— Puisque c’est comme ça, j’appelle les gardes. Vous verrez bien, quand vous devrez payer une amende, ce que ça va vous faire, à vous aussi.
— Mais appelle donc les gardes. Si tu veux qu’un jour je te caresse les oreilles bien comme il faut, tu n’as qu’à faire comme ça, espèce de roquet.
René se revoyait encore tout pantois, regardant le roquet quitter les lieux en balançant les bras dans tous les sens. Ce matin-là, son père Louis l’avait surpris. Le langage qu’il avait tenu au jeune homme, les menaces qu’il avait proférées à l’égard de ce dernier, l’avaient complètement abasourdi. Il ne s’était pas attendu à ce que son père réagît d’une manière aussi dure. Tout gamin qu’il était à l’époque, il avait estimé, sur le coup, que le propriétaire était dans son droit. Ces pêcheurs, assis ou debout au bord de l’eau, à quelques mètres les uns des autres, n’étaient pas chez eux et foulaient l’herbe du pâturage. Mais fallait-il pour autant les priver du seul plaisir qu’ils pouvaient s’offrir, à la belle saison, les dimanches matins ensoleillés ? Bien qu’un peu secoué, il avait fini par donner raison à son père.
René Pactat était toujours accoudé au parapet du pont. Le jour se levait. Il distinguait mieux les eaux de l’Arnon qui gonflaient. Devant lui, la nature se dévoilait doucement. Il était là, à rêver, et il savait qu’il devait se secouer, qu’il devait faire un dernier effort pour laisser derrière lui, si possible, son statut officiel de prisonnier évadé. Il lui restait seulement deux kilomètres à parcourir pour retrouver la vie civile, la vie de paysan. Il jeta encore un coup d’œil à l’eau qui s’engouffrait sauvagement sous les pelles et il ne put s’empêcher de se remémorer les grandes crues de l’Arnon. C’était après plusieurs jours de grosses pluies que la rivière devenait furie jusqu’à couper la route et la raviner. De violentes averses orageuses au nord des Combrailles produisaient aussi, moins de dix heures après, les mêmes effets aux mêmes endroits.
René se souvenait de la fameuse crue de 1934. Ce jour-là, il avait fallu beaucoup de bravoure au cocher et à son cheval tirant une carriole, pour venir arracher des eaux le meunier et sa nombreuse famille, tous perchés sur les meubles du logis et plongés dans l’angoisse.
Il savait qu’il devait quitter ce pont, ce point d’ancrage qui le fixait sur son passé, et ne pas trop traîner en plein jour, surtout avec son air de vagabond. Il fallait qu’il restât prudent jusqu’au bout. Le maigre courrier qu’il avait reçu en Allemagne lui avait fait comprendre que les choses, au pays, allaient plutôt mal. Il n’avait pas intérêt, et encore moins dans son état actuel d’évadé loqueteux, à rencontrer des soldats allemands, même une quelconque autorité en uniforme ou en civil. Sur la petite route qui passait sur ce pont, il allait bientôt circuler des charrettes, mais aussi des cyclistes et des piétons qui ne manqueraient pas d’avoir peur en le voyant : il avait tout l’air d’un vrai clochard. Sa chemise était ouverte. Son pantalon était troué et crotté, et ses chaussures étaient sur le point de rendre l’âme. Pour celles-ci, effectivement, il était grand temps qu’il arrivât : leurs semelles, usées jusqu’à la corde, commençaient à se désolidariser du reste. Oui, un clochard ! Pour survivre, il avait pillé dans les champs et les jardins : il avait volé. Sa faim avait souvent été si forte qu’elle l’avait parfois poussé à écarter la méfiance afin qu’il pût oser demander la charité. Quelle situation ! Impensable ce qu’un affamé est capable de faire pour apaiser la faim qui le tiraille au point de le plier en deux. Impensable, aussi, ce qu’il est capable de manger. Chez René, heureusement, ses nerfs, son moral et sa volonté avaient été sa force essentielle.
René se décida enfin à reprendre la route. Il devait, dès la première heure du jour, réintégrer la ferme familiale, rentrer chez lui, retrouver les siens, changer de vêtements, se raser, enfin se refaire tout neuf. Dans les prés bordant l’Arnon, d’épaisses nappes de vapeur traînaient par endroits : il y avait donc, dans l’herbe, de l’humidité qui laissait penser qu’au cours de la nuit il avait dû, là aussi, beaucoup pleuvoir. Deux cents mètres plus loin, il s’engagea sur le chemin de la Poterie et se sentit un peu plus en sécurité. Il vit des dizaines de moutons qui paissaient calmement sur l’herbe rase. Plus loin, dans les champs, les grains finissaient de mûrir.
Sur ce chemin qui le menait à la ferme familiale, René avait un peu les jambes amollies. Il avait aussi comme un poids sur les épaules… La faim ! C’était la faim qui le rendait faible. Il y avait longtemps qu’il avait l’estomac dans les talons. Mais, curieusement, il se sentait plus fatigué que les autres jours. C’était comme si, à l’approche du but, toutes les souffrances, toutes les peines qu’il avait surmontées jusque-là, resurgissaient en bloc pour l’accabler une dernière fois. Mais bientôt il serait parmi les siens et son calvaire prendrait fin. Ce serait de nouveau la joie autour de lui et en lui. Et pourtant, sur ce chemin de la Poterie, un chemin pierreux et montant, il éprouvait un semblant d’appréhension.
II
Au bout du chemin de la Poterie passait la route de Maugenest, et, de part et d’autre de celle-ci, le hameau du même nom semait ses petites fermes et ses maisonnettes assez loin les unes des autres. Maugenest ! René atteignait enfin son but. Il était arrivé en haut du chemin et se trouvait à cinquante mètres de la ferme familiale. L’habitation située au carrefour était toujours plongée dans le sommeil. Cela rassura l’évadé : celui-ci ne tenait pas à se montrer aux voisins dans un tel état. Si les siens dormaient encore, il s’assoirait dans un coin de la ferme et attendrait.
Il allait arriver à la ferme de ses parents, la ferme des Lilas. On la nommait ainsi à cause des lilas qui bordaient la route, une route de terre battue. Ces lilas aux fleurs mauves, formaient, sur près de vingt mètres, de chaque côté de la grande entrée du domaine, une haie sauvage qui s’efforçait, tant bien que mal, de tenir les grands vents d’ouest en respect.
Une fois dans la grande cour pierrée, on avait, sur la gauche, le logis, son hangar à bois, son clapier et son potager. Dérogeant à la tradition berrichonne, les bâtiments agricoles étaient en retrait par rapport au logis. Si bien que, sur la droite, on trouvait d’abord un immense hangar rempli de matériel, un hangar dans le prolongement duquel se situaient l’écurie, la bergerie, la grange et les étables. Et puis, au fond de la cour, détachée des autres bâtiments, la porcherie. Derrière celle-ci, un vaste pré où se dressait la meule de paille. Contre la porcherie, on trouvait encore le poulailler — un large appentis avec, devant, son espace grillagé — et, en bout des étables, la mare à canards. Enfin, sous une longue rangée de grands chênes, le bûcher, du bois de chauffage soigneusement entassé pour deux ou trois ans de séchage. Derrière les grands bâtiments, on pouvait suivre un étroit chemin sans issue qui donnait accès à plusieurs champs et prairies de la ferme, et au bout duquel se trouvait un large trou d’eau. Ainsi, avec, au centre de sa cour, son puits et son grand bassin, la ferme des Lilas avait à peu près tout pour fonctionner normalement. C’était une ferme d’importance moyenne qui parvenait à nourrir raisonnablement ses occupants.
René Pactat était à deux pas de chez lui et il se sentait troublé. Il pensa qu’il pouvait être cinq heures, enfin guère plus. Il ne pouvait savoir, les Allemands lui ayant piqué sa montre.
À l’approche de la haie de lilas, il réalisa qu’il allait revoir son père, Louis, et sa mère, Marguerite. Il allait serrer sa femme, Josette, dans ses bras. Et puis, il avait un fils, un fils qu’il n’avait pas vu naître, un tout petit bébé d’un an et demi que sa jeune et belle maman de dix-neuf ans allait lui présenter. On l’avait appelé Jean-Michel, son fils : un joli prénom, ma foi !
René entra dans la cour et vit, dans la porcherie, la pâle lumière jaune venant d’une ampoule électrique. La maison d’habitation semblant toujours plongée dans le sommeil, il se dirigea vers ce signe de vie. Il s’arrêta à la porte de cette pièce sombre qu’il fallait souvent éclairer, qui sentait la farine et les légumes cuits et qui était fréquentée par les rats noirs et les chauves-souris.
René attendit. Dans le couloir qui longeait les auges, quelqu’un déversait la nourriture aux cochons. Un homme revint vers la chaudière avec un seau vide à chaque main. René s’attendait à revoir son père, mais l’homme aux deux seaux n’était pas son père. C’était Émile Girault, son beau-frère. Celui-ci laissa tomber ses seaux et resta figé devant le barbu dépenaillé qui attendait dans l’encadrement de la porte.
— René ! Ce n’est pas possible ! dit enfin Émile qui venait de reconnaître le mari de sa sœur.
Il y eut ensuite un moment de silence durant lequel les deux hommes se regardèrent, un silence comme pour contenir l’expression des sentiments qui surgissaient d’un coup. Puis Émile reprit :
— Ils t’ont relâché, comme ça ?
— Tu veux rire ? Penses-tu ! Je leur ai joué compagnie.
— Ce n’est possible que tu te sois évadé ! Comment as-tu fait pour arriver jusqu’ici ?
— Eh bien ! En marchant ! Comment voulais-tu que je fasse autrement ?
— C’est égal ! Ça t’a fait une trotte ! Enfin, tu me raconteras tout un autre jour. Seulement, tu es arrivé après l’enterrement.
— Quel enterrement ?
— Tu n’es pas au courant ?
— Au courant de quoi ?
— Que je suis bête ! Tu ne peux pas savoir puisque ça fait sûrement des semaines que tu es sur les routes.
— Explique-moi, au moins !
— Ton père.
— Quoi, mon père ?
— Il est décédé. Oui, le pauvre, il est mort et enterré depuis une dizaine de jours.
René sentit qu’il allait s’évanouir. Il entra dans l’étable de la chaudière, rabaissa le couvercle du coffre à farine et s’assit dessus. Là, il se plia en deux, enfouit sa tête dans ses mains et n’eut plus la force de dire un mot. Ce qu’il ressentait était pourtant oppressant au point d’en pleurer, mais ses yeux restaient secs et sa bouche n’exprimait aucun son. Le drame qui venait s’ajouter à sa fatigue et à sa faim l’avait totalement anéanti.
Émile dut aider son beau-frère à se redresser. Il s’était aperçu qu’on avait entrouvert la porte du logis et il avait estimé qu’il était temps que René allât à la rencontre de sa pauvre mère, de sa femme et de son fils. Ayant constaté l’extrême faiblesse de l’évadé, il décida de l’accompagner et, au besoin, de le soutenir jusqu’à la demeure. À quelques pas du domicile familial, René pensa à demander à Émile :
— Qu’est-ce qu’il a eu ?
— Oh ! Je ne sais pas bien ! C’est dans le ventre que ça le tenait.
Émile restait dans le vague. Il ne savait pas vraiment quel mal avait emporté son patron. Néanmoins, lié par son travail à la ferme des Lilas, il se sentait concerné par le malheur qui s’y était abattu ; il partageait le deuil de ses occupants et compatissait sincèrement à leur peine.
Émile Girault était le frère de Josette, la jeune épouse de René. C’était un homme de vingt-cinq ans, pas très grand, un peu rond, les cheveux châtain clair, épars et aplatis sur le crâne. Un bon paysan à la tête d’une fermette laissée à la charge de sa femme. Une toute petite ferme au lieu-dit « La Pépinière ». Une modeste maison d’habitation, avec, à côté, un bout de grange et quelques étables pour loger une vache, une chèvre, quelques moutons et une bourrique, une bourrique pour aider à travailler les cinq hectares de terre. C’était des conditions qui poussaient Émile à se faire journalier pour apporter une paie à la maison.
Ainsi, en mai 1939, Émile avait, au pied levé, remplacé, à la ferme des Lilas, René parti faire son service militaire.
Marguerite, la mère de René, était dans la grande salle commune. Quand elle entendit s’ouvrir la porte qui donnait sur la cour, elle était au coin de sa grosse cuisinière à bois et passait le café. Elle tournait le dos aux arrivants et ses cheveux poivre et sel se détachaient légèrement sur sa chemise noire que l’élastique d’une longue jupe de même couleur serrait à la taille. Elle versait de l’eau bouillante dans le filtre de la cafetière, un filtre tapissé de grains d’orge torréfiés et grossièrement moulus. Elle reposa sa casserole sur le feu et se retourna. La surprise s’inscrivit subitement sur la blancheur de son visage de femme forte. Elle resta plantée là, les bras ballants, la bouche ouverte et les yeux écarquillés.
René alla vers sa mère et l’embrassa. Ni l’un ni l’autre ne prononça un mot. Marguerite se reprit et serra bien fort son fils dans ses bras. Ce dernier, sentant venir le malaise, se dégagea poliment et alla s’asseoir près de la table. Sa mère, ayant enfin saisi toute la raison de sa surprise, demanda à son fils :
— Ils t’ont enfin libéré ?
— C’est qu’il s’est évadé ! précisa Émile, toujours sur le pas de la porte restée ouverte.
— Tu t’es évadé ? fit Marguerite, tout étonnée.
— Eh oui ! Tu peux bien penser qu’ils n’allaient pas me laisser partir comme ça !
— Eh bien ! Tu as dû marcher, marcher, marcher ! Dans quel état que tu es fait, mon pauvre enfant ! Je vais faire chauffer de l’eau pour le grand bassin et tu te laveras. Mais, avant, tu as peut-être bien faim ?
— Une faim de loup, oui !
René dévora des œufs sur le plat. Sur la table l’attendaient un fromage de vache et un gros morceau de salé froid avec son épaisse couche de gras. Marguerite, qui était retournée à sa cafetière, demanda à son fils, sans se retourner :
— Tu es au courant ?
— Pour mon père ?
— Oui ! Émile a dû t’en parler, je suppose ?
— Oui ! Mais pourquoi vous ne me l’avez pas écrit ?
— On t’a écrit au mois de mai qu’il était malade. Et puis, la lettre du décès, elle est partie l’autre jour. Tu n’as pas pu la recevoir, celle-là ; et l’autre, c’est sûrement pareil. Tu sais, ça l’a emporté bien vite ; moi, je te le dis !
— Mais qu’est-ce qu’il a eu ?
— Bien difficile à dire ! Il avait mal au ventre et ça a empiré de jour en jour. Le médecin ne savait pas trop. Du coup, il l’a envoyé à l’hôpital, et puis il est mort là-bas, le pauvre. Enfin, ils l’ont laissé mourir. Je suis allée le voir — le père Baudet m’y a emmenée deux fois —, j’ai bien vu qu’ils ne lui faisaient rien.
Après un moment de silence, René se souvint tout de même qu’il avait une femme et un enfant. Il demanda alors à sa mère :
— Et Josette ? Et le petit ?
— Oh ! Ils dorment encore ! Faut les laisser tranquilles.
Pendant que Marguerite parlait, Josette, silencieusement, était sortie de sa chambre et elle était là, derrière René qui mangeait à s’en rendre malade. Oui, elle était dans le dos du mangeur et elle était figée par ce qu’elle voyait, figée par cet homme en guenilles, maigre, barbu, aux cheveux longs et sales. C’était comme si elle ne parvenait pas à rattacher ce dernier à la réalité. Josette était mal réveillée.
Josette Pactat était une jeune femme de taille moyenne, une jolie brune aux yeux noirs. Elle avait un beau visage, des lèvres fines, un nez un peu long peut-être, mais bien droit et bien fait. Ses cheveux soigneusement peignés tombaient sur ses épaules. Côté vestimentaire, ce n’était pas vraiment l’élégance : un tablier gris sur une robe de calicot du même ton et des pieds nus dans des pantoufles aux talons écrasés. Elle était plantée là, derrière René qui, occupé à manger, ne l’avait pas entendue arriver.
— Eh bien ! Tu vas rester longtemps comme ça, plantée comme une cruche ? Tu ne vois donc pas qui c’est ?
Marguerite venait de houspiller sa bru. Elle avait trouvé ridicule l’attitude de Josette et elle le lui avait fait remarquer sur le ton qu’elle employait quand celle-ci était encore sa simple bonniche. Le changement de statut de Josette n’avait pas modifié les habitudes.
L’évadé se retourna et vit sa femme. Il se releva, alla vers elle, l’embrassa sur les joues, puis la serra quelques secondes dans ses bras. Josette était sans réaction. Elle avait très mal dormi et la raison de sa surprise ne parvenait toujours pas à s’insérer complètement dans le réel.
René, qui avait terminé de s’alimenter, voulut voir son fils. Alors Josette l’entraîna dans la chambre et, silencieusement et doucement, tous deux s’approchèrent du landau. Leur bébé dormait, les poings fermés. Le petit avait de beaux cheveux fins, des cheveux châtain clair, mais qui, plus tard, deviendraient bruns, sans aucun doute : le père et la mère étaient bruns. Avant de quitter la chambre, ils s’adonnèrent à quelques gestes amoureux, mais la barbe de René qui avait poussé depuis Schramberg et la mauvaise odeur qu’il traînait avec lui étaient des éléments qui n’étaient pas de nature à trop prolonger les tendres baisers.
Quand ils retournèrent dans la salle commune qu’on appelait couramment la cuisine, car on y cuisait la nourriture, Émile était revenu et mangeait sa soupe. Sur la table, Marguerite avait posé deux bols dans lesquels elle versait le café. Une casserole de lait bien chaud reposait sur un dessous-de-plat ; à côté se trouvaient le pain de ménage et l’assiette de beurre. Les deux femmes allaient prendre leur petit-déjeuner.
Devant les deux bols, René s’étonna :
— Je ne trouve pas que ça sent le café, votre affaire !
— Ce n’est pas du café, dit Marguerite. Seulement de l’orge. Du café, il y a déjà un moment qu’on n’en trouve plus, comme le reste d’ailleurs.
— C’est buvable, au moins ?
— Oh ! Torréfié comme il faut, ce n’est pas mauvais avec du lait.
Pendant que Marguerite et sa bru prenaient leur petit-déjeuner, qu’Émile mangeait un gros morceau de fromage, que René digérait sur sa chaise et semblait réfléchir, de l’eau fumait déjà dans deux fait-tout posés côte à côte sur la grosse cuisinière en chauffe, été comme hiver. René allait bientôt se laver ; c’était nécessaire et urgent même : il sentait franchement mauvais.
Sur la table, devant lui, René avait placé une petite glace contre une bouteille. À côté, il avait mis un grand bol d’eau chaude, son blaireau, son savon et des ciseaux. Avec son coupe-chou, il se rasait et l’opération n’était pas aisée. Il s’était lavé dans la buanderie et avait endossé des vêtements propres. Josette lui avait coupé les cheveux tant bien que mal et, maintenant, il allait redevenir un jeune homme présentable.
Dans la chambre d’à côté, Josette faisait la toilette au bébé qu’on avait entendu babiller au réveil. Marguerite s’apprêtait à aller traire les vaches, mais la présence de son fils la retenait encore. Un seau vide à ses pieds et son pot à traire à la main, elle se tourna vers ce dernier et l’informa :
— Quand tu es parti, ton père a embauché Émile pour te remplacer jusqu’à ton retour. Maintenant qu’il n’est plus là, le pauvre, va bien falloir le garder.
— Qui ça ?
— Eh bien, Émile ! Tous les deux, vous allez bien vous entendre ?
— Bien oui ! Pourquoi ? Il n’y a pas de raison !
— Tu sais, faudra quand même faire attention. Il ne faudrait pas qu’on te demande des comptes. Il y a des gens bizarres qui traînent un peu partout, en ce moment.
— Qui sont-ils, ces gens ?
— On n’en sait rien, mais il faut s’en méfier : ce n’est pas des gens bien commodes.
— Tu crois qu’ils vont s’intéresser à des gens comme nous. Tu crois qu’il y en aurait dans notre coin ?
— Dans la commune, tu veux dire ? Notre maître d’école a bien dit à Émile qu’il pouvait y en avoir . Et puis, à Culan, Émile en a vu toute une bande qui cherche à se faire remarquer.
— Tu lui as dit, à Émile ?
— Quoi ?
— Que tu le gardais définitivement.
— Oui ! Mais il l’a bien compris avec la disparition de ton père. Avant que tu arrives, on cherchait quelqu’un, mais la Louée est passée et on ne voyait personne à embaucher. Au bout du compte, je n’avais plus qu’à aller moi-même l’aider dans les champs. Mais te voilà ! À vous deux, vous allez bien vous en tirer. Il y a les moissons qui vont être bonnes à couper. Émile a déjà commencé les chemins au Chaumat. Faudra voir avec lui.
— Voir quoi ?
— Les chemins ! Hier, je l’ai aidé. Eh bien ! Je te dis, faut voir les ronces qu’il y a. Et des traînantes, des rouges. Il n’y a pas intérêt à ramasser la javelle en manches courtes. Dis, tu voudras peut-être bien te reposer un moment ?
— Non ! Si je veux reprendre le rythme, il faut que je tienne le coup toute la journée.
— Évadé ! Tout de même ! C’est comme si tu avais senti la mort de ton père et que tu t’étais dit : « Faut que j’y aille. » Tu n’as qu’à aller remettre les toiles sur la moissonneuse et puis, si tu te sens la force, tu peux aller retrouver Émile au Chaumat. Mais fais attention à toi. Évite de causer aux gens si tu en rencontres.
— À cause ?
— À cause qu’il ne faudrait pas qu’on te dénonce, pardi !
— Bah ! Ça ne craint rien !
Sous le hangar où il faisait pourtant frais, René avait quand même un peu chaud. Il se sentait faible et il avait légèrement mal à l’estomac. Il glissait péniblement les toiles dans le ventre de la moissonneuse-lieuse, des toiles qu’on mettait à l’abri dans la grange après chaque moisson. Il eut mille peines à fixer celles-ci sur l’élévateur de la machine, dont il graissa les roulements et les articulations. Sur une scie, il changea deux dents ébréchées et reconnut qu’un coup de meule serait nécessaire avant de la glisser dans le banc de scie. Seulement, il fallait être deux pour aiguiser les dents de cette fameuse scie. Il verrait avec Josette.
Quand il eut fini avec la lieuse, il était en sueur. Il resta à l’ombre du hangar et s’assit sur un billot qui traînait là, au pied d’un pilier contre lequel il s’adossa. Il essuya d’un revers de la main la sueur qui perlait sur son front et se mit à penser. Il pensa à son père qui les avait quittés. Il prit alors une décision. Ce soir, à la fraîche, avant la soupe, il attellerait Bijou à la petite voiture et il irait, en famille, se recueillir sur la tombe du père.
Pourquoi en famille ? René ne savait pas. C’était peut-être pour se sentir soutenu dans l’épreuve, ou pour qu’on pût partager avec lui sa douleur, ou encore pour que le père, tout là-haut, pût voir que sa famille restait attachée à son souvenir. Qu’importe ! De toute manière, ce soir, il irait prier sur la tombe de son père. Enfin prier, façon de dire : il y avait longtemps que les prières, du temps du catéchisme, s’étaient envolées.
René estima que la matinée était déjà bien avancée. Il pouvait être onze heures, selon lui. Il n’avait toujours pas de montre. Il allait demander à sa mère s’il ne pourrait pas récupérer celle de son défunt père. Travailler sans montre n’était pas l’idéal. Il faisait vraiment chaud. Il pensa à Émile, au champ du Chaumat, à la javelle. Prendre son vélo et aller rejoindre son beau-frère par cette chaleur ? Non ! Il ne s’en sentait pas la force. Il quitta le hangar, traversa la cour et entra au logis qui, les volets fermés à cause du soleil, était plongé dans la pénombre. Assis sur une couverture, dans un coin opposé à la cuisinière, le petit Jean-Michel jouait avec deux morceaux de bois et une vieille casserole. René se mit à genoux près de son fils et lui posa un baiser sur le front. Le petit ne se détourna pas de son jeu : avec les bouts de bois, il tapait sur la casserole.
Enfin, René se désaltéra. Il but un verre de vin rouge qu’il trouva un peu en vinaigre : le tonneau devait tirer à sa fin. Il but sans faire de commentaire.
Le soleil allait bientôt arriver en fin de course. Bijou, attelé à la petite voiture, attendait au pied des lilas pour aller au cimetière. Il n’aurait qu’une toute petite course à faire, le cimetière n’étant qu’à un kilomètre environ de la ferme. Émile avait aidé à atteler le cheval à la voiture. Il avait tout de suite vu que son beau-frère aurait de la peine à transporter le harnais et à le poser sur la bête. René avait finalement fait une sieste après déjeuner. La fatigue l’avait emporté sur sa volonté de tenir le coup. Il avait dormi deux bonnes heures, était allé retrouver son beau-frère au champ de blé du Chaumat et avait javelé une petite heure. Puis il était revenu avec Émile et tous deux avaient cassé une croûte avant de préparer l’opération cimetière.
Au pied des lilas, René attendait la famille : sa mère, sa femme et son fils. Il se sentait toujours faible. Plusieurs semaines de marche nocturne l’avaient finalement usé. Et à sa fatigue s’ajoutait la mort d’un père. René avait retrouvé sa famille en deuil et il était, lui aussi, en deuil. Libre, mais en deuil.
III
Aux dernières heures chaudes de la journée, le cheval allait au pas. Les deux femmes étaient assises sur le siège mal rembourré de la voiture. Josette portait le petit Jean-Michel sur ses genoux et Marguerite tenait les rênes. René était assis derrière, à même le plancher, entre le siège et la porte arrière. Ce dernier se faisait tout petit et il était songeur. Josette était juste devant lui et le corps svelte de celle-ci le ramena quelques années en arrière.
Il revoyait sa Josette à l’âge de quinze ans. C’était la Saint-Gervais, le jour de la Louée à Culan. Elle était dans un groupe de jeunes filles, toutes candidates à l’embauche. Sur la place de la Grand-Croix, devant le Grand Café, elle attendait, comme les autres, qu’on vînt s’adresser à elle. À quinze ans, Josette avait pratiquement un corps de femme. Il la revoyait avec ses belles chaussures et ses socquettes blanches, sa jupe plissée bleu foncé et son corsage rose, sur le revers duquel elle avait épinglé une reine-marguerite. Sur ses beaux cheveux noirs, elle portait un chapeau de paille orné d’une petite chose en feutrine : une feuille et deux cerises pendouillant au bout de leur queue. Qu’elle était belle, Josette, ce jour-là ! René avait accompagné son père qui, désirant louer les services d’une bonne, s’était adressé à elle. Aussi, devant cette jolie fille, il avait ressenti un petit pincement au cœur.
L’attelage arriva au cimetière. René sauta de la voiture, aida sa femme portant son bébé à en descendre et attacha Bijou à un des anneaux scellés dans le mur. Le trajet s’était déroulé sans encombre. La voiture n’avait croisé qu’un cycliste. Au village, le bistrot était silencieux : le travail des champs retenait encore les paysans. Mais la forge était en pleine activité : le marteau cognait sur l’enclume et les clients étaient soucieux.
Dans les allées du cimetière, René, à voix basse, fit remarquer à Josette :
— Ce n’est pas bien la place d’un bébé !
— Ce pauvre enfant, il ne se rend pas compte à son âge, répondit Josette. Et puis, je n’allais pas le laisser tout seul à la maison. Tu aurais peut-être voulu que je le laisse à mon frère ? Il a bien autre chose à faire en ce moment.
Marguerite était déjà au pied de la tombe de son époux. Elle avait apporté un bouquet d’œillets et elle rassemblait des fleurs fanées pour aller les jeter dans une mini-décharge. René, Josette et l’enfant — ce dernier toujours dans les bras de sa mère — s’approchèrent d’elle. Réunis enfin, ils se recueillirent un long moment durant lequel ils purent prier, chacun à leur manière, devant la tombe du père.
La tombe ! Un monticule de terre bien façonné, recouvert de couronnes mortuaires, avec, au pied d’une croix de bois, une plaque sur laquelle était gravé :
« Ici gît
Louis Pactat
1894-1941. »
Immobile, les mains sur le ventre, René regardait ce déballage de couronnes. Se rendait-il compte qu’il n’entendrait plus la voix si particulière de son père, qu’il ne verrait plus son regard souvent rieur ? Non ! Il n’éprouvait qu’un sentiment vague empreint de tristesse contenue. L’idée que quelque chose s’était arrêté de vibrer, que le soutien de la cellule familiale dans laquelle il avait vécu jusque-là s’était effacé, ne l’habitait encore que superficiellement.
En retournant vers la petite voiture à cheval, René, toujours à voix basse, fit savoir à sa mère :
— Je n’aime pas bien voir mon père enterré à même la terre. Tu ne pourrais pas lui faire faire un caveau ?
— J’y ai bien pensé. Mais il est parti tellement vite que j’ai été prise de court. Je n’allais quand même pas commander un caveau au début de sa maladie. J’ai toujours pensé que ça s’arrangerait. Pour le caveau, quand j’aurai un moment, il faudra que j’en discute avec Lucien, le maçon. Il pourrait nous le faire pour pas trop cher.
Marguerite était une femme d’exception. La mort de son époux lui avait forcément porté un coup, mais rien dans ses paroles ne traduisait sa douleur, rien dans son regard ne laissait apparaître de la tristesse. Elle venait de perdre un être cher et elle gardait, au plus profond d’elle-même, toute la souffrance que lui infligeait cette perte. Loin d’être désemparée par son veuvage qui débutait, elle était au contraire déterminée à surmonter cette épreuve, à prendre les affaires en main, à gérer au mieux la ferme des Lilas. René en était à la fois surpris et soulagé.
Après dîner, René n’attendit pas Josette pour se mettre au lit. Il se glissa dans les draps et s’endormit au bout de quelques secondes. Il y avait longtemps qu’il n’avait pas dormi dans un lit. Il avait traîné sa fatigue jusqu’au soir et avait trouvé la journée un peu longue. Sans la sieste qu’il avait faite à l’ombre d’un chêne, il n’aurait pas tenu le coup. Vers les trois heures du matin, il ouvrit les yeux. Il ne parvint pas à retrouver le sommeil. Trop de choses lui trottaient dans la tête. Inévitablement, le souvenir de son père l’emporta sur le rappel des moments particuliers de son propre vécu. Il le revoyait labourer en automne ou au printemps et, en hiver, remettre à neuf une bouchure et jeter la vieille épine dans un grand feu de joie. Il se le rappelait lorsqu’il élaguait des chênes, coupait ou sciait du bois de chauffage dans la petite parcelle du bois de la Garenne, ou quand il dirigeait les travaux à l’époque des moissons, des charriages et des battages, ou encore quand il travaillait la vigne des Ribattes ou organisait la journée des vendanges.
Il en déduisit qu’il s’était souvent trouvé aux côtés de celui qu’il avait tant admiré. Et, au bout d’un léger vague à l’âme qui aurait pu l’entraîner de nouveau vers le sommeil, il revit Josette, le jour de la Louée à Culan, puis son père, au bistrot, trinquant avec deux compères, deux paysans, deux vieilles connaissances. Ce bistrot ? Ce n’était pas le Grand Café de la place de la Grand-Croix ; ce dernier était bien trop huppé pour de petits paysans comme eux. Non ! C’était le bistrot d’en face, de l’autre côté de la rue, un bistrot sans grandes baies vitrées, avec de simples fenêtres, des tables et des chaises tout aussi simples. Il faisait d’ailleurs un peu sombre, dans cet établissement.
Ce jour-là, René avait mis ses pas dans ceux de son père. À 19 ans, il avait éprouvé le besoin de se sortir, de voir ce qui se passait un jour de Louée. Il se souvenait qu’il avait bu du vin rouge avec les autres et que son père avait tout de suite fait la remarque qui s’imposait en pareille circonstance :
— Rien à voir avec notre vin des Ribattes !
— C’est vrai qu’il est bien un peu en vinaigre, avait reconnu l’un des compères.
— Un vin de bistrot, ça ne vaut pas un bon vin de vigne, c’est bien connu, avait appuyé l’autre.
Mais, ce jour-là, ce qui avait surtout marqué René avait été la discussion qui avait suivi :
— Eh bien, mon vieux Louis ! As-tu trouvé le domestique que tu voulais ? avait demandé à son père l’un des paysans.
— La domestique ! Une petite bonne pour mon gars ! avait répondu son père avec un petit air malicieux.
— Tu cherches à marier ton gars ?