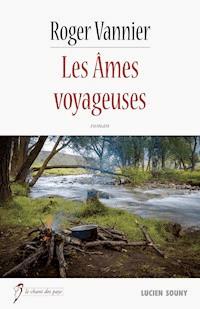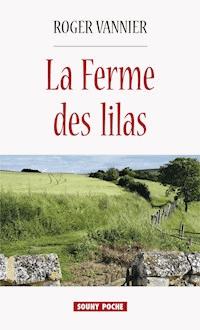Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un héritage qui change toute une vie
Enseignant, Rémi s’adonne à la peinture et aime s’évader au son de la musique classique. Il a choisi de mener une existence tranquille et modeste après un divorce tumultueux… Mais tout s’effondre le jour où il reçoit une fortune colossale léguée par un oncle qu’il n’a même pas connu.
Issu d’un milieu ouvrier, ayant milité à l’université sous la bannière « le paradis des riches est fait de l’enfer des pauvres », il est très mal à l’aise avec ses millions, ses actions et ses biens. D’autant que ses parents, lui reprochant d’avoir accepté l’héritage, se détournent de lui, tout comme le reste de la famille. Pourtant, mis à part sa nouvelle demeure, il ne change rien à son train de vie. Quatre ans plus tard, il est occupé à peindre dans sa luxueuse et gigantesque villa Rosarole quand il entend sonner à la grille. Ébahi, il découvre Sophie, une jeune femme avec laquelle il avait eu une brève liaison, quelques mois avant la fin de son contrat de coopérant, de l’autre côté de la grande bleue.
Certaines idylles marquent les êtres à jamais. Faut-il toutefois chercher à faire revivre le passé ?
Un roman rural qui interroge les valeurs et la relation à l'argent, à ne pas manquer !
EXTRAIT
Ce soir, comme il fait encore doux, il va dîner dehors, sous la ramure d’un tilleul gigantesque. Un salon de jardin et une chaise longue sont restés installés tout l’été près d’un abri qui s’appuie contre un mur mitoyen. Celui-ci mesure quatre mètres de haut et se prolonge tout autour du parc. Quand il est rentré, qu’il a verrouillé son portail, Rémi se sent vraiment chez lui. Il n’a jamais éprouvé ce sentiment au cours de sa jeunesse. Il a fallu, à son retour d’Algérie, qu’il héritât de son oncle pour connaître les effets de la richesse, les charges et les avantages qu’ont tous les propriétaires. À l’intérieur de son domaine, il est isolé. Les bruits de la ville ne l’atteignent pas. Ceux du lycée, qui se sont accrochés à lui, bourdonnent quelques instants dans sa tête, mais, tout de suite après, c’est le grand silence, le repos, la solitude, la rêverie. Seuls les oiseaux, dans l’épaisse verdure, ponctuent de leur chant la tranquillité des lieux.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Roger Vannier est né dans le Cher, à Reigny. Instituteur, il a d’abord enseigné en Algérie, puis il est rentré sur ses terres natales pour terminer sa carrière. Aujourd’hui à la retraite, il mène une activité artistique à laquelle il associe l’écriture. Il vit à Chateaumeillant. Son univers s’enracine dans sa région natale. Il en restitue toute la finesse, l’âme et la beauté.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sur la plus haute des cours en terrasse du lycée de Saint-Amand, Rémi Verneuil s’est arrêté. Il regarde au-delà des deux internats qu’il vient de quitter et il se sent envahi par un léger trouble. En cette fin du mois d’août 1975, un soleil éclatant donne au paysage un air de carte postale. Il est plus de dix heures. Le jeune conseiller principal d’éducation admire le calme qui l’entoure. Seulement, pour lui, hélas, les vacances d’été sont terminées et les préparations pour la rentrée qui est proche ne vont pas cesser de l’accaparer. Il a gardé à l’esprit les deux visions furtives qui, ce matin, lui ont rappelé son passé. Enfin, la chaleur le saisit dans son immobilité et il comprend qu’il ferait mieux de rejoindre la fraîcheur de son bureau où ses deux adjoints sont déjà à pied d’œuvre.
Dès l’ouverture de l’établissement, il a parcouru les couloirs et a comptabilisé de nouveau tous les endroits à surveiller de près. Il a visité les réfectoires, puis les cuisines où les membres du personnel s’activaient, les uns vérifiant leurs ustensiles, les autres lavant la vaisselle. Il a traversé tous les dortoirs pour s’assurer que le grand ménage serait fait à temps. Ce travail n’entre pas dans ses obligations de service, mais il a accepté, dès sa nomination, toutes ces responsabilités qui pallient l’absence de proviseur adjoint, ou de censeur comme il y avait autrefois. Avec son supérieur, il a élaboré le planning des professeurs. Il a fallu attribuer à chacun d’eux un numéro de salle en tenant compte de la matière enseignée et de leurs horaires ; un véritable casse-tête qui demande un temps considérable.
Rémi est maintenant dans son bureau. Devant lui, des formulaires à remplir, des signatures à apposer et un téléphone qui n’arrête pas de sonner. Un répit lui permet de revenir un instant sur ce qui l’a surpris quand il a traversé le dernier dortoir des garçons. Une employée, très brune, manœuvrant un aspirateur industriel, s’est redressée entre deux lits et l’a fixé bizarrement. Il s’est demandé s’il ne rêvait pas. Il a poursuivi son chemin comme si de rien n’était, a regardé droit devant lui et a franchi la porte de sortie, l’esprit chaviré. Pourquoi ne s’est-il pas arrêté pour observer brièvement cette jolie femme ? Elle lui a rappelé une relation adultère qu’il avait assidûment entretenue durant la fin de sa dernière année de coopération en Algérie. Il explique cette mauvaise conduite par son mariage qui avait été une catastrophe, par la vie d’enfer que son épouse dominatrice lui avait menée. Aujourd’hui, il est divorcé, mais, alors qu’il souhaite tracer un trait sur ce passé peu glorieux, il s’est souvenu de cette aventure qui lui avait apporté à la fois bonheur et inconvénients.
Il y avait eu, dès le matin, l’arrivée de son ancien professeur d’anglais, M. Grosjean, venu avec d’autres, pour les séances de rattrapage du baccalauréat. Dans le hall, il l’a aperçu, les cheveux bruns bien peignés et l’épaisse barbe noire soigneusement taillée. Il a été son élève au collège, et leurs relations ont été très mauvaises. Il a même pensé, en le voyant, à l’accompagner dans les couloirs jusqu’à sa salle pour lui rappeler son manque de psychologie et l’injustice dont il avait fait preuve, autrefois, à son égard.
Un peu avant midi, il quitte son bureau et traverse lentement la cour pour rejoindre son appartement de fonction. Dehors, son regard balaie l’espace situé entre les bâtiments scolaires et les bureaux. C’est son habitude. Il agit ainsi par instinct. Il doit s’assurer que tout est en ordre pour écourter son service. La sonnerie, qui annonce le début et la fin des intercours, ne compte pas pour lui. Il peut profiter des rares accalmies pour se libérer, s’il le souhaite, mais, officiellement, il est d’astreinte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, excepté les week-ends. En ce moment, un petit groupe d’élèves ayant subi les épreuves orales remontent vers la sortie. Trois professeurs ont déjà franchi le portail. En somme, très peu de mouvements ; la vie du lycée est calme. Ce ne sera plus le cas dans quelques jours.
Au deuxième étage, dans son trois-pièces où les meubles sont rares, il ouvre son réfrigérateur, s’empare de ce qui va faire son repas et installe couverts et nourriture sur la table de la cuisine. Il va manger froid, calmement et silencieusement. Il se contentera d’un restant de salade composée, d’un peu de charcuterie, d’un morceau de fromage et d’un quartier de melon.
Il déjeune tout en songeant. Ses gestes sont lents, car il n’a pas très faim. Les surprises de ce matin occupent d’abord ses pensées. Mais les vastes responsabilités qu’implique son métier ont vite fait de l’emporter sur les divagations de son esprit. Ses obligations s’imposent à lui et il sait qu’il aura de quoi s’activer tout l’après-midi, et même jusque tard dans la journée. Son déjeuner terminé, la cuisine nettoyée et ordonnée, il va s’allonger sur son lit. Il veut se reposer jusqu’à quatorze heures. Il met son réveil à sonner. La nuit précédente, l’insomnie s’est manifestée et l’a gardé longtemps éveillé, aussi risque-t-il de s’endormir et de connaître un sommeil prolongé. Demain samedi, il n’aura pas d’élèves à recevoir : la rentrée est pour plus tard. Ce soir, il retournera à sa villa et il pourra se détendre.
Dans son bureau, il a mis du temps à effacer les brumes de sa sieste. Il est maintenant dans la cour inférieure et il y croise l’intendant. Celui-ci vient de discuter avec les ouvriers qui remettent en état la chaufferie. Ce n’est pas une tâche qui presse. Les journées froides sont encore très loin, et le proviseur, M. Burlin – Burding pour les élèves –, attendra, comme chaque année, pour rallumer le chauffage, que la température ait suffisamment chuté et que les professeurs, les uns après les autres, soient venus se plaindre plusieurs fois auprès du conseiller principal d’éducation. Depuis son entrée en fonction, à la rentrée de septembre 1970, dans ce lycée tout neuf qui accueillait les élèves pour la première fois, les enseignants lui présentent toujours leurs doléances. Rares sont ceux qui vont s’adresser en haut lieu. La plupart doivent sans doute reconnaître que le contact avec le CPE est plus facile et plus direct. C’est une anomalie qui prend sa source au cœur du mouvement de mai 1968. Cette année-là, la grève des élèves, dans l’ancien établissement, avait paralysé les cours durant plusieurs jours. M. Burlin avait tout fait pour la briser. Il n’avait pas ménagé sa peine pour chasser en vain les sit-in et faire entrer dans les salles tout ce monde revendicatif. Il avait menacé d’exclusion certains meneurs et s’en était pris aux professeurs. Voyant son autorité bafouée, il s’était isolé dans son bureau jusqu’à ce qu’on le vît un jour s’élancer dans la cour, chevauchant un balai et chantant : « Zorro est arrivé… » Sa hargne contre le bouleversement du milieu éducatif lui avait fait perdre la tête et il s’était ridiculisé devant tout le monde. À partir de cette époque mémorable, il s’est montré discret ; il a réduit au maximum ses apparitions. Son personnel l’a quasiment mis en quarantaine et a dirigé sans lui les activités scolaires. Ainsi, de mauvaises habitudes se sont installées dans le système et Rémi, depuis sa nomination à ce poste, en supporte toutes les conséquences.
Après avoir quitté le lycée, fait des courses pour ses repas du week-end, Rémi rentre chez lui, rue Mazagran. Sa maison – son « château », comme dit son père sur un ton sarcastique – se cache derrière un grand mur, à quelques mètres de la voie qui mène à la forteresse de Montrond. C’est une immense demeure située du même côté que les ruines moyenâgeuses, entre le chemin de l’Usine-des-Eaux et l’allée du Prince-de-Condé. Elle est impressionnante avec ses grands escaliers de pierre, ses larges baies vitrées et ses nombreux balcons. Une employée à mi-temps fait chaque jour le ménage dans les pièces qu’il utilise et, de temps à autre, elle dépoussière dans celles qu’il ne fréquente presque jamais. Heureusement que son compte en banque est bien garni, car sa paie de fonctionnaire ne serait pas suffisante pour faire face aux frais d’entretien et de fonctionnement de cette grande villa.
Ce soir, comme il fait encore doux, il va dîner dehors, sous la ramure d’un tilleul gigantesque. Un salon de jardin et une chaise longue sont restés installés tout l’été près d’un abri qui s’appuie contre un mur mitoyen. Celui-ci mesure quatre mètres de haut et se prolonge tout autour du parc. Quand il est rentré, qu’il a verrouillé son portail, Rémi se sent vraiment chez lui. Il n’a jamais éprouvé ce sentiment au cours de sa jeunesse. Il a fallu, à son retour d’Algérie, qu’il héritât de son oncle pour connaître les effets de la richesse, les charges et les avantages qu’ont tous les propriétaires. À l’intérieur de son domaine, il est isolé. Les bruits de la ville ne l’atteignent pas. Ceux du lycée, qui se sont accrochés à lui, bourdonnent quelques instants dans sa tête, mais, tout de suite après, c’est le grand silence, le repos, la solitude, la rêverie. Seuls les oiseaux, dans l’épaisse verdure, ponctuent de leur chant la tranquillité des lieux.
Dans la cuisine, Rémi range ses courses. Avec un plateau-repas, un panier qui contient sa boisson, des fruits et une demi-baguette de pain, il sort et se dirige vers son coin habituel. Il lui reste une bonne heure avant la tombée de la fraîcheur nocturne. Il lui arrive quelquefois d’écouter la radio : l’abri de jardin est doté du courant. Ce soir, il demeure dans le calme. Il pourrait éclairer pour mieux voir ce qui lui reste à manger, mais la lumière attire les frelons ; il doit y avoir un nid dans le parc ou chez les voisins. Il termine son repas et rêve encore un peu dans la semi-obscurité.
Il revient à la jeune femme qui, ce matin, l’a regardé traverser le dortoir. Il avait, en y entrant, l’esprit ailleurs, mais d’un seul coup cette brune, en se redressant, l’a brutalement ramené de l’autre côté de la grande bleue. Il devait y avoir un puissant effet de ressemblance pour qu’il se soit aussitôt rappelé les moments romantiques qu’il a connus là-bas. Il ne peut pas oublier l’amour fou qu’il y a vécu, les sentiments forts qu’il y a ressentis et les relations coupables qu’il a eues. Il ne croit pas que la femme de ménage a quelque chose à voir avec Sophie, la jeune et jolie pied-noir de Souk-Ahras qui lui a fait tourner la tête. Pourtant, il a bel et bien reçu un choc. Pour ne plus y penser, il songe alors à son ancien professeur d’anglais, ce cher M. Grosjean contre lequel il a de la rancune. Cela le ramène dans les locaux du vieux collège du Châtelet, le cours complémentaire, comme on l’appelait autrefois. Il a encore en mémoire le bâtiment, une construction rectangulaire sans étage, comportant cinq salles séparées par des cloisons en bois stratifié. L’isolation phonique n’était pas à la mode, à cette époque. Il y avait toujours une classe pour sonner le réveil de l’autre.
M. Grosjean avait son domicile dans la ville chef-lieu du canton voisin. Rémi se rappelle ses arrivées, très tôt le matin. Il le revoit au volant de sa 4 CV bleu foncé, ou, quand la saison était agréable, conduisant sa vieille moto grise, avec, sur la tête, un casque en cuir du plus triste effet. Il prêtait à rire, parfois, se souvient le jeune homme qui commence à sentir la fraîcheur et qui se décide à rentrer dans son « château » après avoir débarrassé la table.
Dans son logis, il s’installe un moment dans un fauteuil, face à son chevalet. Depuis son retour en France, il s’est mis à peindre pendant ses week-ends et ses congés. Dernièrement, il a ébauché plusieurs toiles. Il est devant celle représentant la grande église de Saint-Amand, dont la première couche lui paraît sèche. Il compte bien poursuivre son œuvre durant ces deux jours. Tout en regardant d’un air vague son travail inachevé, il revient sur ses souvenirs de collégien, à ce hasard qui, ce matin, lui a fait entrevoir Grosjean. Étaitce la personnalité de ce dernier ou la matière qu’il enseignait qui, autrefois, le perturbait tant ? Ou bien les deux ? Il a encore à l’esprit le comportement distant de ce maître, le débit monotone de son enseignement et sa pédagogie digne du XIXe siècle. Ses notes s’approchaient souvent de zéro. Grosjean ne le portait pas dans son cœur. Mais c’était réciproque.
Il gardera, jusqu’à la fin de ses jours, le souvenir d’une boîte de pastilles Valda ou Pulmoll qui fut la source d’un incident des plus regrettables. Il eut lieu en plein cours d’anglais, ennuyeux comme toujours et propice à la somnolence comme souvent. Rémi se revoit passant nonchalamment la main droite dans le casier vide de sa table que d’autres avaient occupée avant lui, puis rencontrant malencontreusement une boîte cylindrique, plate et vide elle aussi, abandonnée par un élève d’un cours précédent. Elle était en équilibre sur le bord, et ses doigts, en la touchant, l’avaient fait chuter sur le sol avec un bruit de ferraille. Elle était tombée sur la tranche et, dans le silence de la salle, avait roulé bruyamment jusqu’aux pieds du sieur Grosjean qui avait arrêté de parler et regardé l’objet, d’un air ahuri.
Le jeune CPE, qui ne peut s’empêcher de sourire, quitte son fauteuil et se dirige vers les escaliers pour rejoindre sa chambre.
M. Grosjean n’avait pas eu besoin de mégaphone. Sa voix forte portait loin, si bien que, à travers les cloisons de bois du collège du Châtelet, on avait aisément entendu : « Verneuil ! Vous êtes un cancre, un perturbateur. Vous venez ici dépenser inutilement l’argent de vos parents et vous dérangez les autres ! » À la récréation suivante, Rémi avait dû donner des explications au directeur. Celui-ci l’avait cru et avait souri, et l’adolescent avait entendu, dans son dos, en repartant, des éclats de voix qui s’apparentaient à de vives remontrances. Grosjean, à n’en pas douter, avait été réprimandé comme il le méritait. C’était l’époque où ses parents et lui habitaient un hameau ; à Culan, sa mère confectionnait des chemises et son père réparait des tracteurs et des faucheuses.
« Comment un professeur peut-il se comporter de la sorte à l’égard de ses élèves ? » se demande Rémi. Il reconnaît que, dans son cas personnel, l’élève et le maître ne s’aimaient pas, que les faits remontent à près de vingt ans et que la pédagogie et la psychologie ont évolué depuis ce temps-là. Mais tout de même il y avait, dans l’attitude de Grosjean, du mépris, de la discrimination, voire de la haine.
Rémi a oublié de fermer les volets et le clair de lune s’invite dans sa chambre. Il a choisi cette pièce du deuxième étage en raison de ses portes-fenêtres qui donnent sur un grand balcon d’où il peut observer le sommet des arbres, les ruines de la forteresse et les maisons de la partie haute d’Orval. Son parc lui cache la vue du Cher qui coule à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau. Ses parents, qui ont réprouvé son choix, lui ont fait entrevoir qu’il ne pourrait pas rejoindre cet endroit quand il serait vieux, qu’il aurait mieux fait de s’installer dans une chambre du rez-de-chaussée. À les entendre, il aurait même dû éviter de s’encombrer de cette maison dont l’entretien risquait de lui coûter cher. N’ayant jamais été attiré par l’argent, le jeune homme s’est d’abord demandé s’il devait accepter l’héritage de son oncle. Mais l’insistance avec laquelle son père a critiqué la façon dont son demi-frère s’était enrichi a grandement contribué à le convaincre. Avec ce legs, il a surtout vu un moyen de faire enrager son paternel, puis il s’est dit qu’il pourrait peut-être utiliser cette richesse pour aider son prochain. Aujourd’hui, il ne s’est toujours pas engagé sur le chemin de la solidarité alors que la manne qui lui est tombée du ciel commence à lui peser sérieusement sur la conscience.
Il peut monter les escaliers pour aller dormir au deuxième étage : il est encore jeune. Il n’a pas de soucis pour entretenir sa demeure et sa fortune est importante. Son oncle Albert lui a laissé de quoi faire face. Ses parents ne soupçonnent qu’une infime partie de la donation qui lui a été faite. « C’est de l’argent mal acquis », a dit son père. Du coup, il doute un peu de la valeur morale de son bien, mais il est conscient qu’il doit passer outre à cette remarque et oublier les moyens qui ont servi à bâtir cette fortune. Cet héritage n’a d’ailleurs pas modifié son train de vie. Seule cette maison bourgeoise lui fait comprendre que quelque chose a changé autour de lui. Autre nouveauté : il n’a plus à s’inquiéter pour ses finances.
Son état de jeune homme fortuné, qui l’oblige à se poser des questions de moralité, lui crée en plus quelques inconvénients. Ses relations avec ses parents ne sont pas très bonnes et, en dehors du lycée, les habitudes qu’il prend dans son « château » le coupent de tout contact avec la société. Il y mènerait presque une existence d’ermite.
Le samedi, en fin d’après-midi, il se repose sous son tilleul. Il est allongé sur sa chaise longue et il écoute de la musique. Après le déjeuner, il s’est placé devant son chevalet et a hésité un moment pour choisir ses couleurs. Il en a déposé plusieurs sur sa palette et s’est mis à peindre. La toile est grande. Il lui a fallu beaucoup de temps pour travailler le ciel selon son goût et repasser, avec des tons appropriés, sur les faces du clocher. Il était plus de dix-sept heures quand il a décidé d’abandonner son œuvre et d’aller prendre l’air. Il est là, maintenant, et il n’entend pas la sonnerie qui retentit dans sa maison. Ce n’est pas un appel téléphonique. Au portail, on appuie sur un bouton et on doit parler en vain dans l’interphone qui est en panne. Il faut un coup de klaxon prolongé pour que Rémi réagisse, se relève et se dirige précipitamment vers l’entrée de sa propriété. Lorsqu’il demande qui lui fait l’honneur d’une visite, Jacqueline, sa mère, se fait connaître et ajoute :
— Il faudra changer ton portail ! En mettre un autre avec des grilles ! Ça nous permettrait au moins d’apercevoir ta voiture. Avec ces grandes portes en bois et ton interphone qui n’a pas l’air de fonctionner, c’est impossible de savoir si tu es chez toi.
— J’étais dehors. Et puis, j’étais loin de penser à vous, fait Rémi, comme pour s’excuser.
— C’est vrai que, depuis qu’il est châtelain, il n’a plus rien à voir avec des prolétaires comme nous, enchaîne Roland, son père, en baissant la tête.
— Arrête, je t’en prie ! lui ordonne Jacqueline. Tu ne vas pas recommencer ?
Le jeune homme leur propose l’apéritif et va chercher les bouteilles, ses parents sur les talons. Il les emmène ensuite vers son coin repos. Autour de la table de jardin, la discussion s’engagera et des piques ne tarderont pas à se glisser dans certaines phrases. Tout en servant les boissons, Rémi s’informe sans réfléchir :
— Alors, quel bon vent vous amène ?
— Tu ne viens plus nous voir. On s’est dit qu’il fallait qu’on aille vérifier si tu n’étais pas mort, répond Jacqueline.
— Je vais très bien ! J’ai repris mon travail au lycée et je suis en pleine forme !
— J’ai vu que tu persistes dans la peinture ! Tu vas sûrement faire fortune.
— Il n’a pas besoin de ça ! intervient Roland. Il a sans doute récupéré tout l’argent du trafic…
— Tu vas arrêter avec ces histoires, l’interrompt sa femme. D’abord, qu’est-ce que tu en sais ? Tout ça, c’est du passé. On n’est pas venu voir notre fils pour remettre les vieilles affaires sur le tapis. D’autant que tu m’avais promis que tu n’en parlerais plus.
Après un court silence, elle annonce qu’elle a vu le frère de Danielle, l’autre jour. Devant les yeux écarquillés de son fils, elle précise :
— Oui, le frère de ton ex-femme. D’après lui, sa sœur aurait dit qu’en Algérie tu l’aurais trompée avec une jeune mouquère.
— Bah ! C’est n’importe quoi !
— Il a bien fallu qu’il y ait eu quelque chose pour que vous soyez amenés à divorcer.
— Comme je vous ai toujours dit, on ne s’entendait plus. Entre nous deux, c’était invivable. C’est la seule raison de notre séparation.
Jacqueline et Roland se regardent ; ils ne semblent pas très convaincus. La discussion se prolonge un peu. On évoque les grands-parents que Rémi devrait aller voir plus souvent. Le père prend l’engagement de ne plus parler d’argent ni d’héritage. La mère promet de ne plus s’immiscer dans la vie privée du fonctionnaire. Les époux Verneuil quittent la propriété bourgeoise, satisfaits enfin d’avoir pu renouer avec leur fils unique.
Ses parents partis, Rémi range sa chaise longue dans l’abri de jardin, débarrasse la table et se dirige d’un pas rapide vers sa demeure : de gros nuages s’amoncellent dans le ciel, des rafales de vent tourbillonnent dans le parc et la nuit semble vouloir s’imposer plus tôt que prévu.
Tout en dînant dans la cuisine, il juge le résultat de la visite surprise globalement positif. Il n’a eu droit ni au bourgeois qui se cache des manants derrière ses grands murs, ni au marché noir et autres pratiques malhonnêtes avec les Allemands sous l’Occupation. C’est, d’ailleurs, de justesse si cette dernière remarque, qui traduit des reproches et peut-être de la jalousie, ne lui est pas venue aux oreilles. Que n’a-t-il pas entendu après avoir accepté l’héritage de son oncle ? Il n’avait pas souvent revu ses parents depuis cette époque. Leurs leçons de morale, leurs sarcasmes, lui étaient devenus insupportables. Les avoir accueillis en cette fin d’après-midi et avoir été dispensé de leurs désagréables réflexions le laissent encore tout pantois. À son père qui veut changer de voiture, il a proposé de l’aider. Il a même dit qu’il pourrait lui en payer une neuve. Mais Roland n’a ni remercié ni fait opposition. Il s’est conduit comme celui qui n’avait pas entendu et il est passé à un autre sujet. Le jeune homme pense qu’il ne veut pas de son concours : il a toujours estimé que l’origine de son argent est sale.
L’orage gronde. Rémi a terminé son dîner. Demain, c’est dimanche : la femme de ménage ne viendra pas remettre les choses en place. Il a donc lavé la vaisselle et rangé la cuisine. Il ferme les volets du rez-de-chaussée. Au deuxième étage, le vent et la pluie se sont engouffrés à travers les portes-fenêtres restées ouvertes. Il essuie le parquet avec une serviette-éponge et il s’enferme dans sa chambre. Il s’allonge sur son lit pour lire à la lumière de sa lampe de chevet. Il ne parvient pas à comprendre le sens des phrases qu’il a sous les yeux. Elles se mélangent sans cesse aux idées qui se bousculent dans sa tête. Il est de l’autre côté de la Méditerranée. Il se revoit ouvrant la porte de son appartement et s’adressant à une jeune fille qui vient de sonner. Une demoiselle élégante, une brune au teint mat. Elle lui demande en souriant de l’emmener voir son père emprisonné à Guelma. Pourquoi est-elle venue vers lui ? D’ailleurs, Danielle s’est montrée surprise. « Qu’y a-t-il entre elle et toi pour qu’elle te prenne pour son chauffeur ? N’y a-t-il pas des taxis en ville ? » Il se dit : « Elle avait raison de poser ces questions. » Il se rappelle encore les explications que la « mouquère », selon l’expression de sa mère, lui a données, ce jour-là. Son père s’étant trouvé mêlé à une sale affaire, elle devait veiller à sa sécurité. Elle était jeune et, ne connaissant personne pour l’aider, elle ne tenait pas à faire appel à n’importe qui. Mais ce n’était pas cela l’essentiel. Elle avait en tête un but bien précis. Rémi se souvient qu’il n’avait pas beaucoup attendu pour comprendre que sa passagère le connaissait depuis longtemps et qu’elle était amoureuse de lui. Étant donné l’âge de cette dernière, il lui avait même demandé si, toute adolescente, elle ne s’était pas déjà éprise de lui. Son silence, ce jour-là, lui avait fourni la réponse. Elle lui avait avoué qu’il venait d’arriver à Souk-Ahras quand elle l’avait remarqué dans la rue. Et lui, il l’avait vue pour la première fois, quelques années plus tard, sur le palier de son appartement. Il n’a pas oublié comment leurs relations avaient évolué, avec quel empressement et quelle intensité s’était opéré leur rapprochement. Il lui avait, au début, opposé leur différence d’âge, mais elle avait balayé cet argument en rigolant et il n’avait pas pu résister à son charme.
C’était l’époque où son ménage allait de plus en plus mal. Danielle était devenue acariâtre. Elle criait contre lui pour un oui ou pour un non. À la fin de la deuxième année de mariage, la vie avec elle n’était déjà plus possible. Si, dans les provisions qu’il venait de rapporter, un produit n’était pas à sa convenance, il devait aussitôt retourner en ville après avoir subi reproches, mépris et insultes. Elle était horrible, comme si sa présence auprès d’elle lui était insupportable. D’ailleurs, faire chambre à part avait été une solution qui s’était imposée très tôt.
Rémi reconnaît que sa femme lui a fait vivre un enfer et qu’il n’en a jamais vraiment connu la raison. Il comprend qu’il ait pu succomber aux avances de Sophie Carlotti. Il repense à cette femme qu’il a aperçue dans un dortoir. Certes, il y avait sans doute de la ressemblance, mais que viendrait faire ici Sophie la pied-noir ? Cet amour, qu’il avait assumé tout en le jugeant immoral, viendrait-il tourmenter son esprit au point que la moindre brune qu’il apercevrait ait le don de le ramener sur l’autre rive ?
* * *
Au soir de la première journée des vacances de Toussaint, Rémi a dîné tôt et, dans son salon, avec Le Lac des cygnes de Tchaïkovski en sourdine, il rêve. Deux mois se sont écoulés au cours desquels il a dû, à sa manière, orchestrer l’activité du lycée, cette ruche, tantôt silencieuse, tantôt bruyante et criarde. Il a guidé et conseillé les professeurs, dirigé et calmé les élèves. Il a discuté avec ces derniers, il a fait la morale à certains et en a sanctionné d’autres. Il a placé ses vingt-huit surveillants à leur poste en fonction des nécessités, mais en tenant compte, autant que possible, de leurs disponibilités : quelques-uns vont en faculté et doivent suivre des cours importants. Dans l’élaboration de leur emploi du temps, le but recherché a été qu’aucun point stratégique n’échappât à l’œil des adultes. Rémi a été constamment débordé et ses adjoints ont, eux aussi, croulé sous les tâches.
Jusque-là, en dehors des week-ends, Rémi n’a pas souvent eu le temps de revenir sur son passé. Généralement, pendant les cours, quand il n’a pas le téléphone à l’oreille, il est toujours sollicité par les uns ou par les autres. Il a déjà écarté de son esprit l’employée qu’il a prise pour son ancienne maîtresse, à la fin du mois d’août. Dans ce lycée où grouillent des centaines d’êtres humains, l’idée qu’il y aurait Sophie Carlotti passant l’aspirateur, le balai ou le chiffon, lui apparaît maintenant complètement stupide.
Dans son fauteuil, il cherche les raisons sérieuses qui l’ont poussé vers Danielle. Les cours de formation les avaient réunis, de même que leur nomination dans une école de campagne. Il pense qu’ils devaient se donner mutuellement l’impression de bien s’entendre, de se sentir proches. Peut-être s’étaient-ils laissé envahir par la pédagogie, se privant ainsi du temps nécessaire au développement de leurs sentiments ? Pourtant, la décision de se marier leur était venue avec naturel et insouciance. La future épouse étant croyante et pratiquante, l’abstinence avait donc précédé les noces. Leur engagement pour la coopération culturelle avait suivi et ils avaient rapidement découvert leur incompatibilité d’humeur. Il en avait résulté des disputes répétées, le rejet de l’autre et une accumulation d’ennuis regrettables. Le retour en France et la séparation par consentement mutuel avaient mis un point final à cette triste expérience. Rémi a la certitude qu’il n’y avait jamais eu d’amour entre eux. À l’époque, savaient-ils, l’un et l’autre, ce que cela signifiait ? Aujourd’hui, il peut répondre à cette question. Au printemps 1970, il a vécu, avec Sophie, des moments inoubliables. Il a éprouvé ce besoin irrésistible d’aller vers elle et il a remarqué, chez la jeune fille, cette même attirance. Ils ont connu un trimestre enchanté. Que s’était-il donc passé, ce jour de fin juin ? Pourquoi sa jeune maîtresse avait-elle disparu ? Il avait vu le chef de la police, qui lui avait dit : « Elle est rentrée en France ; ici, sa sécurité n’était plus assurée. » Il se souvient de l’analyse qu’il avait faite à l’époque : « Elle n’a pas pu disparaître sans m’avertir. » Certes, il était marié, mais elle savait que son union était une catastrophe et que son divorce était programmé. Elle devait régler deux ou trois affaires et, ensuite, rejoindre ses tantes à Toulon. Ils allaient se voir encore quelques jours et se laisser leurs nouvelles coordonnées. Leur aventure s’était finalement terminée brutalement.
Il se demande, aujourd’hui, s’il n’avait pas considéré sa relation avec Sophie comme une compensation de l’enfer que lui faisait vivre Danielle. Cependant, il est sûr d’avoir aimé Sophie. Quand il la voyait venir vers lui, il ressentait des vibrations dans tout le corps, son cœur battait la chamade. Quant à elle, il l’entendait souffler de bonheur dans le creux de son épaule.
De sa liaison avec Sophie, il a remué tant de souvenirs qu’il continue à rêver d’elle. Il se voit l’emmener à Guelma. Il a dû la conduire cinq ou six fois jusqu’à la place de terre battue qui jouxtait la prison. La très mauvaise réaction de Danielle et la passion pour sa passagère l’ont amené à inventer une visite à la maison d’arrêt chaque mercredi. Un soir, rentré tard chez lui, il s’est trouvé devant sa porte qu’il n’a pas pu ouvrir : elle était fermée de l’intérieur et la clé était dans la serrure. Il a sonné en vain pour que sa femme vînt à son secours. Il a pris deux paillassons afin de ne pas dormir sur le béton. Il n’a pas renouvelé l’expérience. Il a quitté l’épouse et a vécu avec sa maîtresse tous les jours de la semaine. Avec elle, il a partagé tous ses repas, il a passé toutes les nuits et tous les week-ends. Ainsi, il assumait pleinement sa vie d’adultère.
Au volant de sa Dauphine Gordini, une voiture couleur crème avec un intérieur en similicuir rouge, il avait à ses côtés, très près de lui, le corps superbe de la jeune fille. Ils se sont souvent garés devant le moulin Kaouki et se sont promenés le long de la Medjerda. Ils se sont rendus plusieurs fois à Annaba, se sont baignés et ont fréquenté les meilleurs restaurants avant de rentrer à Souk-Ahras en fin d’après-midi. Durant ces journées magiques, ils ont formé un couple et ont ignoré, l’un et l’autre, leur différence d’âge.
Le père de Sophie, André Carlotti, tenait une agence de voyages. Il vendait une telle quantité de billets de bateau qu’il arrivait généralement que bien des voyageurs pour la métropole se voyaient refoulés au moment de l’embarquement. Sans doute faisait-il la même chose pour le transport aérien. Il était aussi gérant de garages avec des associés à Alger et à Annaba. Il avait un représentant en France, spécialisé dans l’exportation de grosses voitures. Au lendemain de l’indépendance, la liberté retrouvée donnait aux gens l’envie de se déplacer. Les transports en commun étant pratiquement inexistants, nombreux étaient ceux qui, ayant un permis de conduire, devenaient chauffeurs de taxi clandestins pour nourrir leur famille. Ce nouveau comportement de la société exigeait un grand nombre d’automobiles, grandes et robustes. Les 403 et les 404 étaient particulièrement prisées. C’étaient surtout ces véhicules qui franchissaient les Pyrénées, traversaient l’Espagne et le Maroc, ou débarquaient directement sur les quais des ports algériens. Dans ce circuit qui prenait racine en France, les Peugeot étaient volées. Les services des douanes et de la gendarmerie des deux pays découvrirent le manège des malfaiteurs. Toutes les ramifications du trafic furent investies et beaucoup de responsables furent enfermés. André fut de ceux-là.
Le lendemain matin, Rémi fait un passage dans les allées du centre commercial afin de s’approvisionner en nourriture pour plusieurs jours. Ses achats terminés, il décide de rendre visite à ses parents.
— Assieds-toi ! Je vais te mettre une assiette et tu vas manger avec nous, dit Jacqueline à son fils.
— Non ! J’ai mes provisions dans mon coffre de voiture et je dois rentrer pour les décharger. Et puis, je n’ai pas faim. Je ne pensais pas que vous déjeuniez si tôt.
— Nous allons faire des courses à Bourges et nous ne voulons pas revenir trop tard.
Rémi est venu chez ses parents autant pour les saluer et leur montrer qu’il ne les oublie pas, que pour s’informer de l’état de leur automobile. Celle-ci est sans doute au garage, car il ne l’a vue ni en bordure du trottoir ni sur le parking d’en face. Roland et Jacqueline habitent un locatif individuel dans la rue Malraux, mais, depuis qu’il possède son « château », comme persiste à dire son paternel, ce joli petit pavillon HLM lui donne mauvaise conscience.
— Et votre voiture, quand allez-vous la changer ?
— C’est fait ! répond son père.
— J’ai dit que je pouvais vous aider !
— On a acheté une Renault d’occasion, une R 16 en bon état et à crédit, précise Roland qui fait, une nouvelle fois, celui qui n’a pas entendu les derniers mots que vient de prononcer son fils.
Rémi embrasse ses parents, se retire, et sa mère, qui l’accompagne vers la sortie, lui reproche :
— Tu aurais quand même pu rester déjeuner avec nous.
En ouvrant la porte, il entend son père dire :
— Bah ! Notre table n’est assez bien pour lui !
Dans son salon, après avoir peint une grande partie de l’après-midi, Rémi se repose un moment. Il a le sentiment qu’on l’a laissé dans l’ignorance de certains événements du passé concernant sa famille. Il se reproche de n’avoir pas cherché à s’informer. Mais que pouvait-il espérer apprendre de particulier ? Tout semblait plus ou moins normal, autour de lui. Il savait que sa grand-mère avait divorcé et s’était remariée, mais il s’agissait là d’une situation qui n’avait rien d’exceptionnel. Son vrai grand-père Verneuil, qu’il n’avait pas connu, était décédé. Mais là encore, rien de troublant ; c’était la vie. Ce n’est qu’après l’héritage qu’il a su que l’argent qui l’a fait riche provenait d’origines que son père s’évertue à condamner. Il était jeune adolescent quand il a appris qu’il avait un oncle qui s’appelait Albert et qui était le fils issu du deuxième mariage de son aïeul. Dernièrement, lorsqu’il a voulu connaître pour quelle raison on ne lui avait pas permis de le rencontrer, on lui a répondu que ce dernier n’avait pas été quelqu’un de fréquentable.
Roland avait à peine deux ans quand son père, Étienne, quitta sa mère, Louise, pour aller vivre avec une autre femme. Il y eut divorce. Louise épousa René Pinson, de Saulzais, et Étienne sa maîtresse qui, sans tarder, lui donna un fils prénommé Albert. Son vrai père avait quarante-quatre ans et son demi-frère dix-huit quand les Allemands ont envahi la zone nord où se trouvait, près de Vierzon, leur activité.
Avant, Rémi ignorait ces histoires du passé. Au fil des rares discussions sur ce sujet, il a, malgré lui, retenu quelques éléments, mais il n’a jamais cherché à les approfondir. Cependant, ce malaise qu’il ressent depuis qu’il est devenu un riche propriétaire le pousse à découvrir, avec le plus de détails possible, le passé des uns et des autres. Roland a fait de la résistance. On ne peut l’oublier : il en parle dès qu’une occasion se présente. Mais Albert, qu’a-t-il fait ? Rémi pense qu’il n’y a qu’une seule personne pour l’aider à comprendre : sa grand-mère Louise. Il ira lui rendre visite demain, en début d’après-midi.